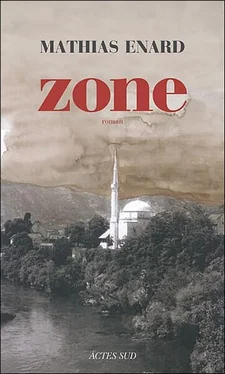Mathias Énard - Zone
Здесь есть возможность читать онлайн «Mathias Énard - Zone» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Город: Paris, Год выпуска: 2008, ISBN: 2008, Издательство: Éditions Actes Sud, Жанр: Современная проза, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Zone
- Автор:
- Издательство:Éditions Actes Sud
- Жанр:
- Год:2008
- Город:Paris
- ISBN:978-2-7427-7705-1
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Zone: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Zone»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Par une nuit décisive, un voyageur lourd de secrets prend le train de Milan pour Rome, muni d’un précieux viatique qu’il doit vendre le lendemain à un représentant du Vatican pour ensuite — si tout va bien — changer de vie. Quinze années d’activité comme agent de renseignements dans sa Zone (d’abord l’Algérie puis, progressivement, tout le Proche-Orient) ont livré à Francis Servain Mirkovic les noms et la mémoire de tous les acteurs de l’ombre (agitateurs et terroristes, marchands d’armes et trafiquants, commanditaires ou intermédiaires, cerveaux et exécutants, criminels de guerre en fuite…). Mais lui-même a accompli sa part de carnage lorsque la guerre en Croatie et en Bosnie l’a jeté dans le cycle enivrant de la violence.
Trajet, réminiscences, aiguillages, aller-retour dans les arcanes de la colère des dieux. Zeus, Athéna aux yeux pers et Arès le furieux guident les souvenirs du passager de la nuit. Le train démarre et, avec lui, commence une immense phrase itérative, circulatoire et archéologique, qui explore l’espace-temps pour exhumer les tesselles de toutes les guerres méditerranéennes. Car peu à peu prend forme une fresque homérique où se mêlent bourreaux et victimes, héros et anonymes, peuples déportés ou génocidés, mercenaires et témoins, peintres et littérateurs, évangélistes et martyrs… Et aussi les Parques de sa vie intérieure : Intissar l’imaginaire, la paisible Marianne, la trop perspicace Stéphanie, la silencieuse Sashka…
S’il fallait d’une image représenter la violence de tout un siècle, sans doute faudrait-il choisir un convoi, un transport d’armes, de troupes, d’hommes acheminés vers une œuvre de mort. Cinquante ans après
de Michel Butor, le nouveau roman de Mathias Enard compose un palimpseste ferroviaire en vingt-quatre “chants” conduits d’un seul souffle et magistralement orchestrés, comme une
de notre temps.
Né en 1972, Mathias Enard a étudié le persan et l’arabe et fait de longs séjours au Moyen-Orient. Il vit à Barcelone. Il a publié deux romans chez Actes Sud :
(2003) — Prix des cinq continents de la francophonie, 2004 — qui paraît en Babel, et
(2005). Ainsi que, chez Verticales,
(2007).
Zone — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Zone», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
XV
freins vapeur cris stridents douleur confuse dans les oreilles lumière intense le train s’arrête Santa Maria Novella Sainte-Marie-la-Neuve gare florentine le panneau est bleu les lettres blanches je me redresse m’étire les voyageurs s’affairent sur le quai des femmes des hommes, des hommes des femmes il doit faire froid ici aussi tous sont engoncés dans de lourds manteaux certaines dames ont des fourrures des angoras des lynx bleus des chinchillas vrais ou faux à Venise il y avait force fourreurs pour l’incroyable quantité de rombières que contient la ville la plus glaciale de Méditerranée caressée par les vents sibériens surgis de la plaine pannonienne, aussi gelée que Constantinople et ce n’est pas peu dire, des magasins aux vitrines débordant de visons et de renard dorés, des échoppes qui contiennent des réfrigérateurs immenses pour conserver tous ces poils en été, espérons pour les fourreurs que le réchauffement climatique soit le prélude d’une glaciation, l’inversion du Gulf Stream fera geler le Rhône en hiver nous aurons tous des chapkas d’astrakan sur la tête on pourra aller en patinant à Ajaccio course de fond Valence Majorque en traîneau les Marocains envahiront l’Espagne à cheval et les singes du rocher de Gibraltar crèveront enfin de froid, sales bêtes les singes, voleurs et agressifs, si humains qu’ils n’hésitent pas à mordre la main qui les nourrit criards lubriques exhibitionnistes et masturbateurs, ils s’adapteront peut-être aux nouvelles conditions climatiques, les simiens, des orangs-outans au long pelage blanc feront leur apparition sur les nouvelles banquises on les chassera pour leur peau ce sera un vrai plaisir, un vrai plaisir de fin du monde, le dernier homme courant après le dernier singe sur un glaçon à la dérive au milieu de l’Atlantique et adieu Berthe, fin des primates hominidés, sur le quai les dames en fourrure regardent leurs maris porter les bagages, le couple à mes côtés n’a pas bougé, ils vont donc jusqu’à Rome, quatre personnes entrent dans notre wagon, une femme d’une soixantaine d’années s’assoit en face de moi sur le fauteuil libéré à Bologne par le lecteur de Pronto , elle n’a pas de vison mais un manteau en laine noire qu’elle a plié pour l’installer au-dessus du siège, un visage assez large mais harmonieux, des cheveux presque blancs, des yeux sombres, un collier de perles sur un cardigan rouge classe moyenne supérieure diraient les statisticiens ou les instituts de sondages, elle fouille dans son sac à main pour y prendre un livre, elle ne m’a pas accordé un regard, le train va bientôt repartir, il va bientôt repartir pour la grande descente sans arrêt jusqu’à Termini, je me rappelle une scène de Mes chers amis , le film de Monicelli avec Tognazzi et Noiret, sur ce même quai, les cinq camarades à l’amitié virile et bruyante ont un jeu tordant, ils attendent qu’un train parte et collent des baffes retentissantes aux voyageurs penchés à la fenêtre, aux voyageurs et surtout aux voyageuses, et ce sport les fait mourir de rire, à tel point que l’un des personnages a cette phrase magnifique, qu’est-ce qu’on est bien entre nous, les gars, qu’est-ce qu’on est bien, c’est dommage que nous ne soyons pas pédés , avec Vlaho et Andi nous aurions pu arriver à la même phrase aux mêmes conclusions nous étions bien ensemble à Osijek en virée à Trieste à Mostar à Vitez nous étions bien drôlement bien la guerre est un sport comme un autre finalement on doit choisir un camp être une victime ou un bourreau il n’y a pas d’alternative il faut être d’un côté ou de l’autre du fusil on n’a pas le choix jamais enfin presque, départ dans l’autre sens, comme Santa Lucia à Venise Termini à Rome Santa Maria Novella est un cul-de-sac, nous repartons, je fais maintenant face à la destination, Rome est devant moi, Florence défile, la noble Florence saupoudrée de coupoles où l’on tortura allègrement Savonarole et Machiavel, la torture pour le plaisir l’estrapade l’eau la vis et l’écorchage, le moine politicien était trop vertueux, Savonarole l’austère interdit les putes les livres les plaisirs la boisson le jeu ce qui ennuyait surtout le pape Alexandre VI Borgia le fornicateur de Xàtiva à la descendance innombrable, ah la belle époque, aujourd’hui le pontife polonais tremblotant immortel et infaillible vient de finir son allocution place d’Espagne, je doute qu’il ait des enfants, j’en doute, mes voisins les musiciens cruciverbistes parlent eux aussi de Florence, j’entends Firenze Firenze un des quelques mots d’italien qui soient à ma portée, dans ma solitude vénitienne je n’avais pas appris grand-chose de la langue de Dante l’eschatologue au nez crochu, avec Ghassan nous parlions français, avec Marianne aussi bien sûr, dans mes longues errances solitaires de guerrier déprimé je ne parlais avec personne, à part pour demander une ombre rouge ou blanche selon l’humeur du moment, ombra rossa ou bianca le nom que les Vénitiens donnent au petit verre de vin que l’on boit à partir de cinq heures, j’ignore pour quelle raison cette jolie expression poétique, aller prendre l’ombre , par opposition à aller prendre le soleil je suppose à l’époque j’abusais de l’ombre et de la nuit dans la solitude, après avoir brûlé mes uniformes et essayé d’oublier Andi Vlaho la Croatie la Bosnie les corps les blessures l’odeur de la mort j’étais dans un sas inutile entre deux mondes, dans une ville sans ville, sans voitures, sans bruit, veinée d’eau sombre parcourue de touristes rongée par l’histoire de sa grandeur, la république du Lion aux mille comptoirs, en Morée à Chypre à Rhodes l’Est méditerranéen était vénitien, les galères et les galéasses des doges régnaient sur les mers — quand j’ai visité l’Arsenal avec Ghassan, en lui racontant la bataille de Lépante face à l’immensité des darses, devant les formes de radoub et les bassins, j’ai compris la puissance infinie de la Sérénissime, un lion en pierre volé à Rhodes gardait avec bonhomie la porte du plus grand arsenal de Méditerranée, pax tibi Marce evangelista meus , paix à toi, Marc mon évangéliste, voici ce qu’un ange dit à saint Marc alors qu’il dormait dans un bateau sur la lagune, avant de traverser la Méditerranée et de mourir près d’Alexandrie, en un lieu nommé Bucculi, la maison du bouvier, où il avait construit une église, les païens en colère le martyrisèrent sans tarder, le saint à la barbe blanche, ils le ligotèrent pour le traîner derrière un char sur des pavés mal équarris jusqu’à ce que mort s’ensuive en chantant ramenons ce bœuf à son étable , à Beyrouth pendant la guerre civile on appréciait beaucoup ce supplice, nombre de prisonniers sont morts attachés par des barbelés à une Jeep parcourant la ville à toute allure, déchiquetés râpés brûlés par l’asphalte asphyxiés les membres démis comme l’évangéliste à Alexandrie et Isadora Duncan la scandaleuse à Nice, en 828 les Vénitiens dérobèrent les reliques de Marc aux Egyptiens pour lui offrir le dernier repos dans leur ville, dans cette basilique si byzantine, aux cinq coupoles, à la nef croustillée d’or la seule église du monde où l’on peut répondre et cum spiritu tuo les pieds dans l’eau, Saint-Marc l’inondable — la Zone est pluvieuse, Zeus noie souvent les villes sous des trombes terrifiantes, Beyrouth Alexandrie Venise Florence ou Valence sont submergées régulièrement, et même une fois en Libye désert des déserts à Cyrène la brillante j’ai assisté à un orage d’apocalypse, le châtiment divin s’abattait sur les ruines et les quelques touristes qui avaient osé venir chez Kadhafi le fou sublime, on m’avait envoyé négocier l’achat de renseignements de première importance sur les activités islamistes arabes, les services libyens étaient imbattables sur ce sujet et Kadhafi vendait tout son stock en échange de sa réintégration au concert des nations, il donnait tout ce qu’il savait sur les activistes qu’il avait plus ou moins soutenus, de près ou de loin, tout le monde de l’ombre se réjouissait des informations libyennes, les Britanniques, les Italiens, les Espagnols, Lebihan le pelé grand amateur de mollusques s’en frottait les mains lui aussi, une bonne opération, il disait “allez en Libye, vous qui aimez voyager, c’est sans doute intéressant” il n’en croyait pas un mot évidemment, un pays où il n’y avait même pas une course cycliste digne de ce nom et où on devait manger des horreurs atrocement piquantes, j’acceptai surtout pour voir Cyrène et le djebel Vert pays d’Omar el-Mokhtar qui avait tant donné de fil à retordre aux Italiens avant de finir au bout d’une corde en 1931, le cheikh à la barbe blanche luttait contre les soldats de la nouvelle Rome presque à mains nues, dans ce morceau de désert que l’Italie avait pris aux Ottomans en 1911 — Rodolfo Graziani chargé d’organiser la répression copia les méthodes des Britanniques en Afrique du Sud et des Espagnols à Cuba, il vida la Cyrénaïque de ses habitants, envoyant vingt ou trente mille Libyens dans des camps, à pied à travers le désert sans approvisionnement, certain de les décimer, il vidait l’eau pour attraper les poissons , sans que Mao Tsé-toung ait encore codifié la guérilla révolutionnaire, de la même façon que les Français en Algérie cinquante ans plus tard “regrouperaient” les civils musulmans entre des barbelés pour mieux pouvoir les contrôler, toujours des camps, encore des camps, des camps espagnols pour les Rifains des camps italiens pour les Libyens des camps turcs pour les Arméniens des camps français pour les Algériens des camps britanniques pour les Grecs des camps croates pour les Serbes des camps allemands pour les Italiens des camps français pour les Espagnols on dirait une comptine ou une chanson de marche, tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, pour les Arméniens les Grecs et les Libyens, pour les Belges y en a plus, pour les Belges y en a plus , etc., monument de la poésie guerrière, en Croatie nous chantions sur l’air de Lili Marleen des paroles venues d’on ne sait où, i znaj da čekam te, et sache que je t’attends , Andi avait même composé une version à lui, où il était question de couper les couilles des Serbes et de défendre la patrie, pauvre Lili, à la porte de la caserne, elle doit encore attendre — c’est en Libye que les soldats de Rommel plébiscitèrent la chanson écrite par Hans Leip pendant la Première Guerre mondiale, les soldats de l’Afrikakorps en Cyrénaïque aimaient la mélodie de la femme qui attend en face de la caserne, devant la grande porte, sous le lampadaire, ils écrivaient des centaines de lettres pour implorer la radio de la diffuser plus souvent, curieusement la station allemande qui émettait vers l’Afrique du Nord se trouvait à Belgrade, c’est de Belgrade que tous les jours à 21h55 précises sonnait wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen , et les soldats couverts de sueur pleuraient leurs dernières gouttes d’eau quelque part entre Tobrouk et Benghazi devant leurs postes à lampes, Rommel lui-même pleurait, Rommel télégraphiait à Belgrade pour demander encore, encore, encore Lili, toujours Lili, les Britanniques la chantèrent en allemand jusqu’à ce que la propagande leur fournisse une version anglaise que la BBC reprenait elle aussi plusieurs fois par jour, Tito et les partisans la sifflaient en Bosnie, les Grecs de l’ELAS à Gorgopotamos, les Italiens survivants d’El-Alamein soupiraient con te Lili Marleen et même nous, quarante-cinq ans plus tard, la chantions au bord de la Drave, i znaj da čekam te , il va être impossible de m’ôter cet air de la tête maintenant, il va m’accompagner jusqu’à Rome avec la voix d’Andi et ses paroles obscènes, à Cyrène en Libye visitant les ruines grecques à une dizaine de kilomètres de la mer je sifflotais Lili Marleen et pensais aux soldats de Rommel et de Montgomery, avant que l’orage n’éclate et ne manque de me noyer au milieu de l’immense temple de Zeus, j’ai trouvé refuge sous l’auvent d’une baraque de boissons fraîches et de souvenirs tenue par un Libanais sympathique Phénicien perdu en Libye et qui s’y ennuyait ferme, me disait-il dans un français impeccable, heureusement qu’il y a quelques touristes, ajoutait-il, j’ai bu un Coca-Cola local, le fracas de la pluie sur la tôle nous a empêchés de poursuivre la conversation, l’air sentait la poussière mouillée et le sel, des éclairs cherchaient à abattre les cyprès et les colonnes grecques l’eau transformait tout le site en une mare de boue que les trombes frappaient avec la foudre grondante dans une lumière violacée striée d’épais traits de pluie qui ricochaient par terre comme des balles si fort qu’on n’était à l’abri nulle part, le Libanais riait, il hurlait d’un rire nerveux couvert par le martèlement de l’orage et essayait tant bien que mal de protéger son comptoir de fortune et l’intérieur de sa guérite, j’étais à l’abri et pourtant trempé jusqu’à la ceinture, Zeus a finalement été clément, il a rangé la foudre dans sa boîte, le ciel s’est ouvert subitement dans une grande lumière blanche, j’ai salué le Phénicien de Sidon perdu entre les cannettes de Pepsi et les colonnes doriques, et j’ai repris la route de Benghazi — dans une voiture de louage, le taux de change et le niveau de vie vous permettent d’acheter toutes les places du taxi collectif et d’échapper ainsi à l’étouffement ou à la thrombose, Lebihan n’était pas très content que j’aille faire du tourisme en Cyrénaïque, même s’il adorait le film Un taxi pour Tobrouk , dont il avait tiré une de ses grandes phrases, un intellectuel assis va moins loin qu’une brute qui marche , c’est ce qu’il m’a dit quand je lui ai parlé de Cyrène, vous vous souvenez de Ventura dans Un taxi pour Tobrouk ? bien sûr, je me souvenais de Lino Ventura et de Charles Aznavour, j’ai répondu pour ma part je préfère Ventura dans L’Armée des ombres, ça l’a fait marrer, Lebihan, et se gratter immédiatement le cuir chevelu dans un rictus, L’Armée des ombres, ah ah, elle est bien bonne , le grand désavantage de la Libye c’était la sécheresse, pays sec sec sec pas une goutte d’alcool depuis l’Egypte jusqu’à la Tunisie, du thé, du café des hectolitres de boissons gazeuses mais pas une bière pas une goutte de vin rien rien rien à part de la contrebande à Tripoli, et encore, Tripoli l’italienne sinistre capitale de l’Immense République des Masses et de son guide le dictateur chafouin dont la garde personnelle fait pâlir d’envie tous les chefs d’Etat du monde, un vrai corps de garde constitué d’Amazones sublimes et dangereuses, des femmes musclées armées jusqu’aux dents de vraies combattantes pour le Guide de la Révolution le chantre de l’Unité africaine écrivain poète grand protecteur de son peuple, constructeur de la Grande Rivière artificielle qui amène les eaux fossiles du Sahara jusqu’à la côte pour l’irrigation, le pétrole bleu après l’or noir, le rêve du Conquérant de Septembre de gouverner un pays vert, vert comme l’islam, une Afrique verte, il a donné à la Libye le fleuve permanent qu’il lui manquait pour rivaliser avec l’Egypte, on fait maintenant pousser des salades en Tripolitaine, des salades et des tomates, mon orage devait être une chance inouïe car tous les observateurs soutiennent qu’en Libye il ne pleut jamais et que le changement climatique ne va pas améliorer les choses, loin de là, difficile d’imaginer le Sahara fleuri, il y a à peine trois mille ans il y avait des gazelles des singes des chevaux sauvages des eucalyptus des baobabs des arbres à pain tout a grillé d’un grand coup de chaleur, tout, il n’en reste que les peintures rupestres des habitants de l’époque et des squelettes enfouis sous des tonnes de silice, on raconte qu’en 1944 les Bédouins de l’Est libyen se sont tous transformés en archéologues militaires, ils démontaient les chars brûlés, les canons abandonnés, récupéraient les caisses de munitions vides, les objets oubliés dans les casemates, les commerçants de Benghazi vendaient des tonnes de couvertures trouées, de bidons percés, de rouleaux de barbelés et même une boîte à musique, le seul souvenir que j’ai acheté en Libye, une petite boîte à musique vernie avec un visage de femme peint à la laque sur le couvercle, le boutiquier dans la vieille ville près du souk Al-Jarid m’a raconté son histoire, le petit objet de quatre centimètres sur deux environ avait été fabriqué près de Vienne et offert à un soldat en permission, les pillards l’avaient trouvé sur son cadavre enfoui par l’effondrement d’une tranchée de sable, avec des lettres, deux photographies une montre cassée enfin des effets personnels dont les nomades n’avaient que faire mais qu’ils vendirent un bon prix en ville, ainsi que six mines antichars que les sables avaient vomies à deux pas du corps, de belles grosses mines jaunes toutes rondes toutes neuves bien lourdes, le marchand qui acquit le tout ne savait pas à quoi pouvaient bien servir des mines antichars en temps de paix mais, conscient du danger, il les entreposa dans un coin de son arrière-boutique où personne ne pourrait les manipuler par erreur et les oublia, il les oublia si bien qu’elles n’explosèrent qu’en novembre 1977 au moment de la Révolution populaire, lorsque le Comité révolutionnaire voulut mettre la main sur les biens cachés du collaborateur de l’impérialisme, le responsable du commando de l’égalité n’avait jamais vu une mine allemande, il pensait avoir découvert de l’or ou des métaux précieux, si jaunes, si lourds, si bien cachés dans une malle au fin fond d’un dépôt, les Tellerminen 35 étaient armées, personne ne s’en était rendu compte, les Bédouins avaient parcouru le désert trois jours durant avec ce fardeau explosif, le marchand de Benghazi les avait sagement entreposées sans que les cent cinquante kilos de pression nécessaires à leur déclenchement soient atteints, et il s’en fallut de peu que l’ardeur socialiste ne les épargne encore, si le chef de la troupe, avide et curieux, n’avait pas attrapé un marteau qui traînait par là pour ouvrir ces jolis conteneurs dorés : les trente kilos de TNT qu’ils contenaient ont envoyé dans les airs non seulement le zèle révolutionnaire, mais aussi l’échoppe où il se tenait, et une fois la poussière retombée la seule chose retrouvée intacte, dans les débris et les gravats, fut la petite boîte à musique, ouverte, qui jouait Lili Marleen au milieu des ruines comme si de rien n’était, le soldat tué trente ans plus tôt sifflait sa revanche, sa femme lui avait offert ce portrait original pour qu’il pense à elle en écoutant sa chanson préférée, au milieu du Sahara, elle l’attendait comme Lili, à Vienne, il n’est jamais revenu, porté disparu dans les sables libyens, elle n’a plus rien su de lui, parfois elle s’imaginait qu’il était toujours vivant, parfois qu’il était décédé, pensait-elle à la boîte à musique peinte, commandée spécialement dans une boutique de la Kärtner Strasse, entendit-elle, dans un dernier rêve, l’explosion des mines de Benghazi le 12 novembre 1977, le jour même de sa mort à l’hôpital Franz-Josef, âgée de soixante-deux ans seulement, alors que sonnait une dernière fois le petit air métallique à trois mille kilomètres de là, en Libye, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen , le dernier souffle d’un grenadier autrichien décomposé depuis longtemps — j’ai offert la boîte à musique à Stéphanie à mon retour, je lui ai raconté cette anecdote que je tenais du vendeur, elle a pris le petit objet d’acajou du bout des doigts comme s’il s’agissait d’un morceau de cadavre, avant de l’enterrer dans un placard comme les Tellerminen dans l’arrière-boutique près du souk Al-Jarid, la dernière trace de l’un des cinquante mille Allemands morts au combat en Afrique se trouve-t-elle encore dans une armoire parisienne, Lili attend toujours quelque part, wie einst Lili Marleen , je vais débarquer à Termini en sifflant comme un GI en 1944, ça vaut toujours mieux que chantonner tiens voilà du boudin , toujours mieux, est-ce cet air martial étrange qui fascina tant Millán Astray le borgne lors de sa visite aux légionnaires français de Sidi bel-Abbès, Millán Astray l’estropié symbole des aspects martiaux du régime franquiste fonde la Radio nacional de España et devient en quelque sorte ministre de la Propagande, un Goebbels militaire passionné de samouraïs du Bushido et de l’honneur guerrier sous toutes ses formes, fils d’un fonctionnaire directeur de prison José Millán Astray passe son enfance au milieu des criminels et des délinquants, cadet à seize ans envoyé à dix-huit comme sous-lieutenant dans les dernières batailles de l’outre-mer espagnol, aux Philippines d’abord où il s’illustrera dans la défense de fortins perdus dans la jungle, jusqu’au bout, il montre un courage physique hors du commun, un sang-froid digne d’Andrija grand pasteur de guerriers, il revient décoré et enhardi pour intégrer l’école de guerre, puis est envoyé de nouveau dans les colonies, au Maroc cette fois-ci : c’est là qu’il perd son bras et son œil dans deux escarmouches, au moment de la guerre du Rif contre les petits guerriers d’Abd el-Krim — au printemps 1951 Millán Astray a soixante et onze ans, le vieux général amoureux des décapitations de Berbères se consacre à la culture au théâtre à la zarzuela à la poésie, comme sa sœur Pilar, auteur de boulevard célèbre à Madrid dans les années 1910, à soixante et onze ans Millán Astray le fauve dirige un obscur institut pour les Glorieux Mutilés de guerre de la patrie, il adore qu’on lui tire le portrait, un de ses principaux loisirs consiste à arpenter les boutiques des photographes, en civil, en uniforme, avec ses petits-neveux, avec sa fille, avec médailles, sans médailles, il photographie son corps de mutilé, son visage inquiétant où manque un morceau de la pommette gauche, emporté par le projectile qui l’a aussi privé d’un œil, photos avec bandeau façon pirate ou monocle sombre, la manche droite pendante, vide, Millán Astray l’immortel se prend en photo pour freiner la décadence de son corps, pour la documenter, pour l’éternité qui se souviendra de lui fringant et noble, Millán Astray se voit d’une grande noblesse morale sur ces photos rigides, un chevalier, un gentilhomme, droit et courageux serviteur du pays, un homme d’honneur, il continue à participer aux activités de la Radio nacional de España, avec l’aide de camp que l’armée franquiste continue à avoir la gentillesse de lui fournir, il aime beaucoup les concerts et ce samedi 14 avril 1951 à Madrid il est en grand uniforme pour aller écouter une jeune prodige de douze ans jouer Bach et Scarlatti, Millán Astray préfère l’opérette, comme sa sœur, mais qu’à cela ne tienne, le concert de cet après-midi de printemps est important, organisé au profit des glorieux mutilés de la guerre patriotique, Franco ne viendra pas, il est occupé, Carmen Polo sa femme aux larges hanches sera là, avec sa fille Carmencita et son mari qui viennent de célébrer leur première année de mariage, des personnalités, des invités de marque certains venus d’Argentine pour discuter avec Franco le Duce ibère dernier représentant du fascisme international : par une coïncidence comme seule l’histoire sait en concocter Ante Pavelic est à Madrid, accompagné de son état-major, Maks Luburic sera dans la salle aussi, Millán Astray le glorieux fondateur de la Légion ne les connaît pas, il sait juste que la pianiste est croate, qu’elle s’appelle Marija Mirkovic et est accompagnée de son père un homme assez distingué fervent catholique — ils sont arrivés la veille et ne tarissent pas d’éloges sur la beauté de Madrid, les églises, le faste historique de la capitale de Philippe II le prudent, Millán Astray a serré la main de cette enfant prodige du piano, timide mais au regard décidé, qui parcourt l’Europe en ruine avec ses fugues de Bach, le programme Scarlatti est une exception, un hommage à Madrid, la toute jeune fille et son géniteur sont allés voir bien sûr la rue Leganitos derrière la Gran Vía où le compositeur napolitain avait sa résidence, Domenico Scarlatti le prolixe maître de musique de la reine, virtuose du clavecin, ma mère a travaillé pour l’occasion deux sonates difficiles qu’elle joue à cent à l’heure comme il se doit, elle m’a souvent raconté ce concert, elle a encore les photos sous verre dans des cadres d’argent aux armes de l’Espagne, le carton d’invitation avec son cordon de velours rouge, ma mère se souvient encore en rougissant d’avoir raté un ornement de la septième mesure d’une sonate de Scarlatti, je voulais aller trop vite, ces gens étaient là pour m’écouter jouer vite, j’ai sauté un trille et la sonate s’est effondrée sous mes doigts, je glissais de mesure en mesure comme quelqu’un qui a trébuché dans un escalier c’était horrible — au premier rang Carmen de Franco aux traits durs, Millán Astray le borgne, Pavelic grand collectionneur d’yeux et d’oreilles serbes, Luburic le boucher de Jasenovac, quel parterre, six ans seulement après la fin de la guerre Pavelic et Luburic étaient encore en bons termes, ils avaient toujours le secret espoir de reconquérir la Croatie perdue, incognito le Poglavnik était venu d’Argentine jusqu’à Madrid pour négocier l’aide de Franco — le Caudillo ne l’avait pas reçu, confiant l’affaire à un subalterne, il lui avait conseillé de rester tranquillement à Buenos Aires et de se faire oublier, le gouvernement de Perón était accueillant — Pavelic prenait un risque calculé en se rendant à Madrid, il y reviendrait quelques années plus tard, protégé une fois de plus par l’Espagne très catholique, ma mère âgée de douze ans le 14 avril 1951 donnait un concert au profit des orphelins de Carmen de Franco et des mutilés de Millán Astray, je me dis que le vieux général borgne et manchot devait faire peur à une enfant de cet âge, le concert fut retransmis en direct sur Radio nacional de España, la presse ne mentionna bien évidemment pas la présence des hôtes de marque croates, je me demande si mon grand-père était content de les revoir, ces Oustachis fringants, peut-être aurait-il préféré les oublier, toujours est-il que ma mère fut autorisée à se faire photographier avec Pavelic l’imprudent égomane, avec Millán Astray le vieux lion du Rif aux mains tremblantes, cardiaque et décrépit, avec Carmen de Franco la sévère bigote, au rythme enjoué des fugues de Bach, au son du piano qui remplaçait utilement les marches militaires, soy un novio de la muerte, je suis un fiancé de la Mort, l’homme marqué par la griffe du Sort, qui s’attache par le lien le plus fort à la compagnie loyale de la Mort , quel chant, le tout sur des flonflons espagnols qu’on croirait sortis d’une course de taureaux, les animaux de compagnie de la camarde, artistiquement massacrés par des matadors en habit de lumière, ma mère à l’âge de douze ans jouait devant ces chevaliers défaits par l’âge, chevaliers à la triste figure marquée par la guerre et la mort sous toutes ses formes, dans leur propre chair comme Astray ou dans celle des autres comme Luburic, moi aussi je suis un fiancé de la Moire implacable alliée d’Hadès dans mon train grondant vers le néant, affublé du masque mortuaire d’Yvan Deroy le fou, filant vers Rome et la fin du monde au milieu des collines toscanes invisibles en compagnie de voyageurs fantômes et de souvenirs de massacres dans ma valise, fils de ma mère adoubée, au cours de cette cérémonie espagnole, par les guerriers présents, elle reçut l’énergie de ces fiers soldats pour transmettre à son fils une histoire inflexible, féroce, une part de Destin tel un fardeau sur les épaules, tout est lié, tout est lié, silence du public, les mains de ma mère entament le contrepoint 11 de L’Art de la fugue, ré la sol, fa mi ré, do ré mi , pas trop vite pour laisser entendre les quatre voix qui s’y répondent, pour se mettre en doigts aussi, à la moitié du morceau le public commence à piquer du nez, il faut un peu moins de dix minutes à Marija Mirkovic ma génitrice pour venir à bout de la fugue, avec brio, si carrée déjà, si métronomique que malgré son tout jeune âge elle parvient à jouer comme si elle avait quatre mains, la suite va réveiller les foules, prélude et fugue en ré mineur du premier livre du Clavier bien tempéré , Millán Astray écarquille son œil unique pour suivre les phalanges de cette enfant surdouée si frêle sur sa banquette de velours rouge, dans la lumière du printemps quand Madrid sent les fleurs et le blé en herbe de Castille, frêle mais décidée Marija a promené son Bach et ses sonates de Scarlatti dans toute la France, en Hollande, en Angleterre, à douze ans en robe crème elle a été applaudie par l’Europe entière, elle a déjà reçu plus de roses que dans toute sa vie, elle sait devant qui elle joue ce 14 avril 1951, elle veut bien faire, Carmen Polo de Franco l’austère lui offrira une médaille de la Vierge pour la remercier, ma sœur la porte encore aujourd’hui — ma sœur reçut la sainte inspiration de la femelle du dictateur, moi les regards tutélaires de Millán Astray et Luburic mes maîtres ès noblesse militaire et dans la froide cruauté de Pavelic l’homme bien peigné ma conscience patriotique, voilà les fées qui se penchèrent sur mon berceau, les premières photos de mon histoire, d’un côté les grands-parents témoins de l’assassinat du roi Alexandre sur la Canebière, de l’autre ma mère jouant Bach et Scarlatti pour Pavelic l’homme qui avait commandité l’attentat, les jeux de la destinée, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen , quelle solitude dans ce train maintenant qu’il ne reste plus qu’à se laisser glisser jusqu’à Rome, pour quoi faire, pour faire quoi de plus à Rome prendre une revanche sur le Destin barbare ou trouver une tombe accueillante, je commence à entrevoir ma part de destinée, ma mère savait-elle de quel dieu elle allait être l’instrument et dans quel combat, lorsqu’elle faisait une brève révérence au dictateur croate et à Millán Astray à Madrid — peut-être se voyait-elle une grande carrière de concertiste, avant que le miracle de l’âge ne s’estompe et que, malgré les efforts de son professeur du Conservatoire, Yvonne Lefébure elle-même virtuose dès dix ans, elle ne se révèle une pianiste somme toute commune, dont la passion pour l’instrument, peut-être émoussée par l’adolescence, le poids terrible de la tradition, puis de la famille, s’est affaiblie et est devenue une petite flamme entretenue par la pédagogie : des dizaines de filles de bonne famille relativement douées venaient chez elle pour préparer le concours du Conservatoire supérieur, pourquoi a-t-elle épousé un homme qui n’appréciait que peu la musique je n’en sais rien, pourquoi moi-même n’ai-je jamais pu supporter le répertoire de ma mère, allergique à Bach, à Scarlatti et au reste, je connais pourtant ces œuvres par cœur, je suis rétif à l’art, insensible à la beauté, comme disait Stéphanie la brune qui appréciait énormément ma mère, elle disait c’est une chance d’être le fils d’une artiste pareille, comment se fait-il que tu n’aies jamais appris le piano, je n’en sais foutre rien, peut-être n’étais-je pas doué, tout simplement, j’étais bien plus doué pour le sport, programmé pour être un guerrier peut-être, ce qui ne veut rien dire d’ailleurs, Achille aux pieds rapides joue de la lyre et récite des poèmes sous sa tente — ma sœur Leda a appris tout le piano qu’elle a voulu, des années durant, accrochée à sa mère comme un morpion aux couilles d’Andrija, moi j’étais le public, il fallait supporter les concerts privés pour la famille le dimanche après-midi, après le déjeuner ma mère appelait, venez tous, venez, Leda va nous jouer quelque chose , ma sœur se pavanait comme une pigeonne en rut, posait ses grosses fesses sur le tabouret tous les présents s’asseyaient sur des chaises en rang face à l’instrument où elle cabotait, sonatine de Clementi numéro Dieu sait combien, etc., mon père stoïque applaudissait à tout rompre, bravo ma chérie bravo c’était parfait, ma mère professeur jusqu’au bout des ongles disait, oui, c’était bien, mais , mais le tempo, mais le crescendo, mais ceci, mais cela, chaque dimanche nous attendions le mais de ma mère après les applaudissements, j’avais honte pour ma sœur, quand j’y pense, j’avais honte qu’elle se donne ainsi en spectacle, une honte mêlée de jalousie peut-être, qu’est-ce que j’avais à montrer, moi, qui me vaille les applaudissements de ma famille, Leda s’est coulée dans le moule prévu pour elle, une jeune fille parfaite, douce et appliquée, puis une femme mortellement ennuyeuse qui s’est dégoté un mari somptueusement insipide auquel elle donne des enfants parfaitement niais qui finiront dans la banque ou l’assurance, et voilà, la pianiste Marija Mirkovic étonnait Millán Astray à Madrid le 14 avril 1951 sans savoir qui était ce général rigide au physique inquiétant, et maintenant, des centaines de kilomètres plus loin, Francis le couard pense à sa mère et à cet invalide illustre dans un train avançant en trombe vers le néant dans la nuit italienne, seul comme une étoile un soir de nuages, dans quel moule obscur me suis-je coulé, moi, quel professeur sortira de l’ombre pour me dire c’était très bien, mais … Lebihan peut-être, entre deux huîtres et deux courses cyclistes, ou Maurice Bardèche lui-même le vieux fasciste me dira vous avez bien fait, mais… peut-être Ezra Pound le chroniqueur radiophonique de l’Italie mussolinienne marchera hors des ténèbres pour murmurer it was perfect but… ou Tihomir Blaškic le colonel de Vitez quittera sa retraite bosniaque pour m’apostropher vrlo zanimljivo, ali se… , Marianne prendra par la main ses cinq enfants ils m’attendront tous sur un quai de gare pour me coller un coup de pied dans les parties en disant peut mieux faire , et Stéphanie la grande douloureuse me regardera comme un ange annonçant la fin du monde je comprendrai que j’aurais pu être meilleur, je sais je n’ai pas été à la hauteur, les hommes déméritent, fantômes soyez compréhensifs c’est la fin des temps Francis est fatigué, il peine avec son fardeau, comprenez, vous qui êtes tous très chrétiens et croyez au barbichu à la lourde croix, prenez en compte la peine de Francis le porteur de valise enfoncé dans son fauteuil de première, écrasé par l’alcool la fatigue les amphétamines les morts et les vivants comme s’il n’arrivait plus à arrêter son cerveau ses pensées le paysage noir qui défile et les spectres qui lui mordillent les pieds, tiens voilà la lune, nous avons percé les nuages l’astre est au milieu de la fenêtre, il éclaire l’Italie centrale quelque part du côté de San Giovanni Valdarno, Saint-Jean sur l’Arno ville du Baptiste le décapité, à mi-chemin entre Florence et Arezzo, dans deux heures je serai à Rome, le plus dur est fait, je reprends le livre posé sur la tablette, Rafaël Kahla est né au Liban en 1940, dit la quatrième de couverture, et vit aujourd’hui entre Tanger et Beyrouth, étrange formulation, entre Tanger et Beyrouth il y a Ceuta Oran Alger Tunis Tripoli Benghazi Alexandrie Port-Saïd Jaffa Acre Tyr et Sidon, ou bien Valence Barcelone Marseille Gênes Venise Dubrovnik Durrës Athènes Salonique Constantinople Antalya et Lattaquié, ou encore Palma Cagliari Syracuse Héraklion et Larnaka si l’on considère les îles, Tanger gardienne de la lèvre inférieure de la Zone, Rafaël Kahla écrivain libanais réside donc partiellement dans le comptoir le plus occidental de ses ancêtres phéniciens, la Tingis carthaginoise aujourd’hui ville ocre et blanc capitale de l’émigration clandestine du tourisme et de la contrebande, au port bourré d’Africains espérant un départ improbable vers l’Espagne toute proche, j’imagine Rafaël Kahla habiter dans la Médina, dans une de ces maisons traditionnelles à cour centrale dont les toits-terrasses ont une vue magnifique sur la baie, une de ces maisons où William Burroughs s’installa fin 1953, il arrivait de Rome, il arrivait d’Amérique du Sud où il avait cherché le yagé des voyants et des télépathes, il arrivait de Mexico où il avait abattu d’une balle en pleine tête sa femme Joan, il arrivait de New York où il était tombé amoureux d’Allen Ginsberg qui l’avait envoyé paître, Rome l’ennuyait à mourir, trop de statues, pas assez d’éphèbes, pas assez de drogues et de liberté, Rome morte en rampant d’une maladie oculaire écrira-t-il, Burroughs prophète des psychotropes survivra à Kerouac à Cassady à Ginsberg à son propre fils Billy Burroughs l’ivrogne, il survivra à la morphine à l’héroïne au LSD aux champignons et mourra à l’âge vénérable de quatre-vingt-trois ans — à Tanger il s’installe dans une pension servant de bordel aux Européens homosexuels, il se plaît dans ce trou à rats, le haschisch est bon marché les tout jeunes gitons rifains que la pauvreté pousse dans les bras occidentaux aussi, William Burroughs écrit Interzone et Le Festin nu en quatre ans de marijuana d’opiacés d’alcool et de prostitués mâles, il aime la ville sans pays de la concession internationale, nid d’espions de trafiquants d’armes et de drogue, la porte de la Zone l’inspire, William est devenu écrivain parce qu’il a tué sa femme, ivre, dans un bar de Mexico en jouant à Guillaume Tell avec un verre, une cartouche au beau milieu du front cette vision le hante la tache rouge la tête qui s’éloigne vers l’arrière le sang qui dégouline du crâne ouvert la vie qui s’en échappe, Lowry l’ivrogne a failli étrangler sa femme à plusieurs reprises — pourquoi Rafaël Kahla l’auteur libanais est-il devenu écrivain, lui, peut-être pour la même raison violente, je l’imagine combattant pendant la guerre à Beyrouth, qui sait, il a abattu un camarade par erreur ou sauvagement massacré des civils, comme Eduardo Rózsa le volontaire hongrois en Croatie grand tueur de Serbes a peut-être fait abattre les deux journalistes qu’il prenait pour des espions avant de se lancer dans l’écriture autobiographique, Burroughs le visionnaire revoit sa femme morte, à Tanger, il lui parle la nuit, il pense à elle même quand les petits Arabes lèchent ses blessures de l’âme, il pense à Joan morte et à lui surtout dans la ville qui n’existe pas exotique à la dérive quelque part entre l’Atlantique et la mer Noire, au café de France, au café Tangis où le service est rapide et frais dit la pancarte Burroughs plane entre deux mondes comme un vautour sur le désert de Sonora, à Tanger la blanche salie par le temps, au milieu des ding ! du chariot de sa machine à écrire et des soupirs des coïts payants dans les chambres voisines — à Venise entre deux mondes dans une ville à la dérive perdue dans l’histoire je n’écrivais pas, je buvais je marchais je lisais traînant mes morts comme Burroughs les siens, je lisais des histoires de fantômes qui me convenaient bien, j’avais choisi Venise parce que nous n’avions pas pu y aller avec Vlaho et Andi, trop loin, trop cher, notre expédition adriatique s’était arrêtée à Trieste la habsbourgeoise, j’ai quitté Zagreb dans un bus pour Venise avec mon barda en toile kaki je me suis installé dans un hôtel à Cannaregio je me souviens il y avait si longtemps que je n’avais pas sorti ma carte de crédit qu’elle était collée au portefeuille et présentait de petites taches verdâtres au verso le réceptionniste l’a prise avec un air dégoûté j’avais l’impression de puer la guerre je devais puer la guerre la graisse de fusil l’humidité le tabac le havresac vert les cheveux si courts les yeux écarquillés et rougis je pensais m’arrêter deux jours à Venise et prendre le Marco Polo de nuit pour Paris retrouver Marianne aux seins blancs et quelque chose m’est tombé dessus je n’ai pas eu la force, coincé entre deux mondes j’arpentais la ville la nuit la ville du grand silence du brouillard et de la peste, j’ai trouvé l’appartement du Ghetto par hasard en passant devant une agence immobilière de San Polo j’ai quitté l’hôtel acheté une carte de téléphone appelé Marianne un soir glacial depuis une cabine toute proche je parlais à Marianne mais je ne lui parlais pas je regardais les barques et les canots à l’amarre dans le minuscule canal à deux mètres du téléphone public, je me suis dit je vais rester ici un peu je crois, elle a répondu je viens si tu veux pourquoi pas j’avais envie qu’elle vienne et réchauffé par sa voix je suis rentré m’emmitoufler dans mon tapis d’Orient et fixer le plafond — qu’est-ce qui m’a sauvé de la noyade à Venise, je l’ignore, Marianne peut-être, ou Ghassan, ou moi-même, le fantôme d’Andrija qui habitait en moi, sa furie, si j’avais eu une once de volonté ou de culture j’aurais peut-être écrit comme Burroughs à Tanger mais j’en étais bien incapable, j’étais incapable de quoi que ce soit c’est Marianne qui a appelé mes parents pour leur dire que j’allais bien que je me reposais à Venise, je me reposais, je buvais mes maigres soldes accumulées et mes économies parisiennes en mangeant mes dernières amphétamines, je n’avais pas la drogue créatrice, la drogue c’était pour pouvoir marcher pendant des heures, la nuit, dormir peu, comme sur le front, être en éveil mais cette fois-ci pour rien, pour trembler quand un inconnu surgissait du brouillard, monter des embuscades nocturnes contre des spectres, soûl et drogué je rasais les immeubles à pas chassés un fusil imaginaire à la main, je jetais rapidement un coup d’œil aux carrefours avant de les traverser en courant, courbé comme si un tireur d’élite allait m’aligner depuis une fenêtre du palazzo Guardi, je reprenais mon souffle dos au mur avant de balancer une grenade fictive dans l’angle mort, j’ai le cœur à cent quatre-vingts pulsations-minute je suis au plus fort des combats dans le silence bruissant de la lagune, je tends un piège mortel au vaporetto n o 1 le seul à remonter le Grand Canal la nuit, je l’attends avec un lance-grenades antichars au bout d’une impasse près de l’Académie soûl halluciné je vise les loupiotes qui dansent sur l’eau noire je tire j’imagine le trait de feu sifflant atteindre l’embarcation exploser illuminer les façades des palais les églises j’imagine la déflagration la vague de chaleur me fait fermer les yeux je l’ai eu je l’ai eu j’ai coulé un navire ennemi les touristes américains s’enfoncent dans la ténèbre pour rejoindre les rats quelle joie je m’allume une clope je retourne hanter les ruelles en jouant toujours au soldat et ce des heures des nuits durant obsédé par mes souvenirs, et il est facile, dans la pénombre de Venise, de vivre ses cauchemars dans la solitude, car il n’y a rien autour qui vive, à part les ombres mortes du brouillard et les cris des cornes de brume, à son arrivée Marianne me dit j’ai l’impression que tu reviens de très loin, je reviens de loin oui, j’étais incapable de coucher avec elle j’avais encore sur la peau le contact des prostituées des musulmanes violées des cadavres je n’étais plus en moi j’étais dans le Bardo la salle d’attente des âmes errantes et petit à petit plus je buvais avec Ghassan plus je retrouvais une position physique dans le monde de la nuit un nouvel être j’avais l’impression de reprendre pied de marcher un peu sur l’eau de la lagune enfin ce genre d’illusions et plus je pensais récupérer un nouveau corps plus je voulais l’essayer sur celui de Marianne qui elle s’enfonçait dans la neurasthénie en préparant son agrégation en se levant tôt en travaillant toute la journée en allant courir trente minutes chaque après-midi à dix-huit heures tapantes aux Zattere elle n’avait plus jamais envie de faire l’amour, moi je revenais à la vie, mon sexe de spectre était dressé comme un cyprès dans un cimetière, je vidais Marianne de son désir de sa vitalité de son argent aussi, je la pompais, je l’épuisais en l’attirant vers le fond avec moi, quand je sortais le soir pour mes randonnées nocturnes d’insomniaque jusqu’à retrouver Ghassan elle me demandait de lui tenir compagnie dans le silence humide du Ghetto, je restais en lui susurrant peut-être, oui, pourquoi pas, avec un air lubrique, et parfois elle était si désespérée de solitude qu’elle se laissait faire, les jambes écartées, toute sèche, je lui faisais mal et ahanais grossièrement sur son épaule sans qu’elle bouge, résignée, les yeux fermés, l’éjaculation nous plongeait immédiatement dans la tristesse moi j’avais honte de l’avoir forcée elle, elle comprenait que j’allais la laisser seule de toute façon une fois le désir assouvi alors pour échapper à la vergogne et éviter son regard je partais en catimini pendant qu’elle feignait d’être assoupie, dans l’escalier les couilles bien vidées je vissais le bonnet noir sur mon crâne, saisi par le froid je courais pour me réchauffer toujours dans la même direction, vers le quai de l’Oubli les bars d’Aldo, de Muaffaq le Syrien ou le Paradis-Perdu, je traversais la grand-place du Ghetto déserte, à Venise tout fermait tôt, règlement antibruit de la ville fantôme — les cités mourantes commencent par réglementer leur agonie en avançant de plus en plus l’heure de fermeture des établissements de perdition, jusqu’à les convertir tous en salons de thé avec dispense spéciale pour ouvrir jusqu’à minuit, le rêve des maires dignement élus par des rombières en fourrure déjà couchées à l’heure de l’apéritif, débarrasser la ville la plus silencieuse du monde des derniers sons de la vie : les touristes se couchent tôt, les touristes en ont plein les pattes et rentrent vite à l’hôtel pour jeter leurs dernières forces dans le déduit, avant de s’endormir du sommeil du juste, bercés par le clapot mou du Grand Canal sur les pilotis et les pontons, car il ne sera pas dit qu’ils n’auront point forniqué dans la capitale de la gondole et du romantisme, ils oublient que le romantisme était une maladie de la mort, un genre de peste noire du sentiment et de la folie, ils oublient qu’ it’s so romantic signifie en réalité c’est terriblement morbide , Marianne le ressentait, elle, même si elle n’était pas poitrinaire comme la Dame aux camélias, mais soumise aux assauts d’un ex-guerrier plus ou moins violent, plus ou moins ivrogne, qui rassemblait en gros tous les clichés du machisme absolu, et encore aujourd’hui dans ce train aux trois quarts vide j’ai la sensation d’un échec d’une violence impardonnable comme avec Stéphanie près de dix ans plus tard — ferme les yeux Francis j’écrase une larme de rage impossible d’oublier impossible même dans le sommeil peut-être Burroughs à Tanger était-il dans un état semblable, hors de lui, combattant la bête noire du souvenir et de la honte le hibou aux pattes d’araignée collé dans un coin de la mémoire, comme Marianne Stéphanie la brune aux longs cheveux l’experte de la géopolitique de la Zone est accrochée à mon plafond personnel comme un insecte, trop de choses il y a trop de choses tout est trop lourd même un train n’arrivera pas à amener ces souvenirs à Rome tant ils pèsent, ils pèsent plus que tous les bourreaux et les victimes dans la mallette au-dessus de mon siège, cette collection de fantômes commencée avec Harmen Gerbens le vieillard cairote, Harmen Gerbens à la triste moustache emprisonné à Qanâter au Caire, étrange destin, échapper à la police néerlandaise pour finir emprisonné en Egypte, il faudrait être saint Christophe pour porter tout cela, les quarante-trois clichés de Gerbens et ses feuilles de commentaires dans son journal, Gerbens le violeur documentariste grand metteur en scène de pornographie concentrationnaire, au début je ne savais pas pourquoi je récupérais ces informations ces noms et ces photos à droite et à gauche, dans les fichiers immenses du Service, d’abord, puis de plus en plus loin, pour quelle raison fait-on les choses pas par désir de savoir, pas par besoin de comprendre, pour conquérir une place dans le monde qui se défait, Burroughs à Tanger se battait contre sa propre violence à coups d’opiacés d’alcool et de kif, comme Malcolm Lowry à coups de gnôle, Tanger ville de la dérive de la grande illusion et de la contrebande, perdue seule sur l’épaisse lèvre inférieure de la Zone, William Burroughs est américain, les rives du Mississippi lui manquent-elles, les avenues bien rangées de New York, les palmiers de Palm Beach, il est ailleurs, cette nuit d’octobre 1955, il ne dort pas, il n’écrit pas il ne lit pas il est assis sur une chaise en bois les yeux plongés dans l’obscurité, dehors ou dedans, il fume un joint de pâte de marijuana, la fenêtre est ouverte il fait encore bon malgré l’automne, William a quarante et un ans, l’âge d’homme, derrière lui au-delà du mur mal blanchi il entend gémir, quelqu’un gémit, deux secondes, trois, s’arrête et recommence, un rythme assez lent, tranquille, un homme gémit bouche fermée Burroughs souffle sa fumée, l’ouïe si tendue qu’il a l’impression d’être une chauve-souris voletant dans la pièce voisine, ses oreilles si grandes ouvertes qu’il entend grincer les dents serrées du type gémissant, Burroughs sent très précisément se contracter le bas de son scrotum, plus il écoute et plus son sexe se gonfle, quel bonheur, il déboucle son pantalon pour laisser s’épanouir l’engin, à l’air libre dans les volutes grises, il souffle sur son pénis, il regarde l’œil unique du membre happer la marijuana, la lèvre minuscule de cette bouche de carpe s’ouvrir pour fumer à son tour et devenir de plus en plus grande, il observe sa verge durcir au rythme des geignements de l’homme dans la pièce d’à côté, curieux, intéressé puis fasciné par les veines bleues qui parcourent sa propre chair, William pose le joint un instant pour attraper le sac en plastique sur la table, il est dans le noir, il peut se concentrer sur les gémissements qui se poursuivent, plus rapides, plus puissants, dans la chambre voisine, au-delà du bruit du plastique qui se colle à sa bouche, à ses narines, il a du mal à respirer, plus il inspire et moins il parvient d’air à ses poumons, la tête entièrement recouverte par le sac, sa main se contracte sur la chair brûlante entre ses jambes, il commence à geindre à son tour et plus il gémit plus l’air lui manque plus l’air lui manque plus il secoue son organe démesuré ses oreilles bruissent il a très chaud il voit rouge des corps doux et forts se pressent contre lui Burroughs est tout en lui-même et hors de lui la chauve-souris s’est changée en scarabée volant il se secoue de plus en plus fort souffle violemment sa salive glisse contre le sac il est avec Joan l’androgyne il est avec Joan l’androgyne morte c’est elle qui le prend elle lui enfonce deux doigts dans la gorge et deux autres dans l’anus il a mal sa glotte se contracte il est asphyxié il écrase sa bite comme un poisson elle gicle elle se vide il explose, Burroughs explose près de l’évanouissement sa semence s’envole dans le soir la viscosité plane un instant comme l’orgasme il ne peut pas crier il ne peut pas crier il va crever ses tympans sonnent il bat des bras et des jambes il est noyé le sperme retombe sur ses cuisses au moment où il arrache le sac inspire inspire inspire il jouit une seconde fois en ouvrant les yeux la chambre déformée se balance autour de lui dans le silence sonore de Tanger, complètement avachi sur sa chaise Burroughs avale de l’air, avale de l’air, avale de l’air, loin, le cœur échappé, dans un bien-être total, mou, détendu, il observe en souriant une goutte grumeleuse un filament blanc pendre à son index, il le regarde longuement avant de se lécher le doigt d’un air curieux et de rallumer le joint, la fumée brûle ses muqueuses irritées, totalement détendu, le sac de l’épicerie maintenant par terre, Burroughs sent les fibres d’osier de la chaise lui meurtrir le cul, il a soif, il sèche le fond de sa bière d’un trait, est-ce qu’il lui vient un poème, est-ce qu’il lui vient un fragment d’ Interzone , est-ce qu’il lui vient autre chose que le sommeil, la chaleur le réveillera la chaleur le grand jour les bras pliés sur la table effondré souillé le haschisch éteint encore dans la main vaincu par le plaisir et la mort dans les reflets bleutés de la baie de Tanger gardienne de la Méditerranée — le lendemain matin William Burroughs est encore tout tremblant, courbaturé, il se passe sous l’eau dans la salle de bains commune et descend se perdre dans l’animation, où va-t-il prendre un café, je l’imagine bien au bar Baba, je ne sais pas s’il existait déjà à l’époque, le café Baba à Tanger a l’air d’avoir toujours été là, depuis les Phéniciens commerçants sans scrupules ancêtres de Ghassan et de Rafaël Kahla l’écrivain, des tables des chaises de vieilles affiches au mur des serveurs affables les légendes de Tanger s’y sont toutes attablées, Burroughs j’imagine aussi, Bowles l’homme bleu, Jean Genet, Tennessee Williams, Mohamed Choukri le crève-la-faim, au café Baba aujourd’hui il y a un poster du Barça le FC Barcelone club que les Marocains adorent j’ignore pour quelle raison ils se sentent solidaires de cette équipe catalane qui n’a pas la moitié des titres de sa rivale madrilène, peut-être les couleurs de son maillot bleu et rouge leur rappellent-elles instinctivement quelque épisode glorieux, Jean Genet aimait-il le football je n’en sais rien, il aimait très certainement voir ces beaux sportifs courir en petite tenue sur une herbe bien verte, Genet parvient à Barcelone trente ans avant de venir à Tanger la trouble, Barcelone est une ville noire un port qui sent la friture et les malandrins, où il y a du sang coagulé sur les couteaux de poche au manche usé, dans les ruelles coincées entre le port et l’avenue Parallel Genet tombe amoureux d’un Serbe puant la gomina et la crasse, Genet bande pour le crime, Genet bande pour le crime comme d’autres pour l’armée, Genet bande pour un Serbe déserteur de la Légion étrangère, un Serbe manchot, voleur et maquereau, qui l’humilie et qu’il humilie, un Serbe qui a servi pendant la Première Guerre mondiale, qui a réchappé à la défaite, à la débâcle et perdu sur les routes s’est enrôlé chez Millán Astray le fiancé de la Mort, pour finir lui aussi mutilé comme le général amoureux de la décapitation, puis mendiant voleur trafiquant d’opium et amant de Jean Genet l’illuminé sodomite, Stéphanie à Barcelone cherchait vainement des traces de cette époque glorieuse où l’écrivain s’accouplait avec des marins pour quelques pesètes, sans penser que c’était impossible, bien sûr, que sa propre condition de touriste était la preuve même de la disparition de la ville qu’avait entrevue Genet juste avant la guerre civile, l’argent et les visiteurs étrangers supposaient la fin des quartiers borgnes, et il me paraissait très lâche de rechercher aujourd’hui avec nostalgie les traces de l’humiliation des pauvres des putains des voleurs tout en descendant dans un hôtel de demi-luxe pour classes moyennes européennes, alors qu’elle ne supportait pas la version contemporaine de cette plèbe d’avant-guerre, les Maghrébins toute la journée le dos contre un mur attendaient quelque chose qui n’allait pas se produire, les grosses putes noires s’engueulaient avec les putes mineures décharnées en provenance de l’Est, tous parqués, contraints par des flics aux matraques rapides à quelques rues minuscules, à un carrefour où ils revenaient sans cesse entre deux arrestations musclées, priés de ne pas s’égailler dans des endroits plus passants, sommés de se faire discrets ou de disparaître comme par magie, expulsés le plus souvent sans ménagement, Barcelone cherchait à éradiquer la prostitution dans la rue pour la réserver aux bordels clinquants et modernes où il y avait une douche dans chaque chambre et un certificat d’hygiène — Stéphanie la curieuse jouait à se faire peur en me proposant de l’emmener dans un claque agréable, où nous aurions pu coucher avec une jolie femme bien propre, l’idée l’excitait beaucoup, je me souviens à l’hôtel un soir qu’elle avait un peu bu elle me susurrait ses fantasmes à l’oreille, bien sûr je lui donnais la réplique, je lui expliquais les mœurs des maisons closes en sentant son désir monter, je savais évidemment que Stéphanie était une fille bien, limitée par sa classe sociale et son éducation et que jamais elle n’irait dans un endroit pareil, mais qu’à cela ne tienne nous étions en vacances loin du boulevard Mortier de la conspiration internationale des dossiers et de toute chose sérieuse, à part la Zone, je n’en sortais pas, la maison de Francesc Boix le photographe de Mauthausen le camp de la Bota l’immeuble de la police vía Laietana où les franquistes torturaient tout ce qui leur tombait sous la main la prison modèle rue Entença qu’avait dirigée le père de Millán Astray je devais penser à tout cela en couchant avec Stéphanie, Stéphanie proustienne le matin célinienne le soir, j’ai soif tout d’un coup, je pourrais retourner au bar boire quelque chose peut-être juste un verre d’eau à bulles pour me ravaler l’intérieur de la bouche asséché par le gin et le tabac, dehors il fait noir malgré la lune, des collines ondulent à très grande vitesse, cette voie rapide ne croise plus aucune ville, il n’y a plus que la campagne entre nous et Rome, j’observe les formes de la flûtiste endormie sur l’épaule de son compagnon, on distingue ses dessous sous son pull, Stéphanie aimait beaucoup les jerseys en cachemire gris à col en V, elle les mettait à même la peau sur un soutien-gorge noir, les femmes laissaient Genet indifférent, je crois, pas Burroughs, il a eu un enfant avec Joan avant de l’abattre par jeu — de tous les héros de Tanger, Paul Bowles Jean Genet ou Tennessee Williams Burroughs est sans doute le seul à fréquenter aussi les dames, ce matin d’octobre 1955 après sa première expérience d’hypoxyphilie l’étouffement délicieux William Burroughs prend un café tranquillement au Baba ou au Tangis, Tanger vit sa dernière année d’indépendance sous l’égide de la communauté internationale, comme on dit, en 1956 le sultan du Maroc son manteau à capuche et son petit âne sont entrés dans la ville, il ne restait plus aux Espagnols que Ceuta et Melilla, et aux Français que les yeux pour pleurer, bien que le Maroc ne fasse pas exactement partie de ma Zone je m’y suis tout de même rendu en mission une fois, question de coopération internationale antiterroriste évidemment, les Marocains étaient très avancés en la matière ils avaient déjà commencé à enfouir dans le désert les islamistes les gauchistes et les démocrates et ce dès les années 1960, dans des prisons bien sèches et en plein air, à Kenitra, à Tazmamart puis à Outita, très récent bagne qui n’a rien à envier à ses aînés les plus fameux : les méthodes marocaines étaient simples à défaut d’être efficaces, il s’agissait d’emprisonner le plus grand nombre possible de pauvres types, de chômeurs, de traîne-savates divers et variés, religieux ou non, pour avoir fréquenté la même rue, la même école ou le même quartier qu’un opposant, ce qui n’augmentait pas la popularité du pouvoir en place mais remplissait dignement les taules du royaume — les services marocains avaient toujours une dent contre nous, ou plutôt nos relations avaient dans le pied l’épine de Ben Barka, et à chaque fois qu’un juge français sortait une commission rogatoire ou qu’un ancien flic faisait des révélations sur l’affaire ils se vexaient, nous mettaient des bâtons dans les roues, tout en comprenant vaguement que nous n’y pouvions pas grand-chose, après tout ils n’avaient qu’à ne pas l’enlever, leur Ben Barka, pour le dissoudre dans l’acide ou l’enterrer au fin fond du désert, c’était prendre un gros risque, la preuve on en parle encore, une fois de plus je profitai de ma mission pour voir un peu du pays, Casablanca et Tanger en train rapide, un train d’ailleurs tout à fait convenable, évidemment sans le design Pininfarina du TGV italien d’aujourd’hui, à Tanger j’avais cherché la pension-bordel où logeait Burroughs le télépathe visionnaire et j’avais essayé de lire Le Festin nu , sans succès, à part quelques pages au hasard, ni Tennessee Williams ne m’inspirait, ni Bowles le buveur de thé, la tombe de Genet était à Larache assez loin de là, je me suis assis au café Baba avec un journal pour me donner une contenance, j’étais descendu à la pension Fuentes, sur une place minuscule de la vieille ville, touriste pour touriste autant aller jusqu’au bout, je gagnais du temps, je gagnais du temps avant de rentrer à Paris de retrouver Stéphanie et mon boulevard obscur où je m’enfonçais dans la paperasse et les commentaires de Lebihan le roi du vélo, il était tout proche de la retraite, dans les limbes entre la vie active et la résidence en Normandie, et il s’en rendait compte lui-même : ah, Francis, je ne suis plus à ce que je fais, je n’ai plus le cœur à l’ouvrage, vous comprenez ? il passait des heures à bayer aux corneilles, avant que la culpabilité ne le prenne et qu’il ne se mette à courir dans tous les sens en cherchant désespérément quelque chose à faire, quelque chose qui lui donne le sentiment d’être de nouveau de la partie, indispensable, et donc de gaspiller une énergie folle façon mouche du coche, lui qui était si endurant normalement il ne savait plus comment aborder un col, ce fanatique de la petite reine pédalait dans le vide, cherchait à dépasser tout le monde dans les faux plats, Francis il faut que vous alliez au Maroc, je connaissais tellement mon Lebihan l’homme à la pelade incurable que je faisais la sourde oreille, aller où, pourquoi, j’ai beaucoup de travail maintenant, alors je le voyais se mettre en danseuse immédiatement, Francis je monte une mission tout de suite, c’est vital, par la bande vous pouvez avoir le nom qui nous manque dans le dossier Z., essayez de les persuader d’un échange pour le dossier Y., attention, lisez la prospective, Francis, le dossier A. va prendre de l’importance, l’économique nous relance tous les jours, Francis, le poste patauge, la gouttière perce allez-y au moins ils auront l’impression qu’on s’intéresse à eux, Francis montrez-leur que nous pouvons faire plus que ces toqués du technologique, là Lebihan était injuste, précisément par un hasard absolu nous étions les responsables d’une note magnifique sur Les Modes de communication de Q. sur Internet , Lebihan n’entendait rien à l’informatique et en était très fier, de cette note, la quantité d’information à traiter rendait les spécialistes d’Internet pratiquement inopérants, à moins qu’un fou n’envoie un mail en braille pour demander des nouvelles de la santé de Ben Laden : à l’ère du Web le renseignement humain retrouvait son heure de gloire et Lebihan, sur le point de partir en retraite, retrouvait son petit vélo, l’homme formé à l’époque de la guerre froide reprenait du poil de la bête, par instants il criait en se grattant Francis, Francis, vous n’avez pas avancé sur l’histoire K. , et Francis soufflait, Francis passait des heures à recouper des notes informes venues de postes incongrus pour avancer sur K., en rêvant de Croatie, de Bosnie, d’action et de bruits d’obus, Francis pensait à ses camarades morts, au cul de Stéphanie, à des milliers de fessiers balançant dans des culottes provocantes, toutes cachées par les pantalons de flanelle grise qui sont le pain quotidien des fonctionnaires, mais notre spécialité, l’information, nous mettait à même de déchiffrer, d’apercevoir le string de telle ou telle et de nourrir notre désir, jour après jour, pour ces dessous administratifs et secrets — à Tanger il n’était pas question de dessous, bien au contraire, j’étais stupéfié par l’absence de femmes, remplacées par des Africains, des Sahariens, des Subsahariens, tous espérant un prompt passage vers l’Europe et ses gloires, la ville semblait emplie d’hommes traqués, en attente, les yeux baissés, toute la Casbah hébergeait des clandestins craintifs et des passeurs obèses, un pays dans l’attente, Tanger ville escale où le trafic humain remplaçait la contrebande de drogue d’armes et d’influences, tous ces pauvres types dans les limbes devaient survivre en attendant leur passage en Espagne, la pension Fuentes ressemblait à des dizaines d’autres, le personnel plutôt agréable appréciait le touriste occidental, moi j’étais tenté de m’embarquer pour Algésiras avec un chargement de clandestins, de devenir moi-même clandestin, de disparaître, d’oublier Francis l’ex-guerrier espion de bas étage Stéphanie la grande stratège Lebihan le cycliste et tout le toutim, j’aurais dû, j’aurais dû, si j’y pense bien j’ai été sur le point de changer de vie trois fois, une à Venise dans l’eau noire d’un canal, une à Tanger dans un hôtel de bas étage, une autre aujourd’hui, consommée, ça y est, je m’appelle Yvan Deroy le fou, à chaque fois un ange est apparu, à chaque fois il y a eu une intervention divine un miracle comme disent certains pour me remettre sur les rails qui me guident maintenant vers Rome, à Tanger j’errais dans les ruelles de la Médina ou au bord de la mer, entre Atlantique et Méditerranée, hanté par Burroughs la drogue et la mort, poursuivi par Stéphanie et notre relation chaque jour plus difficile, par la valise qui s’alourdissait et dont j’imaginais qu’elle pourrait me couler dans une barque au milieu du détroit de Gibraltar : à Tingis la phénicienne le saint s’est révélé être un vieux Rifain à l’épaisse chevelure grise et frisée, à la moustache presque blanche, qui buvait des bières dans un café bondé et bruyant, alors que je tuais le temps en feuilletant Le Festin nu sans y comprendre goutte à la table d’à côté, c’est lui qui m’adressa la parole, il me demanda vous êtes français ? et après que j’eus acquiescé distraitement il enchaîna je n’aime pas les Français , avec un grand sourire, je l’ai trouvé immédiatement sympathique, j’ai dit moi non plus , moi non plus je n’aime pas spécialement les Français, ni personne d’ailleurs a priori , le vieux s’appelait Mohamed Choukri il était écrivain, connu comme le loup blanc à Tanger qu’il arpentait de haut en bas depuis quarante ans, il savait toutes les tavernes toutes les putains au ventre purulent tous les étrangers attirés par l’exotisme la délicatesse troublante de ces contrées morbides il avait fréquenté Bowles et Genet il faisait un peu pitié avec sa besace en plastique de clochard dans laquelle il trimballait ses œuvres complètes pour les vendre aux touristes, conscient d’être une légende vivante, un morceau de la ville, comme elle rongée par le Crabe, Choukri me disait j’ai trois cancers distincts et indépendants, croyez-le ou non , on aurait pu les nommer comme les clous qui crucifièrent le Christ, pauvreté, violence et corruption, il avait les trois cancers de Tanger le vieux Mohamed au prénom de Prophète, il était en train de mourir, je lui achetai ses romans Le Pain nu et Le Temps des erreurs , dont les titres me semblaient convenir à merveille, Choukri me demandait si j’étais venu pour le kif, pour les garçons ou pour la nostalgie et j’étais bien en peine de lui répondre, qu’est-ce que j’aurais pu dire, je suis venu parce que Burroughs a tué sa femme, ou un truc du genre, ça ne tenait pas debout, je suis venu parce que Burroughs a failli mourir asphyxié en se branlant avec un sac en plastique sur la tête, je suis venu parce que je cherche à me guérir de mon propre cancer, j’ai fini par murmurer je suis venu pour m’embarquer sur une patera à destination de l’Andalousie , il a souri, ah vous êtes journaliste, il y en a beaucoup qui font le voyage, c’est le dernier sujet à la mode , j’aurais voulu dire que non, je n’étais pas journaliste mais espion, Choukri le mourant m’a demandé de lui offrir une bière, j’en ai commandé deux, c’est pas grave, ton journal paie , il souriait en permanence avec une ironie mordante, toutes les cinq minutes quelqu’un venait lui serrer la main, lui qui avait bouffé le cœur de sa mère lors des famines des années 1940 dans le Rif, tellement il avait faim, qui s’était perdu dans la grande ville peu avant l’indépendance, qui avait poursuivi Jean Genet et recherché son amitié par intérêt, comme Genet l’aurait fait lui-même avec d’autres vingt ans plus tôt, Choukri à la jeunesse gâchée par la misère et la bêtise crasse de sa famille se rachetait, il devenait écrivain en suçant le talent de Genet, de Williams et de Bowles, qui ne demandaient pas mieux, Choukri se hissait vers la lumière en marchant sur ces vieillards célèbres pour lesquels il ne cachait pas vraiment son mépris, ou du moins ses réserves, saint Genet s’était fâché contre lui quand il avait appris la parution de Jean Genet à Tanger , et maintenant Mohamed Choukri l’homme du ressentiment rongé par le cancer buvait ses dernières bières en me racontant les émeutes de 1952, les autorités internationales réprimaient durement les manifestations en faveur de l’indépendance, Mohamed avait dix-sept ans, place du Grand-Souk l’armée mit en batterie une mitrailleuse et commença à tirer sur la foule, Choukri m’expliquait qu’il avait vu là son premier cadavre tué par balle, il avait croisé auparavant des morts de faim des malades des poignardés mais jamais personne tué par une arme à feu, de gros calibre qui plus est, et il avait été fortement impressionné par la puissance du projectile, la façon dont les hommes étaient abattus en plein vol disait-il, perforés morts avant même de toucher terre, laissant des corps apparemment sans violence, la face contre le sol, le sang qui se répandait doucement sur leurs vêtements s’opposait à la panique de la foule courant en tous sens au rythme de la mitrailleuse, j’ai pensé à Burroughs tirant une cartouche à bout portant dans la tête de sa femme, à Lowry étranglant Margerie, à Cervantès trois fois humilié, à Barcelone, à Lépante, à Alger, peut-être Choukri aussi devient-il écrivain à ce moment précis, quand son père bat sa mère soumise par habitude plus que par plaisir, quand il est contraint à voler pour manger et enfin lorsqu’il court se réfugier dans la Casbah pour échapper à la fusillade, humilié par les trois pouvoirs, familial, économique et politique, je regardais Mohamed le gris dans ce bouge de Tanger à côté de l’affiche jaunie par la fumée du club de foot barcelonais, Choukri avec son air de clochard céleste, prétentieux et humble à la fois, proche de la fin, peut-être déjà aveugle au monde qui l’entourait, tourné vers lui-même son histoire ses drames ses masques sans jamais sortir d’eux, il sera toujours l’enfant battu hâve et émacié du Rif, il sera toujours l’adolescent qui court pour échapper aux balles françaises et espagnoles, et je me dis que j’aurais beau prendre une barcasse à destination de l’Europe en clandestin je resterais moi-même, Francis fils de ses parents, fils de la Croate et du Français, de la pianiste et de l’ingénieur, comme on dit Achille fils de Pélée, Ajax fils de Télamon, Antiloque fils de Nestor, nous allons tous reposer au Leucé l’île Blanche à l’embouchure du Danube, tous les fils de, fils du destin des pères, qu’on les appelle Faim, Courage ou Douleur, nous ne deviendrons pas immortels comme Diomède fils de Tydée transformé en paon, nous allons tous claquer, dévisser notre billard et trouver une belle sépulture, Mohamed Choukri le traîne-misère avare et généreux est déjà dans la terre, Burroughs le tireur d’élite et Lowry l’ivrogne aussi, même le pape va passer la crosse à gauche incessamment, et moi ensuite, peut-être faudrait-il abandonner le combat et se laisser aller à la mort et à la défaite, s’admettre vaincu et reprendre les noirs vaisseaux et l’ironie comme Cervantés, mais vers où, c’est trop tard, j’aurais pu descendre à Florence maintenant c’est trop tard, plus d’arrêts avant la destination finale, il va falloir aller jusqu’au bout, il va falloir se laisser porter jusqu’à Rome et continuer la bataille, le combat contre les Troyens grands dompteurs de cavales, contre moi-même mes souvenirs et mes morts qui m’observent en grimaçant
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Zone»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Zone» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Zone» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.