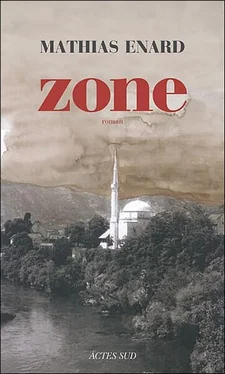Mathias Énard - Zone
Здесь есть возможность читать онлайн «Mathias Énard - Zone» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Город: Paris, Год выпуска: 2008, ISBN: 2008, Издательство: Éditions Actes Sud, Жанр: Современная проза, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Zone
- Автор:
- Издательство:Éditions Actes Sud
- Жанр:
- Год:2008
- Город:Paris
- ISBN:978-2-7427-7705-1
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Zone: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Zone»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Par une nuit décisive, un voyageur lourd de secrets prend le train de Milan pour Rome, muni d’un précieux viatique qu’il doit vendre le lendemain à un représentant du Vatican pour ensuite — si tout va bien — changer de vie. Quinze années d’activité comme agent de renseignements dans sa Zone (d’abord l’Algérie puis, progressivement, tout le Proche-Orient) ont livré à Francis Servain Mirkovic les noms et la mémoire de tous les acteurs de l’ombre (agitateurs et terroristes, marchands d’armes et trafiquants, commanditaires ou intermédiaires, cerveaux et exécutants, criminels de guerre en fuite…). Mais lui-même a accompli sa part de carnage lorsque la guerre en Croatie et en Bosnie l’a jeté dans le cycle enivrant de la violence.
Trajet, réminiscences, aiguillages, aller-retour dans les arcanes de la colère des dieux. Zeus, Athéna aux yeux pers et Arès le furieux guident les souvenirs du passager de la nuit. Le train démarre et, avec lui, commence une immense phrase itérative, circulatoire et archéologique, qui explore l’espace-temps pour exhumer les tesselles de toutes les guerres méditerranéennes. Car peu à peu prend forme une fresque homérique où se mêlent bourreaux et victimes, héros et anonymes, peuples déportés ou génocidés, mercenaires et témoins, peintres et littérateurs, évangélistes et martyrs… Et aussi les Parques de sa vie intérieure : Intissar l’imaginaire, la paisible Marianne, la trop perspicace Stéphanie, la silencieuse Sashka…
S’il fallait d’une image représenter la violence de tout un siècle, sans doute faudrait-il choisir un convoi, un transport d’armes, de troupes, d’hommes acheminés vers une œuvre de mort. Cinquante ans après
de Michel Butor, le nouveau roman de Mathias Enard compose un palimpseste ferroviaire en vingt-quatre “chants” conduits d’un seul souffle et magistralement orchestrés, comme une
de notre temps.
Né en 1972, Mathias Enard a étudié le persan et l’arabe et fait de longs séjours au Moyen-Orient. Il vit à Barcelone. Il a publié deux romans chez Actes Sud :
(2003) — Prix des cinq continents de la francophonie, 2004 — qui paraît en Babel, et
(2005). Ainsi que, chez Verticales,
(2007).
Zone — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Zone», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
XVIII
à Rome en 1598 Michelangelo Merisi dit le Caravage organise sa première décapitation : il fait trancher la tête d’un vieux cheval par un brigand athlétique recruté devant un des nombreux lupanars autour du mausolée d’Auguste, dans son atelier il observe avec attention les muscles du tueur nu saillir sous le poids de l’épée, la courbe de l’épaule quand elle abat le fer sur la gorge de l’animal, les naseaux fumants de fièvre, terrassée par la maladie la bête est condamnée le Caravage n’a pas le temps de dessiner bien sûr, il détaille le reflet sur la lame quand elle pénètre l’encolure le jet de sang noir et droit qui arrose la cuisse du guerrier et devient pourpre, les jambes de l’équidé se convulsent, le métal revient à la charge, le mercenaire sauvage lève à nouveau l’arme et frappe plus haut ouvrant une nouvelle plaie le cheval ne bouge plus l’homme a atteint les vertèbres, le bourreau est rouge et visqueux jusqu’à la taille, il se penche en avant pour finir son ouvrage, Michelangelo Merisi le regarde saisir la crinière tailler les dernières chairs et brandir de la main gauche la lourde tête, sans effort, elle dégoutte et ses yeux sont fixes, le Caravage a un haut-le-cœur, ses deux domestiques lancent des seaux d’eau sur le bourreau frémissant, on croit voir son cœur battre dans sa poitrine imberbe, le Caravage commence à dessiner, des muscles, des épées, des jets sanglants, pendant que le spadassin se lave, avant que Merisi l’inverti ne le paie pour tout autre chose, un rituel bien plus répréhensible à l’époque que la mort d’un cheval malade, Rome est une cité sombre dangereuse peuplée de dagues de prostituées défigurées de coupe-jarrets de ruelles sans lumière, le Caravage aime cette ville, après sa fuite il n’aura de cesse qu’il n’y retourne, même si Naples a son charme, sa perdition, même si on peut trouver des amants et des têtes à couper jusqu’à Malte la prude, c’est toujours Rome la plèbe de Rome le faste de Rome qui attirera Caravaggio le sacrificateur, l’amoureux des corps de la nuit et de la décapitation, Rome qui s’avance à grands pas dans la nuit toscane, demain les Américains auxquels Antonio le barman ressert un chianti vont peut-être s’arrêter à Saint-Louis-des-Français sur le chemin de la place Navone, pour voir les trois toiles de la chapelle Contarelli, l’appel, l’inspiration et le martyre de saint Matthieu, parmi les œuvres les plus célèbres du Caravage, l’épée de l’homme nu auprès du saint étendu à terre, la beauté de l’ange, à quelques mètres de là dans la première chapelle à gauche se trouvent les plaques de commémoration des soldats français morts en Italie, les officiers de la France libre commandant des Marocains des Tunisiens des Algériens des Sénégalais des Antillais que personne ne regarde, pauvres types oubliés, les tabors et les goumiers, sacrifiés si facilement par les généraux alliés — retirés du front d’Italie en juillet 1944 après avoir laissé dix mille morts et disparus sur le terrain ils participent au débarquement en Provence, traverseront toute la France avant de franchir le Rhin en avril 1945, il me semble apercevoir leurs trains de mulets par la fenêtre, en Italie la peur de la “maroquinade” devint une vraie panique, disproportionnée au vu des faits, des quelques centaines d’exactions des troupes coloniales, il fallait bien se nourrir, se réconforter, gagner quelque chose à la guerre qui ne donnait rien d’autre que de la douleur, les officiers français avaient le pouvoir de passer leurs soldats par les armes à la moindre incartade, sans autre forme de procès qu’une note envoyée à l’état-major, on en dénombre près d’une centaine, une centaine de types fusillés pour une raison ou pour une autre, parmi les milliers de membres du Corps expéditionnaire français qui ne reverront pas l’Atlas, le Rif, le Constantinois, la Kabylie, beaucoup des survivants mettront leur expérience militaire au service du FLN quelques années plus tard, certains seront torturés, abattus sans sommation ou tomberont dans des embuscades face aux officiers coloniaux qui les avaient portés vers la victoire ou vers une plaque, une petite plaque de marbre à quelques pas des Saint Matthieu du Caravage, une plaque pour résumer les milliers de noms dans les cimetières français éparpillés sur le sol italien entre Naples et le lac Trasimène : à Salonique, une fois Cités à la dérive refermé, entre deux tavernes et deux bouteilles de vin de Macédoine, grâce à un guide de voyage acheté au hasard dans un kiosque à journaux je suis allé voir la nécropole de Zeitenlick, le cimetière de la campagne des Balkans, où se trouvent neuf mille tombes françaises et les ossements de huit mille Serbes des années 1915–1917 oubliés au bord d’une grande avenue, en pleine ville, les rescapés des Dardanelles débarquèrent en 1915 pour soutenir les Serbes en déroute, dans la nécropole se trouvent un carré britannique bien entretenu, un parterre russe, un monument italien, un gigantesque ossuaire serbe, un recoin pour les musulmans d’Algérie, pour les Français israélites, pour les bouddhistes d’Indochine, les Malgaches et les Sénégalais le monde entier était venu se faire trucider par les Bulgares sauvages les Allemands et leurs alliés autrichiens, et le monde entier reposait maintenant entre les cyprès sur l’avenue Langada à deux kilomètres de la mer, dans le soleil d’août, je repensais à la visite des Dardanelles avec Marianne six ans plus tôt, des centaines de pages plus tôt, voilà que par hasard en solitaire je voyais l’épisode suivant, les noms de ceux qui étaient encore vivants quand nous découvrions les paysages tourmentés de la péninsule, les forts de Kilitbahir, le cap Helles, maintenant je pouvais suivre leur parcours, neuf mille de plus avaient claboté un peu plus loin, entre-temps j’avais fait la guerre moi-même, je m’étais arrêté à Venise, Marianne était partie, j’étais devenu fonctionnaire de l’ombre et je me trouvais seul par hasard à Thessalonique devant toutes ces tombes qui pour ainsi dire m’appartenaient, comme m’appartenait la maison natale d’Atatürk en montant vers les ruelles de la ville haute, une demeure ottomane restaurée, ocre-rose, Mustafa Kemal dont j’avais visité le musée aux Dardanelles, son chemin était inverse, lui, vers l’est, vers l’Anatolie glorieuse, au moment de sa naissance en 1881 Salonique est la deuxième cité de l’Empire ottoman, peuplée pour moitié de juifs séfarades et pour l’autre de Turcs, de Grecs, de Slaves et d’Européens, Salonique nid d’espions selon Pabst, ce film m’avait fasciné dans mon enfance, pourquoi en 1912 après la guerre des Balkans Mustafa Kemal avait poursuivi sa carrière militaire, jusqu’à renvoyer à la mer les Britanniques et les Français à Gallipoli, puis les Grecs d’Asie Mineure en 1923, les juifs eux avaient poursuivi l’étude, jusqu’à ce que les Allemands les rattrapent en 1941, et que mi-1943 il n’en reste plus qu’une poignée, éparpillée dans les montagnes avec la Résistance — le camp de transit de Salonique se trouvait à côté de la gare, les trains commencèrent à partir dès mars 1943, vers Treblinka, Sobibór et Birkenau, en août cinquante mille personnes avaient été déportées, et près de quarante mille gazées, j’appris tout cela au Musée juif, avant les communautés d’Athènes et de Rhodes celle de Thessalonique est détruite par Aloïs Brunner enragé spécialiste, arrivé en Grèce en février 1943, alors que jusque-là les mesures antijuives se limitent à l’interdiction des bicyclettes et des radios, Brunner prend les choses en main, le taureau par les cornes, il organise une police juive de malfrats pour l’aider dans sa tâche, et six mois plus tard il ne reste officiellement plus un juif à Salonique, les derniers Prominenten dont le grand rabbin Zevi Koretz sont installés dans un train à destination d’un des camps de Bergen-Belsen, pas question d’extermination pour lui, les Allemands ont la sensation de lui devoir quelque chose, tout comme aux trois cents juifs de nationalité espagnole que le consul de Franco réclame, les Espagnols surprenants insistent pour récupérer leurs juifs, un convoi part donc pour Bergen-Belsen, d’où un transport est organisé vers le sud, et les séfarades prennent le chemin du retour vers les terres d’Isabelle de Castille qu’ils ont quittées quatre cents ans plus tôt, à travers la France de Vichy, se croisent-ils en gare de Narbonne ou de Bordeaux, ceux qui vont vers la destruction et ceux qui y échappent, je n’en sais rien, arrivés en Espagne on les parque dans des bâtiments militaires à Barcelone : en janvier 1944 ces habitants des côtes de l’Egée se retrouvent de l’autre côté de la Méditerranée, après des semaines de train, de camps de transit, de tractations diverses, de privations et de maladie, de Macédoine en Saxe de Saxe en France de France en Catalogne avant d’être finalement envoyés au Maroc-Espagnol, indésirables sur le sol de la patrie, et d’entreprendre, pour leur propre compte cette fois, un nouvel exil qui en mènerait certains jusqu’en Palestine, plus chanceux finalement que le grand rabbin Zevi Koretz : il mourut du typhus juste après la libération des camps, Zevi Koretz l’ashkénaze germanophone avait très bien compris les ordres d’Aloïs Brunner et les avait exécutés strictement, il pensait faire pour le mieux, peut-être avait-il peur de la violence allemande, peut-être ignorait-il ce qui attendait ses concitoyens aux environs de Cracovie, on n’en saura jamais rien — au sortir du musée de la Présence juive ma solitude commence à me peser de plus en plus, j’ai chaud, j’ai soif, le long après-midi d’été a encore du temps devant lui alors je vais manger et boire dans un local climatisé, en pensant aux périples des enfants d’Israël, et en essayant d’imaginer Salonique parlant judéo-espagnol, français et turc, entre un hammam, une mosquée et deux églises byzantines, cette année la ville est capitale culturelle de l’Europe, triste récompense pour les quelques survivants de l’ancienne Jérusalem des Balkans, comme Léon Saltiel, dont j’ai acquis les Mémoires au musée, Léon Saltiel est juif et communiste et dès les premières mesures des SS début 1943, regroupement, marquage, il rejoint l’ELAS, les partisans grecs, dans les montagnes, où il participe à quelques actions héroïques, jusqu’à ce que la guerre civile éclate entre factions résistantes début 1944, Léon Saltiel quitte alors le maquis pour retourner clandestinement à Salonique en compagnie d’une camarade originaire de Ioannina, Agathe, dont il est éperdument amoureux, il s’aperçoit que toute sa famille a été déportée et que les collaborateurs bradent les biens des juifs, il se cache avec sa combattante amoureuse chez un ami, Stavros, mais il est dénoncé, arrêté, torturé et envoyé à Mauthausen où il parvient, après un périple atroce, en compagnie de partisans yougoslaves et d’un autre résistant grec, Manos Hadjivassilis de Macédoine, lui aussi a traversé les Balkans à pied un fusil à la main avant d’être arrêté en Slovénie, Manos se suicide dès l’arrivée au camp, il se jette sur les barbelés, les gardiens SS l’achèvent, Léon Saltiel parle plusieurs langues, il se lie d’amitié avec les communistes espagnols qui organisent la résistance dans le camp, a-t-il rencontré Francesc Boix le photographe c’est probable, Léon Saltiel est malade à la libération, il reste deux mois dans une infirmerie américaine, entre la vie et la mort, il est sur pied en juin 1945, à trois mille kilomètres de son pays, il apprend qu’il y a eu la guerre civile, qu’on s’est battu dans Athènes, que les communistes s’opposent aux Britanniques et aux royalistes, Léon veut revoir Agathe et Salonique, il obtient un passeport de la Croix-Rouge et entreprend le long voyage, à pied à travers l’Autriche et la Hongrie, il parvient à Belgrade où il est arrêté pour des raisons qu’il ignore, finit par être relâché et renvoyé vers l’Italie par Zagreb avec un contingent de prisonniers de guerre, à Venise après deux semaines de quarantaine médicale dans un camp de transit humide on le met dans un train pour Ancône, à Ancône il rencontre des Grecs, ils lui trouvent une place sur un cargo qui accoste enfin à Patras le 1 erdécembre 1945 : le jour de son trentième anniversaire Léon Saltiel est en Grèce, il se rend facilement à Athènes et de là à Salonique, il a peur de ce qui l’attend, entre-temps ses cheveux ont repoussé, ses pauvres vêtements civils fournis par la Croix-Rouge sont en ruine, ses galoches aussi, il a la barbe sauvage, les yeux creusés, il se rend dans le centre de la ville, remonte l’avenue Egnatia, il va retourner là d’où il est parti, au café de Stavros lieu de son arrestation, il va boire un café sans sucre, tranquille, en regardant passer les quelques voitures cahotantes de l’après-guerre, il oblique à gauche, dans la rue Sainte-Sophie, jusqu’à la frontière de la ville haute, il est près de six heures du soir, il a quelques drachmes en poche, que lui ont données des coreligionnaires d’Athènes, ils lui ont aussi proposé de prévenir quelqu’un de son arrivée par téléphone, il a refusé, il n’est plus qu’à cent mètres de chez Stavros, Léon Saltiel hésite, il pourrait redescendre et passer voir l’immeuble où habitait sa mère, la boutique de son beau-frère, même s’il sait qu’il n’y a plus rien, que tous sont morts, il le sait mieux que quiconque car il a vu les piles de cadavres, les exécutions sommaires, il a senti l’odeur de la chair brûlée, quand le vent glacial faisait frémir le Danube, il pourrait aller à la synagogue, la communauté a sûrement prévu quelque chose pour ceux qui reviennent, il ne doit pas être le seul à rentrer, il pourrait aller aussi aux locaux du parti, il ne sait pas s’il en a très envie, parler, raconter, expliquer, il y avait quelques Grecs avec lui à Mauthausen, une dizaine, aucun juif, tous sont morts, l’un d’eux s’est pendu avec la cordelette qui retenait son pantalon, Adonaï, Adonaï , Léon n’a jamais été religieux, le dernier de ses compagnons est mort d’une pneumonie après la libération, d’autres étaient arrivés après l’évacuation d’Auschwitz, quelques-uns même de Salonique, mais ils étaient déjà repartis quand Léon est sorti de l’infirmerie, les Américains ignoraient comment le rapatrier en Grèce, il a marché le long du Danube jusqu’à Vienne, les soldats le regardaient comme s’il était un mort-vivant et maintenant au coin de la rue à une centaine de mètres du café il hésite, il a honte, Stavros est un bon camarade, est-ce qu’il a été lui aussi raflé par les Allemands, Léon Saltiel s’avance jusqu’à la terrasse du café, il jette un coup d’œil à l’intérieur, attend un instant, entre, marche jusqu’au comptoir, Stavros est là, il n’a pas changé, il se plante devant lui, sans rien dire, Stavros lui jette un coup d’œil distrait sans le reconnaître, gêné Léon s’assoit à une table, il attend, il ne sait pas quoi dire, il dit Stavros un café sans sucre s’il te plaît, affairé derrière le comptoir l’homme répète la phrase en direction de la cuisine, un sans sucre, Léon est désemparé il hésite à crier Stavros c’est moi il reste silencieux une femme sort de la cuisine un petit plateau d’aluminium à la main c’est Agathe, Léon baisse la tête, elle pose brutalement le café et le verre d’eau fraîche sur la table, Léon fixe la mousse brune dans la petite tasse, il a vu l’alliance à sa main droite, il repense soudain à Aris Andréanou qui s’est pendu dans les douches avec sa ceinture, à son cou démesuré et tordu, ses yeux vers le haut, sa bouche ouverte, il attend patiemment que le marc se dépose, il sait maintenant que ni Agathe ni Stavros ne vont le reconnaître, parce que c’est un fantôme, parce que pour eux il est mort, il comprend soudain pourquoi et comment il a été arrêté, Léon Saltiel boit son café amer, puis un peu d’eau, il jette une pièce qui tintinnabule dans le plateau en métal, et s’en va — je fais de même, à mi-chemin des Mémoires de Saltiel je paie mes consommations et je sors, j’ai lu pendant deux bonnes heures en anglais, ce qui ne m’était pas arrivé depuis le digne Institut de sciences politiques de Paris, l’après-midi est bien avancé, je monte dans la vieille ville en suant, besoin d’air, besoin de voir la mer de haut, demain je vais partir je ne sais pas trop pourquoi mais j’ai envie soudain de prendre ma bagnole et d’aller vers le nord, de rentrer à Paris par la route, de passer en Bulgarie et en Serbie, après tout j’ai un passeport français, nous sommes en août, il y a des touristes, je vais franchir les Portes de Fer et suivre le Danube jusqu’à Budapest, voir l’autre côté, à quoi ressemble le fleuve en Voïvodine, sur l’autre rive, en 1997 la guerre était terminée depuis deux ans, la région reprenait son souffle, quelle drôle d’idée quand j’y pense, aller me jeter dans la gueule du loup tchetnik à moustaches, sans permission, je n’étais pas censé me rendre dans ce genre de pays, en théorie je devais demander une autorisation spéciale pour tous les déplacements à l’étranger, ce qui est le comble pour un espion, mais bon, je ne voyais pas trop ce qui pouvait m’arriver, à part tomber en panne, je n’avais jamais vu ni Belgrade la blanche, ni Novi Sad l’autrichienne, peut-être les âmes serbes enterrées dans le cimetière militaire de Salonique m’avaient-elles mis cette idée en tête, elles cherchaient à se venger de mes aïeux austro-hongrois qui les envoyèrent dans la tombe, elles voulaient m’attirer dans un piège pour me noyer dans le Danube, en octobre 1915 Guillaume II le Kaiser seconde les Autrichiens dans la bataille, le 9 octobre Belgrade est prise, les Serbes reculent sur tous les fronts, d’autant plus que Ferdinand de Bulgarie, auquel on a promis la Macédoine et le Kosovo, vient de poignarder dans le dos la Serbie orgueilleuse, la retraite s’impose, l’armée est détruite et ses restes éparpillés seront ajoutés au Front allié de Salonique, où ils combattront jusqu’en 1917, au total près de trois cent mille soldats serbes trouveront la mort pendant la Première Guerre mondiale, bravement, dit-on, pendant que les Autrichiens mettront à feu et à sang leur pays occupé — le rapport de Rodolph Archibald Reiss en 1915, utilisé pendant des lustres par la propagande, me revenait en mémoire, ces bonshommes éventrés, les civils énucléés, les vagins ouverts à la baïonnette pour laisser suinter la semence de dizaines de troupiers, les nez coupés, les oreilles arrachées, le tout décrit avec la froideur du spécialiste de la police scientifique : qu’il soit utilisé par l’un ou l’autre camp ne retire pas sa véracité au témoignage, attestée par la force de la vengeance, de la haine de celui qui y croit, haine qu’il va purger, des dizaines d’années plus tard, contre ses ennemis, par peur, peur de la tradition, peur de la légende qui le pousse lui aussi à aller vers l’autre le couteau en avant, comme les récits d’atrocités serbes nous poussaient, dans la peur, à découper leurs cadavres en morceaux, effrayés sans doute que de tels guerriers n’aient le pouvoir de ressusciter, les enchaînements de massacres serbo-croates donnaient toujours raison au récit antérieur, sans que personne ait tort, puisque chacun, à l’instar des Autrichiens en Serbie, pouvait citer un cas d’atrocité commise par l’autre camp, l’autre en soi, il fallait gommer son humanité en lui arrachant le visage, l’empêcher de procréer en lui coupant les couilles, le contaminer en violant ses femmes, annihiler sa descendance en tranchant les seins et les poils pubiens, revenir à zéro, annuler la peur et la douleur, l’histoire est un conte de bêtes féroces, un livre avec des loups à chaque page, Tchedo va t’égorger mon enfant, et il le fera sûrement, aussi sûrement que toi-même, croit-il, tu as déjà brûlé ses rejetons braillards dans la fosse ardente, chez nous le collectif procède du récit de la douleur individuelle, de l’emplacement des morts, des cadavres, ce n’est pas la Croatie qui saigne ce sont les Croates, notre pays est là où sont ses tombes, nos assassins, les assassins de l’autre côté du miroir attendent leur heure, et ils viendront, ils viendront parce qu’ils sont déjà venus, parce que nous sommes déjà allés leur tailler les oreilles en pointe, mettre nos pieux dans le ventre de leurs femmes et leur arracher les yeux, une grande vague d’aveugles hurlants va crier vengeance, va venir défendre ses tombeaux et les ossements de ses morts aussi sûrement que la marée, descendue, remonte au rythme des mouvements de la lune, j’ai envie de prendre ma bagnole et de traverser la terre de mes ennemis, envie de m’envoyer une petite poire à Zemun en regardant la Save grossir le Danube, de voir si les filles sont belles, d’écouter du turbo-folk chanté par la plantureuse épouse d’Arkan le Tigre, de m’acheter un tee-shirt avec la tête de Miloševic ou de Mladic et de rigoler un peu, envie de rire en pensant que quelques années auparavant peut-être le serveur m’aurait abattu sans ciller aux alentours d’Osijek et que c’est fini maintenant, c’est le tour des Kosovars, puis les Albanais se vengeront à leur tour et mangeront des orthodoxes au petit-déjeuner, nous sommes tous attachés les uns aux autres par les liens indissolubles du sang héroïque, par les intrigues de nos dieux jaloux, c’est fini tout ça, après quelques années de purgatoire dans un bureau au milieu des dossiers je suis dans le dernier train avant la fin du monde, avant la grande lumière et le renouveau, quand il y aura des zèbres dans les collines toscanes, des zèbres des gazelles et des lions qui boufferont de temps en temps un touriste égaré, quand on boira un excellent vin norvégien, quand Yvan Deroy, à soixante-dix ans, regardera jouer les singes sur les pentes de l’Argentario planté d’eucalyptus et d’arbres à pain, les Américains sont impatients d’arriver à Rome, moi aussi, je suis dans le train depuis trop longtemps, une des Américaines ressemble vaguement à la femme de la Pomponette hier soir, elle doit penser que je suis un pauvre type, je me sens tout poisseux comme si je sortais maintenant de chez elle, de sa loge obscure rue Marcadet, les hommes sont veules, ils veulent se battre chasser baiser boire chanter de temps en temps et jouer au football, ils sont lâches devant leurs passions, j’aimerais que tout finisse comme dans Les Temps modernes , quand Charlot prend par le bras son amoureuse et s’en va sur la route, je n’ai pas su prendre Stéphanie par le bras, quand je suis remonté chez moi deux heures plus tard passablement soûl et trempé après l’incident du pistolet elle n’était plus là, le flingue était toujours par terre au même endroit Stéphanie était partie j’ai pris un crayon et du papier et je lui ai écrit une lettre d’excuses, en lui expliquant que je savais bien sûr que l’arme ne pouvait pas fonctionner, que c’était une très mauvaise blague, et puis je finissais en pleurant sur mon sort d’ancien combattant pour attirer sa pitié, comme quoi la guerre était encore très présente pour moi et des conneries du même acabit, une lettre bien sentimentale bien lâche bien baveuse pour qu’elle me pardonne, l’amour vous fait faire des saloperies, je pensais, j’étais ivre mais pas aveugle, j’ai mis la missive dans une enveloppe que je déposai dans sa boîte aux lettres en allant au boulot, elle fit son effet, ma bafouille, je m’arrangeai pour ne pas croiser Stéphanie boulevard Mortier avant qu’elle ne la lise, et le lendemain je remis une couche, des fleurs, livrées chez elle vers vingt heures, alors que j’étais sûr qu’elle était au logis, et je ne sais si ce fut l’effet apaisant des roses ou le baume de mes excuses, mais à vingt heures trente précises j’avais un coup de fil, c’était elle, elle me demandait si je voulais aller dîner, comme si de rien n’était, j’ai dit d’accord, on peut se retrouver à mi-chemin, vers la République par exemple, elle a choisi un restau chic sur le canal Saint-Martin, quand je l’ai vue au bord de l’eau je l’ai serrée dans mes bras très fort, en m’excusant au creux de son oreille, elle m’a dit ne me refais plus jamais ça, d’accord ? et promets-moi de jeter cette arme à la poubelle, j’ai dit bien sûr, bien sûr, je n’en pensais pas un mot, je l’ai gardé encore longtemps, le petit Zastava, finalement je l’ai offert il y a quelques mois à Lebihan à l’occasion de son départ à la retraite, avec un percuteur tout neuf acheté sur Internet, ça lui a fait très plaisir — ni Stéphanie ni moi ne voyions que cet incident avait ouvert une brèche, une place pour la violence, je ne comprenais pas que la marée montait, qu’elle allait nous rattraper, que plus je remplissais la valise de noms et d’images, plus je cherchais à éviter les souvenirs de Croatie, de Bosnie en me plongeant dans la Zone plus la fêlure grandissait, et Stéphanie le grand stratège qui passait ses journées avec des généraux et des directeurs de cabinet était aveugle, ou peut-être pas, comme Marianne elle se laissait séduire par le côté obscur, le goût du danger, les guerriers brillent d’une lumière noire tel Arès lui-même, Andi le sauvage était attirant aussi, une belle brute malgré sa laideur, un de ces diables angéliques qui plaisaient tant à Jean Genet l’inverti amoureux des combattants palestiniens, Andi aurait été capable de tout pour posséder une fille comme Intissar la Palestinienne, j’en suis sûr, je me demande si Rafaël Kahla l’écrivain a été combattant lui-même, s’il a côtoyé ces Palestiniens, nous racontons tous la même histoire, au fond, un récit de violence et de désir comme Léon Saltiel le juif grec dans ses Mémoires, Léon trahi qui erre dans Salonique déserte, sa famille, ses amis ont disparu dans les camps, ses camarades se cachent au creux des montagnes de Macédoine et d’Epire, avec des groupes armés qui bientôt reprendront le combat contre la monarchie fasciste, Agathe a épousé Stavros, ce sont eux qui l’ont dénoncé aux Allemands, chaque jour à Mauthausen il pensait à Agathe avant de s’endormir, il se construisait un amour idyllique pour survivre, s’accrochait à son souvenir comme à un arbre pour ne pas s’envoler par la cheminée du crématoire, les yeux d’Agathe, les mains d’Agathe et aujourd’hui dans Thessalonique à moitié morte ce bois si solide n’est qu’une vieille étrave rongée par la mer, Saltiel tourne en rond plusieurs jours avant de se décider à retourner dans l’appartement familial, occupé par un cousin rescapé à qui il fait promettre de ne révéler sa présence à personne, Léon s’enferme huit jours, pendant huit jours il boit et fume dans le noir, poursuivi par la brève agonie de Manos Hadjivassilis l’électrocuté, par le cou tordu et la bouche ouverte d’Aris Andréanou, par l’alliance au doigt d’Agathe, il ne reste rien ni personne alors Saltiel décide d’en finir, épuisé par la douleur et l’alcool il tisse grossièrement une courte corde avec un drap, en noue une extrémité autour de sa nuque et cherche un point haut, une canalisation, une poutre, pour y attacher l’autre côté, sans succès, il ne trouve rien en hauteur qui puisse supporter son poids, alors désespéré, le drap toujours en écharpe, il monte sur l’appui d’une fenêtre pour se lancer dans le vide, il est tard, la nuit est belle, un vent frais caresse ses jambes nues, la mer est toute proche, le drap avec lequel il allait se pendre est une écharpe agréable, la brise marine tire Léon Saltiel de la brume, Zeus l’assembleur de nuées a aperçu sa détresse et le secourt, la noire peine s’estompe se mêle aux embruns à la poussière de lune et d’étoiles sur le golfe de Salonique, Léon s’accroche au montant de la fenêtre, il est debout à quatre étages du sol, il a failli se pendre et se jeter dans le vide, pour quoi, pour qui, il n’y a plus personne, il rentre dans l’appartement s’effondre sur son lit et s’endort d’un sommeil de tombe, la corde encore au cou — le lendemain Léon taille sa barbe mais ne la rase pas, il a rêvé, il a vu clairement son destin, il met une belle chemise, une jolie veste, tant pis si tous ces vêtements sont trop grands pour lui maintenant, tant pis, il est très occupé toute la journée, il s’affaire jusque tard le soir, il ne tremble pas lors des moments les plus difficiles, quand Agathe crie, l’implore, lorsque sa jupe découvre une de ses jambes, Léon Saltiel accomplit méthodiquement son devoir, comme un huissier de justice ou un comptable, avant de rejoindre les communistes dans la montagne, en 1948 il est arrêté et déporté dans l’île de Makronisos, pour des raisons politiques, qui n’ont à voir ni avec le supplice d’Agathe sous les yeux écarquillés de Stavros bâillonné sur sa chaise, ni avec la ceinture de cuir autour de la gorge si fine de la jeune femme, ni avec la balle qui traverse un peu plus tard la nuque de Stavros le traître pour écourter son agonie : Saltiel revient de sa seconde déportation en 1953, et, toujours d’après ses Mémoires, quitte la Grèce une fois de plus en 1967, au moment de la dictature des colonels, il ne rentrera qu’en 1978, pour mourir, à Salonique, et ce n’était pas mourir parmi les siens, puisque les siens, les juifs, les communistes, Agathe, Stavros, avaient disparu depuis longtemps — je me demande pourquoi Agathe a dénoncé Saltiel, par amour sans doute, amour dans des temps troubles, j’imagine qu’ils avaient réfléchi à un plan pour se débarrasser du gêneur, avec Stavros le mouchard, peut-être, peut-être n’avait-elle rien à voir dans tout cela, Saltiel ne dit pas s’il l’a torturée par pure vengeance ou pour savoir, pour savoir si elle l’avait réellement donné aux Allemands, un juif communiste, vrai régal pour la Gestapo, Saltiel n’explique pas non plus comment il a échappé au peloton d’exécution dans la cour de la prison de l’Heptapyrghion, tout en haut de la ville, a-t-il parlé, a-t-il échangé des informations contre son envoi en camp de concentration, mettant déjà un pied dans la Zone grise, la nôtre, celle des ombres et des manipulateurs, Salonique perle de l’Egée me rappelait Alexandrie, dans la ville basse trônaient les nobles sièges des banques, des assureurs, des transporteurs du début du siècle, comme dans la métropole égyptienne la Bourse du coton et la Banque d’Egypte, la place Aristote avait quelque chose de la place Saad-Zaghloul devant le Cecil, où tous les touristes britanniques allaient en pèlerinage, les nostalgiques se pressaient au bar de l’hôtel Cecil un livre de Lawrence Durrell à la main, en cherchant des yeux Justine ou Melissa et feignant de ne pas voir les restaurations et aménagements de la modernité, le business center , les plantes en plastique, le kitsch évident d’un hôtel de luxe international, alors qu’ils cherchaient le cuir rouge de l’avant-guerre, la fumée des havanes, les Grecs les Italiens et les juifs d’Alexandrie, que la guerre et Nasser ont petit à petit renvoyés vers l’exil, vers le Nord, aujourd’hui Alexandrie est une immense cité égyptienne plus peuplée que Paris, bigote et pauvre, mais qui s’enorgueillit d’une belle bibliothèque, construite par un gouvernement amoureux des projets pharaoniques, une des bibliothèques les plus vides de la planète, symbole du régime de Moubarak l’opiniâtre, une belle coquille grise en marbre d’Assouan — rien ne revient de ce qui a été détruit, rien ne renaît, ni les hommes disparus, ni les bibliothèques brûlées, ni les phares engloutis, ni les espèces éteintes, malgré les musées les commémorations les statues les livres les discours les bonnes volontés, des choses en allées il ne reste qu’un vague souvenir, une ombre qui plane sur Alexandrie douloureux fantôme parcouru de frissons, et c’est tant mieux sans doute, tant mieux, il faut savoir oublier, laisser les hommes les animaux les choses partir, avec Marianne nous avions rencontré un couple de Britanniques bien nés qui arpentaient la ville en calèche, ils ne souhaitaient pas prendre de taxi, ils étaient disposés à payer des centaines de maravédis pour trôner à l’arrière d’un attelage de chevaux faméliques conduits par un Egyptien enturbanné, elle en jodhpurs crème et veste cintrée, lui en saharienne avec un chapeau à large bord modèle ANZAC 1915, et la seule touche de couleur dans cette débauche de tons sable était leurs visages rôtis par le soleil d’Egypte, deux tomates mûres sous les couvre-chefs d’époque, lui lisait le guide d’Alexandrie rédigé par E.M. Forster en 1920 et elle Mort sur le Nil , ils avaient un peu plus de vingt ans et l’air très amoureux, bien évidemment ils étaient descendus au Cecil, nous avions découvert ces spécimens dans une pâtisserie historique près de la Grand-Place, et c’était comme trouver tout à coup deux ptéranodons au rond-point des Champs-Elysées ou deux dauphins du Yang-tseu dans la Seine, Marianne était enchantée de discuter avec eux, bien qu’elle fût un tantinet jalouse des bagages en cuir et des hôtels de luxe, leur anglais était très châtié, très élégant, tout en coups de pomme d’Adam saillante, ils étaient à leur aise enfoncés dans les fauteuils de la pâtisserie immense, sirotant un thé en sachet, ils étaient documentés cultivés connaissaient Cavafy par cœur et savaient le grec ancien, des phénomènes, moi je n’étais pas spécialement jaloux, la Britannique rougeaude était osseuse les seins plats rien à voir avec la chemise blanche de Marianne dont les boutons paraissaient sur le point de se faire la malle sous la pression, Marianne entière et spontanée était à mille milles de l’Anglaise affectée, les Egyptiens paraissaient ne rien remarquer d’anormal, ils étaient heureux des pourboires et autres bakchichs dont le jeune couple les arrosait, dans la plus grande tradition coloniale — lui s’appelait James et était écossais, fanatique de rugby et de statuaire grecque, ils nous proposèrent de nous emmener en excursion dans leur calèche, à Montazah, pour visiter le palais et les jardins, j’avais envie de dire on verra si le ridicule tue, mais je m’abstins, après tout c’était drôle et le lendemain matin nous étions au rendez-vous, Marianne s’était habillée “campagne”, un chemisier de vichy rouge et un petit foulard assorti, nous nous sommes tassés dans le coupé malgré les cris du postillon enturbanné, qui souhaitait que nous empruntions deux véhicules, James finit par le convaincre d’accepter la surcharge contre notre poids en livres-or, et nous voilà partis, au milieu des taxis des autobus bondés des gaz d’échappement dans les embouteillages les klaxons les cloches des tramways les pieds de la cavale frappaient dur le bitume au petit trot, nous étions secoués par des ressorts fatigués les tympans percés par le grincement continu d’essieux mal graissés et les cris du charretier qui fouettait son palefroi comme un enragé, c’était merveille que de voir le crottin s’échapper du cul de la bête et s’entasser sur la chaussée à chaque arrêt, on n’était pas partis pour gagner le sulky d’or, malgré la hargne du cocher contre son coursier, pour arriver à Montazah nous devions parcourir six ou sept milles, le cheval avait du mal à trotter, ce qui lui valait double ration de cravache, nos amis britanniques trônaient, droits comme des I dans les cahots, profitant du paysage de la plaine marine, fiers et contents, à tel point que je me demandais si nous voyions la même chose, la détresse de la carne suant sous la méchanceté de l’aurige la pauvreté de l’Egypte l’enfer de la circulation l’inconfort du char bringuebalant les souffles de gazole des bus les enfants mendiants noirs de crasse qui nous couraient après et que le conducteur chassait comme des mouches en les cinglant de son knout, peut-être nos hôtes avaient-ils des visions de Cléopâtre, de Durrell, de Forster, de Cavafy, aveuglés par le phare d’Alexandrie, Marianne n’était pas trop à l’aise non plus, les voitures nous dépassaient rageusement en klaxonnant, trois quarts d’heure plus tard nous étions à Montazah, fallait-il que les Britanniques aiment leur calèche, j’étais fourbu les fesses tannées presque autant que le canasson héroïque, le palais en question se trouvait au milieu de jardins magnifiques plantés de manguiers de poivriers de bougainvillées de lauriers roses, un château qu’on aurait dit construit en Lego rouges et blancs une bâtisse des plus insolites, style austro-ottomano-kitsch pour Farouk contraint à abdiquer par les Officiers libres, par le général Néguib et Nasser l’Alexandrin aux épais sourcils, finis les princes et les princesses des palais somptueux, place aux thèmes martiaux et aux discours vociférants de la révolution en marche dans les trémolos et les soupirs d’Oum Kalsoum la joufflue, comme il n’y avait pas grand-chose à voir à part les jardins nous sommes allés boire un jus de mangue à la terrasse d’un hôtel que le développement touristique avait eu le bon goût de poser au bord de l’eau comme un chancre noir de vingt étages, nos amis flegmatiques avaient encore une visite à proposer, plus originale celle-là, il s’agissait d’aller voir la maison natale de Rudolf Hess l’aviateur ami de Hitler et vice-Führer du Reich, Alexandrie avait produit de tout, des poètes des guerriers des espions des chanteurs des nazis de haut rang, pour James il s’agissait d’une visite quasi familiale, Hess fell in my uncle’s garden , disait-il, Hess est tombé dans le jardin de mon oncle, en novembre 1941 Rudolf Hess aux commandes d’un Messerschmitt modifié pour l’occasion vole jusqu’en Ecosse au nez et à la barbe des défenses côtières anglaises, et, à court d’essence, saute en parachute pour atterrir chez un noble écossais ébaubi par l’apparition inopinée du dauphin de Hitler dans ses hortensias, on ignore toujours pourquoi, sans doute pour essayer de négocier la paix avec la Grande-Bretagne avant l’invasion de l’URSS, sans ordres du Führer peut-être, Churchill le fit immédiatement emprisonner dans la Tour de Londres, puis condamné à perpétuité en 1946 à Nuremberg l’aviateur dérangé alla tenir compagnie à Speer le bâtisseur de temples teutoniques dans la prison de Spandau, fou amnésique hypocondriaque dépressif son agonie dura jusqu’en 1987, dans la tristesse et la solitude, ultime pensionnaire d’une geôle démolie après sa mort, les dernières années Rudolf était hanté par le souvenir de la baie d’Alexandrie, tout au long du jour il dessinait des portiques grecs et des vues du phare disparu, obsédé par la ville qu’il avait quittée quatre-vingts ans plus tôt, la lumière de la Méditerranée dernière flamme de ses yeux vides, incapable de se souvenir de son procès en Allemagne mais parlant de sa gouvernante italienne avec tendresse, de son jardin, de son collège, des jeunes filles en robe blanche, des réceptions place des Consuls, de ses leçons de natation aux bains de Chatby, de la splendide villa de son père dans le quartier de Santo Stefano, à deux pas de la mer, quatorze ans d’enfance à Alexandrie et plus de quarante ans de prison, de quoi réfléchir, de quoi se souvenir, pensait-il à Antoine et Cléopâtre quand il se donna la mort à l’âge vénérable de quatre-vingt-treize ans, par une chaude journée d’août Hess réussit à s’isoler dans un cabanon de jardin du bastion de Spandau avec un mètre cinquante de câble électrique dérobé qu’il enroule autour de son cou, il serre bien fort à l’aide de la crémone d’une fenêtre, plus ingénieux que Léon Saltiel, plus déterminé aussi, Hess s’asphyxie pour échapper à la vie trop longue, au destin interminable de reclus, Hess guerrier sans batailles, sans gloire à part un raid aérien et une exceptionnelle longévité, parti d’Alexandrie en 1910 l’homme sans intérêt le criminel de guerre sans guerre meurt dans l’ambulance où l’on s’acharne à le ranimer, dernier grand nazi vivant dernier représentant d’une espèce éteinte, James l’excentrique Ecossais avait de quoi être déçu, à l’emplacement de la villa de la famille Hess au bord de la mer se trouvait un immeuble gris semblable à des centaines d’autres devant la Corniche, autant dire devant l’autoroute, plus de jardin luxuriant, de demeure fastueuse, la trace du destin de Hess avait été effacée sans états d’âme par l’Egypte moderne, alors nous sommes remontés dans la calèche cahotant au milieu des taxis jaunes et des avertisseurs pour retourner au centre-ville, le cheval s’était mis à boiter et refusait obstinément de trotter, il restait au pas et déclenchait la furie du cocher qui hurlait, debout pour cravacher de toutes ses forces l’équidé têtu, avec rage, la lanière de cuir frappait dur et faisait s’envoler des mouches et des gouttelettes de sueur, le vieux bourrin secouait l’encolure, hennissait, on l’aurait dit bon pour l’équarrissage, son conducteur était en train de l’achever, la bête trébuchait de temps en temps sur le bitume, dans la calèche l’ambiance n’était pas à pavoiser, les Britanniques ne regardaient plus la mer briller mais le canasson subclaquant encaisser la furie du charretier enturbanné, Marianne serrait les dents et poussait un petit cri dès que le fouet s’abattait violemment sur l’animal, quatre jeunes Européens bien-pensants étaient responsables du supplice d’une carne couverte d’écume, aux naseaux dilatés, cependant personne n’est descendu, l’attelage a fini par nous ramener devant le Cecil, James a remis son chapeau droit sur sa tête et a payé le prix convenu au cocher qui a réclamé un supplément pour sa pauvre Rossinante, et l’Ecossais l’a envoyé littéralement se faire foutre, si j’ai bien compris, avec grand plaisir — pour un peu il aurait pris lui-même le fouet et administré une correction néocoloniale à l’Egyptien, les Britanniques sont sensibles en matière de cavales, il était pourtant responsable du calvaire du petit cheval, nous nous sommes séparés bons amis en promettant de nous revoir, à chaque fois que je suis retourné à Alexandrie j’ai repensé au couple anachronique à Rudolf Hess et à la calèche, en déjeunant avec mes généraux égyptiens amateurs de whisky grands chasseurs de terroristes, ils me montraient fièrement le chantier de la nouvelle bibliothèque, espérons qu’elle connaisse un destin différent de son ancêtre incendiée, un répit dans le temps avant de finir noyée par la montée des eaux de la Méditerranée, après la fonte des glaces du pôle, sa belle jetée de granit couleur cendre transformée en plage lisse et agréable pour les phoques rieurs, qui y joueront à se laisser glisser sur le ventre en barrissant de plaisir
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Zone»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Zone» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Zone» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.