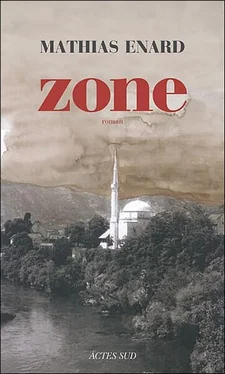Mathias Énard - Zone
Здесь есть возможность читать онлайн «Mathias Énard - Zone» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Город: Paris, Год выпуска: 2008, ISBN: 2008, Издательство: Éditions Actes Sud, Жанр: Современная проза, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Zone
- Автор:
- Издательство:Éditions Actes Sud
- Жанр:
- Год:2008
- Город:Paris
- ISBN:978-2-7427-7705-1
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Zone: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Zone»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Par une nuit décisive, un voyageur lourd de secrets prend le train de Milan pour Rome, muni d’un précieux viatique qu’il doit vendre le lendemain à un représentant du Vatican pour ensuite — si tout va bien — changer de vie. Quinze années d’activité comme agent de renseignements dans sa Zone (d’abord l’Algérie puis, progressivement, tout le Proche-Orient) ont livré à Francis Servain Mirkovic les noms et la mémoire de tous les acteurs de l’ombre (agitateurs et terroristes, marchands d’armes et trafiquants, commanditaires ou intermédiaires, cerveaux et exécutants, criminels de guerre en fuite…). Mais lui-même a accompli sa part de carnage lorsque la guerre en Croatie et en Bosnie l’a jeté dans le cycle enivrant de la violence.
Trajet, réminiscences, aiguillages, aller-retour dans les arcanes de la colère des dieux. Zeus, Athéna aux yeux pers et Arès le furieux guident les souvenirs du passager de la nuit. Le train démarre et, avec lui, commence une immense phrase itérative, circulatoire et archéologique, qui explore l’espace-temps pour exhumer les tesselles de toutes les guerres méditerranéennes. Car peu à peu prend forme une fresque homérique où se mêlent bourreaux et victimes, héros et anonymes, peuples déportés ou génocidés, mercenaires et témoins, peintres et littérateurs, évangélistes et martyrs… Et aussi les Parques de sa vie intérieure : Intissar l’imaginaire, la paisible Marianne, la trop perspicace Stéphanie, la silencieuse Sashka…
S’il fallait d’une image représenter la violence de tout un siècle, sans doute faudrait-il choisir un convoi, un transport d’armes, de troupes, d’hommes acheminés vers une œuvre de mort. Cinquante ans après
de Michel Butor, le nouveau roman de Mathias Enard compose un palimpseste ferroviaire en vingt-quatre “chants” conduits d’un seul souffle et magistralement orchestrés, comme une
de notre temps.
Né en 1972, Mathias Enard a étudié le persan et l’arabe et fait de longs séjours au Moyen-Orient. Il vit à Barcelone. Il a publié deux romans chez Actes Sud :
(2003) — Prix des cinq continents de la francophonie, 2004 — qui paraît en Babel, et
(2005). Ainsi que, chez Verticales,
(2007).
Zone — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Zone», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
IX
à part assassiner mon voisin l’étrangler peut-être comme Lowry sa femme il n’y a rien à faire rester dans le silence fermer les yeux les ouvrir chercher le sommeil 8 décembre aujourd’hui en ce moment à Rome place d’Espagne le Saint-Père moribond fait son discours il n’en finit pas de passer l’arme à gauche ce pape peut-être est-il éternel autant qu’infaillible ce serait le comble, tout à coup un homme se refuse à mourir, il ne trépasse pas comme ses semblables, il survit, envers et contre tout il s’accroche, grabataire, tremblotant, sénile mais il s’accroche, il atteint cent ans, puis cent dix, puis cent vingt, tout le monde prend des paris sur son décès mais non, il parvient à cent trente ans et un beau jour on comprend qu’il ne mourra plus, qu’il restera suspendu entre la vie et la mort coincé là avec son parkinson, son alzheimer, momifié mais vivant, vivant, pour les siècles des siècles et cette découverte attriste tellement ses successeurs potentiels qu’on décide bien sûr de l’empoisonner, le bouillon d’onze heures pour le vieillard encombrant, pas de chance comme les premiers martyrs chrétiens il survit à l’empoisonnement, il perd la vue mais son cœur bat toujours, il profère de temps en temps des paroles à l’oreille de ses visiteurs, en latin, des milliers de pèlerins font la queue pour l’apercevoir, on vend ses cheveux un par un comme autant de morceaux d’éternité, un des derniers crins éternels de l’homme béni qui n’en finit pas de claboter, comme la fin du monde n’en finit pas d’arriver, un poil imputrescible ainsi le cadavre de ces saints qui ne se décomposent jamais et puis de guerre lasse on l’oublie dans un coin de palais, avec des serviteurs qu’il enterre tous, la poussière le recouvre petit à petit il disparaît des mémoires, du présent c’est un tableau vivant un buste une statue à laquelle on n’accorde plus aucune importance — je ne peux pourtant pas me plaindre du Saint-Siège c’est à eux que je dois ma nouvelle vie, l’argent en échange de la mallette, à ce nonce apostolique de Damas qui m’a présenté le secrétaire du dicastère concerné par mon affaire, en grand secret bien entendu, Damas ville de la poussière presque autant que Le Caire, ville de la poussière et du chuchotement, de la peur et des informateurs de police, où on vous enterre vivant dans une prison grise au milieu du désert, les oubliettes syriennes sont profondes, on en remonte peu souvent, combien de Syriens ou de Libanais manquent encore à l’appel, pris à un barrage ou arrêtés chez eux personne ne sait ce qu’ils sont devenus, s’ils croupissent toujours au fond d’un cachot ou ont été abattus d’une balle dans la tête à Mezzé ou à Palmyre, pendus à deux pas des ruines de la ville de la reine Zénobie du temple de Bêl et des tombeaux fabuleux, sous les palmiers on croise parfois un camion découvert empli de types au crâne rasé, tout le monde détourne alors les yeux pour ne pas les voir, ce sont des détenus que l’on transfère de Damas ou de Homs, on va les jeter dans le cul-de-basse-fosse de Tadmor pour l’éternité : les regarder porte malheur, comme les condamnés à mort, la prison est à quelques kilomètres de la palmeraie à l’orée de l’interminable steppe de pierre, je suis allé la voir par curiosité, à distance respectable, une ancienne caserne française, dit-on, entourée d’un mur d’enceinte gris et de barbelés, pas de lumière du jour pas de promenade pas d’air ni de ciel, les prisonniers passent le plus clair de leur temps les yeux bandés, je pensais à Rabia, une de nos sources au ministère de la Défense syrien, un fils de bonne famille qui aimait trop l’argent les voitures de sport la drogue et le danger, il avait disparu un beau matin et son contact nous avait appris sur un ton badin il est en Suisse , euphémisme utilisé en Syrie pour désigner ce pénitencier au milieu des roches et à deux pas d’un des sites antiques les plus célèbres du Moyen-Orient, si beau quand l’aube de safran irise les colonnes blanches et le château arabe leur berger sur sa colline, Palmyre-Tadmor cité caravanière aujourd’hui peuplée de caravanes de touristes et de prisonniers, ville des agneaux égorgés en pleine rue sous les yeux effarés des Européens qui passent, capitale de la steppe syrienne où ce Rabia que je n’ai jamais vu doit encore pourrir s’il survit, en Suisse, c’est-à-dire à Tadmor à Sadnaya à Homs ou autrefois à Mezzé dans une de ces prisons militaires hauts lieux de la torture et des exécutions sommaires où ont été pendus tout au long des années 1980 et 1990 les Frères musulmans syriens, par dizaines, par centaines, leurs cadavres enfouis dans des fosses communes au creux des vallons désertiques, avec ceux des morts sous la torture ou de maladie, tuberculose, abcès divers, septicémies, mal nourris, entassés à plusieurs centaines par baraquement, interdits de visite, les activistes musulmans étaient raflés à Hama, à Alep, à Lattaquié et envoyés, un bandeau sur les yeux, à Palmyre en arabe Tadmor la bien nommée, où ils croupissaient dix, quinze ans jusqu’à ce qu’on les libère, paranoïaques, délirants, dénutris ou invalides, j’en ai rencontré un en Jordanie, une source de plus dans ma Zone, quatorze ans de prison syrienne, entre 1982 et 1996, de seize à trente ans, sa jeunesse torturée, brisée, un œil en moins, une jambe boiteuse, il me racontait que son principal loisir en prison était de compter les morts , il maintenait le comput des pendus dans la cour, de ceux qui disparaissaient dans les hurlements au milieu de la nuit, au début j’essayais de me rappeler leurs noms, racontait-il, mais c’était impossible, je gardais juste le compte, je m’y accrochais comme à ma vie, pour savoir si je mourais quel numéro j’aurais, jour après jour, en quatorze ans j’ai compté 827 morts dont plus de la moitié par pendaison, le plus souvent à la chaîne, la nuit — j’ai été arrêté devant chez moi à Hama au moment des événements de 1982, je ne savais rien de l’islam et du Coran, j’étais un ignorant, ils m’ont arrêté parce qu’un de nos voisins était avec les Frères, je venais d’avoir seize ans, ils m’ont mis un bandeau sur les yeux et m’ont battu, je ne sais pas où je me trouvais, dans une caserne je suppose, j’ai passé deux jours sans boire une goutte d’eau et j’ai été transféré à Palmyre dans un camion, personne ne savait où nous allions, nous sommes arrivés de nuit, on nous a fait descendre à coups de trique — les soldats nous ont torturés jusqu’à l’aube, c’était la coutume avec les nouveaux venus, il fallait nous briser, nous faire comprendre où nous nous trouvions, on m’a cassé la jambe avec une barre de fer, je me suis évanoui, je me suis réveillé dans un baraquement comme un grand dortoir, ma jambe était violette toute gonflée j’avais soif, je ne savais pas ce qui était le plus douloureux, si c’était la soif ou la fracture, je ne pouvais pas parler, un des prisonniers m’a donné de l’eau et m’a fait comme une attelle avec un vieux cageot c’est le seul soin médical que j’ai reçu, l’os s’est mal remis en place et depuis je boite je n’arrive plus à courir, fini le foot mais en prison on ne pensait pas au football, la cour c’était surtout pour pendre des gens, grâce à Dieu j’en suis sorti, j’ai appris le Coran par cœur, les livres étaient interdits, les stylos aussi, mais le Coran circulait de bouche à oreille, des chuchotements, j’ai appris sourate après sourate en commençant par les plus courtes, je les ai apprises de la bouche des détenus plus âgés, dans le noir, un flot continu presque inaudible serrés les uns contre les autres nous priions tous ensemble, pour que les gardiens ne remarquent rien nous nous prosternions devant Dieu en pliant seulement le petit doigt, comme il est permis aux malades, Dieu a voulu que je survive, au moment où j’ai compté le 492 emort j’ai un œil qui s’est infecté est devenu une grosse boule purulente et douloureuse et ne s’est jamais rouvert, j’étais de bonne constitution j’étais jeune le temps a passé à Palmyre on ne vous appelait que pour une chose, pour vous pendre, les gardiens nous parlaient très peu, parfois après minuit ils appelaient une liste de noms c’était les pendus du jour, nous les saluions tout le monde s’était habitué aux exécutions, la première chose que j’ai faite quand je suis arrivé en Jordanie c’est aller à la mosquée pour prier debout, enfin, pouvoir me mettre à genoux même si ma jambe me faisait mal, pour remercier Dieu de m’avoir tiré de cet enfer, il finissait son récit et j’ai pensé qu’il aurait dû remercier Dieu aussi de l’y avoir mis, dans cet enfer, mais pour lui les Alaouites baasistes au pouvoir en Syrie étaient des mécréants, des envoyés du diable, Hasan (appelons-le Hasan) me renseignait volontiers sur l’opposition syrienne et sur leurs activités clandestines qu’il suivait encore de près mais était beaucoup plus réticent à parler des Jordaniens ou des Palestiniens, il a fini assassiné par le Mossad en 2002, au moment de la Grande Purge, quand la CIA envoyait dans le monde entier des listes interminables d’“individus suspects” dont les plus chanceux se retrouvaient à Guantánamo de nouveau les yeux bandés torturés une fois de plus car beaucoup étaient déjà passés dans les mains des Jordaniens des Syriens des Egyptiens des Algériens ou des Pakistanais pour des raisons différentes mais avec les mêmes résultats, ils finissaient dans l’île du rhum des cigares des mulâtresses sculptées par le soleil et la dictature, ils suaient à Cuba dans leurs combinaisons orange de haute sécurité bien plus visibles et réjouissantes pour l’œil des gardiens que les pyjamas rayés ou unis de Palmyre la magnifique : Hasan n’eut pas cette chance, si l’on peut dire, il mourut atteint par un petit missile radioguidé israélien qui détruisit entièrement le véhicule dans lequel il voyageait en compagnie de sa toute jeune épouse et de leur fille de deux ans, il est mort sur mes indications, c’est moi qui l’ai vendu à Nathan Strasberg en échange d’informations sur des contrats civils américains en Irak, comme preuve de bonne volonté j’ai sacrifié une source de toute façon un peu périmée, Hasan le boiteux avait pris part à l’organisation de deux attentats à Jérusalem et d’un autre contre des Israéliens en Jordanie, il devenait de plus en plus discret, mentait trop souvent, adieu Hasan rescapé de Tadmor, adieu Rabia le fils du dignitaire tombé en disgrâce après la mort d’Hafez al-Assad le vieux lion de Damas qui avait réussi, contre toute attente, à mourir dans son lit, ou plutôt au téléphone, le jour de sa mort on ne trouvait plus une bouteille de champagne en Syrie, à Beyrouth ou à Jérusalem, le Vieux de la Montagne avait joué pendant trente ans au poker moyen-oriental et il était imbattable, il avait joué avec Kissinger, avec Thatcher, avec Mitterrand, avec Arafat, avec le roi Hussein et bien d’autres, toujours gagnant, toujours, même avec une paire de sept, parce qu’il était rusé peut-être mais surtout sans scrupules inutiles, prêt à sacrifier ses pièces à renverser ses alliances à assassiner la moitié de ses compatriotes s’il le fallait, Hasan le boiteux lui devait quatorze ans de prison, chanceux comparé aux vingt mille morts peut-être de la répression des années 1980, chanceux Rabia, dont le père dignitaire ministre alaouite lui permit de s’enrichir sur le dos de ses concitoyens et de vivre quelques années d’abondance avant de finir entre quatre murs pour quelque temps : quand j’allais à Damas, à Alep ou à Lattaquié j’avais toujours l’impression de mettre la tête dans la gueule du loup, dans ce pays d’indics où une moitié de la population surveillait l’autre il fallait redoubler de prudence, le seul avantage étant que l’autre moitié était du même coup plutôt encline à travailler pour l’étranger, moyennant des devises sonnantes et trébuchantes, j’allais à Damas “en touriste” et pour ne pas griller ma couverture trop vite je devais me promener, à Palmyre, à Apamée, visiter le musée d’Alep, voir l’église de saint Siméon le Stylite le saint enchaîné en haut de sa colonne dont la base subsiste encore, explorer la vieille ville de Damas, m’émerveiller dans le cortile de la mosquée des Omeyades où se trouve, dit-on, une des têtes tranchées du Baptiste, et surtout manger, manger, boire et m’ennuyer en regardant tomber le grésil de l’hiver sur la ville de la tristesse et de la poussière, bien sûr l’ambassade de France était pour moi zone interdite, c’est dommage, j’aurais bien aimé voir la belle maison arabe où s’installa Fayçal en 1918, Fayçal le chérif de La Mecque que Lawrence d’Arabie avait converti en roi des Arabes, avant que les Français et le général Gouraud ne le délogent de sa nouvelle capitale et que les Britanniques ne le récupèrent pour le poser sur le trône d’Irak en donnant une légitimité hachémite à ce pays nouvellement fondé par la réunion de trois provinces ottomanes qui n’avaient aucune intention de cohabiter pacifiquement au sein d’un Etat fantoche, même pour faire plaisir à Churchill ou à Gertrude Bell l’espionne archéologue, dans ce Proche- ou Moyen-Orient que Français et Anglais s’étaient partagé sans scrupules dès 1916, que pouvait-il bien rester de Fayçal dans la résidence du puissant ambassadeur de France en Syrie, le premier fauteuil en velours dans lequel le roi bédouin s’était assis, peut-être, les ressorts fatigués du lit où il avait dormi, son fantôme venait-il troubler le sommeil d’une charmante ambassadrice, lui provoquait-il des rêves de chevaux au galop dans le désert torride, des cauchemars de soif ou des songes érotiques de nuits arabes endiablées — les nuits de Damas ou d’Alep n’étaient pas très propices à la luxure, aux délices de Capoue la très prude dictature syrienne préférait une austérité martiale, Aphrodite ne passait que rarement les montagnes du Mont-Liban, sur les bords du Barada rivière presque sans eau il y avait quelques cabarets où des Saoudiens ivres arrosaient de billets de banque des danseuses du ventre grasses et flétries qu’accompagnait une musique acide, un bonhomme très laid armé d’un seau en plastique rouge ramassait le tapis de biffetons pendant que ces dames continuaient à remuer leurs seins dans les moustaches des émirs qui commandaient sur-le-champ une autre bouteille de Johnny Walker pour faire passer leur trique, à Alep dans une rue torve entre deux magasins de pièces détachées pour automobiles se trouvait un établissement du même genre mais peuplé d’Ukrainiennes et de Bulgares en maillot de bain qui levaient les jambes façon french cancan pour quelques soldats moustachus buveurs de bière, après chaque numéro elles allaient s’asseoir sur les genoux des clients, je me souviens l’une d’elles avait vécu à Skopje et parlait à peu près serbe, elle m’a proposé de me rejoindre ensuite à mon hôtel moyennant la modique somme de deux cents dollars, à ce tarif-là les Syriens ne devaient pas s’envoyer en l’air souvent, elle m’a raconté qu’elle était arrivée à Alep après avoir répondu à une offre d’emploi pour danseuses, elle adorait danser, elle se disait que danser dans une troupe syrienne serait un début je ne savais pas si je devais la croire ou non, et puis surtout le salaire était intéressant, ce n’était pas de la prostitution, disait-elle, c’était de la danse, elle avait l’air d’essayer de se convaincre elle-même, elle avait tout juste vingt ans, un visage souriant elle était blonde comme les blés, toutes étaient blondes comme les blés, elle est remontée sur scène pour le numéro suivant, elle me regardait en se trémoussant, les cinq filles prenaient des poses lascives sur My Way , elles mimaient des baisers la bouche en cul-de-poule déprimé je suis parti retrouver mon hôtel et la solitude de ma chambre très heureux de ne pas avoir besoin de succomber aux charmes des danseuses en maillot de bain, je me souviens le lendemain j’avais un “rendez-vous” avec un homme dont j’ignorais tout à une terrasse de café devant l’incroyable citadelle d’Alep, je devais être assis à une terrasse avec un pull rouge et une écharpe en laine posée sur le dossier de la chaise devant moi — parfois la réalité devient un film d’espionnage des années 1960, sans doute cet honorable correspondant avait-il lu trop de romans d’espions de la guerre froide, dans la Zone les choses étaient bien différentes, j’étais un peu inquiet tout de même, je n’avais pas trop envie que deux agents de la sécurité syrienne s’assoient à ma table et me disent “alors, pull rouge et écharpe en laine, hein ?” et m’expulsent de Syrie à coups de pied dans le fondement après m’avoir passé à tabac, ou pire, le plus probable serait qu’ils me gardent au secret quelque part en attendant de pouvoir m’échanger contre quelqu’un ou quelque chose, et même s’il y a effectivement une part de risque dans mon métier elle paraît toujours très lointaine, en service jamais je n’ai porté une arme ni rien de ce genre (j’avais bien chez moi un petit 7,65 Zastava mais c’était un souvenir de guerre inutilisable) pourtant ce matin-là en allant au rendez-vous à la citadelle je n’étais pas tout à fait rassuré, parce qu’on était en Syrie, parce que la Syrie est le pays des mouchards, parce qu’en Syrie il n’y a que peu de touristes et qu’il n’est pas facile de se fondre dans la foule comme au Caire ou à Tunis, j’ai remonté l’interminable souk d’Alep à pied, j’ai acheté trois babioles pour Stéphanie la brune (au diable les voyages secrets), du savon de laurier, un foulard en soie et un petit narghilé en cuivre sans doute impossible à fumer mais au moins j’avais l’air d’un parfait touriste quand j’ai débouché du marché couvert sur la place de la citadelle, je me suis installé à une terrasse, j’ai demandé coffee, coffee, café, s’il vous plaît , j’ai posé mon écharpe sur la chaise devant moi, et j’ai attendu en contemplant le glacis de la forteresse imprenable, chef-d’œuvre de l’architecture militaire arabe disait le Lonely Planet ouvert sur la table pour me donner une contenance d’aventurier solitaire, j’avais fini mon café quand un homme d’une soixantaine d’années, assez grand, les cheveux blancs, s’est approché de moi et m’a demandé si je parlais français, j’ai répondu oui, bien sûr, et il m’a dit c’est un plaisir de vous rencontrer , il a ajouté venez, nous allons visiter la citadelle , il a payé mon café avant même que je puisse réagir et m’a pris par le bras comme si j’étais une demoiselle, il ne l’a pas lâché pendant toute la visite, et j’avoue que cette tendresse inhabituelle donnait à notre couple étrange un air des plus naturels qui soient, il a insisté pour payer les tickets d’entrée, il me signalait les mâchicoulis, les couloirs qui se tordaient pour briser les assauts des envahisseurs, les grilles au plafond pour bombarder les assaillants, et ce n’est que lorsque nous sommes sortis du donjon central sur l’immense tertre au milieu des remparts qu’il a commencé à parler vraiment, je ne disais rien, je voulais d’abord écouter, ressentir, essayer de deviner si j’avais intérêt à faire affaire avec lui ou non, comme disait le chef Lebihan vous êtes doué pour les rapports humains , le contact avait parlé d’une source d’un intérêt exceptionnel , ce qui justifiait ma présence, j’avais déchanté quand j’avais appris qu’il était impossible de régler cette affaire par des boîtes aux lettres, une source si exceptionnelle ne prend pas de risques, normalement nous ne nous rencontrons jamais, c’est un réseau syrien qui fait parvenir les renseignements mais là la source sympathique par ailleurs me tenait le bras comme s’il s’agissait de mon père, au sommet venteux de la citadelle d’Alep la grise, d’où l’on voyait toute la ville, la grande mosquée en contrebas, les innombrables pigeons qui tournaient autour du minaret, les toits noirs du souk, les petites coupoles des caravansérails, les immeubles modernes de la banlieue et jusqu’à la campagne dont la terre paraissait rouge dans le soleil d’hiver, je m’appelle… euh… je m’appelle Harout , son hésitation était assez peu professionnelle, je commençais à sentir le coup fourré, l’erreur de mon contact, j’ai soupiré intérieurement, pfff, tout ça pour ça, j’ai répondu Harout, parfait, comme vous voudrez, sur mon passeport du moment je m’appelais Jérôme Gontrand, avec un d , j’ai dit juste “Jérôme”, j’ai patienté il faut savoir attendre être calme j’avais mon filet à papillons à la main j’attendais que Harout se détende un peu pour l’y prendre et l’ajouter à ma collection de lépidoptères, c’était lui qui allait me capturer je l’ignorais bien sûr, lui qui me précipiterait dans ce train cinq ans plus tard, tiens déjà une ville, sans doute Modène, plus qu’une quarantaine de kilomètres avant Bologne, le Pendolino ralentit, dans la nuit toutes les banlieues italiennes se ressemblent, de jour aussi très certainement, c’est bien Modène, je viens d’apercevoir le panneau qui annonce la gare, Modena, la petite ville tranquille, belle, la sœur de Reggio avec deux spécialités la charcuterie et les voitures de luxe, le cochon et les Maserati voilà bien un raccourci très italien tout comme mon voisin le lecteur de Pronto il ne cracherait sans doute ni sur l’un ni sur l’autre, avec son bonnet Ferrari, il devrait l’agiter à la fenêtre, nous venons de passer tout près des usines de la Scuderia, je me souviens du centre historique de Modène, magnifique, places, églises, Duomo, il y a tout juste un an le jeudi 11 décembre Mohammad el-Khatib se faisait exploser à cinq heures du matin à l’angle de la place Mazzini à quelques mètres de la synagogue, une des plus belles d’Italie, le Palestinien né au Koweït et titulaire d’un passeport jordanien a mis le feu à sa 205 Peugeot blanche l’a garée devant la synagogue, les policiers en faction ont tenté d’intervenir avec un extincteur mais sans succès, Mohammad a attendu au volant dans le véhicule en flammes portes et fenêtres fermées, il a attendu que le gaz GPL explose et éventre la voiture éparpillant son corps aux quatre vents, il était peut-être déjà mort carbonisé quand tout a sauté, la synagogue a été très légèrement endommagée, il n’y a eu aucune victime, à part Mohammad et une chienne yorkshire très âgée et cardiaque morte de peur dans son urine au deuxième étage du bâtiment d’en face, quelques vitres brisées, rien de plus, le chien s’appelait Pace, paix , étrange coïncidence qu’aucun journal n’a relevée — sans le savoir Mohammad el-Khatib a déclenché toutes les alarmes antiterroristes du monde, nous avons tous cherché si ce pauvre type était en relation avec une cellule connue, si son nom figurait déjà quelque part, dans un dossier, dans un rapport, et ce jusqu’à ce que les services italiens confirment la version de la police, un suicide, pas un attentat suicide, un suicide tout court : Mohammad el-Khatib, inconnu, dépressif, psychotique, violent, sous neuroleptiques s’était immolé par le feu peut-être sans même penser à l’explosion qui s’ensuivrait, il voulait mourir devant la synagogue, peut-être mourir comme les martyrs palestiniens de Jérusalem ou de Tel-Aviv, dans la gloire et les flammes, ou peut-être sacrifier sa vie pour protester contre l’occupation, pacifiquement, ou bien peut-être tout simplement mourir, au cœur d’une nuit grise de décembre, quand Hadès appelle — toujours est-il qu’il n’y avait plus de juifs à tuer à Modène, que la synagogue n’est ouverte que pour les grandes fêtes, et qu’à cinq heures du matin il ne passe pas grand monde dans les rues de la ville, les carabiniers et le substitut du procureur ont patiemment ramassé les ruines cramoisies du corps de Mohammad, les ont rassemblées dans des sacs en plastique noir, les services municipaux se sont hâtés de faire disparaître toute trace du décès, ils ont nettoyé l’asphalte, réparé l’éclairage public, changé les vitres brisées et brûlé à son tour, dans une décharge, la dépouille du vieux clébard crevé dont la maîtresse ne savait que faire, je pensais à Attila József, le poète hongrois qui s’était allongé sur les rails de chemin de fer près du lac Balaton pour se faire couper en trois morceaux par le premier train, ou en deux dans le sens de la longueur par les roues aiguisées, Attila József a eu une double influence en Hongrie, poétique et mortelle, si je puis dire, des dizaines de poètes maudits ou d’adolescents trop lucides sont descendus pour mourir sur les voies au même endroit que lui, ou, quand l’administration des chemins de fer, alarmée, a décidé de clôturer l’endroit, un peu plus loin sur la même ligne — de la même façon Mohammad suivait l’exemple des martyrs palestiniens ces petits Christs solaires qui coupent leur corps en deux à la taille avec une ceinture d’explosifs, Nathan Strasberg me racontait que leurs têtes étaient propulsées dans les airs à plusieurs dizaines de mètres de hauteur, comme une bouteille en plastique par un pétard, j’imagine leurs derniers instants, ils contemplent Jérusalem une dernière fois, de si haut, dans un ultime clignement de paupières ils voient briller le Dôme du Rocher, au sommet de leur dernière ascension, au point d’équilibre, comme lorsqu’on lance une balle en l’air, leurs têtes saignantes s’immobilisent un quart de seconde dans le ciel avant de retomber — il y a des traditions dans le suicide, des groupes, des confréries, celle des pendus, plutôt campagnarde, celle des armes à feu et des armes blanches, plus martiale et virile, celle des moyens de transport, résolument moderne, celle des empoisonnés ou des hémorragies de baignoire à l’antique, des gazés avec ou sans explosion, des brûlés vifs, pour ma part j’appartiens à la catégorie des noyés, des signes d’eau tentés par la disparition totale de leur corps dans le flot noir, Mohammad el-Khatib manifestait en mourant, il faisait un dernier geste, peut-être le seul qui comptait pour lui, ce matin de décembre à quelques centaines de mètres de la gare que nous traversons en trombe, il se rangeait au côté des morts les plus célèbres de son peuple, les rejoignait malgré son exil italien, son suicide n’empêcha pas Luciano Pavarotti de se marier le surlendemain au Teatro di Modena ( le théâtre est l’église des artistes , dira-t-il) à quelques centaines de mètres de là, avec sept cents invités, parmi eux Bono chanteur de U2 et Zucchero qui entonneront Stand by Me au milieu des robes Armani, des policiers à cheval, des bijoux des mondains des mondaines des ténors Placido Domingo José Carreras d’un chœur de gospel et d’un ensemble à cordes pour aider Mohammad el-Khatib et le chien crevé à monter au paradis sans doute, il y a tant de façons de réagir aux souffrances et à l’injustice, Pavarotti a mis un répertoire d’associations humanitaires sur sa liste de mariage, le Palestinien de Modène s’est immolé par le feu devant une synagogue vide et Harout à Alep me tenait par le bras en tentant de m’expliquer quelque chose que je ne comprenais pas, au haut de la citadelle, sur le grand terre-plein balayé par le vent, quelque chose qui avait trait à des massacres vieux de plus de quatre-vingts ans, des marches de la mort au milieu du désert, et je ne voyais pas ce que ceci venait faire dans nos négociations, au bout d’une demi-heure j’ai fini par l’interrompre, j’étais gelé et j’avais envie d’aller droit au but, il m’a répondu ne vous inquiétez pas , ne vous inquiétez pas vous aurez vos informations, vous saurez tout ce que vous voulez savoir, et même plus, au plus haut niveau, vous pourrez savoir la couleur du caleçon de Hafez al-Assad si ça vous chante, vous obtiendrez des canaux privilégiés pour négocier avec les Syriens en cas de besoin et une oreille attentive à la présidence, enfin tout ce que vous voulez en Syrie et au Liban, mais à une condition : que la France reconnaisse officiellement le génocide des Arméniens — j’étais sidéré, je n’en croyais pas mes oreilles, ce bonhomme était définitivement cinglé, qu’est-ce que je pouvais faire pour la reconnaissance du génocide arménien, il m’a souri très calmement, je lui ai dit écoutez, vous devriez plutôt parler avec quelqu’un de l’ambassade, ce sont des diplomates qu’il vous faut je crois, enfin je vais voir ce que je peux faire, Harout m’a interrompu et il m’a dit ne vous inquiétez pas, ce n’est pas pressé vous savez, c’était il y a si longtemps déjà que cela peut attendre quelques années, Harout n’était en fait que le représentant des “honorables correspondants” dont les services et les informations devaient s’avérer peut-être si utiles à la France que malgré les dommages occasionnés aux relations franco-turques l’Assemblée nationale a adopté définitivement le 18 janvier 2001 la proposition de loi reconnaissant le génocide arménien alors qu’en 1998 une initiative similaire n’avait pas prospéré, le texte s’étant “perdu” au Sénat, où il n’avait jamais été mis à l’ordre du jour, et j’ignore aujourd’hui si l’homme ou plutôt les hommes que représentait Harout avaient quelque chose à voir ou non dans cette histoire, à Alep en 1997 en tout cas la reconnaissance officielle du génocide par la France paraissait tout à fait improbable, et un an plus tard l’Assemblée votait une première fois le texte à l’unanimité, un grand colloque historique était qui plus est organisé à la Sorbonne, les Turcs sont entrés dans une rage noire et brûlaient des drapeaux tricolores à Ankara, les Français se présentaient une fois de plus comme les Justes et la patrie des Droits de l’homme, les députés unanimes se donnaient l’accolade au sortir de l’hémicycle, certains avaient du mal à retenir leurs larmes comme s’ils venaient de sauver eux-mêmes des milliers d’hommes du massacre, oubliant que les corps dormaient depuis près de cent ans déjà à Deir ez-Zor dans le désert syrien, aux alentours d’Alep ou dans l’Est de l’Anatolie, cette petite Arménie historique où la meilleure preuve de la destruction est l’absence des Arméniens aujourd’hui, où sont-ils donc passés, ils ont disparu, disparu de Van, de Diyarbakir, d’Erzurum — dès mai 1915 le préfet de Djézireh se plaint des cadavres que charrie l’Euphrate, attachés deux par deux, abattus d’une balle dans le dos ou passés au fil des longs couteaux des Circassiens ou des Tchétchènes que les Ottomans ont recrutés comme bourreaux indéfectibles, Harout me racontait tout cela à Alep, au bar de l’hôtel Baron où avaient dormi les Jeunes-Turcs venus de Stamboul pour superviser la boucherie, les caravanes de déportés en provenance du nord passaient quelque temps dans le camp de concentration de Bab à quelques kilomètres de la ville, tout le monde a oublié , disait Harout, tout le monde a oublié que les camps de la mort étaient ici, autour d’Alep, à Raqqa sur l’Euphrate, à Deir ez-Zor, à Hama, à Homs, et jusque dans le djebel Druze , près d’un million d’Arméniens sont passés par là dans leur longue marche vers la mort et ceux qui survivaient aux camps étaient envoyés toujours plus loin, à pied ou en charrette, jusqu’à ce que leur nombre soit si réduit qu’il devenait possible de les tuer à la main, de les brûler vifs, de les exploser à la dynamite ou de les noyer dans le fleuve, les témoins parlent d’anthropophagie causée par la famine, d’enfants se nourrissant d’excréments d’animaux, de Bédouins arabes qui razziaient les colonnes de déportés, enlevant les jeunes femmes nubiles, une courte apocalypse, quelques mois, entre 1915 et 1916, au moment où les soldats britanniques et français tombent comme des mouches sur les côtes des Dardanelles bien gardées face aux soldats commandés par Mustafa Kemal qu’on n’appelle pas encore Atatürk, Harout me racontait, devant un verre d’arak dans les fauteuils en cuir patiné de l’hôtel Baron, la mise à mort des Arméniens et comment la communauté d’Alep, présente dans la ville depuis les croisades, avait été rançonnée mais plus ou moins épargnée, il me racontait la fin de l’Empire ottoman le plus brillant, le plus bel empire de Méditerranée, des Balkans jusqu’en Libye, qui avait pourtant protégé ses minorités chrétiennes pendant des siècles, moyennant tribut — Harout Bedrossian né en 1931 m’a montré des photos de sa famille vers 1900, les hommes en tarbouche et les femmes en robe noire, il m’a emmené goûter les meilleurs soujouk et bastourma d’Alep , son français était impeccable et distingué, colonial, avec un bel accent étrange, nous ne parlions pas de travail, bien sûr, il n’était qu’un intermédiaire, comme moi, nous étions deux porteurs de valises, des hommes d’affaires louches, en bonne intelligence et rien de plus, l’homme ou les hommes qu’il représentait étaient des businessmen proches de ministres qu’ils arrosaient pour obtenir le droit de commercer avec l’étranger, clients d’apparatchiks alaouites et de caciques régnant sur une partie des innombrables polices et services de renseignements du pays de la grisaille et des prisons sans sortie, dont le désert était parsemé d’ossements arméniens que le gouvernement glorifiait surtout pour emmerder les Turcs leurs ennemis héréditaires, les Turcs fer de lance de la lutte contre l’Axe du Mal, avec qui la coopération militaire battait son plein, la France formait des officiers turcs à l’école de guerre des officiers français partaient en stage en Turquie des matériels des savoir-faire étaient échangés ainsi que des informations principalement sur l’Iran et le Caucase russe, malgré les apparences nos relations bilatérales étaient tout à fait cordiales et ce n’était pas quelques centaines de milliers d’Arméniens morts et oubliés qui allaient remettre en question l’équilibre géostratégique de l’après-guerre froide, nous, nous continuions à travailler, rien ne s’arrête, même quand les députés légiféraient pour le bien de la Turquie , pour l’amener, disaient-ils, à voir son passé en face ou quelque chose du genre, ce qui faisait crever de rire les ex-Ottomans en coulisses, la France ferait mieux de balayer ses cadavres devant sa porte, la France qui en 1939 évacue les derniers Arméniens lors de l’affaire d’Alexandrette, avec le cynisme propre à la République, après avoir maté dans le sang les révoltes syriennes elle vend à l’ennemi une partie du territoire syrien, la France patrie rageuse et violente bombarde les civils de Damas avec furie en 1945 au moment de partir, cadeau d’adieu, politique de la terre brûlée, je retire mes canons mais je vais m’en servir une dernière fois, laissant quelques centaines de morts inconnus sur le carreau, rien de bien grave, des Arabes, des Orientaux fourbes et incompréhensibles pour le général Oliva-Roget responsable de la canonnade, persuadé que les agents provocateurs britanniques sont derrière les émeutes qu’il réprime dans le sang avant de s’embarquer avec armes et bagages pour Paris rendre compte à de Gaulle grand pasteur de guerriers, la France embarrassait la Turquie en 1998 en lui jetant à la figure des milliers d’ossements arméniens, ce à quoi les Turcs rétorquaient par les milliers de cadavres algériens, et ce même Parlement de la V eRépublique qui avait voté la loi d’amnistie des crimes de guerre d’Algérie reconnaissait officiellement le génocide arménien, ému aux larmes, en 2001 — les massacres des autres sont toujours moins encombrants, la Mémoire toujours sélective et l’histoire toujours officielle, je me souviens avec Marianne aux Dardanelles le guide turc nous chantait les louanges d’Atatürk père de la nation le grand organisateur de la résistance de la péninsule, promis à un noble destin : ce fossoyeur de l’Empire avait réhabilité les Jeunes-Turcs dès son arrivée au pouvoir en 1923, alors qu’ils avaient été jugés à Stamboul en 1919 et condamnés pour les massacres de 1915–1916, reconnaître aujourd’hui le génocide serait trahir la Mémoire sacrée du père moustachu des Turcs, comme abroger la loi d’amnistie de 1968 pour l’Algérie est impossible et vain, trahison à la Mémoire du Général victorieux : la Mémoire, cet ensemble mortuaire de textes et de monuments, de tombes inscrites à l’inventaire, de manuels scolaires, de lois, de cimetières, de quarterons de militaires en retraite, ou pourrissant sous de riches tombeaux, pas de petites croix presque anonymes dans le cimetière de la multitude, mais un hypogée de marbre, solitaire comme celui de Charles Montagu Doughty-Wylie à Kilitbahir aux Dardanelles : l’officier britannique tombé en avril 1915 était sans doute le seul de son contingent à parler couramment le turc, à connaître intimement l’Empire contre lequel il se battait, où il avait résidé comme consul entre 1906 et 1911, à Konya et en Cilicie, Charles Doughty moustachu lui aussi avait ensuite été attaché militaire auprès des troupes ottomanes pendant la guerre des Balkans, chargé d’organiser le secours des blessés, il obtint même une décoration pour sa bravoure et son abnégation, le sultan lui agrafa une rose de cristal au revers de son veston, médaille ironique, Charles Doughty prendra une balle turque en plein visage au haut d’une colline perdue en Méditerranée, sans pouvoir profiter de la vue sublime sur l’Egée, des côtes troyennes qu’il connaissait si bien, déchirées par les canons de marine — et il ignorait certainement, au moment de mourir, que les Arméniens qu’il avait sauvés en 1909 en Cilicie étaient en train d’être à nouveau massacrés, cette fois-ci sans que personne puisse intervenir, ni le consul américain ni les quelques témoins des massacres, en 1909 à Konya Charles Doughty-Wylie et sa femme reçoivent la visite d’une voyageuse archéologue britannique, Gertrude Bell, qui les photographie dans leur jardin, en compagnie de leur serviteur et de leur énorme caniche noir, Mme Wylie en robe blanche, chapeautée, visage ingrat, traits durs, jalouse, peut-être, du succès de l’aventurière auprès de son mari, avec raison — Gertrude est amoureuse du beau Charles, la première femme “intelligence officer” du gouvernement de Sa Majesté est éprise de l’élégant militaire diplomate, elle ira se recueillir en secret sur sa tombe, aux Dardanelles, quelques années plus tard, au moment où elle intrigue pour la formation de l’Irak moderne et propose le trône à Fayçal roi des Arabes, Gertrude Bell l’espionne archéologue est sans doute responsable de bien des malheurs de la région, je pensais à elle à Bagdad devant le musée qu’elle avait fondé et qui venait d’être pillé, on retrouverait des sceaux-cylindres mésopotamiens jusqu’en Amérique, tout le monde vous proposait des antiquités, les onusiens repartaient les poches pleines de monnaies, de statuettes et de manuscrits médiévaux, le pays éventré perdait ses richesses par les entrailles et la tombe de Gertrude Bell, verte et silencieuse, était toujours là à Bagdad où personne ne se souvenait plus d’elle et de son rôle dans la naissance du pays, de ses intrigues ou de son amitié avec T.E. Lawrence l’Arabe, ni de sa mort mystérieuse, suicide ou accident, d’une overdose de somnifères le 12 juillet 1926 : j’ai dormi dans la chambre de Gertrude Bell à l’hôtel Baron à Alep, en pensant à Charles Doughty-Wylie et aux Arméniens, avant de poursuivre mon tour, en bon touriste de carnaval, je me suis rendu à Lattaquié, en train, depuis la gare d’Alep où arrivait autrefois l’express d’Istanbul, après avoir fait le tour du Taurus — le train syrien qui franchissait les montagnes n’avait pas de vitres, j’étais proprement gelé dans le wagon, maintenant j’étouffe, j’ai une gueule de bois terrible, je suis tout tremblant, flou, poisseux, à Lattaquié le ciel était violet après la pluie, la mer immense d’un gris inquiétant j’ai pris une chambre dans un hôtel au nom saugrenu de La Gondole , j’ai dîné dans un restaurant tenu par des Grecs, un poisson assez bon dans mon souvenir avec une sauce au sésame, il n’y avait rien à faire à Lattaquié à part boire dans un bar ma foi plutôt sordide où des aviateurs russes étaient en bordée, soûls comme seuls les Slaves peuvent l’être, deux géants de l’Oural avec uniformes et casquettes dansaient une valse grotesque, monstrueuse, tendrement enlacés leurs énormes paluches posées sur les épaules, ils se balançaient d’un pied sur l’autre en chantant je ne sais quel air russe, ils buvaient de l’arak sans eau à la bouteille pour le plus grand dégoût du patron, un Syrien hâlé un peu dépassé par les événements, les deux ours ex-soviétiques se sont étalés sur une table provoquant l’hilarité de leurs camarades qui m’offraient à boire, le taulier avait très envie de les virer mais il n’osait pas — je suis rentré ivre dans ma chambre d’hôtel pas très gaie, au mur des photos de Venise m’ont plongé dans la tristesse je me sentais plus seul que jamais Marianne m’avait quitté Stéphanie allait me quitter mon métier de l’ombre était des plus sordides je regardais le plafond ou les reproductions de gondoles en pensant aux Arméniens morts de Harout Bedrossian, aux Kurdes et aux Arabes trompés par Gertrude Bell, aux Dardanelles à Troie la bien gardée à la lagune secrète dans le brouillard de l’hiver à la mort partout autour de moi je pensais aux prisons syriennes aux pendus aux islamistes torturés à toutes ces existences gâchées jetées à la mer comme la pluie qui frappait fort contre la vitre et maintenant un crachin italien strie horizontalement la nuit aux alentours de Bologne, et malgré la valise la décision la nouvelle vie devant moi je ne suis pas en meilleur état que dans cette chambre d’hôtel à Lattaquié sur la côte syrienne la profession de solitude malgré le contact des corps malgré les caresses de Sashka j’ai l’impression d’être inatteignable d’être déjà parti déjà loin enfermé au fond de ma mallette remplie de morts et de bourreaux sans espoir de sortir au grand jour jamais, ma peau insensible au soleil restera à jamais blanche, lisse comme le marbre des stèles de Vukovar
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Zone»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Zone» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Zone» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.