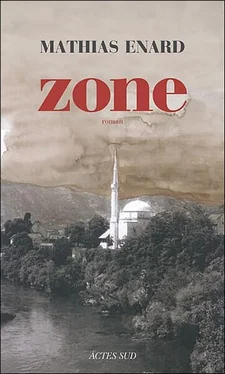Mathias Énard - Zone
Здесь есть возможность читать онлайн «Mathias Énard - Zone» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Город: Paris, Год выпуска: 2008, ISBN: 2008, Издательство: Éditions Actes Sud, Жанр: Современная проза, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Zone
- Автор:
- Издательство:Éditions Actes Sud
- Жанр:
- Год:2008
- Город:Paris
- ISBN:978-2-7427-7705-1
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Zone: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Zone»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Par une nuit décisive, un voyageur lourd de secrets prend le train de Milan pour Rome, muni d’un précieux viatique qu’il doit vendre le lendemain à un représentant du Vatican pour ensuite — si tout va bien — changer de vie. Quinze années d’activité comme agent de renseignements dans sa Zone (d’abord l’Algérie puis, progressivement, tout le Proche-Orient) ont livré à Francis Servain Mirkovic les noms et la mémoire de tous les acteurs de l’ombre (agitateurs et terroristes, marchands d’armes et trafiquants, commanditaires ou intermédiaires, cerveaux et exécutants, criminels de guerre en fuite…). Mais lui-même a accompli sa part de carnage lorsque la guerre en Croatie et en Bosnie l’a jeté dans le cycle enivrant de la violence.
Trajet, réminiscences, aiguillages, aller-retour dans les arcanes de la colère des dieux. Zeus, Athéna aux yeux pers et Arès le furieux guident les souvenirs du passager de la nuit. Le train démarre et, avec lui, commence une immense phrase itérative, circulatoire et archéologique, qui explore l’espace-temps pour exhumer les tesselles de toutes les guerres méditerranéennes. Car peu à peu prend forme une fresque homérique où se mêlent bourreaux et victimes, héros et anonymes, peuples déportés ou génocidés, mercenaires et témoins, peintres et littérateurs, évangélistes et martyrs… Et aussi les Parques de sa vie intérieure : Intissar l’imaginaire, la paisible Marianne, la trop perspicace Stéphanie, la silencieuse Sashka…
S’il fallait d’une image représenter la violence de tout un siècle, sans doute faudrait-il choisir un convoi, un transport d’armes, de troupes, d’hommes acheminés vers une œuvre de mort. Cinquante ans après
de Michel Butor, le nouveau roman de Mathias Enard compose un palimpseste ferroviaire en vingt-quatre “chants” conduits d’un seul souffle et magistralement orchestrés, comme une
de notre temps.
Né en 1972, Mathias Enard a étudié le persan et l’arabe et fait de longs séjours au Moyen-Orient. Il vit à Barcelone. Il a publié deux romans chez Actes Sud :
(2003) — Prix des cinq continents de la francophonie, 2004 — qui paraît en Babel, et
(2005). Ainsi que, chez Verticales,
(2007).
Zone — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Zone», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
VII
tout est plus difficile à l’âge d’homme vivre enfermé en soi entrechoqué miséreux empli de souvenirs je ne fais pas ce voyage pour rien, je ne me recroqueville pas comme un chien dans ce fauteuil pour rien, je vais sauver quelque chose je vais me sauver malgré le monde qui s’obstine à avancer péniblement à la vitesse d’une draisine manœuvrée par un manchot, en aveugle un train la nuit dans un tunnel le noir encore plus épais j’ai dû dormir un moment, si seulement j’avais une montre, je n’ai qu’un téléphone, il est dans ma veste à la patère, mais si je le prends je vais être tenté de vérifier que je n’ai aucun message et d’en envoyer un, toujours la passion pour les télégrammes, envoyer des signes dans l’éther comme des signaux de fumée des gestes sans objet des bras des mains tendues vers le néant, à qui pourrais-je envoyer un message, depuis ce téléphone à carte que j’ai pris soin de faire acheter par un clochard moyennant un gros pourboire, par chance il avait une pièce d’identité et n’était pas trop délabré, le vendeur n’a pas fait de difficultés, j’ai quitté mon appartement laissé quelques affaires chez ma mère vendu mes livres en vrac à un bouquiniste de la porte de Clignancourt pris trois quatre trucs, en rangeant je suis évidemment tombé sur les photos, j’ai revu Andrija dans son uniforme trop grand, Marianne à Venise, Sashka à vingt ans à Leningrad, le camp de la Risiera à Trieste, le menton carré de Globocnik, les moustaches de Gerbens, j’ai tout emporté, et je peux dire que tout ce que je possède est au-dessus de moi dans un sac de taille assez réduite, à côté de la petite mallette qui va au Vatican et que je compte bien remettre à peine arrivé à Rome, ensuite ce soir dans ma chambre au Plazza via del Corso je vais boire au bar de l’hôtel jusqu’à sa fermeture et demain matin je prendrai un bain je m’achèterai un costume neuf je serai un autre homme j’appellerai Sashka ou j’irai directement chez elle je sonnerai à la porte et Dieu sait ce qui va se passer, Zeus décidera du destin qu’il convient de me donner les Moires s’activeront pour moi dans leur cave et advienne que pourra on verra bien si la guerre me rattrapera ou si je vivrai vieux en regardant grandir mes enfants les enfants de mes enfants quelque part caché dans une île ou un immeuble de banlieue de quoi pourrais-je bien vivre, de quoi, comme Eduardo Rózsa je pourrais raconter ma vie écrire des livres et des scénarios de films autobiographiques — Rózsa né à Santa Cruz de la Sierra en Bolivie d’un père juif communiste résistant de Budapest était l’envoyé spécial d’un journal espagnol à Zagreb avant de devenir commandant dans l’armée croate, je l’ai croisé une ou deux fois sur le front et plus tard en Irak, un amoureux de Che Guevara et de la guerre qui fonda notre brigade internationale, un groupe de volontaires qui parlaient anglais entre eux des Guerriers de la Grande Croatie libre et indépendante tous arrivés comme moi après les premières images de la folie yougoslave, Eduardo était déjà là, il débarque en Croatie en août 1991 un mois avant moi au moment d’Osijek et des premiers affrontements, il arrive d’Albanie et avant cela de Budapest et de Russie où il s’est formé à l’espionnage à la guérilla à la littérature comparée et à la philosophie, un poète — aujourd’hui il écrit des livres des recueils de poèmes et joue son propre rôle dans des films, peut-être Che Guevara aurait-il fini ainsi s’il n’avait pas fait le choix d’Achille, si on lui avait prêté vie il serait peut-être lui aussi — les armes rangées, la vie faite — devenu acteur, il a une si belle gueule : comme Hemingway Eduardo Rózsa écrivait vite, je l’imagine dans la nuit d’août sur la terrasse de l’hôtel Intercontinental de Zagreb où logeait toute la presse étrangère, la Vanguardia de Barcelone lui reprochait de trop décrire les combats et de ne pas assez parler de politique, il buvait de petits verres en racontant les premières batailles les chars yougoslaves contre les Croates dépenaillés, sa chambre d’hôtel était transformée en vrai musée de la Guerre, des éclats d’obus des munitions des queues de roquette des cartes des reliques en tout genre, Eduardo drôle de personnage idéaliste guerrier aujourd’hui converti à l’islam après avoir lutté pour le crucifix catholique, vice-président de la communauté musulmane de Hongrie, ancien chargé de communication du premier gouvernement irakien libre, les hommes veulent des causes, des dieux qui les inspirent, et dans ce mois d’août 1991 torride devant la piscine de l’Intercontinental sa R5 criblée de balles au parking son stylo à la main il pense à la sierra bolivienne au socialisme au Che et à son vieil uniforme troué, il vient de se faire tirer dessus par les Serbes sur l’autoroute de Belgrade, il rédige sa chronique, c’est la première fois qu’il est sous le feu, la vitre à moitié baissée a volé en éclats, le siège passager s’est ouvert soudain en crachant sa mousse dans des sifflements et des bruits métalliques, avec la vitesse et la distance il n’a sans doute pas entendu les détonations, il a fait une embardée éteint les phares par réflexe et continué droit devant lui les mains moites et serrées sur le volant la sueur dans les yeux jusqu’à la banlieue de Zagreb, jusqu’à l’hôtel, jusqu’aux collègues étrangers les deux photographes français qui partagent sa chambre, ils voient arriver Eduardo en nage hors de lui ces deux journalistes de vingt-cinq ans sont venus eux aussi jusqu’en Croatie pour se faire tirer dessus et courir dans la campagne les tanks yougoslaves aux fesses, pour eux Eduardo est un maître, un homme d’expérience et voilà qu’il arrive tremblant et en sueur, il ne dit rien, il prend son carnet et va doucement se soûler à la prune au bord de la piscine en regardant les reporters américaines rire dans l’eau des blagues de leur caméraman, c’est là que ça se produit, touché par Zeus Eduardo Che Rózsa a choisi son camp, dès le lendemain à Osijek il ira voir les officiers croates, il s’enrôlera, rejoindra les rangs achéens dans une belle colère, une rage contre les Serbes : les journalistes l’ont vu un beau jour dans un uniforme kaki, un fusil sur l’épaule et à mon arrivée fin septembre il avait abandonné la plume pour se consacrer à la guerre, il en reviendra décoré médaillé citoyen d’honneur de la nouvelle Croatie, un héros, parrain de je ne sais combien d’enfants, et il écrira lui-même ses exploits, jouera son propre rôle au cinéma — la première fois que je l’ai vu ce n’était pas à l’écran, il était assis au milieu du fossé dans lequel je rampais à Osijek, j’avais la trouille au ventre, absolument désemparé, les obus pleuvaient devant nous il y avait l’armée yougoslave ses blindés et ses troupes d’élite, je ne savais pas où j’allais je remontais la tranchée le nez dans le parfum d’automne, dans l’humus, pour m’échapper, pour rentrer chez moi, pour retrouver la chambre de bonne et les caresses de Marianne, je n’entendais plus rien je ne voyais plus grand-chose j’avais aperçu mon premier blessé tiré mes premières cartouches vers un bosquet, l’uniforme de la garde nationale n’était qu’une veste de chasse qui protégeait peu je frissonnais je tremblais comme un arbre sous les explosions Rózsa était assis là moi je rampais droit sur lui il m’a regardé en souriant, il a écarté doucement le canon de mon arme avec le pied, il m’a fait asseoir, il a dû me dire quelque chose dont je n’ai aucun souvenir et lorsque les nôtres ont commencé à faire feu c’est lui qui m’a appuyé contre le parapet d’une tape dans le dos pour que je tire moi aussi, avant de disparaître, Athéna vient insuffler le courage et l’ardeur aux mortels dans la bataille, et j’ai tiré posément, j’ai bien tiré avant de sauter hors du fossé avec les autres, la peur évanouie, envolée avec les projectiles en direction de l’ennemi et de la ferme que nous devions prendre, loin de Zagreb, loin de l’hôtel Intercontinental de sa piscine couverte de sa terrasse et de son sauna que je n’avais jamais vus, loin de Paris, Che Rózsa poursuivra sa carrière, j’entendis son nom plusieurs fois au cours de la guerre, des actes héroïques et d’autres plus mystérieux, comme l’assassinat d’un journaliste suisse accusé d’espionnage au profit de je ne sais qui, d’aucuns pensaient qu’il était venu infiltrer la brigade : on l’a retrouvé mort par strangulation au cours d’une patrouille, une dizaine de jours avant que le photographe britannique Paul Jenks ne soit abattu d’une balle dans la nuque alors qu’il enquêtait sur la mort du précédent, les héros sont souvent nimbés de ténèbres, marqués par Hadès grand mangeur de guerriers, Eduardo comme les autres, même si en ce temps-là les journalistes tombaient comme des mouches, en Croatie du moins, ou plus tard autour de Sarajevo assiégée — en Bosnie centrale, entre Vitez et Travnik, ils se firent beaucoup plus rares, à part quelques reporters de la télé du HDZ, le parti croate de Bosnie, qui avaient l’étrange habitude de sortir de nulle part, comme des diables d’une boîte, d’apparaître au moment le plus insoupçonnable et quelques reporters britanniques accrochés aux blindés blancs des emmerdeurs de la BRITFOR — ces photographes et journalistes faisaient un bien étrange métier, en quelque sorte espions publics, délateurs professionnels au profit de l’opinion, du plus grand nombre, nous les voyions ainsi, des mouchards de luxe qui nous haïssaient autant que les soldats de Sa Majesté nous méprisaient, frustrés par l’inaction la main sur la commande de leurs canons de 30 millimètres, perchés au haut de leurs Warriors repeints en blanc, les marchands de glace les appelait-on en Croatie, à quoi pouvaient-ils bien servir, ils ramassaient les cadavres et négociaient des cessez-le-feu pour se rendre en permission à Split, ils se baignaient, dansaient, buvaient du whisky avant de revenir compter les coups à Travnik, à la jumelle depuis leurs fenêtres, ou faire du jogging autour du stade — Eduardo Che Rózsa ex-agent secret ex-journaliste ex-commandant d’une des brigades les mieux organisées de Slavonie orientale écrivain poète scénariste devenu musulman et militant pour l’Irak et la Palestine, à Budapest dans sa maison de banlieue, repense-t-il aux tchetniks qu’il a abattus, à ses deux premiers morts, déchiquetés à la grenade dans une grange au bord de la Drave, à ses camarades tombés comme les miens, est-ce qu’il pense encore à la guerre, à la Croatie, lui le catholique par la mère communiste par le père, meurtrier par la grâce de Dieu, se souvient-il de la pluie glaciale de l’hiver 1991 aux alentours d’Osijek, Eduardo grandi au Chili jusqu’au coup d’Etat contre Allende, expulsé vers Budapest avec un charter de “rouges” étrangers qu’il n’était pas loisible de passer par les armes ou la baignoire, Eduardo dans un chemin inverse au mien commença par le renseignement avant de devenir journaliste, puis volontaire pour combattre avec les Croates, à nos côtés, et revint, plein d’usage et raison, vivre en Hongrie le reste de son âge, dans la poésie les scénarios les livres les missions étranges, plus tout ce que j’ignore de lui sans doute, Eduardo Che Rózsa qui ne m’a pas reconnu quand nous nous sommes croisés à Bagdad sur les bords du Tigre peu de temps après l’invasion, entre une gargote et un marchand de cacahouètes, au moment de l’euphorie passagère de la victoire, de la dictature renversée, de la justice restaurée — les trésors de Troie n’avaient pas encore fini de brûler, manuscrits, œuvres d’art, vieillards, enfants, que déjà les coalisés se congratulaient sur les rives du fleuve, sans se préoccuper des premiers attentats, des signes d’une catastrophe du même calibre que celle des années 1920, voire pire, Eduardo Rózsa se promenait en compagnie de quelques officiels sur les bords du Tigre éternel, je mangeais un épi de maïs acheté à un vendeur ambulant avec un type de l’ambassade, je venais de rencontrer Sashka et je n’avais envie ni de guerre ni de paix ni de la Zone ni de me rappeler la Croatie ou la Bosnie je voulais retourner à Rome ne serait-ce que vingt-quatre heures pour être avec elle, et voilà que le commandant Rózsa passe sans me voir, un fantôme, était-ce moi le fantôme ou lui, j’avais déjà commencé à disparaître je m’enfouissais petit à petit dans le contenu de la valise, dans Sashka que j’imaginais avoir vue pour la première fois à Jérusalem des années auparavant, en Irak il faisait une chaleur inouïe, une vapeur moite montait du Tigre lent et bordé de roseaux où de temps en temps s’échouaient des cadavres et des charognes comme sur la Save en 1942 sans émouvoir les patrouilles américaines qui se promenaient encore tels les Dupont Dupond un air béat sur le visage en regardant autour d’eux le pays qu’ils venaient de conquérir et dont ils ne savaient que faire, Bagdad partait à la dérive, ingouvernable comme Jérusalem ou Alger, elle se décomposait, un atome bombardé de neutrons, la faim, la maladie, l’ignorance, le deuil, la douleur, le désespoir sans bien comprendre pourquoi les dieux s’acharnaient ainsi sur elle, détruite, renvoyée aux limbes, à la préhistoire comme par les Mongols en 1258, bibliothèques, musées, universités, ministères, hôpitaux ravagés, Rózsa et moi les ex-guerriers venus pour partager ses dépouilles ou en humer les cendres, en spécialistes de la défaite, de la victoire, du Nouvel Ordre Mondial, de la paix des braves, des armes de destruction massive qui faisaient bien rigoler les militaires, ils se tapaient dans le dos en buvant de la Budweiser comme après une bonne blague, à Bassora les Britanniques étaient les même qu’en Bosnie, très sportifs, professionnels et indifférents, ils déchargeaient des camions d’aide humanitaire comme je les avais déjà vus faire à Travnik, comme Rózsa les avait observés à Osijek, avec la différence que cette fois-ci ils étaient autorisés à se servir de leurs armes, ce dont ils ne se privaient pas : ils chassaient les anciens baasistes comme d’autres le cerf ou plutôt le sanglier dans les Ardennes, les soldats anglais revenaient à Bassora, à l’endroit même où leurs grands-parents s’étaient installés en 1919, après les Dardanelles, après le Hedjaz et la Syrie, les tommies épuisés posaient leurs guêtres au pays des palmes et des citrons séchés, au bord des marais et des méandres du Chatt al-Arab, ils s’empiffraient de dattes et d’agneaux confisqués aux bergers autochtones, en se demandant combien de temps allait encore durer la guerre, elle dure toujours, près d’un siècle après le coup de feu balkanique de Gavrilo Princip, le pistolet de l’arbitre dans une course de fond, tous les participants sont déjà sur la ligne de départ, prêts à s’élancer vers le monde d’Arès grand mangeur de guerriers, espérant en revenir chargés de trésors et de gloire : Che Rózsa commandant bardé de médailles de la grande guerre patriotique croate, Vlaho ou moi décorés de l’ordre de la nation reconnaissante, Andrija avec une belle tombe de marbre noir sans cadavre, à notre frère le Héros , il n’a plus de corps, Andrija, pas d’ossements sous sa dalle, pas d’épingle dorée sur son veston c’est un nom une phrase un frère et un héros, je pensais à lui dans Bagdad conquise humiliée soumise et pillée en croisant Rózsa le Hongrois de Bolivie reconverti à l’islam et à l’entraide internationale, président de la communauté musulmane de Budapest, ou quelque chose du genre, après avoir été un fervent défenseur de l’Opus Dei, renseignait-il les Hongrois, les Russes ou les Anglais, étions-nous toujours collègues, collègues de l’ombre — dans la nuit de la guerre, de la Zone, des souvenirs des morts, nous habitions ensemble, sans nous voir, nous partagions la même vie, en nous croisant au bord du Tigre, ce Styx comme le Tibre comme le Jourdain le Nil ou le Danube comme tous ces fleuves mortels dégouline vers la mer, rivière d’urine le long d’un mur, les voies fluviales se recoupent comme les voies de chemin de fer et tissent une toile d’araignée autour du vide, au centre le creux marin abstrait et mouvant, d’un noir d’encre la nuit vert d’eau le jour et bleu acier à l’aube, je me suis toujours demandé pourquoi Eduardo Rózsa avait rejoint les Croates, pourquoi ces volontaires, cette brigade internationale dont j’aurais pu faire partie, il raconte dans ses livres qu’il combattait pour la Justice , pour aider le faible face au fort, les Serbes avaient eux aussi pourtant l’impression d’être menacés dans leur bon droit, ils défendaient leur terre, qui était leur terre parce que leurs maisons et leurs morts s’y trouvent, et des volontaires venaient aussi leur prêter main-forte, comme Rózsa et les siens aux Croates ou les moudjahidin aux Bosniaques, tous y voyaient une affaire internationale, un combat du juste contre l’injuste, à part les camarades plus ou moins apolitiques de Rózsa il y avait en Croatie un groupe de combattants étrangers dans les rangs du HOS, l’extrême droite croate, des néofascistes qui savaient par cœur des chants oustachis, des Français pour beaucoup, j’en connaissais de vue quelques-uns, aperçus au détour d’un meeting à Paris, ce genre de monde est petit, je les ai revus en armes aux environs d’Okučani puis croisés à Zagreb, c’était des soldats joyeux et paillards, ils étaient contents d’être là — comme disait Le Pen le borgne national l’émule oculaire de Millán Astray une expérience militaire est toujours bonne pour les petits , il avait eu la sienne en Algérie, et les réseaux de solidarité internationale envoyaient des recrues se peindre la figure en vert et apprendre la langue dans les vieilles chansons des années 1940, j’aurais pu en être, j’aurais pu en être c’est certain si je n’étais pas parti par un tout autre biais, au fond nous étions tous volontaires, même Vlaho qui avait déserté l’armée yougoslave en plein service militaire à près de sept cents kilomètres de chez lui pour rejoindre les rangs de la garde nationale là où il se trouvait, près d’Osijek, il était resté avec nous, Vlaho le Dalmate, malgré le froid et la pluie qui lui gelait les os, et pourtant Dieu sait s’il était gras en arrivant, gras, doux et drôle, avec un visage tout rond, angélique, Vlaho était volontaire comme Andrija comme moi comme les Français du HOS comme Eduardo Rózsa, comme Orwell pendant la guerre d’Espagne, comme Cendrars en Champagne en 14, comme le demi-frère de Sashka, Kolia, avait combattu aux côtés des Serbes, solidarité slave orthodoxe contre Slaves catholiques, ex-communistes contre ex-fascistes, elle ne l’avait pas revu depuis des années me racontait-elle, Kolia le maigre le mystique revenu d’Afghanistan avait tourné en rond dans la Russie trop étroite de la fin des années 1980 avant de se lancer dans une aventure militaire avec les tchetniks, la sajkaca sur le crâne, en sifflant sans doute la Marche slave de Tchaïkovski, je revois Sashka allongée sur son sofa bleu au Transtévère quand elle apprend que j’ai été soldat en Croatie elle dit quelle coïncidence, mon frère a été à la guerre avec les Serbes, a été à la guerre , ce sont ses mots, moj brat pobyval na vojne , les chemins de la slavitude se croisent dans les lignes de tir, où était-il, je lui demande, gdje , je l’ai peut-être aperçu, peut-être nous sommes-nous mesurés à la kalachnikov, peut-être a-t-il tué un de mes camarades, peut-être un de ses obus nous a-t-il précipités dans la boue molle des champs de maïs, cul par-dessus tête, elle répond en Serbie, konjechno , les yeux si clairs de Sashka sur son divan ne comprennent pas la question, elle ne voit pas la guerre, elle ne peut pas comprendre, je devrais préciser, je sais que c’est en vain — dans le sabir slavo-latin que nous parlons il n’y a pas de place pour les nuances guerrières, nous avons si peu de mots communs, de vieilles paroles slaves et des vocables italiens transparents en français, trop peu pour éclairer les motivations des volontaires internationaux russes français ou arabes et c’est tant mieux, je me rends compte que c’est pour le mieux, l’imprécision l’impossibilité d’entrer dans les détails, tout reste dehors quand je suis chez elle, la guerre, la Zone, la valise que je remplis, le sens passe par les mains les cheveux le regard immense de Sashka les coïncidences qui nous lient l’un à l’autre les voies de chemin de fer du passé qui se croisent, à Jérusalem, à Rome, comme avec Eduardo Rózsa mon double hongrois reconverti dans la poésie et la politique internationale, qu’est-ce que je pourrais expliquer de mon engagement — partir pour une noble cause, celle de mes ancêtres habsbourgeois qui avaient défendu Vienne contre les Turcs, celle de ma famille maternelle, bourgeoisie de Zagreb liée à l’Autriche et à l’Italie, maman pleura de tristesse et de joie lors de mon départ, je sais qu’elle alla tous les jours à l’église prier pour moi, et mon père sans admettre prier autant repensait à sa guerre à lui, ses deux ans d’Algérie, bien content que la mienne ait un sens , comme il disait, même si ce sens lui échappait un peu, il ne connaissait presque pas la Croatie, à part quelques cousins de sa femme, mais respectait la passion pour le Pays, lui-même discret nationaliste français catholique, ingénieur sans grande curiosité pour le monde, un peu effacé, pourtant tendre et attentif — je me souviens du train électrique démesuré qu’il nous avait construit, tout un réseau sur une planche de bois gigantesque, patiemment, des dizaines d’arbres, de voies, d’aiguillages, de feux, de gares et de villages, contrôlés par des transformateurs, des potentiomètres complexes qui réglaient la vitesse des motrices qui se croisaient, s’attendaient, allumaient leurs fanaux rouges dans la pénombre de Noël, se perdaient dans des tunnels sous des montagnes de plastique recouvertes d’une herbe trop verte et rugueuse au parfum de colle se mêlant à l’odeur d’ozone de tous ces moteurs électriques en fonctionnement, depuis la gare de triage jusqu’au passage à niveau, des mètres et des mètres de petits câbles rouges et bleus couraient le long des voies clouées sur la planche, pour l’éclairage public, les barrières, les maisons, je me souviens il y avait un train de marchandises avec une locomotive à vapeur, un transport militaire allemand gris, des wagons de passagers français, des années durant dans le sous-sol de notre maison d’Orléans nous avons ajouté des voies des arbres des décors des trains à ce fantastique assemblage à l’échelle HO, j’imagine la fortune engloutie petit à petit dans cet ensemble qui dort aujourd’hui dans des cartons, depuis notre déménagement à Paris et le démontage douloureux de l’installation qui mit un terme précis à l’enfance, adieu les modèles réduits place au monde des trains réels comme celui-ci, quelque part entre Parme et Reggio d’Emilie — Eduardo Rózsa raconte dans un de ses livres la colère de son père communiste lorsqu’il apprit que son fils se battait aux côtés des Croates, des fascistes, pensait-il, des descendants des Oustachis du NDH, Nezavisna Država Hrvatska , l’Etat indépendant de Croatie de 1941 : la vérité c’est que des nazillons il y en avait à la pelle, accrochés à la mythologie de la victoire sur les Serbes, à la mythologie du seul Etat croate “indépendant” balayé par les partisans, nous avions tous la Foi, nous participions tous à l’histoire le fusil à la main les pieds dans des chaussettes douteuses l’haleine chargée le regard fier pour Dieu et la patrie pour venger nos morts pour nos enfants à venir pour la terre pour nos ancêtres enterrés dans la terre, contre l’injustice serbe, puis pour nos camarades pour le plaisir peut-être aussi le goût de cuivre du plaisir de la guerre la gloire l’honneur la peur le danger le rire le pouvoir nos corps aiguisés nos cicatrices et dans l’appartement minuscule du Transtévère il m’était impossible d’expliquer tout cela à Sashka, pas plus qu’elle ne pouvait m’expliquer les sentiments de son demi-frère qui ne l’intéressaient pas, elle ne l’avait pas revu depuis qu’elle avait quitté Pétersbourg en 1993, quand Kolia revenait de la guerre, justement, elle était partie s’était enfuie à Jérusalem ville de la Paix, de la lumière et de la violence éternelle, où j’aime penser que je l’ai croisée, alors qu’elle peignait de fausses icônes russes pour les touristes américains près de la porte de Damas, un ange sur l’épaule, je l’ai croisée c’est certain comme je croisais des balles avec son demi-frère aux alentours de Vukovar, comme les locomotives se croisaient en deux réseaux distincts sur la planche de mon père, comme je croise Eduardo Rózsa dix ans plus tard à Bagdad sans qu’il m’aperçoive, au bord du fleuve — et les milliers de documents de la mallette que le train promène à travers la campagne italienne ne sont que cela, des intersections, des hommes entrevus au Caire à Trieste ou à Rome, c’était simple, il n’y avait qu’à dévider les fils suivre les rails attendre de les rencontrer dans la nuit dans ma propre nuit qui grignote le paysage et les usines agroalimentaires de la région du parmesan et de la nouille : le cruciverbiste s’est levé pour aller aux toilettes, mon voisin somnole tranquillement, le wagon est silencieux, il ronronne ou siffle, je ne sais pas, au gré du mouvement des voies, je ferme les yeux, où voudrais-je aller maintenant, à Beyrouth la bleue retrouver les Palestiniens et Intissar dans le petit livre crème, pas encore, ou en Irak pays de la faim de la mort et de Babel, à Troie peut-être avec Marianne, aux Dardanelles homériques, à Mycènes ville d’Agamemnon pasteur de guerriers, elle domine la plaine aux belles cavales, loin des monts et des collines près d’Hissarlik, loin des fossés et des ravines où s’empilaient les corps desséchés des soldats anglais et australiens en 1915 il fallait y acheminer l’eau par bateau dans d’immenses cuves métalliques, j’ai soif tout d’un coup, peut-être le cruciverbiste est-il parti au bar et pas aux lavabos, des Dardanelles à l’Irak, de Troie à Babylone, d’Achille à Alexandre, en repensant à Heinrich Schliemann le découvreur d’Ilion la bien gardée, de Mycènes parée d’or, à Arthur Evans le chevalier de l’Empire de Sa Majesté qui poursuivit jusque dans sa quatre-vingt-dixième année l’aventure en Crète à Cnossos, la pipe à la bouche, convaincu d’avoir découvert le labyrinthe et le sanctuaire des puissants taureaux, et moi aussi, en quelque sorte je suis un archéologue, le pinceau la brosse à la main je fouille et sonde des choses disparues, enfouies, pour en faire surgir des cadavres, des squelettes, des fragments, des débris de récits recopiés sur des tablettes chiffrées, mes Scripta Minoa à moi, commencés par l’excavation de Harmen Gerbens le brutal violeur alcoolique de Garden City, et poursuivis par des milliers de noms de bourreaux et de victimes, consciencieusement annotés, dessinés telles les poteries calcinées de Troie VII la mystérieuse cité brûlée, répertoriés, classés, sans que je comprenne la raison de ma passion, comme Schliemann ou Evans, poussés toujours plus avant dans des recherches infinies, debout sur la grande fosse de l’histoire, les pieds dans le vide : à mon arrivée boulevard Mortier, après avoir été recruté contre toute attente malgré mon passé guerrier et mes origines étrangères, plongé dans ma Zone solitaire peuplée de fantômes d’ombres vivantes ou mortes au beau milieu des archives infinies du secret dans ces couloirs insonorisés, ces tunnels sous le boulevard, chaque soir je traversais Paris jusqu’au 18 earrondissement et mon deux-pièces cuisine de nouveau fonctionnaire, trente mètres carrés de désordre au sixième sans ascenseur, comme il se doit, la tête sous le zinc du toit parisien, le coude sur le zinc du rade d’en bas, matin et soir, avant et après le métro, café à l’aller, pression au retour, petit à petit les habitués deviennent la famille anonyme du patriarche limonadier, les soldats de l’officier brasseur, Jojo Momo Pierre Gilles et les autres, des fous et des moins fous, des alcooliques et des sobres, des solitaires et des pères de famille, certains étaient comme les cafards, impossibles à éradiquer, d’autres disparaissaient du jour au lendemain, et Momo Pierre Gilles et leurs frères de bouteille spéculaient alors sur la disparition de Jojo, cancer, cirrhose, ou cette deuxième plaie de l’ivrogne après la Faculté, la femme, l’épouse qui vous interdit de 421 et de petit kir, il allait de soi pour tous ces piliers de comptoir qu’on ne quittait pas volontairement un bon bistrot quand on en avait trouvé un, c’était aussi improbable à leurs yeux que laisser un appartement confortable et bon marché pour s’en aller vivre à l’Armée du Salut, Michel le patron rassurait ses ouailles sur le destin de tel ou tel, je l’ai croisé dans le quartier, il va bien — il mentait c’est certain pour ne pas effrayer sa paroisse, par générosité, saint Michel le patron avait une grande tendresse pour ses buveurs invétérés, et plus qu’un fonds de commerce il y voyait une entreprise de salut public, la fabrique du lien social à laquelle il participait volontiers en se servant un petit baby de temps en temps, en payant de bon gré la tournée quand il perdait aux dés, il prodiguait tendresse et conseils amoureux, professionnels ou financiers, à la petite échelle d’un bar de quartier, où rares étaient ceux qui réussissaient à obtenir une ardoise (le crédit est mort, les mauvais payeurs l’ont tué) plus par sens de l’éducation et de la morale, d’ailleurs, que par méfiance ou avarice, le bistrot du 18 e, autant dire un bar sans nom, sans rien de spécial dans le décor ou dans les banquettes de skaï marronnasse fait partie de ma vie, chaque soir une ou deux bières au comptoir avant de monter mes étages bien cirés jusqu’à mon domicile sans femme ni télévision, au cours de l’ascension de mon Olympe parisien je me défais petit à petit de la crasse du monde du Boulevard, de la Zone, pour entrer dans une autre — mes photos de la Risiera di San Sabba au mur, à côté le portrait de Globocnik à Trieste, celui de Stangl à Udine, maintenant le cliché de Sashka à Pétersbourg, et à sa place, avant, bien encadrée, l’image de Stéphanie sur le Bosphore, que j’ai retrouvée dans un placard et que j’ai balancée hier matin dans une poubelle, le verre s’est brisé immédiatement dans un cri, pendant des années chaque soir le même rituel monter les marches sortir la longue clé couleur bronze l’introduire dans la vieille serrure ouvrir la porte sentir l’odeur de tabac froid parfois de poubelles ou d’alcool aller jusqu’à la fenêtre ouvrir les volets regarder quelques secondes les voitures passer dans la rue ranger les bouteilles vides qui traînent les fringues éparpillées puis prendre un livre m’asseoir dans mon fauteuil avec, selon l’humeur et les ressources, un verre de vin ou une bière à la main — curieux cette passion pour la lecture, un reste de Venise, de Marianne grande dévoreuse de livres, une façon de s’oublier de disparaître corps et biens dans le papier, petit à petit j’ai remplacé les romans d’aventures par les romans tout court, la faute à Conrad, à Nostromo et au Cœur des ténèbres , un titre en appelle un autre, et peut-être sans bien comprendre, qui sait, je me laisse porter, page après page, et bien que j’aie passé déjà une grande partie de ma journée de fonctionnaire trouble à lire — des notes, des rapports, des fiches, sur mon écran bien gardé — il n’y a rien alors que je désire plus qu’un roman, où les personnes soient des personnages, un jeu de masques et de désir, et petit à petit m’oublier moi-même, oublier mon corps au repos dans ce fauteuil, oublier mon immeuble, Paris, et jusqu’à la vie entière au gré des paragraphes, des dialogues, des aventures, des mondes insolites, c’est ce que je devrais faire maintenant, continuer le récit de Rafaël Kahla, retrouver Intissar la Palestinienne et Marwan mort à un carrefour de Beyrouth, voyage dans le voyage, pour écarter la fatigue, les pensées, le train bringuebalant et les souvenirs — guerrier, espion, archéologue de la folie, perdu maintenant sous un nom d’emprunt entre Milan et Rome, en compagnie de fantômes vivants comme Eduardo Rózsa le justicier hongrois vêtu de noir qui allait à la messe bien volontiers, tout ce que je m’efforçais d’oublier en lisant dans mon fauteuil à Paris, en m’enfonçant dans la Zone dans l’Algérie des égorgeurs et des égorgés, la Zone territoire des dieux courroucés et sauvages qui s’affrontaient à l’infini depuis l’âge du bronze au moins et peut-être même avant, depuis les cavernes les haches de pierre et les silex qui provoquaient de magnifiques blessures bien déchiquetées, sans compter les massues, les casse-tête, les triques, les maillets, ancêtres du marteau du camp de Stara Gradiška avec lequel mes cousins oustachis défonçaient les crânes serbes juifs et roms pour se désennuyer du couteau, au même moment à Trieste à la Risiera les gardes ukrainiens achevaient les partisans croates et slovènes avec une belle arme presque une masse médiévale un cube de métal acéré fixé à un épais câble d’acier au confortable manche de bois, qui avait fabriqué cet engin, un ingénieur ou un mécanicien qui sait, peut-être son nom est-il quelque part dans la valise, quelque part, dans le dossier de Trieste, ville du grand vent et de la matraque, à la magnifique synagogue et aux deux églises orthodoxes, serbe et grecque, Trieste port des Habsbourg depuis le XIII esiècle où passèrent les corps de François-Ferdinand et de la belle Sophie en provenance de Sarajevo, la ville leur rendit un dernier hommage, son adieu à l’Empire, avant de les expédier par le train à Vienne via Klagenfurt, bientôt le port adriatique changerait de mains et de nation, passerait à l’Italie avant de retrouver la germanité fin 1943, puis d’être pris d’assaut par les nouveaux Slaves du Sud pour quelques mois en 1945 : quatre pays en trente ans, ville austro-hongroise italienne annexée au Reich puis à la république yougoslave de Slovénie enfin gouvernée par les Anglo-Américains avant de retrouver l’Italie et de s’endormir pour longtemps aux confins de l’Europe démocratique, fatiguée, désertée par les juifs les Grecs les Allemands les Hongrois les Slovènes, enclavée à l’extrémité de la Vénétie julienne, à la frontière de la slavitude rouge, au bord du Karst meurtrier, auprès du golfe bien gardé par le château branlant de Duino où Rilke profitait en 1912 des mêmes largesses que, trente ans plus tard, les officiers de la marine allemande qui s’y installèrent, hiersein ist immer herrlich , Rilke reçu par la princesse Thurn und Taxis narguait de loin le sombre James Joyce, accueilli au même moment par de raides professeurs de la Berlitz School et morigéné par sa jeune épouse à chaque fois qu’il rentrait soûl, le petit Irlandais rustre et titubant dans le vent, un des nombreux visiteurs, des nombreux wagons qui se croisent là, sur les môles interminables d’un port aujourd’hui presque désert, j’y suis allé pour la première fois en permission entre deux fronts avec Andrija et Vlaho, je les ai traînés à Trieste depuis Zagreb en passant par Rijeka la grise et par Opatija la plus respectable des stations balnéaires austro-hongroises où nous sommes restés à peu près une heure, le temps de nous apercevoir que la moyenne d’âge des curistes était proche de celle de Vichy, d’Evian ou plutôt de Karlovy Vary, c’était la fin de l’hiver 1992, le printemps n’était pas encore arrivé, Vlaho malade se soignait à la rakija , il était vexé parce qu’une prostituée avait refusé de coucher avec lui sous prétexte qu’il était enrhumé à mort, il avait fait un scandale dans ce bar sordide de Novi Zagreb, provoquant l’hilarité générale, m’enfin, c’est juste mon nez qui goutte, pas le reste, j’ai pas la chtouille du tarin — depuis il était grognon, nous lui proposions malicieusement de profiter des eaux sulfureuses d’Opatija et des vieilles dames, sûrement moins regardantes que les professionnelles attentives à leur santé, qui plus est toutes ces Allemandes âgées et respectables venaient certainement pour se soigner elles aussi, elles seraient compréhensives, Vlaho haussait les épaules en disant ah, c’est malin, c’est malin, bon, on va où ? et de fil en aiguille nous sommes arrivés en Italie, avant de repartir pour l’Herzégovine en passant par la Dalmatie, une pause de deux jours chez Vlaho plus ou moins guéri, insultés à longueur de journée par son grand-père le Partisan qui levait tous ses verres en criant smrt fašizmu , Vlaho répondait heil Hitler en vidant le sien pour le faire enrager, au milieu des vignes à quelques kilomètres de Split où dansaient les soldats de la Forpronu, leurs hélicoptères nous survolaient et nous, nous avons dû faire du stop militaire pour rejoindre Mostar — aujourd’hui ces souvenirs sont un genre de vieux film yougoslave, les images paraissent vieillies, démodées, elles ne sont plus miennes, seules les sensations restent : la honte, la peur, le plaisir, le danger restent, les odeurs aussi, les contacts, le visage d’Andrija, la main de Vlaho, serrée autour de son verre ou de son fusil, c’était notre champion de démontage et graissage, même les armes les plus exotiques, les plus invraisemblables il pouvait les mettre à nu presque les yeux fermés, armer une mine ou un piège à fil aussi simplement qu’il se grattait le cul ou se mouchait, sans jamais se rendre compte, croyait-on, de ce qu’il manipulait, avec une dextérité de rongeur devant une noix, rapide, précis, il mangeait de la même façon, vite, les pattes avant jointes, son visage bonhomme s’ouvrait dans un sourire immense à la vue de la boisson de la nourriture ou d’une arme nouvelle : Vlaho est un mulot, un loir, une souris ou un rat, et surtout un enfant mâle, la guerre était son élément, car elle était simple, drôle et virile, dans un monde où devenir un homme ne signifiait pas grandir mais s’affûter, se réduire, se tailler comme une vigne ou un arbre auquel on retire petit à petit les branches, la partie femelle, ou la partie humaine, allez savoir, un buis de jardin classique sculpté en forme de guerrier, on aurait aussi bien pu dire en forme de phallus, de fusil, d’archétype du mâle auquel nous cherchions tous à ressembler, fort, adroit, chasseur préhistorique décervelé capable de toutes les forfanteries, bravache, orgueilleux mais soumis au plus fort et au supérieur hiérarchique, méprisant les faibles, les femmes et les pédés, tout ce qui ne lui ressemble pas, en fait, Vlaho, Andrija, les autres et moi petit à petit nous nous sommes transformés en soldats, en professionnels, bien sûr nous écrasions une larme de temps en temps, mais elle était vite cachée et effacée déguisée en sueur ou en fumée dans l’œil, une accolade et voilà, ou du moins c’est ce que nous aurions souhaité, parfois tout s’effondrait, le bouclier d’Achille percé, les belles cnémides arrachées, la lance brisée, et il restait alors juste un enfant nu recroquevillé appelant sa mère ou ses frères gémissant pleurant dans son sac de couchage ou sur son brancard, je me souviens du jour où Andrija l’invincible s’est effondré une première fois, lui le guerrier des guerriers que nous n’avions jamais vu en dehors de sa carapace : aux environs de Vitez, un matin comme les autres dans un village comme les autres, alors que les tensions étaient à leur comble avec les musulmans, un matin tiède, de petite brume, un transport de munitions vers le nord, à quelques kilomètres de Travnik la belle meurtrière un beau matin au parfum de printemps, avec le sergent Mile et Vlaho le chauffeur fou aux commandes de la voiture, je ne me souviens plus pourquoi nous nous sommes arrêtés près de cette bâtisse, sans doute parce qu’il y avait un cadavre sur le seuil, un homme âgé, un chargeur entier dans la tête et la poitrine, mitraillé d’assez près et son chien aussi, maison croate, la porte était ouverte, il planait une odeur d’encens comme dans une église, intérieur sombre et meubles en bois, volets fermés ils avaient dû être abattus la nuit, le type et son clébard, pourquoi avait-il ouvert sa porte, pourquoi était-il sorti, Mile nous fait signe, une lumière orangée vacillante sort d’une pièce du fond, un incendie miniature, quelque chose brûle, on s’approche à trois, Vlaho reste derrière pour surveiller l’entrée, une grande chambre des bougies partout, des dizaines de bougies encore allumées et sur le lit double une vieille dame allongée les mains sur la poitrine une robe noire ou gris foncé les yeux fermés et je ne comprends pas, Andrija retire son casque en signe de respect, il retire son casque soupire et bafouille quelque chose, Mile et moi l’imitons sans comprendre, nous sommes tous les trois en train de veiller une vieille dame qui ignore qu’elle est veuve, que le mari qui a allumé tous ces cierges pour elle a été fusillé avec son chien sur le pas de sa porte par des inconnus ou des voisins, elle n’a rien entendu, sur son lit de mort, ni les rafales dehors, ni les pas dans sa maison, ni les rires de ceux qui ont planté, bien droit, ce grand crucifix au milieu de son ventre, dont l’ombre absurde danse sur le mur aux côtés des visages baissés d’Andrija et de Mile, nu-tête, et c’est la voix de Vlaho qui nous réveille, u kurac , il vient d’entrer dans la pièce, bordel, qu’est-ce que vous foutez, bon, on y va oui ou non , il jette un coup d’œil distrait à l’aïeule au corps profané, je remets mon casque, Mile remet son casque et nous sortons comme des automates sans rien dire on remonte dans la Jeep Andrija s’assoit à côté de moi il reste silencieux les yeux dans le vague des larmes commencent à couler sur ses joues il les essuie doucement avec sa manche, il ne sanglote pas il regarde le paysage les maisons les arbres je l’observe il pleure comme une fontaine silencieuse sans se cacher, pourquoi, des cadavres il en a vu des quantités, des jeunes, des vieux, des mâles, des femelles, des brûlés noircis, des découpés, des mitraillés, nus, habillés ou même déshabillés par une explosion, pourquoi celui-ci, Andrija mourra quelques semaines plus tard, il aura le temps de venger ses propres larmes, de cautériser ses pleurs dans les flammes, de ravager à son tour des corps ennemis, des maisons, des familles, exultant avec Ajax fils de Télamon, avec Ulysse dans les ruines de Troie, Andrija le furieux il vengeait cette grand-mère inconnue dont il ne m’a jamais reparlé, j’ai encore dans l’œil l’ombre du Christ sur la tapisserie à fleurs, dans la lueur des cierges, rien n’avait été dérangé, aucune inscription vengeresse sur les murs, rien, c’était un étrange miracle ce crucifix fiché Dieu sait comment dans la chair de cette vieille femme, Andrija bouleversé sans l’être par ce signe, le sergent Mile ne disait rien non plus, Eduardo Rózsa aussi a craqué un jour, et Millán Astray, et Achille fils de Pélée, un jour un beau jour que rien ne prédisposait à la chose, et moi aussi, je me suis craquelé, fissuré façon mur de pisé séchant doucement, à Venise ce fut l’effondrement suivi de l’errance fantomatique dans les couloirs de la Zone, on meurt bien des fois et aujourd’hui dans ce train tous les noms de cette valise secrète me tirent vers le fond tel le parpaing attaché aux jambes d’un prisonnier balancé dans le Tibre ou le Danube, au milieu de l’Emilie bourgeoise, un train où les voyageurs sont bien assis, un wagon de passagers s’ignorant les uns les autres, feignant de ne pas voir ce qu’ils partagent de destin, ces kilomètres communs confiés au Grand Conducteur l’ami des modèles réduits des hallebardes et de la fin du monde, face à face certains dans le sens de la marche et d’autres dos à la destination, comme moi, le regard vers l’arrière, dans la nuit noire, tourné vers Milan gare de départ : Millán Astray l’ami de Franco, le général maigre borgne et manchot le légionnaire responsable de jolis massacres au Maroc avait une passion coupable pour la décapitation, il aimait égorger le bougnoule à la baïonnette, c’était son péché mignon, pour ne pas dire son violon d’Ingres, en 1920 il fonda la Légion étrangère espagnole, après un séjour à Sidi bel-Abbès chez les Français qui sont toujours fiers de leur savoir militaire, entraide coloniale bien naturelle, les légionnaires français impressionnèrent donc grandement Millán qui n’était ni borgne ni manchot à l’époque, juste habité, fasciné par la mort, Millán fabriqua au Maroc pour le compte de l’Espagne sa Légion où affluaient les pauvres, les malfrats et les relégués de l’Europe entière, et il les accueillait en leur chantant des hymnes — les légionnaires espagnols que j’ai croisés en Irak ressemblaient à de jeunes mariés qu’on aurait habillés pour leurs épousailles, ils chantaient en marchant d’un pas rapide, soy el novio de la muerte , vers leurs noces comme celles de leurs ancêtres en Afrique, à qui Millán disait vous êtes morts, pouilleux, ribauds, vous êtes morts et cette nouvelle vie vous la devez à la mort , vous allez revivre en la donnant, en bons fiancés vous allez courtiser, servir la camarde avec passion, lui tenir la faux, l’aiguiser la polir la lustrer la brandir à sa place au Maroc d’abord puis après le début de la croisade anti-rouges de Franco sur le sol même de la patrie, en Andalousie, à Madrid puis sur l’Ebre dans la dernière grande offensive, au Maroc contre les sanglants Berbères dompteurs de cavales, dans les désastres militaires du protectorat espagnol qui permirent la création éphémère de la première république indépendante d’Afrique, la république du Rif des indigènes, la république d’Abd el-Krim el-Khattabi dont on trouve encore les billets de banque froissés et jaunis chez les brocanteurs de Tétouan, Abd el-Krim le héros, le fossoyeur des Espagnols fut sur le point de prendre Melilla après le désastre d’Anoual en juillet 1921 où périrent dix mille soldats espagnols mal armés, mal nourris, sans chefs et sans discipline, une des plus retentissantes erreurs militaires après la Somme et le Chemin des Dames, qui fera trembler la monarchie libérale d’Alphonse XIII l’exilé romain : savait-il, dans sa chambre du Grand Hôtel de la piazza Esedra, avec sa collection de pantoufles et ses visites princières, que son ennemi d’alors, le cadi berbère aux petits chevaux, avait trouvé asile au Caire, à la cour du roi Farouk l’anglophile : je l’imagine fumer le narghilé sur les bords du Nil, des années durant, jusqu’à ce que, un jour de 1956, le nouveau roi indépendant du Maroc lui propose de rentrer chez lui — il refuse, peut-être parce qu’il aime trop Nasser et Oum Kalsoum, ou peut-être parce qu’il préfère se faire sucer le sang par les moustiques cairotes plutôt que par un roi chérifien, il meurt sans plus revoir son pays ni tenir une arme, à part un 9 millimètres Campo Giro ramassé sur le cadavre mutilé du général Silvestre, commandant de l’armée du Rif, dont la crosse plaquée de corne de buffle, lisse et sans rayures, porte le blason d’Alphonse XIII envoyé en exil par la défaite de son général et de son pistolet flambant neuf, Silvestre le massacré au corps introuvable et éparpillé, remplacé par les frères Franco Bahamonde ou Juan Yagüe, les faucons aux noms poétiques, et leur aîné Millán Astray à l’œil absent, auquel ses légionnaires offraient de jolis paniers en osier garnis de têtes berbères coupées, pour son plus grand délice, comme avant lui vers 1840 Lucien de Montagnac, colonel tout aussi manchot, pacificateur de l’Algérie, trompait l’ennui colonial en décapitant des Arabes comme des artichauts — je revois soudain la photo de Henryk Ross du ghetto de Łódz, une caisse remplie de têtes d’hommes à côté d’une autre plus grande où sont entassés les corps étêtés, voilà qui aurait réjoui Astray le borgne ou Montagnac le hargneux, admirateurs des samouraïs aux sabres effilés et des saints céphalophores : bien après ses guerres, Millán Astray le rapace traduit en espagnol le Bushido japonais, code de l’honneur et de la mort honorable, de la décapitation du soldat vaincu, loi de l’ami qui vous tranche le cou et vous préserve ainsi de la douleur, comme les révolutionnaires français adoptèrent la guillotine pour son côté démocratique et indolore, pour tous une mort de roi, le chef roulant dans le panier, alors qu’avant la Révolution la tête tranchée était réservée aux nobles, les vilains mourant dans de sympathiques souffrances spectaculaires, écartelés ou brûlés le plus souvent, s’ils survivaient à la question — à Damas il y a peu on pendait les opposants aux immenses lampadaires de la place des Abbassides, depuis une nacelle mobile qu’à Paris on utilise surtout pour tailler les arbres, je me rappelle qu’un jour un pendu resté trop longtemps en l’air avait fini par être décapité son corps était tombé sa tête avait roulé jusqu’entre les voitures provoquant un accident qui avait fait un mort de plus, une fillette innocente, sans doute aussi innocente que le type dont le visage sans épaules avait effrayé le conducteur, lui aussi innocent, comme il y a beaucoup d’innocents parmi les tueurs de la valise, autant que chez les victimes, assassins violeurs égorgeurs décapiteurs rituels qui ont appris à manier leur couteau sur des agneaux ou des moutons, ensuite Zeus a fait le reste, en Algérie mes islamistes étaient les champions toutes catégories de l’égorgement, en Bosnie les moudjahidin abattaient leurs prisonniers de la même façon, comme on saigne un animal, et moi-même mon entrée boulevard Mortier est signée de sept têtes de moines abandonnées dans un fossé, je n’échappe pas à la décapitation, ces figures me poursuivent, jusqu’à Rome et au Caravage à sa tête de Goliath le poing fermé de David sur la chevelure ensanglantée ou au palais Barberini si civil Judith l’épée dans la gorge d’Holopherne, le sang jaillit tellement bien, la belle veuve a un air dégoûté et résigné à la fois en tranchant la carotide royale, la servante tient le sac qui enveloppera la relique moite aux yeux grands ouverts, aux cheveux poissés, image sombre entre les scènes religieuses, les saints Jérôme, les portraits d’évêques devenus papes, les jeunes filles innocentes Judith la sauvage décapite gentiment le général babylonien, pour sauver son peuple de la même façon que Salomé obtient la tête du Baptiste, décollé dans sa cellule par un garde rugueux, au couteau épais, tel que l’a représenté le Caravage, encore, sur l’immense toile de la cathédrale Saint-Jean-des-Chevaliers, à Malte, l’été 1608, au moment d’intégrer l’ordre, un an après être arrivé dans l’île imprenable, quarante ans après le siège ottoman où Jean de Valette tirait des têtes turques comme boulets dans ses canons, pour effrayer l’ennemi, Michelangelo Merisi di Caravaggio le Milanais aurait aimé mourir décapité, il mourut malade sur une plage de l’Argentario, face à la mer grise qu’il n’avait jamais peinte, ou qu’il avait toujours peinte, dans les immensités noires où naissent les corps des éphèbes et des saints, des meurtriers des prostituées des soldats déguisés en saints, le Caravage grand maître de l’obscurité et de la décapitation
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Zone»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Zone» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Zone» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.