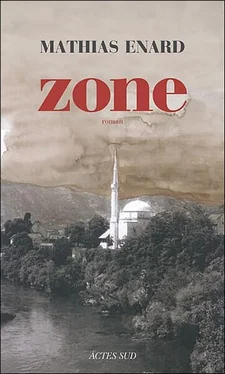Mathias Énard - Zone
Здесь есть возможность читать онлайн «Mathias Énard - Zone» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Город: Paris, Год выпуска: 2008, ISBN: 2008, Издательство: Éditions Actes Sud, Жанр: Современная проза, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Zone
- Автор:
- Издательство:Éditions Actes Sud
- Жанр:
- Год:2008
- Город:Paris
- ISBN:978-2-7427-7705-1
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Zone: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Zone»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Par une nuit décisive, un voyageur lourd de secrets prend le train de Milan pour Rome, muni d’un précieux viatique qu’il doit vendre le lendemain à un représentant du Vatican pour ensuite — si tout va bien — changer de vie. Quinze années d’activité comme agent de renseignements dans sa Zone (d’abord l’Algérie puis, progressivement, tout le Proche-Orient) ont livré à Francis Servain Mirkovic les noms et la mémoire de tous les acteurs de l’ombre (agitateurs et terroristes, marchands d’armes et trafiquants, commanditaires ou intermédiaires, cerveaux et exécutants, criminels de guerre en fuite…). Mais lui-même a accompli sa part de carnage lorsque la guerre en Croatie et en Bosnie l’a jeté dans le cycle enivrant de la violence.
Trajet, réminiscences, aiguillages, aller-retour dans les arcanes de la colère des dieux. Zeus, Athéna aux yeux pers et Arès le furieux guident les souvenirs du passager de la nuit. Le train démarre et, avec lui, commence une immense phrase itérative, circulatoire et archéologique, qui explore l’espace-temps pour exhumer les tesselles de toutes les guerres méditerranéennes. Car peu à peu prend forme une fresque homérique où se mêlent bourreaux et victimes, héros et anonymes, peuples déportés ou génocidés, mercenaires et témoins, peintres et littérateurs, évangélistes et martyrs… Et aussi les Parques de sa vie intérieure : Intissar l’imaginaire, la paisible Marianne, la trop perspicace Stéphanie, la silencieuse Sashka…
S’il fallait d’une image représenter la violence de tout un siècle, sans doute faudrait-il choisir un convoi, un transport d’armes, de troupes, d’hommes acheminés vers une œuvre de mort. Cinquante ans après
de Michel Butor, le nouveau roman de Mathias Enard compose un palimpseste ferroviaire en vingt-quatre “chants” conduits d’un seul souffle et magistralement orchestrés, comme une
de notre temps.
Né en 1972, Mathias Enard a étudié le persan et l’arabe et fait de longs séjours au Moyen-Orient. Il vit à Barcelone. Il a publié deux romans chez Actes Sud :
(2003) — Prix des cinq continents de la francophonie, 2004 — qui paraît en Babel, et
(2005). Ainsi que, chez Verticales,
(2007).
Zone — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Zone», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
X
le nonce apostolique ambassadeur du Saint-Siège en Syrie était un homme charmant cultivé d’une bonne famille italienne c’est Harout Bedrossian Arménien catholique qui me l’a présenté — curieux les détours qu’a souvent le Destin pour mieux retomber sur ses pieds, une fois la valise remplie il me fallait la vendre, vider ces milliers de documents de noms et de récits patiemment récoltés tout autour de ma Zone en commençant par Harmen Gerbens le tortionnaire hollandais, des documents récupérés en cinq ans d’enquêtes interminables, de vols de papiers secrets d’archives de recoupements de témoignages, pourquoi ces milliers d’heures à reconstituer patiemment cette liste, pour remplir la vie terriblement vide du Boulevard et de Paris, pour donner un sens à mon existence peut-être, qui sait, pour partir en beauté, pour me faire pardonner mes morts, mais par qui, obtenir la bénédiction du Saint-Père, ou tout simplement de l’argent qui vaut tous les pardons, pour m’installer quelque part sous le nom d’Yvan Deroy mon double cloîtré dans sa folie et sa violence, mes papiers sont légaux, réels, comme ceux que j’utilisais pour circuler dans la Zone, les Pierre Martin, les Bertrand Dupuis si simples qu’ils en devenaient immédiatement vrais, je crois que je laissais peu à peu mon identité dans ces pseudonymes, je me divisais, petit à petit Francis Servain Mirkovic se dissolvait dans les vrais faux papiers pour se reconstruire comme un atome dans les milliers de noms de la valise, regroupés en un seul, Yvan Deroy pauvre dingue qui n’a sans doute jamais vu la mer ni caressé une femme, enfermé depuis toujours, il est si facile de s’approprier une identité, de mettre son visage à la place d’un autre, de prendre sa vie, né la même année que moi, il a eu la même adolescence fascinée par les idéologies violentes, oscillant entre l’extrême droite et l’extrême gauche avec une facilité déconcertante, sans opinion, en fait, à part celle de ses amis, Yvan Deroy s’il était sorti de son hôpital aurait collé des affiches néonazies, séduit par l’ordre martial et la haine, enchaînant préparation militaire sur préparation militaire et devançant l’appel pour enfin devenir un homme, un vrai, comme on dit, faisant l’admiration de ses parents et promis à un beau destin, le service militaire l’apprentissage des armes, de l’humiliation et de l’esprit de corps, cet esprit de corps qui intéressa tant Millán Astray le fondateur de la Légion espagnole lors de sa visite chez les Français à Sidi bel-Abbès en Algérie, le village fortifié dans la plaine oranaise inspira grandement le général borgne, les légionnaires venus de l’Europe entière se reconstruisaient dans la caserne, ils retrouvaient une famille un pays dans la Légion et plus que la France ils servaient la Légion elle-même, mon service militaire fut instructif, le crapahut en chantant, mon sac, mon fusil et mes camarades, camps, marches de nuit, j’aimais ce rythme, cette vie bien remplie, l’illusion de l’importance et de la responsabilité que vous donne un grade, un scratch en velcro sur la poitrine, un commandement, un pouvoir — au camp Joffre de Rivesaltes nous bivouaquions dans des baraquements plutôt sordides, descendus du plateau du Larzac des Corbières ou de je ne sais où avec armes et bagages — exercices de tir, manœuvres, j’ignorais bien sûr où nous campions, ce qu’étaient ces bâtiments délabrés, qui ils avaient accueilli en février 1939, puis en 1942, puis en 1963, bref toutes les utilisations possibles d’un camp militaire bien placé, proche de la route, de la voie ferrée et de la mer, un camp dont j’ai vu des images d’époque bien plus tard, je dormais dans un sac de couchage kaki là où avaient dormi les réfugiés espagnols républicains, soldats ou civils, rouges ou noirs, ceux qui effrayaient tant la France de Daladier qu’on jugea préférable de les interner puis de les exploiter dans des usines d’armement et pour la fortification des côtes avant que les Allemands ne les déportent à Mauthausen, pour la plupart, parmi eux Francesc Boix le photographe, né à Barcelone dans le quartier de Poble Sec le 31 août 1920, interné à Rivesaltes puis à Septfonds, enrôlé dans les Compagnies de travailleurs étrangers et capturé par les Allemands il arrive à Mauthausen le 27 janvier 1941, il y restera quatre ans, le triangle bleu agrafé sur la poitrine : ses clichés volés aux SS documentent la vie du camp, la mort omniprésente, Francesc Boix témoigne à Nuremberg et à Dachau, il meurt à Paris le 4 juillet 1951, deux mois avant son trente et unième anniversaire Francesc Boix meurt de maladie à l’hôpital Rothschild sans avoir revu Barcelone, à Paris il habitait une chambre de bonne rue Duc au coin de la rue du Mont-Cenis, à cinq minutes à pied de chez moi, nous nous sommes croisés au camp de Rivesaltes, nous nous sommes croisés sur les pentes de Montmartre, il travaillait comme photographe au journal L’Humanité , bien sûr, pour quoi d’autre que pour l’humanité, je suis allé voir sa maison natale à Barcelone, un quartier tranquille, à flanc de coteau, avec des arbres, un bâtiment du début du siècle sis au numéro 19 de la calle Margarit, son père tailleur possédait une échoppe au coin de son immeuble, aujourd’hui il y a un bar, j’y ai bu un canon à la santé du jeune socialiste espagnol qui s’est enrôlé dans l’armée républicaine fin 1938, alors que la débâcle était certaine, que la bataille de l’Ebre était perdue et que Franco, Millán Astray, Yagüe et les autres fonçaient sur Barcelone l’irréductible, propulsant cinq cent mille militaires et civils sur les routes de l’exil, ils passèrent la frontière à Cerbère, au Perthus, à Bourg-Madame, beaucoup finiront par retourner en Espagne ou choisiront l’exil au Mexique : Francesc “Franz” ou “Paco” n’a pas cette chance, il quitte définitivement Barcelone avec ses compagnons d’armes, la République est défaite, Paco ne perd pas le sourire, il a dix-sept ans, l’espoir, de l’humour, de la joie, une passion pour la photographie et un petit appareil photo que lui a offert le fils d’un diplomate soviétique, un Leitz modèle 1930, grâce auquel il a publié ses premiers reportages dans la revue Juliol , alors que le Front tenait encore bon et que la révolution était en marche, Francesc Boix sera le reporter de Mauthausen, je l’imagine en uniforme rayé, dans le froid terrible de l’Autriche, quatre hivers, quatre longs hivers de souffrance de maladie de mort qu’il occupe en dissimulant des clichés, en organisant la résistance, jusqu’à la libération — les Espagnols libèrent le camp eux-mêmes et pendent une banderole pour accueillir les Américains, Mauthausen et Gusen débordent de cadavres, mais si peu au vu des cent cinquante ou deux cent mille décès du complexe de camps, parmi eux les massacrés de la carrière de granit, les gazés de Hartheim, les morts par hypothermie, trempés dans l’eau glaciale pendant des heures, les victimes des expériences médicales, les électrocutés, les pendus, les fusillés, les malades, les affamés, les épuisés par le travail, les asphyxiés dans les camions à gaz, les battus à mort, selon la longue liste des modus operandi nazis, j’avais dix-huit ans j’ignorais le destin de Francesc Boix quand je jouais à la guerre dans le camp de Rivesaltes, je n’ai pas le souvenir d’y avoir rêvé de déportation, celle des Espagnols ou celle des juifs étrangers qui y transitèrent, en route vers la mort, ou celle des harkis que la France y installa en 1963 et dont certains y demeurèrent plus de sept ans avant qu’on ne leur trouve un logement définitif — dans ces baraquements pourris qui tombaient en ruine les uns après les autres aucune plaque, aucune stèle aucun souvenir, Francesc Boix le photographe de l’ Erkennungsdienst de Mauthausen, le tout jeune homme de la rue Margarit à Barcelone, le témoin du procès de Nuremberg, à quoi pensait-il, après avoir témoigné, de retour au Grand Hôtel, il a aperçu Speer, Göring ou Kaltenbrünner dans les box des accusés, il a commenté les clichés dérobés aux SS, pris par l’étrange officier artiste Paul Ricken, auteur, en plus des images officielles du camp, de près d’une centaine d’autoportraits, de face, de profil, en uniforme, en civil, en armes, à cheval — c’est peut-être à lui que pense Boix, ce 27 janvier 1946 allongé sur son lit dans la chambre 408 du Grand Hôtel de Nuremberg, il repense à une des photos de Ricken, une des plus troublantes, où le nazi s’est pris allongé dans l’herbe, les bras le long du corps, en costume, bien chaussé et cravaté, dans la même pose que les pauvres types abattus par les gardes quand, d’après les Allemands, ils essayaient de s’enfuir : Ricken s’est offert un simulacre de mort violente, il s’est mis en scène comme le cadavre qu’il avait photographié la veille, pour quelle raison, Boix a des tirages avec lui, il les regarde, allongé sur son lit, il prépare la deuxième partie de son témoignage, que va lui demander l’avocat de la défense ? bah, on verra bien, il a une pensée pour Marie-Claude Vaillant-Couturier, si belle, il a fait son portrait pour la une de Regards , ils se sont rencontrés dans les couloirs, ont-ils parlé d’Espagne, qui sait, Vaillant-Couturier a écrit un reportage sur les Brigades internationales, elle témoigne aussi sur les camps, on dit qu’elle a franchi l’entrée monumentale de Birkenau en chantant La Marseillaise , elle est réellement magnifique, je me demande si Boix était amoureux d’elle, s’il la désirait, il avait sans doute la tête ailleurs, se souvenait-il encore de sa baraque à Rivesaltes, peut-être la même que celle où j’ai dormi, près de cinquante ans plus tard, moi aussi en uniforme, presque aussi jeune que lui mais promis à un autre destin : l’idée des documents de la mallette vient peut-être de Boix le photographe de Barcelone, en tout cas les 296 images de Paul Ricken sont bien rangées, numérisées, dans ma valise, pas celles de Mauthausen, mais celles de Graz, un sous-camp où Ricken a été muté fin 1944, le reportage de la marche de la mort de l’évacuation vers Ebensee, des centaines de mourants achevés par balle une fois tombés d’épuisement, les photos de Ricken le sec sont nettes et artistiques, il a pris son temps, pas un instantané tremblé plus ou moins flou, mal composé, tout l’inverse, une œuvre morbide consciente et précise où il cherchait à percer un secret, peut-être, Ricken l’artiste SS fou a été condamné à la prison à perpétuité au procès de Dachau en 1946, les 296 clichés sont restés clandestins — 296 plans rapprochés, presque toujours cadrés de la même façon, où l’on voit le visage du bourreau au moment où il tire, parfois crispé, parfois détendu, impassible le plus souvent, et l’effet du tir, au même moment, un nuage noir qui s’élève de la tête d’un homme étendu, collection d’exécutions documentant le massacre, comment Ricken a-t-il pu convaincre les SS de se laisser photographier, je n’en sais rien, Paul Ricken était un bizarre, professeur d’histoire de l’art membre du Parti national-socialiste dès la première heure, Boix et ses camarades espagnols le décrivent comme un type plutôt agréable, pas une brute, il ne dénonçait jamais ses “employés” détenus, ne faisait preuve d’aucune violence, il était juste un rien dérangé, je crois qu’il documentait sa propre déchéance morale dans ses centaines d’autoportraits, il se voyait tomber avec le monde autour de lui, tomber dans la nuit sans fond et c’est cette nuit qu’il photographie une semaine durant pendant la marche de la mort, c’est un parcours, un itinéraire, comme le mien depuis le camp de Rivesaltes jusqu’au train pour Rome, la disparition d’un homme dans la fascination de la violence, la sienne propre et celle des autres — Francis Servain Mirkovic s’est désagrégé de la même façon que Paul Ricken, peut-être ai-je voulu moi aussi documenter le voyage, disparaître et renaître sous les traits d’Yvan Deroy, si cela est possible, le train avance, bientôt Bologne, puis Florence et enfin Rome, j’ai soudain la sensation inouïe que quelque chose va se produire dans ce wagon, quelque chose de tragique comme au cours de la marche de Paul Ricken l’artiste nazi à lunettes, mon voisin dort, la tête en arrière la bouche ouverte le couple des mots croisés discute à voix basse rien de nouveau sous le soleil ferroviaire température constante vitesse plus ou moins constante pour autant qu’on puisse en juger sur l’écran noir de la fenêtre où s’anime, de temps en temps, une bourgade sinistre, à Rivesaltes nous allions en camion, de vieux camions bâchés qui grinçaient couinaient se balançaient sur leurs amortisseurs pourris, les chauffeurs étaient eux aussi des appelés formés sur le tas dans une cour de caserne, leurs notions de conduite étaient on ne peut plus militaires et succinctes, debout sur le frein dans les descentes, on était bringuebalés comme des sacs dans les virages, j’ai retrouvé ces sensations dans d’autres camions en Slavonie ou en Bosnie sauf que le plus souvent c’était Vlaho qui conduisait, tout aussi mal mais avec le sourire, le bougre a failli plus d’une fois nous balancer dans la Neretva avec armes et bagages, têtu comme une mule il était aussi impossible de lui faire lâcher le cerceau que de lui apprendre à utiliser le frein moteur, pour lui rétrograder eût été déchoir, une lâcheté, et encore aujourd’hui, mutilé, il descend les pentes dalmates à fond de train dans un véhicule spécialement modifié pour son handicap, Vlaho le chauffard vigneron catholique il y a longtemps que je ne l’ai pas vu, j’avoue que c’est entièrement de ma faute, trop de souvenirs, l’ombre d’Andrija, de nos exactions de soudards, nous parlerions de guerre, c’est certain, je me demande si Francesc Boix aimait revoir ses compagnons de déportation, il ne souhaitait sans doute pas se rappeler certains moments, les petites lâchetés quotidiennes de l’univers concentrationnaire, on ne survit pas quatre ans à Mauthausen sans quelques compromissions, sans entrer dans la zone grise des privilégiés, des Prominenten mieux nourris, moins battus que leurs camarades, dociles exécutants, comptables, administrateurs ou photographes au service du camp, qui pourra leur reprocher d’avoir échappé aux cent quatre-vingt-six marches de la carrière de pierres, aux baignoires glacées ou aux manches de pioche, d’avoir réussi à tirer leur épingle du jeu et survécu, les prisonniers de luxe étaient autorisés à se déplacer librement dans l’enceinte du camp, y a-t-il une culpabilité à survivre c’est probable, à Venise au bord de l’eau noire quand je pensais à Andrija j’étais pris de honte et de douleur, la triste mort d’Andrija dont je porte le cadavre absent, où que j’aille, il pèse, j’avance avec son corps sur les épaules une valise à la main, tout cela est bien lourd — au départ Lebihan mon chef pustuleux trouvait tout à fait naturelle ma passion pour les archives et les secrets, il me disait vous verrez, ça vous passera, les débutants sont toujours enthousiastes, c’est bien normal, après tout c’est un des avantages du métier, ces connaissances, il m’aidait à obtenir des informations auxquelles je n’aurais pas eu accès normalement, de vieilles fiches qui n’intéressaient plus personne mais étaient encore classifiées “secret-défense”, des rapports d’époque souvent microfilmés, des dossiers personnels, Lebihan disait que cette façon de faire était la meilleure pour m’apprendre le fonctionnement réel du Service, savoir comment obtenir telle ou telle information, etc., sa maxime était “les archives sont le terreau du renseignement”, c’était un vieux de la vieille de “l’humain”, comme on dit, avec lui j’étais à bonne école, quand il est parti à la retraite il m’a invité à déjeuner, des huîtres au Wepler, s’il vous plaît, il était plutôt content, même s’il me disait ça va me manquer, tout ça, je l’imagine découper des journaux dans une campagne aux alentours d’Evreux ou de Vannes, recoupant les sources, remplissant des classeurs aux ciseaux et à la colle, à moins qu’il ne s’adonne plus qu’à sa passion pour le vélo, Lebihan me racontait en engloutissant ses fines de Claire place de Clichy que quand il avait débuté, pour un autre service , il adorait enquêter dans les milieux du cyclisme, nous avons tous nos marottes, ajoutait-il en référence aux miennes, moi c’était le vélo, les gauchistes et les anars dans la petite reine — il n’y a pas de sot métier, j’ai pensé, et bien des facettes à la sécurité nationale — bien sûr on n’en trouvait pas beaucoup, des gauchos dans la pédale, mais bon, j’en dénichais à chaque fois quelques-uns, surtout des journalistes sportifs, hé hé, mes chefs du moment me disaient toujours enfin, Lebihan, allez plutôt à la Sorbonne ou à Nanterre, c’est là que ça recrute, alors je traînais mes guêtres à la fac quelque temps pour noyer le poisson, mais dès qu’il y avait la possibilité de suivre le Tour ou un Paris-Roubaix, j’en étais — aujourd’hui il doit se passionner pour les scandales et les enjeux financiers de son sport favori, expliquer les tenants et aboutissants des affaires à une épouse distraite ou à des copains de bistrot, bien sûr je n’ai aucune nouvelle de Lebihan depuis notre dernière poignée de main après le cognac au Wepler, il était ému, le vieux cycliste, pensez, il m’avait formé, et bien formé, il avait asséché le style de mes notes et de mes rapports, m’avait appris tous les secrets des métiers de l’ombre, des fiches et des archives, jusqu’à en remplir la valise, il se doutait de quelque chose, bien sûr, mais il était trop proche de la retraite pour se préoccuper vraiment de quoi que ce soit, pas envie de se mettre de possibles ennuis sur le dos, l’histoire avec Stéphanie ferait le tour du Service, enfin presque, les “relations intimes” entre fonctionnaires n’étaient pas encouragées, même si, au fond, elles résolvaient un certain nombre de problèmes de sécurité, au pire les possibles fuites resteraient internes et les conversations sur l’oreiller ne passeraient pas, si je puis dire, la porte du Boulevard : c’est le dénouement de l’affaire qui m’a valu un “éloignement” stratégique au fond de la Zone pour quelque temps, afin de ne pas la croiser tous les jours, et ce grâce aux intrigues de Lebihan auprès de la direction du personnel, merci au chef paternaliste fondu de bicyclette — Francesc Boix le photographe de Mauthausen adorait le vélo, lui aussi, il couvrit le Tour de France de 1947 à 1950 pour L’Humanité et Regards , à l’arrière d’une moto, comme il se doit, Lebihan l’aurait peut-être fiché comme “rouge” à la fin des années 1960 s’il n’était pas décédé en 1951, pauvre Francesc mort d’une étrange maladie de misère ou de remords contractée au camp, une de ces maladies inexplicables dont la mort est la seule issue, j’imagine d’où elle peut provenir, un soir de l’hiver 1943 qui sait Francesc Boix a peut-être reçu quelques faux reichsmarks du camp de Mauthausen en échange de son travail, Paul Ricken l’a à la bonne, il lui a obtenu d’aller faire un tour dans la première baraque près de l’entrée, le bordel pour les prisonniers, ouvert après la visite de Himmler six mois plus tôt, la passe coûte deux marks quelques déportées de Ravensbrück y travaillent elles ont été choisies par les SS elles sont belles dit-on, Boix traverse la cour principale dans la nuit, la première fois qu’il est allé au bordel c’était à Barcelone, près du Parallèle, dans un quartier trouble de ruelles puantes, un claque à l’ancienne, rouge, velouté, la chambre minuscule sentait la luxure et l’onguent prophylactique du Doctor Cáspar, il s’est allongé avec une Aragonaise grassouillette, nettement plus âgée que lui, l’affaire a été vite bouclée, il s’est reculotté en hâte pour achever de s’enivrer avec ses camarades, il aurait bien pris la jeune femme en photo, un souvenir de ses cuisses laiteuses et de sa toison abondante, qui remontait presque jusqu’au nombril, il se souviendra d’elle, mais peut-être pas vraiment de la jouissance, du moins pas autant qu’il aimerait s’en souvenir, le plaisir est un éclair sans traces, il traverse la cour de Mauthausen le mouroir pour aller retrouver son ami Garcia au bordel, récompense ultime du pouvoir nazi à ceux qui le servent bien : l’Allemagne nous tient par les couilles, pense-t-il, l’Allemagne nous tient par les couilles et il rigole tout seul, ce matin quinze Tchèques et Yougoslaves ont été fusillés par la Gestapo juste à côté du bureau d’identification où il travaille, il développait des films quand il a entendu les coups de feu, il est sorti de la chambre noire a regardé par la fenêtre a vu les cadavres affalés contre le mur il y avait quatre femmes parmi eux, et maintenant la nuit tombée il va au bordel où il y a un tourne-disque avec des chansons allemandes, les “gardiens” du claque sont des droit commun, envoyés ici après les crimes les plus terribles, assassins, violeurs, ces dégénérés sont les rois du camp, leurs sujets les juifs, les Polonais et les homosexuels, les nobles sont les opposants allemands, les républicains espagnols, bref toute la hiérarchie nazie — Francesc Boix croise quelques prisonniers faméliques qui reviennent d’un Kommando extérieur, il les salue avec respect, il sait qu’il a de la chance, que les quelques Espagnols employés dans les services d’administration du camp sont des privilégiés, que les détenus succombent les uns après les autres, épuisés, rompus par l’esclavage et le sadisme des gardiens, il salue aussi Johannes Kurt le SS qui les accompagne, pas un des plus méchants, pas un des meilleurs non plus, parmi les détenus il y a aussi d’anciens SS des déserteurs du front de l’Est, ceux-là n’échappent à aucune corvée à aucun travail pénible ils ne vont pas durer longtemps, ils ont déchu, ils ne méritent pas de vivre, ils ont trahi la patrie et son Führer hargneux, Francesc arrive à la porte du bordel, il y entre, retire son béret, dans l’antichambre un ex-garde-chiourme converti en maquereau est avachi dans un fauteuil, ses yeux brillent, la pièce pue l’alcool de pelures de patate, il y a de la musique, guten Abend, Spanier lui dit l’homme, il lui fait signe de passer, dans la salle des femmes des femmes en civil et des hommes en costume rayé, des voix des conversations amènes des rires au milieu du bruit des sabots en bois sur le parquet, une dizaine de putains, le double de détenus, Boix avise Garcia en grande conversation avec une des dames, il s’approche, le calot à la main comme un enfant timide, les femmes parlent allemand, Garcia le présente, il s’empresse de demander ich heisse Franz. Wir gehen ? dans son germain de contrebande, ils s’en vont vers une des pièces adjacentes, Francesc tend ses deux reichsmarks, la fille les prend, laisse tomber sa robe, sa peau est couverte de bleus et de cicatrices, elle lui fait signe d’aller vers le lavabo, elle baisse son pantalon rayé lui lave les parties en l’examinant soigneusement pour voir s’il n’a pas de poux, l’eau est glaciale il a l’impression que son engin se rétracte jusqu’au fond de son pelvis, il a un peu honte, il se souvient de Barcelone ici il est muet, il attrape un des seins tombants de la femme elle le regarde d’un air apeuré il ferme les yeux repense à sa putain aragonaise à la photographie qu’il n’a pas prise l’Allemande le tire par le sexe jusqu’au lit elle s’allonge elle écarte les jambes Francesc s’étend sur elle elle pue la sueur et le baraquement elle s’appelle peut-être Lola peut-être Gudrun il remue tant qu’il peut sans résultat elle pousse des cris de carnaval il fait semblant de jouir se relève lui sourit elle est laide ils ne sont dupes ni l’un ni l’autre — Francesc Boix retourne dans la grande salle le sourire aux lèvres Garcia lui donne une tape sur l’épaule, ça va mieux, hein, dit-il, et Boix répond sans mentir oui, ça va mieux, ça va déjà mieux et ça ira encore mieux bientôt, à quel moment sait-il qu’il va s’en sortir, qu’il va survivre, à quel moment prend-il la décision de survivre ? on raconte que les déportés savaient, voyaient ceux qui avaient une chance et ceux qui allaient crever, Manos Hadjivassilis un des résistants grecs de l’ELAS parvenu à Mauthausen après tout un périple, évadé deux fois, repris à près de mille kilomètres de Salonique aux alentours de Gorizia en compagnie de partisans yougoslaves, à peine parvenu au camp, encore dans la file d’attente pour l’identification, déjà détruit par ce qu’il voyait autour de lui, pris par la certitude que c’était la fin, Manos sortit soudain des rangs se mit à courir en direction des barbelés électrifiés pour s’y jeter, l’électricité lui contracta tous les muscles le fit saigner du nez et de la bouche dans une odeur d’ozone et de chair grillée il était encore vivant quand un gardien l’acheva d’une pieuse rafale, exit Manos Hadjivassilis le communiste grec de Macédoine qui avait parcouru l’Epire et traversé les Balkans à pied un fusil à la main, l’image de son cadavre photographié par Paul Ricken apparaîtra dans le bain révélateur de Francesc Boix, puis pendue sur une corde à linge pour sécher, entre-temps le corps de Manos aura déjà disparu dans le crématoire, pour finir au cœur du ciel poisseux d’Autriche, espérons que Zeus le patient ait fait pleuvoir ce nuage gris au-dessus de l’Olympe, Boix sortira du camp, lui, et ira même en Grèce couvrir la guerre civile pour des publications communistes, un répit, un bref sursis avant l’hôpital Rothschild et le cimetière de Thiais, Francesc était déjà mort, il était déjà mort à Mauthausen dont on ne sort pas, il était mort entre les bras de la prostituée allemande, un soir au bordel de la baraque n o 1, dans l’impossible contact avec cette Gudrun ou Lola, son âme tombée entre leurs deux corps, c’est là qu’il avait contracté la maladie, là, dans l’impossibilité de trouver autre chose que la chair plus ou moins putride, aucun autre contact possible, aucune consolation, une solitude éternelle l’avait pris, il flotterait sur le monde sans rien toucher, comme Paul Ricken documentariste de la déchéance, atteint de la même affection — si j’y pense mes tentatives pour échapper à la Zone au souvenir participent peut-être du même syndrome, que s’est-il passé, à Venise avec Marianne, à Paris avec Stéphanie la brune, dans les bars à putes de Zagreb ou les cabarets sordides d’Alep, que s’est-il passé en Bosnie, qu’est-ce qui m’attend à la fin de ce voyage, à Rome, dans la tendresse distante de Sashka et de son appartement, qu’est-ce qui m’attend sous le nom d’Yvan Deroy le fou, vais-je pouvoir me débarrasser de moi-même comme on enlève un pull-over dans un train surchauffé, dans la désespérance noire de la nuit bolonaise, des banlieues à n’en plus finir, je frissonne au souvenir du visage de Stéphanie, je revois son portrait balancé hier avec le reste des objets inutiles de l’appartement, peut-être un clochard va-t-il le récupérer pour le cadre ou pour les cheveux châtain foncé mi-longs, les quelques taches de rousseur sur le nez et les pommettes, le demi-sourire très posé, sûre d’elle, le col roulé noir, une image de trois quarts avec Sainte-Sophie et le Bosphore derrière elle, à la fenêtre de notre dernière chambre d’hôtel, un portrait d’une beauté fulgurante, peut-être le clodo qui fouille dans la poubelle tombe-t-il lui aussi amoureux d’elle, il la voit et aussitôt il se pâme, il va garder la photo pour se tenir compagnie, il lui parlera, lui inventera un prénom une vie une histoire d’amour passionnelle, s’il savait, s’il connaissait Stéphanie Muller l’Alsacienne brillante forte et dangereuse, je l’ai croisée avant son départ en poste, avant qu’elle ne soit sous la gouttière, comme on dit dans notre jargon, être sous la gouttière signifie partir en poste à l’étranger et donc recevoir sur la tête une pluie d’espèces sonnantes et trébuchantes correspondant à trois ou quatre fois un salaire parisien, Stéphanie promise à un grand avenir est sans doute à Moscou à l’heure qu’il est, je suis censé ignorer où elle se trouve, je n’aurais pas dû repenser à elle, il doit faire bien froid à Moscou, un peu comme en Alsace, pas du tout comme ici en Italie douce et méditerranéenne, je me retourne sur le siège, j’ai envie de me lever, de faire quelques pas pour chasser l’image de Stéphanie au corps parfait, à la voix parfaite, à l’intelligence aiguë, Stéphanie à qui je racontais l’histoire de Francesc Boix le photographe de Mauthausen lors de notre voyage à Barcelone, comment peux-tu te passionner pour des histoires pareilles, disait-elle, elle lisait Proust et Céline, rien que Proust et Céline, ce qui lui donnait, je crois, le cynisme et l’ironie nécessaires à sa profession, elle relisait le Voyage et la Recherche qu’elle appelait ainsi, par leur petit nom, le Voyage et la Recherche , tous deux dans la Pléiade, comme il se doit, et me remplissait d’une admiration jalouse, je n’avais pas réussi à terminer la Recherche , les histoires de nobles et de bourgeois parisiens m’ennuyaient presque autant que les jérémiades de leur narrateur, et le Voyage me déprimait terriblement, bien que les errances de ces pauvres types aient tout de même quelque chose de touchant, quand nous partions en vacances ou en week-end Stéphanie mettait dans son sac, au hasard, un des volumes de Proust ou le premier tome de Céline, on ne change pas de marque de parfum, elle ne changeait pas de livre, son Chanel et son Marcel, et voilà, prête à partir, ses seules concessions à la nouveauté étaient des ouvrages sur Proust et Céline, séparément ou les deux à la fois, qu’elle lisait d’un œil distrait, critique, et ces essais la confortaient dans sa monogamie, la poussaient à revenir au Texte après le commentaire : écoute, disait-elle, je me fade des notes et des rapports toute la journée, je rédige des analyses, j’ai bien le droit à un peu de détente, le droit de lire des trucs bien écrits, ça me change, Stéphanie est une spécialiste de ce qu’on appelle le risque-pays , elle a travaillé quelque temps à la délégation des Affaires stratégiques avant de passer le concours de notre magnifique caserne de l’ombre, avant qu’on ne lui suggère, plutôt, de passer ce concours administratif discret — à Barcelone ville des banques et des palmiers je cherchais les traces de Boix, des républicains, des anarchistes, des miliciens du POUM, des staliniens du PSUC, elle, elle parlait tapas, musée Picasso, Miró, elle disait c’est sympathique , ce restaurant est très sympathique , le quartier est vraiment sympathique , Gaudí, c’est sympathique , elle était tellement belle, avec ses lunettes de soleil sur le port, en regardant partir les ferries qui vont à Majorque et à Minorque, ses cheveux jusqu’aux épaules, sa main dans la mienne, j’en oubliais ma Zone, ma valise, je devenais un touriste, ce qui est la plus agréable des conditions quand on est deux, qu’on a de l’argent et envie de faire l’amour tout le temps, elle me répétait arrête de penser à ces histoires de guerre, on rentre à l’hôtel ? nous rentrions à l’hôtel dont on ne ressortait qu’à la nuit tombée, pour nous enfoncer dans le carnaval des ruelles du centre de Barcelone qui donnaient l’impression d’avoir été fabriquées par les touristes eux-mêmes pour les rendre sympathiques , comme une vieille putain se met une perruque violette s’il le faut, prête à tout pour vous plaire, Barcelone susurrait fiesta, fiesta à l’oreille de l’homme du Nord prêt à tout pour se divertir, pour s’empiffrer de soleil et de paella, pour se noyer dans des litres et des litres de sangria rouge et épaisse comme le sang des taureaux de la Monumental dont le décès rituel donnait des frissons d’interdit aux Français, aux Anglais, aux Allemands convaincus par le spectacle si réussi d’une Espagne sauvage et mystérieuse qu’ils seraient seuls à connaître, on trouvait même de l’absinthe pour les nostalgiques incurables, je me souviens il y avait un rade appelé Marseille au détour d’une ruelle sinueuse peuplée de péripatéticiennes très laides, un bar tenu par un Allemand chauve, obèse et antipathique, une taverne puant la crasse, l’anis et le tabac froid, je suis entré avec Stéphanie aveuglé par l’amour et le Guide du routard , on nous a lancé une absinthe qui aurait fait pleurer Van Gogh, avec une bouteille d’eau en plastique et un sucre emballé dans du papier, les traditions se recomposent, les touristes et les jeunes indigènes touillaient leur sucre dans l’absinthe avec une cuiller façon café au lait, la fée verte avait un goût déprimant de chartreuse, la musique et les voix étaient assourdissantes, sympathiques , si vivantes, je pensais à ce pauvre Francesc Boix et à sa prostituée aragonaise, les stars du quartier s’appelaient Jean Genet et Pierre Mac Orlan, il y avait même un restaurant de poisson très chic qui s’enorgueillissait de les avoir reçus et arborait fièrement les écussons de guides touristiques du monde entier, la lopette Genet le voleur famélique ne devait pas dîner souvent dans des restaus de grande classe, paix à son âme, avec ses michetons et ses gitans aux longs surins brillants, l’Allemand chauve et puant a fini par nous mettre dehors parce que nous ne consommions pas assez vite à son goût, au fond une libération, le petit-fils qui sait d’un des gardiens de Boix à Mauthausen sert maintenant de l’absinthe aux petits-neveux du photographe, Stéphanie était un peu ivre et enchantée de l’expérience, elle ne voulait pas rentrer tout de suite, nous sommes allés faire un tour sur le port, là où en 1569 Miguel de Cervantès s’était embarqué pour l’Italie, deux ans avant la bataille de Lépante, dont on fabriquait les immenses galères dans les darses toutes proches, reconverties aujourd’hui en musée de la Marine — Cervantès avec sa collerette voit sur la plage les navires militaires tirés au sec, les chiourmes qui festoient sans savoir que bientôt il sera à bord d’un de ces vaisseaux, à manœuvrer une arquebuse face au Turc cruel, il observe un moment les feux sur le sable, c’est le soir, il s’enfonce dans les ruelles près de l’église Sainte-Marie-de-la-Mer pour trouver un estaminet propice à l’ivresse, où l’on sert le vin épais des villages alentour et, passablement soûl, peu avant minuit, il engage une discussion animée avec un gentilhomme du cru : pourquoi en viennent-ils aux mains, je l’ignore, ils décident de sortir, enflammés par l’alcool et les insultes ils tirent leurs épées sur une placette voisine, Cervantès est un bravache mais il est ivre, le fer s’entrechoque par deux fois, deux fois seulement et son fleuret s’envole, le laissant désarmé à la merci du Catalan, qui devait être poète, qui devait très certainement être poète car au lieu de l’embrocher sur-le-champ il décide d’humilier le Madrilène, lui ordonne de se mettre nu, là, à la pointe de l’épée, avant de lui faire administrer une solide correction par ses gens d’armes et de le laisser à moitié évanoui contre les pavés mal équarris dans la nuit cruelle — fourbu, endolori Cervantès se traîne jusqu’à la muraille qui entoure le port, il est encore soûl, et il rit, il ne peut s’empêcher de rire aux éclats de sa propre infortune, décidément il n’y a plus de chevaliers ni d’esprit chevaleresque, l’homme est nu, maintenant, dans les méandres de la modernité, il enfile le caleçon long que son adversaire a eu la gentillesse de lui laisser non sans l’avoir préalablement trempé dans le caniveau, l’enfile et retourne chercher une taverne accueillante où continuer à rire et oublier ses contusions, sans chemise, aussi dévêtu que Don Quichotte dont il aura l’intuition bien plus tard, en repensant à la rixe barcelonaise, rixe d’ivrognes comme il se doit en littérature — avec Stéphanie nous sommes allés dans un estaminet bien différent, le côté moderne, stylé, de la capitale catalane, un endroit rouge et blanc, sobre, où les clients buvaient debout, dans la fantasmagorie artistique d’un projecteur de vidéos, des cocktails aux couleurs assorties : il y avait des hommes bien habillés, des femmes élégantes, et le contraste était si grand qu’on avait l’impression d’une ville devenue schizophrène, ou illusionniste, d’un côté le faux sordide nostalgique et de l’autre l’image la plus avant-gardiste de la modernité tranquille et bourgeoise, bien loin de Don Quichotte, les deux aspects tout aussi artificiels l’un que l’autre me semblait-il, l’identité de Barcelone doit se trouver cachée quelque part entre ces deux images, comme Beyrouth de l’autre côté exactement de la Zone se balançait à l’infini entre modernité rutilante et pauvreté belliqueuse, reflet, symétrie de Barcelone sur l’axe central de l’Italie, la Méditerranée pliée en deux les deux ports de l’Est et de l’Ouest se recouvrent exactement, à Beyrouth quand j’y allais en mission nos types de l’ambassade m’emmenaient souvent dans une boîte de nuit au nom étrange de BO18, un hangar derrière le port dans le quartier de la Quarantaine, où avait eu lieu un des premiers massacres de la guerre civile, en janvier 1976 les phalangistes avaient passé par les armes les Palestiniens d’Intissar et les Kurdes qui habitaient ce camp putrescent coincé entre les conteneurs des docks et la décharge municipale, et c’est à l’endroit précis de la boucherie que le propriétaire avait ouvert son établissement, où rugissait une alternance agréable de musique internationale et de pop arabe, à l’heure de grande affluence l’ambiance était incroyable, de jeunes femmes magnifiques dansaient debout sur les tables rectangulaires, sur le bar interminable, le décor et l’éclairage étaient sobres et de bon ton, dans l’atmosphère explosive de la boîte surchauffée tout le monde buvait des cocktails B-52 enflammés au briquet par un barman expert, tout le monde suait à grosses gouttes, tout le monde secouait son corps, par instants retentissait une sirène bruyante, comme celles qui s’utilisaient pour les attaques aériennes et soudain, par miracle, le toit mobile du hangar s’ouvrait, les étoiles et le ciel de Beyrouth apparaissaient au-dessus des danseurs, des buveurs et les chants, les cris, la musique montaient vers les cieux comme une colonne de fumée, répandant la fête et la joie dans la baie de Jounieh, jusqu’aux petites heures du matin, l’ouverture du plafond était régulée automatiquement par la température ambiante et protégeait les derniers clients de la fraîcheur de l’aube en se refermant doucement, comme le sarcophage d’un vampire, j’étais soûl au BO18 il était près de sept heures il faisait grand jour affalé dans un coin j’observais les employés commencer à nettoyer, dans la grande salle vide j’ai regardé la disposition des tables, en rangs parallèles, des blocs en bois, deux mètres de long environ tous alignés comme dans un cimetière, des tombes, j’ai pensé dans mon ivrognerie, les tombes des massacrés de la Quarantaine, j’ai regardé de plus près et effectivement chaque table portait sur le côté une petite plaque en bronze, invisible dans le noir, avec une liste de noms en arabe, les clients dansaient sur les cercueils figurés des morts de la Quarantaine, les sirènes de la guerre retentissaient dans la nuit, Beyrouth dansait sur des cadavres, Beyrouth dansait sur des cadavres et j’ignore s’il s’agissait d’un hommage posthume ou d’une vengeance, une revanche sur la guerre qui empêchait de danser en rond, d’une forme de mémoire aussi, un cimetière musical pour ceux qui n’avaient pas de tombeau, une libation fumante au cours d’un banquet funèbre, des danses funéraires, un dernier cocktail avant l’oubli — les Libanais sont les champions du design et du décor d’intérieur de ce côté-là de la mer, comme les Catalans de l’autre, ils mettent en scène la tragédie : à Beyrouth, on trouve peu de monuments consacrés à la guerre civile, peu de plaques, pas de mémorial, chacun porte sa part de souvenir comme il peut, comme Rafaël Kahla l’écrivain porte les souvenirs des combattants palestiniens, Intissar et Marwan, les légendes abondent, ainsi les récits mythiques de Ghassan à Venise, les ogres de la guerre libanaise, leur geste, l’ost d’un seigneur contre un autre, les morts les disparus tout cela est porté individuellement, c’est un récit personnel de larmes et de vengeance, au contraire à Barcelone de l’autre côté de la mer la démocratie retrouvée a multiplié les hommages et les monuments, les rues ont été rebaptisées, George Orwell le milicien trotskiste désabusé possède même une place à son nom dans la vieille ville, elle sent l’urine certes, mais c’est une jolie petite place entourée de bars un rien sordides, peuplée de néohippies italiens qui jouent Bella ciao, Bella ciao au pipeau, encore un endroit que Stéphanie trouvait sympathique , comme la rue Avignon toute proche où j’aime à croire que Picasso reçut l’Inspiration dans une maison close, ses demoiselles d’Avignon sont les prostituées malingres d’un bordel de Barcelone, aujourd’hui devenu une pension pour touristes — Stéphanie armée de Proust et de Céline aimait tout, les beaux quartiers aux larges avenues où auraient pu se promener les personnages du faubourg Saint-Germain ou de l’Opéra, et le centre historique plutôt miséreux où devaient exercer les confrères ibères de Bardamu, entre la tombée du jour et l’heure du dîner nous restions à l’hôtel, après avoir fait l’amour nous lisions, moi l’ Histoire de la guerre d’Espagne de Brasillach et Bardèche, que le vieux fasciste m’avait offerte quand j’étais encore au lycée et qui m’avait paru l’ouvrage le plus adapté, avec les souvenirs d’Orwell, à une escapade en Catalogne, Stéphanie était hors d’elle, ça me donne la nausée disait-elle, tu devrais avoir honte de trimballer ces horreurs nazies jusqu’ici, j’essayais de lui expliquer que cette version de l’histoire avait été officielle en Espagne jusqu’à la fin du franquisme, les méchants étaient les rouges, les bons les autres, et qu’il y avait encore quelques “historiens” pour défendre la thèse selon laquelle Franco avait sauvé l’Espagne de Staline et des anarchistes, qui sont encore pires, Stéphanie n’en démordait pas, ce n’est pas une raison, disait-elle, pour lire des fascistoïdes et des nazillons, alors j’utilisais un autre argument, un coup bas, je disais et Céline ? et Céline, ce n’était pas un fasciste antisémite ? vexée elle répondait ce n’est pas pareil, ce n’est pas si simple, j’étais tout à fait d’accord, ce n’est pas si simple, et nous en restions là, ce n’était pas si simple, c’était même plutôt complexe, Stéphanie Muller brillante intellectuelle française analyste géopolitique pour notre étrange Service se mettait à me chatouiller pour se venger, et la querelle politique s’achevait dans les plumes et les bruits de matelas, je pense qu’elle aurait pu pardonner à Brasillach s’il avait écrit un seul grand livre, mais c’était pour elle un écrivain médiocre qui ne méritait aucune clémence, il avait été truffé de plomb à la Libération, et voilà, épuré — la France épurait, Stéphanie me chatouillait et Barcelone brillait de tous ses feux catalans, modernes, européens, festifs, et ne souhaitait pas se rappeler qu’elle s’était enrichie surtout dans les années 1960, en plein franquisme, que la bourgeoisie locale s’était bien vite accommodée de la dictature et avait fait fortune en exploitant des dizaines de milliers de migrants venus de l’Espagne entière : pauvre Orwell, dans sa chambre d’hôtel près de la place de Catalogne, aujourd’hui à deux pas de la Fnac, des galeries Lafayette locales et d’un magasin de cosmétiques, pourchassé par les staliniens après la guerre dans la guerre de mai 1937 qui les opposa au POUM et aux anarchistes, contraint de fuir pour éviter la répression, le bel Orwell dans sa chambre comprend que la bataille est perdue, et ce près de deux ans avant la fin, avant la longue route qui mènera Boix vers Mauthausen, terminus Nord — Stéphanie la douce aimait les mythes révolutionnaires, le poing levé et les no pasarán , elle préférait les souvenirs d’Orwell aux élucubrations idéologiques de Bardèche et Brasillach, Brasillach le Catalan de Perpignan aimait pêcher au lamparo du côté de Collioure, dans la barque de son cousin, des anchois luisants, des sardines grassouillettes, était-il déjà antisémite, avait-il seulement déjà rencontré un juif, avait-il déjà succombé aux facilités de la paranoïa et de la conspiration, lui qui passait souvent près du camp Joffre de Rivesaltes, où, après les soldats espagnols, furent concentrés une bonne partie des juifs étrangers raflés en zone libre, Brasillach approuvait ces déportations, selon lui il fallait se débarrasser des juifs jusqu’aux enfants, ce n’est pas pour cela que de Gaulle le fit fusiller, au matin du 6 février 1945, dans l’aube glacée du fort de Montrouge, Brasillach cria vive la France comme les résistants envoyés au peloton avant lui, de Gaulle le noble avait rejeté le pourvoi en grâce de Brasillach pour des raisons obscures, peut-être par haine des homosexuels, peut-être pour contenter les communistes, peut-être par paresse, ou peut-être, comme le pensait Stéphanie, parce que ce n’était pas un si grand écrivain que ça, mais certainement pas pour son antisémitisme, s’il avait été juste antisémite Brasillach aurait été gracié, témoin son beau-frère Maurice Bardèche qui fut libéré au bout de quelques mois de prison ou Céline lui-même, rapatrié après des mois à se geler les couilles dans une cabane au Danemark : le petit médecin amer était un partisan du sionisme et de l’Etat d’Israël, censé débarrasser l’Europe de ses juifs encombrants, ces hybrides, ces apatrides immondes, et Stéphanie pensait en son for intérieur qu’il avait raison, qu’au fond, l’exil était la seule solution au problème juif, la réponse à la question juive et Israël était un placard bien pratique pour ranger ces débris encombrants de Méditerranée, d’Europe centrale ou de France, ces débats me déprimaient, je pensais à Harmen Gerbens le Hollandais et à son appartement, aux juifs du Caire ou d’Alexandrie passés par l’Espagne en 1967, à tous ces mouvements dans la Zone, flux, reflux, exilés qui en chassent d’autres, au gré des victoires et des défaites, de la puissance des armes et du tracé des frontières, une ronde sanglante, une vendetta éternelle et interminable, toujours, qu’ils soient républicains en Espagne fascistes en France palestiniens en Israël tous rêvent du destin d’Enée le Troyen fils d’Aphrodite, les vaincus aux villes détruites veulent détruire à leur tour d’autres villes, récrire leur histoire, la changer en victoire, ailleurs, plus tard, je pensais à une page du carnet de Francesc Boix, le photographe de Barcelone, une des pages du manuscrit perdu de ses souvenirs, le chemin a changé, les ornières ont été comblées par les cadavres et les ombres des cadavres, la route ne décrit plus les mêmes coudes, le ciel paraît plus chargé comme si les nuages n’en finissaient pas de moudre et de mâcher on ne sait quelles idées, des idées qui ne veulent plus de nous, avec Estrella il y a longtemps, ses doigts refermés sur mes poignets comme des menottes de chair, l’air enfumé du café bondé ne faisait même pas pleurer ses yeux, pas une larme, rien, juste cette clarté aigue-marine dont on sait qu’elle promet plus qu’elle ne peut tenir, il y avait aussi Miguel et Inés ce soir-là, nous avions décidé non pas de refaire le monde mais d’ajouter quelques absurdités, des taches d’incongruité afin de mieux nuancer sa cruelle teinte de plomb, j’avais les poches pleines de billets n’ayant plus cours, je promenais mon doigt au-dessus de la flamme des petites bougies tenaces, Estrella me parlait de cette maladie qui avait failli faire d’elle un petit corps glacé glissé sous la terre, du médecin ivre qui avait réussi, par on ne sait quel hasard, à diagnostiquer son mal et lui fournir les moyens de s’en relever, et en l’écoutant je ne pouvais m’empêcher de ressentir chacun de ses maux, d’épouser la courbe mouvante de sa douleur, je devenais le souvenir de chacune des gouttes de sueur qui avaient éclos sur sa peau, j’étais la fièvre, son feu nourri de glace dans ses yeux, tout cela Estrella me le disait à demi-mot, entre deux gorgées, deux soupirs légers comme des plumes, tout se faisant toujours dans un entre-deux, une parodie de crépuscule, je compris alors que je passerais la nuit dans les bras d’Estrella, qu’il ne s’agissait ni de choix ni de désir, la ville baignait dans un halo implacable, on entendait feuler des moteurs et glapir des ivrognes, à croire que la ville se rêvait campagne, de nuit certaines places auraient pu être des champs, et voilà qu’Estrella s’était levée, une ascension, un miracle, son menton m’indiquait la porte, Inés et Miguel nous suivirent un instant puis disparurent, ils cessèrent d’exister ou retournèrent à un état d’avant l’existence, tout parut se dissoudre puis la respiration d’Estrella se fit plus saccadée et je sus que nous courions, non pas réellement, mais dans nos cœurs, dans nos chairs, un escalier se présenta à nous et dix minutes plus tard elle me jetait sur un lit la ville eut alors la délicatesse de s’absenter derrière les carreaux de la fenêtre, tous les bruits se contractèrent en un minuscule poing sonore, j’avais envie d’oublier les secondes à mesure qu’elles se déployaient devant mes yeux, je n’aurais pas supporté qu’elles s’accumulent, se sédimentent, complotent contre moi, je voulais rester fragile et volatil, mais Estrella était comme le mercure, elle roulait sur moi, me contournait, je n’arrivais pas à défaire ses vêtements, mes doigts s’attardaient sur les innombrables boutons de son gilet, mes yeux étaient fermés et j’avais l’impression de voir l’intérieur de mon corps, un paysage en perpétuel changement, peuplé de machines ahanantes et de monstres apeurés, c’était l’alcool, bien sûr, mais aussi l’épuisement de l’homme voué à se perdre dans la beauté d’autrui, il y eut un moment où je sentis qu’elle me prenait en elle, et mon sang dans mes tempes chantait comme un roulement de tambour, mes ongles s’enfoncèrent, mes dents cherchèrent ses os, quelque part dans une pièce voisine un gramophone libéra un air d’opéra, une voix de femme vaincue mais furieuse se mit à parler de nous, de ce que nous allions devenir si nous commettions l’erreur de changer ces gestes en habitude, ces cris en promesses, l’espace en temps, puis tout se brisa, tout cessa, j’étais sur le port et je fumais un cigare, j’étais vieux, très vieux, les gens passaient devant moi en flottant, il y avait deux soleils dans le ciel, je venais je crois de mettre au point une bombe si puissante que même les mers allaient s’enflammer, un télégramme m’apprenait au dernier moment que mon maléfique projet était éventé, je devais me rendre aux autorités, au lieu de ça je m’évertuais à faire démarrer une voiture volée, la manivelle refusait de tourner, des enfants se moquaient de moi et l’inquiétude finit par m’extirper de ce mauvais rêve, Estrella dormait tout contre moi, elle souriait dans son sommeil, ses deux mains reposaient entre ses cuisses, il devait être cinq heures du matin, je suis parti sans laisser de mot, le sceau de ses lèvres sur ma nuque, plus entier que la veille, un peu plus vieux, aussi, comme s’il me restait encore d’insoupçonnés pucelages à abandonner à la vie , disait Boix, cinq ans après Mauthausen en se souvenant de Barcelone aujourd’hui perle de Méditerranée capitale de la Catalogne triomphante emplie de la morgue, de l’arrogance des nouveaux vainqueurs nationalistes, fiers de leur victoire économique sur l’oppression castillane, où les bons ont enfin triomphé, obtenu la vengeance posthume qu’ils souhaitaient : avec Stéphanie main dans la main nous nous promenions sur la plage et le front de mer récemment remodelés, modernisés, débarrassés de leurs gargotes, plantés de palmiers, arrachés à George Orwell et Francesc Boix, précipités vers Cannes Gênes ou Nice à grands coups d’investissements touristiques, prêts à recevoir les pelletées de Nordiques venus fondre sur le sable, vers dix-neuf heures les Ramblas se couvraient d’une vague inexorable de bikinis et de serviettes de bain enserrant des chairs rougeaudes épuisées de soleil, des autocars pressés lâchaient leurs nuées de photographes amateurs devant la Sagrada Familia, des tonnes de paella décongelaient dans les fours, Stéphanie s’achetait des chaussures, des robes, des bijoux fantaisie — je réussis à la convaincre d’aller jusqu’à la fin de l’avenue Diagonal, quand elle rejoint la mer si chère aux promoteurs et aux urbanistes modernes, pour voir un immense chantier, un terrain vague semé de bulldozers et de bétonneuses, au bas d’immeubles élégants, avec vue, parmi les plus chers et les plus modernes de la ville, ce terrain vague fourmillant d’ouvriers s’appelait autrefois campo de la Bota, le camp de la Botte, et les phalangistes l’avaient choisi comme lieu d’exécution par balle, deux mille innocents, anarchistes, syndicalistes, ouvriers, intellectuels, avaient été massacrés sous les fenêtres des appartements de luxe d’aujourd’hui, sommairement condamnés par une cour martiale distraite et exténuée, puis confiés à un peloton d’exécution distrait et exténué, avant que leur souvenir ne soit définitivement enterré par des ouvriers immigrés distraits et exténués : à la place du charnier aux deux mille cadavres la mairie de Barcelone construisait son Forum des Cultures, Forum de la Paix et de la Multiculturalité, en lieu et place de la boucherie franquiste on élevait un monument au loisir et à la modernité, à la fiesta , une gigantesque opération immobilière censée rapporter des millions en recettes indirectes, tourisme, concessions, parkings, et enterrer de nouveau à jamais les pauvres vaincus de 1939, les sans-grade, ceux qui n’ont rien à opposer aux excavatrices et aux pelleteuses à part la liste interminable de leurs noms et prénoms, Stéphanie était soudain indignée, mais il n’y a pas un monument ? pas une plaque ? je répondais ne t’inquiète pas, un architecte brillant trouvera bien un moyen de dissimuler un vibrant hommage dans son œuvre, quitte à mettre quelques fausses traces de balles dans un mur en béton, aujourd’hui le Forum des Cultures est principalement utilisé pour des concerts, on y danse sur les cadavres comme à Beyrouth, comme au BO18 de la Quarantaine à Beyrouth, mais au lieu de la danse du souvenir il s’agit de la danse de l’oubli que seule permet la mémoire étatique, qui juge où il est bon de se souvenir et où il vaut mieux mettre un parking, bien plus utile à une ville européenne que les souvenirs encombrants de gens qui seraient morts, de toute façon, morts aujourd’hui de vieillesse, grabataires, aliénés ou malades, leurs enfants et leurs petits-enfants sont heureux ils ont des motocyclettes des tramways et des pistes cyclables, des plages où parquer les touristes, ce ne sont pas quelques milliers de balles franquistes qui vont changer les choses, on ne peut pas vivre assis en pleurnichant sur des cadavres, c’est le mouvement de l’univers, je pensais aux immeubles bon marché qui encombrent aujourd’hui l’ancien camp de Bolzano, on n’y bat pas plus sa femme qu’ailleurs, je suppose, les fantômes n’existent malheureusement pas, ils ne viennent pas tarabuster les locataires des HLM de Drancy, les nouveaux habitants des ghettos vidés de leurs juifs ou les touristes qui visitent Troie, ils n’entendent plus les pleurs des enfants brûlés dans les ruines de la ville : à la Risiera à Trieste j’avais croisé un groupe de lycéens en promenade, au milieu des baraquements près du crématoire ils étaient très occupés à se conter fleurette, à se carapater pour fumer, à se pousser du coude, sous l’œil sévère d’une professeur d’histoire émue, ici tant de gens ont souffert, disait-elle, et cette phrase n’avait pas de sens pour eux, ou si peu, c’est bien normal, elle en aura de moins en moins, comme aujourd’hui les monuments aux morts de 14 éparpillés en France n’émeuvent plus personne, ils trônent sur des ronds-points fleuris dans des squares en face d’églises solennelles les poilus, appuyés sur leur Lebel de pierre la musette au côté le casque sur la tête une curiosité un décor ainsi la colonne de Marathon ne serre plus la poitrine d’aucun touriste, plus de pleureuses aux Thermopyles devant l’épitaphe de Simonide de Céos, passant, va dire à Lacédémone que nous sommes morts pour honorer ses lois , Léonidas le Spartiate est aujourd’hui une marque belge, je me taperais bien un chocolat à la santé du roi tué par les Perses, une petite douceur fondante dans le train qui approche de Bologne
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Zone»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Zone» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Zone» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.