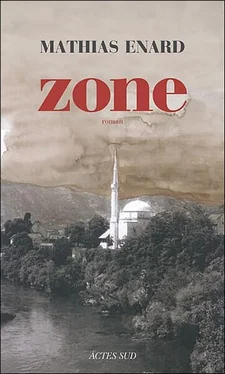Mathias Énard - Zone
Здесь есть возможность читать онлайн «Mathias Énard - Zone» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Город: Paris, Год выпуска: 2008, ISBN: 2008, Издательство: Éditions Actes Sud, Жанр: Современная проза, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Zone
- Автор:
- Издательство:Éditions Actes Sud
- Жанр:
- Год:2008
- Город:Paris
- ISBN:978-2-7427-7705-1
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Zone: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Zone»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Par une nuit décisive, un voyageur lourd de secrets prend le train de Milan pour Rome, muni d’un précieux viatique qu’il doit vendre le lendemain à un représentant du Vatican pour ensuite — si tout va bien — changer de vie. Quinze années d’activité comme agent de renseignements dans sa Zone (d’abord l’Algérie puis, progressivement, tout le Proche-Orient) ont livré à Francis Servain Mirkovic les noms et la mémoire de tous les acteurs de l’ombre (agitateurs et terroristes, marchands d’armes et trafiquants, commanditaires ou intermédiaires, cerveaux et exécutants, criminels de guerre en fuite…). Mais lui-même a accompli sa part de carnage lorsque la guerre en Croatie et en Bosnie l’a jeté dans le cycle enivrant de la violence.
Trajet, réminiscences, aiguillages, aller-retour dans les arcanes de la colère des dieux. Zeus, Athéna aux yeux pers et Arès le furieux guident les souvenirs du passager de la nuit. Le train démarre et, avec lui, commence une immense phrase itérative, circulatoire et archéologique, qui explore l’espace-temps pour exhumer les tesselles de toutes les guerres méditerranéennes. Car peu à peu prend forme une fresque homérique où se mêlent bourreaux et victimes, héros et anonymes, peuples déportés ou génocidés, mercenaires et témoins, peintres et littérateurs, évangélistes et martyrs… Et aussi les Parques de sa vie intérieure : Intissar l’imaginaire, la paisible Marianne, la trop perspicace Stéphanie, la silencieuse Sashka…
S’il fallait d’une image représenter la violence de tout un siècle, sans doute faudrait-il choisir un convoi, un transport d’armes, de troupes, d’hommes acheminés vers une œuvre de mort. Cinquante ans après
de Michel Butor, le nouveau roman de Mathias Enard compose un palimpseste ferroviaire en vingt-quatre “chants” conduits d’un seul souffle et magistralement orchestrés, comme une
de notre temps.
Né en 1972, Mathias Enard a étudié le persan et l’arabe et fait de longs séjours au Moyen-Orient. Il vit à Barcelone. Il a publié deux romans chez Actes Sud :
(2003) — Prix des cinq continents de la francophonie, 2004 — qui paraît en Babel, et
(2005). Ainsi que, chez Verticales,
(2007).
Zone — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Zone», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
XI
comme des rails dans la nuit des traits des réseaux infinis de relais et nous, le plus souvent silencieux, étrangers qui ne nous ouvrons pas plus l’un à l’autre que nous ne le faisons à nous-mêmes, obscurs, obtus, perdus dans les innombrables rails qui entourent la gare de Bologne nœud ferroviaire inextricable, des aiguillages, des circuits, des voies de garage à n’en plus finir, une gare divisée en deux parties égales où au contraire de Milan le gigantisme du bâtiment est remplacé par la profusion des voies, la verticalité des colonnes par le nombre des traverses, une gare qui n’a besoin d’aucune démesure architecturale parce qu’elle est en soi démesurée, le dernier grand carrefour de l’Europe avant le cul-de-sac italien, tout transite par ici, les bouteilles de nero d’Avola venues des pentes de l’Etna que buvait Lowry à Taormine, le marbre des carrières de Carrare, les Fiat et les Lancia y croisent les légumes séchés, le sable, le ciment, l’huile, les peperoncini des Pouilles, les touristes, les travailleurs, les émigrants, les Albanais débarqués à Bari y foncent vers Milan, Turin ou Paris : tous sont passés par Bologne, ils ont vu leur train glisser d’une voie à l’autre au gré des aiguillages, ils ne sont pas descendus visiter la basilique, ils n’ont profité d’aucun des charmes d’une ville agréable et bourgeoise, suave et cultivée, le genre de ville où l’on aime à s’établir, de ces cités qui vous offrent une retraite avant l’heure et où l’on se réveille, sans que rien se soit produit de vraiment notable, au seuil de la mort quarante ans plus tard, une cité comme Parme, où il fait bon vivre, c’est-à-dire crever agréablement et de façon bien policée, avec des distractions suffisantes pour que l’ennui devienne la caresse régulière d’une mère endormant son enfant, une ville que sa gare labyrinthique protège du monde incertain des trains de l’ailleurs du battement de l’irrégulier de la vitesse et de l’étranger, une gare dans laquelle j’entre à présent le quai défile dans une lumière orangée, les serrures pneumatiques soufflent, les portes s’ouvrent, mon voisin un peu surpris un peu endormi se lève attrape une petite valise prend son magazine et sort, bon vent l’ami me voilà seul, me demandant si quelqu’un va s’installer en face de moi ou si, alors que le hautparleur annonce trois minutes d’arrêt, je vais être livré à moi-même pour les siècles des siècles, comme le petit christ de bois médiéval rescapé on ne sait comment du XII esiècle et perdu dans une chapelle obscure de San Petronio la basilique magnifique, à quelques pas d’ici, solitaire au milieu des Jésus flamboyants et douloureux, lui il a un demi-sourire, la première fois que je l’ai vu il pleuvait des trombes d’eau des cordes des hallebardes c’était le déluge et l’église était pleine de ceux qui s’abritaient de la pluie, y compris un groupe de Sénégalais vendeurs de faux Versace qui regardaient vers la porte la pluie tomber sans se soucier le moins du monde de ce qu’il y avait dans leurs dos, la splendeur de l’Eglise et la magnificence de son histoire n’étaient rien pour eux et ils avaient raison ils vendaient des sacs aux touristes et des statues africaines made in Indonesia , qu’est-ce que ce temple païen surchargé de santons pouvait bien faire pour eux à part les abriter un moment de l’orage, comme moi, qui sait, sans doute entrai-je dans le temple pour ne pas me tremper, ou par curiosité, ou par désœuvrement, j’étais en transit, j’allais vers Bari pour embarquer sur un de ces rafiots grecs qui sillonnent l’Adriatique, quand la tempête éclata je trouvai refuge dans la cathédrale face au petit christ en bois polychrome si simple et si penaud qu’on aurait dit la statue de L’Oreille cassée , comment ai-je fait pour le voir, dans ce recoin sombre qu’on n’avait même pas la possibilité d’illuminer avec une pièce de cinq cents lires, ces boîtes à lumière typiques des églises italiennes doivent servir à payer toutes les factures d’électricité de toutes les églises y compris le Vatican, à l’époque elles fonctionnaient une fois sur deux, le temps d’illumination était inversement proportionnel au renom de l’œuvre d’art, deux minutes pour un Caravage, cinq pour une sombre Vierge avec ou sans Enfant, mais mon petit christ à moi restait dans le noir, il a la beauté des choses primitives, le visage épais, les yeux en amande, et l’artisan que je sens derrière lui — un savetier, un charpentier — devait chérir ce petit être magique de la même façon qu’un enfant adore sa poupée, avec dévotion et tendresse, comme dans l’anecdote de Moïse et du berger de Roumi le mystique de Konya : le petit pâtre chantait pour Dieu, il voulait le caresser, le peigner, lui laver les pieds, le cajoler, le faire beau, le sévère Prophète barbu et cornu accroché à sa transcendance lui passa un savon pour son irrespect avant d’être à son tour réprimandé par le Seigneur lui-même, laisse les simples m’adorer simplement disait-il et j’imagine le sculpteur médiéval briquer son petit christ pour le peindre, chanter des hymnes, sentir le parfum rouge du bois qui est plus vivant que le marbre, Dieu à l’époque était partout, dans les arbres, dans le ciseau de l’ébéniste, dans le ciel, les nuages et surtout dans les épaisses chapelles sombres comme des caves où l’on entrait avec un respect terrifié, on pénétrait l’encens épais un vrai rideau de fumée masquant l’au-delà, et en revenant chez soi on était prêt à avoir les pieds mordillés par le diable dans son lit, on était prêt à être guéri par un saint et aveuglé par l’apparition d’un ange, à San Petronio basilique de Bologne les Italiens ont cru éviter il y a peu un attentat islamiste des plus étranges, artistique, les terroristes présumés souhaitaient détruire une fresque de Giovanni de Modène, peinte au début du XV esiècle et représentant l’enfer selon Dante, un horrible démon y dévore et torture les pécheurs, et parmi eux, dans la neuvième fosse du huitième cercle, Mohammad prophète de l’islam, allongé souffrant sur un rocher, sous les yeux de Dante, ainsi qu’il le raconte, dans je ne sais plus quel chant infernal, fendu du menton jusques au cul, entre les jambes pendaient les viscères, le cœur et les poumons à découvert, et ce triste sac, qui en merde transforme ce qu’on ingurgite, il me regarda, et avec la main s’ouvrit la poitrine, disant “vois comme je me déchire. Vois comme dépecé est Mahomet” , pauvre Prophète, et ainsi l’avait représenté le peintre de Modène, la poitrine ouverte, ce qui devait déclencher l’ire, près de six cents ans plus tard, des soi-disant islamistes que le zèle des carabiniers avait interpellés dans la noble basilique, croyant sincèrement déjouer un attentat des plus odieux, contre l’Art et la civilisation — une fois de plus l’alerte italienne était fausse, les terroristes étaient de simples touristes qu’il fallut relâcher quelques jours plus tard, l’église n’avait pas explosé, la fresque impie était toujours en place et le Prophète déchiré toujours en proie aux démons, jusqu’à la fin des temps dans l’enfer des chrétiens, et voilà que le train repart de Bologne, petit à petit le convoi s’avance le long du quai en direction de Florence, le plus long est fait, le plus long c’était franchir la longue plaine du Pô comme dans la guerre il fallait traverser l’espace entre deux collines à découvert, poursuivi par l’abri qu’on venait de quitter, pressé par celui qu’on allait rejoindre, en courant tout en attendant la balle qui allait vous arrêter ou l’obus qui allait vous précipiter cul par-dessus tête lancer vos membres vos effets vos boyaux dans les nues vous ouvrir en deux comme le Prophète dans la terre remuée cette glaise d’argile rougie où pointaient ici un œil, bille égarée, gélatineuse, inutile sans son crâne, reliée à la boue au néant par un filament absurde trace du cerveau, là une main dont le hasard de l’explosion avait épargné trois doigts mais pas le bras pas l’épaule pas la tête et cette extrémité à l’annulaire disparu gisait auprès d’un torse glougloutant et toujours en courant on se demandait bêtement à quoi pouvait bien servir une main sans membre à branler et sans visage à raser, dans ces sautes d’humour viril inopiné qui vous font survivre, et pourtant on courait à en faire dans son froc les obus sur les talons les chars comme maintenant le train court dans le noir à mille kilomètres à peine des pentes que je dévalais les Serbes puis les Bosniaques aux miches : bientôt la douceur civile de la Toscane, bientôt Florence puis la ligne direttissima jusqu’à Rome, les banlieues de Bologne s’étirent, de longs intestins gris percés par les voies et le train comme par une lance, Dante avait bien compris les hommes, sacci merdae pour l’éternité, ainsi qu’on les voit dans l’enfer, dépecés, démembrés, ouverts par une explosion dans la guerre, répandus, morcelés, éparpillés tel un fantassin par une grenade — comme celle que j’échangeai à Trieste en 1993 dans un bar contre trois bouteilles de vodka, j’avais une grenade dans mon sac, je ne me souviens plus pourquoi j’avais pris un tel risque à la frontière, un bistrotier nous parlait du “conflit yougoslave” et de fil en aiguille nous avions fait affaire, il était tout heureux d’avoir le petit objet kaki, une poire mortelle d’une jolie couleur verte et nous, nous étions enchantés d’avoir obtenu trois flacons transparents, nous allions nous ouvrir et nous répandre l’âme plutôt que les viscères, avec Andi et Vlaho nous avons bu les bouteilles inespérées, au goulot, c’était une bien bonne cuite, l’alcool me faisait perdre l’équilibre dans le vent violent, à Trieste on tend des cordes dans les rues pour que les enfants les vieux et les ivrognes s’y agrippent quand la bora souffle, et elle souffle de la bouche même du diable jusqu’à cent vingt à l’heure, vrai de vrai, ce soir-là malgré la rampe improvisée je suis tombé dans la force du courant d’air, je suis tombé, tombé, tombé et avec moi Vlaho et Andrija, nous avons ri comme jamais quand Andrija a vomi sous le vent et nous a repeints, Vlaho, moi et une passante qui s’est demandé une fraction de seconde ce que pouvaient bien être ces miettes humides et odorantes qui mouchetaient soudain son paletot, avant de voir, de comprendre, d’avoir un haut-le-cœur et de se mettre à courir en trébuchant, Andrija n’avait pas besoin de s’essuyer tellement le vent soufflait, c’était un triton, une fontaine crachant une gerbe de dégueulis magistrale qui partait vers l’arrière et clapotait contre les murs, contre nous autres hilares, contre notre amitié bien scellée dans tous les fluides, dans la bêtise des fluides, dans l’âme et le corps déchirés par l’alcool et la guerre, dans le sang les débris de la vie contre la mort comme dégueuler contre un mur, un mur de balles de fusil et de couteaux orthodoxes nos ennemis d’alors et maintenant je vais vers Rome la catholique, Rome qu’Andrija et Vlaho n’ont jamais vue, jamais vous n’avez vu les chaînes de saint Pierre à Monti ou la fontaine des Fleuves du Bernin, ni toi Andrija paysan de Slavonie pourtant très croyant, ni toi Vlaho de Split, ni le petit musulman glabre et cinglé que j’ai tué de mes mains à l’arme blanche, avec plaisir comme on va boire un coup, je le reconnais, dans la rage suivant l’injustice insupportable, entre les souffles bringuebalants du train, ma baïonnette couteau improvisé dans sa jeune gorge bosniaque, la joie de son sang innocent bouillonnant jusque sur mes mains, comme Andrija vomissait à Trieste dans le vent, vomissait le sang des Serbes grands mangeurs d’enfants, ou pas, qu’importent les raisons pour tuer elles sont toutes bonnes dans la guerre, après cette cuite transfrontalière entre deux fronts nous sommes retournés en Croatie pour aller en Bosnie, repassant chez les Slovènes qui nous avaient tant emmerdés à l’aller, bien plus que les Italiens que nous avions pu amadouer avec mes papiers français et quelques beaux biffetons bien allemands, dans la perspective de l’Europe à venir assise sur des armes et des billets comme une grand-mère sur ses économies, on me payait pour me battre j’ai oublié le tarif, il est des choses qu’on ne faisait pas pour l’argent, pas pour le prix du billet de train ou la distance en kilomètres, je me tortille sur mon siège il est temps d’aller au bar temps de me dégourdir les jambes temps de faire une pause dans le voyage, l’avantage peut-être unique de la première classe c’est que le wagon-restaurant est souvent tout proche, je me lève, la campagne est toujours aussi sombre on n’y voit goutte dehors c’est tant mieux ces paysages ne me disent rien qui vaille — le petit musulman décapité, Andrija tué au bord de la Lašva, Vlaho le débonnaire mutilé, nous tous alignés dans nos terribles chemises qui auraient aussi bien pu être brunes, le cou coupé sans soleil, mon plaisir en tranchant la chair palpitante de désespoir d’un fou innocent, ce vomi bienfaisant sur le manteau de la dame altière de Trieste, dernière trace acide d’un homme disparaissant, ce costume ce camouflage qui rassemble les soldats et les ecclésiastiques, tous je vais les boire d’un trait entre Bologne et Rome, sur les voies si droites, guidé, contraint par les rails vers un autre destin, ou le mien, ainsi le conducteur de locomotive seul de sa congrégation à ne pouvoir décider la course de sa machine, forcé par le métal comme la main dans la guerre vers la gorge de la victime, il ne peut dévier, il connaît son office, il sait où il doit aller, je trébuche dans le train, on ignore de la lame les hésitations sur les anneaux cartilagineux de la trachée, l’asphyxie dans le sang, les bulles roses et rouges de l’air dans son jet bouillonnant et ce réflexe du condamné, ce mouvement des mains vers le cou, suivi par cette contorsion du corps entier qui fait la joie de qui tranche cette artère et cette veine cave, ce plaisir du bourreau qui observe ensuite, content, la mare immense s’agrandir encore sous la tête inerte je traverse un autre wagon de première, le train semble s’être vidé à Bologne, la voiture-bar ressemble à un bordel de campagne, toujours ce velours rouge, dans les villages musulmans j’ai vu de beaux puceaux avoir une soudaine rage de violeurs dans leurs yeux sombres, une fois joui ils auraient massacré quiconque s’approchait de leur proie comme des hyènes, ils voulaient retenir pour eux celle qu’ils venaient de torturer, donnant l’amour dans la douleur un geste biblique d’une infinie beauté enfantine et solitaire, certains pleuraient en achevant leurs propres victimes, allez savoir où se cachaient leurs restes de mères, d’amoureuses auxquelles ils envoyaient des télégrammes tout aussi enflammés que les miens, ils écrivaient des lettres que personne ne saura lire jamais puisqu’elles contiennent les regards disparus de ces filles de ferme écartelées dans la boue, parfois c’était drôle Andrija était champion pour nous faire rire il n’avait pas son pareil pour planter une marguerite dans un cul dégoulinant de foutre, pour crier Za dom spremni ! en pénétrant avec une moue inspirée un vagin rétif, parfois sanglant, parfois croûteux, mais le plus souvent bien tenu, comme il disait le socialisme a beaucoup fait pour l’hygiène intime, diable merci, il avait tout de même réussi à attraper des morpions, mais difficile de savoir s’ils provenaient d’un corps, de la paille ou de la crasse généralisée, impossible à déterminer, le pou vient avec le soldat et le prisonnier, parasites préliminaires, organismes préfigurant la décomposition à venir, les vraies bestioles qui vous mangeront réellement et sans pommade qui vaille : bactéries, champignons, larves, ou chiens renards et corbeaux si vous avez la malchance de tomber dans un coin où personne ne viendra vous ensevelir pour limiter au lent et minuscule l’effet de gomme des charognards, qui sont la majeure partie du vivant, tout comme les soldats, le barman itinérant a un uniforme lui aussi, il est seul derrière le comptoir bringuebalant qui traverse l’Italie à fond de train, avec quoi vais-je me soûler, combien de mignonnettes va-t-il falloir que j’ingurgite, le whisky sentirait trop le cafard écrasé, la chambrée, je choisis quelque chose de plus bucolique, du gin, plus proche de l’infusion et donc de la nature, des buissons, des fourrés, des bords de la Lašva, de Vitez, des alcools de prune ou de raisin qu’on s’enfilait là-bas, comme le Xoriguer de Minorque terrible genièvre d’ascendance britannique, je m’offre un gin, sec et tiède avec un hallebardier sur l’étiquette, dans un verre en plastique transparent, à la santé de la Grande-Bretagne, à la santé de sa reine et des chevaux noirs de Minorque, à saint Jean patron de la ville de Ciutadella à Minorque, patron des aigles et des îles perdues, Saint Jean l’évangéliste l’Aigle de Patmos premier romancier de la fin du monde, le barman me jauge du regard, quel genre de cinglé peut bien avaler du gin pur et sans glace, dans un train qui plus est et je ne serais pas loin de lui donner raison, c’est infect, cela brûle et laisse dans la bouche un goût de potion, de remède prescrit par Bardamu lui-même pour guérir je ne sais quelle sombre maladie de la misère, nous entrons dans un tunnel, mes tympans sont compressés, j’ai l’impression d’être dans une cage, j’ai besoin d’air, si je pouvais j’ouvrirais une fenêtre, j’y passerais la tête pour être décoiffé par le vent glacé de décembre — Stéphanie la brune son Céline sous le bras me ferait la morale si elle était là, elle me dirait tu ne vas pas boire maintenant, tu ne vas pas encore t’enivrer, elle utilisait t’enivrer drôle de terme Dieu sait de quel livre elle l’a tiré, je préférais ne pas répondre, ne rien dire, commander mon verre ou me le servir tranquillement sans polémiquer, Stéphanie Muller vient d’une famille d’enseignants de Strasbourg, de ceux qui se saignent aux quatre veines pour que leurs enfants parviennent à quelque chose, ils avaient été si fiers qu’elle intègre Sciences-po, c’est là que nous nous étions rencontrés avant que je ne la recroise quelques années plus tard au détour d’un des couloirs sombres du boulevard Mortier, où j’œuvrais sous la férule de Lebihan l’amateur d’huîtres — les parents de Stéphanie savaient qu’elle travaillait comme analyste pour le ministère de la Défense, mais ignoraient exactement où, nous avons tous nos secrets, curieusement elle détestait tant la violence, les armes et la guerre (étrange vu son employeur) que je ne lui avais pas réellement raconté mes activités de soudard balkanique, par lâcheté : pour elle toute cette période de ma vie était très vague, floue, quelques photos, rien de plus, elle n’était jamais allée en Croatie, elle fut très étonnée d’apprendre que j’avais passé quelques mois à Venise, entre deux eaux, flottant comme un cadavre dans la lagune à l’odeur fétide, Stéphanie belle et brune aurait souhaité y aller, plus d’une fois elle revint à la charge : pourquoi pas Venise, elle avait trouvé un bel hôtel assez bon marché, des vacances nous feraient du bien, j’ai dû lui expliquer que je ne souhaitais pas y retourner, que je ne voulais pas revoir Venise la Sérénissime reine du brouillard et du tourisme, pas encore, c’était trop tôt, elle trouvait cela étrange, pourquoi, pourquoi, mais a fini par accepter de changer de destination, Barcelone était tout aussi méditerranéenne et attirante, à Venise j’avais été bien malade et bien miséreux j’avais toujours froid même enroulé dans mon tapis, je n’avais pas pu rejoindre la France, pas la force, pas le courage et je me cachais au beau milieu de la lagune en lisant toute la nuit en sortant au point du jour un soir j’ai rassemblé mes treillis mes uniformes j’en ai fait une grosse boule que j’ai brûlée dans le bac de la douche après l’avoir imbibée de rhum de cuisine, tout, insignes compris : je n’ai gardé que le poignard, sa gaine, et quelques crucifix en plastique, gadgets qu’on nous distribuait par poignées entières comme les clés du paradis aux volontaires iraniens sous Khomeiny, il fallait donner une réalité à la barbarie c’était le début d’une vie nouvelle le tissu se consumait dans une belle fumée au parfum de crêpes, on n’échappe pas à sa patrie, ma patrie je la flambais au rhum avec mes frusques de soldat et ma mère je la laissais dans le silence elle qui m’avait donné sans le savoir ce couteau et ces crucifix c’était sans doute elle que je voulais conserver avec les colifichets guerriers, les flammes de mon holocauste de salle de bains détruisaient l’illusion d’avoir eu un pays avec la même facilité qu’on avale un verre d’alcool fort c’est désagréable sur le moment on sent son parcours le long de l’œsophage et tout seul dans ce bar déchirant la campagne je vais m’en offrir un autre, un gin à la santé de ma mère croate et bigote, un gin za dom , le barman a deviné mes intentions, il me sourit et me sort une autre mignonnette, spremni , un gin à la santé des pompiers de Venise alertés par les voisins qui m’avaient pris pour un fou, un gin patriotique, mon deuxième gin tiède, je ferais mieux d’aller m’asseoir et de dormir, plus très longtemps avant Florence et plus très longtemps avant Rome, si j’étais descendu à Bologne j’aurais pu retourner à Venise, au Paradis-Perdu ou au Hollandais-Volant boire des spritz avec Ghassan, lui le crucifix il le portait tatoué sur son biceps libanais, ou prendre un bateau jusqu’à Burano et regarder les petites maisons de pêcheurs pencher leurs bleus, leurs ocres sur les canaux, observer l’angle incongru du campanile et tourner en rond comme je tourne en rond dans ce train soudain bien lent, nous traversons la nuit noire, même les yeux collés à la vitre je ne distingue rien, à part les poteaux réguliers des caténaires, à part une forme sombre dans le paysage, une ondulation montagneuse qui est peut-être imaginaire, peut-être due au gin, j’ai ma dose d’alcool je me calme doucement, une cigarette et tout ira bien mieux, j’arriverai jusqu’à Rome — comme si j’avais le choix, même mort sur un siège ce train m’amènerait à destination, il y a dans les chemins de fer une obstination qui est proche de celle de la vie, voilà que je deviens idiot et philosophe, le gin sans doute, je vais aller fumer illégalement entre deux wagons, ou dans les chiottes, au moins dans les trains on ne vous menace pas encore de mille morts si vous fumez dans les toilettes, c’est un des rares avantages pour les contrevenants comme moi, on peut cloper assis, ce qui devient un luxe de nos jours, on se soucie de notre santé, tous autant que nous sommes, les innocents, les pécheurs, les victimes, les bourreaux, les chastes, les fornicateurs tous nous avons droit aux égards de la santé publique, on s’intéresse à nos poumons à notre foie à nos parties génitales avec une vraie sollicitude, et c’est agréable de se sentir aimé désiré protégé par l’Etat comme par ces femmes d’autrefois qui disaient ne bois pas tant, ne fume pas tant, ne regarde pas tant les jeunes filles, sans doute les hommes, mon père, mon grand-père se cachaient-ils pour un verre de goutte de la même façon que je vais aller me planquer pour fumer, mon grand-père serrurier fils de serrurier fabriquait des clés réparait aussi des instruments agricoles et des outils, et c’est impossible à imaginer aujourd’hui quand personne n’a jamais vu une forge, sauf peut-être le barman, il a la tête rurale, presque minière, un rostre épais, un front rugueux, des cheveux courts densément frisés très bruns la cinquantaine passée je l’imagine né début 1946 et son père à lui a dû courir l’aventure mussolinienne le bras levé depuis Rome jusqu’à Athènes en passant par Tirana, un paysan de Campanie ou de Calabre brutal mais au grand cœur de ceux qui font les meilleurs soldats et les meilleurs fascistes, habitués à l’ordre du temps de Dieu de la famille et de la nature, je l’imagine se geler en Epire, pousser un obusier sans munitions tiré par deux ânes faméliques, fasciné par la gloire des bersaglieri et le génie du Duce, confiant en la victoire avant de prendre ses jambes à son cou face à des Grecs affamés et nu-pieds qui allaient lui couper les oreilles, avait-il connu le plaisir avec une longue négresse en Ethiopie ou une rugueuse Albanaise au visage carré, avait-il avalé du sable en Libye, avait-il souffert dans un char Fiat où la température atteignait souvent soixante-dix degrés en plein soleil, quand la soif tuait plus que les claymores anglaises semées dans le désert, cailloux parmi les cailloux, je me demande où l’avait surpris la nouvelle de la chute de Mussolini, la fin d’une aventure, le début d’une autre, savait-il que son village avait été libéré depuis longtemps et que sa femme n’avait d’yeux que pour les beaux Yankees, jeunes paysans eux aussi, d’Oregon ou du Dakota, contrainte par sa famille et sa religion à attendre un homme dont elle ne savait rien depuis près de trois ans — peut-être était-ce un grand amour, une de ces passions presque antiques qui se jouent dans l’absence, dans l’illusion, il parcourait la guerre de Grèce en Egypte et en Russie le cul dans la neige les pieds gelés pendant qu’elle brodait son gilet pour leurs noces, pour un peu je demanderais au barman le prénom de son père, Antonio qui sait, il me regarde l’observer et siroter le fond de mon gin, le train ralentit brusquement, freine pour aborder une courbe, sans doute le convoi qui le ramena chez lui en juin 1945 avait-il marqué ici un arrêt, un signal fermé entre le monde qu’on venait d’effacer et celui qui restait à détruire, une femme l’attendait à la fin du trajet, à l’âge d’homme où tout est plus difficile, plus sournois, plus violent tant il la désirait sans la connaître, Antonio au fond le cœur lourd triste de quitter la guerre désirait ce souvenir avec une ferveur qui l’écœurait lui-même, et j’espère qu’il est descendu du train qu’il a parcouru les montagnes à en perdre haleine, éternué dans les grains naissants, laissé la froideur de la lune lui caresser l’épaule pour mieux jouir de sa solitude troublante effondré auprès d’un olivier j’espère qu’il a osé s’enfuir lors de cet arrêt inopiné, le train immobilisé en pleine voie parfois on sent sa chance, il y a des portes pour s’échapper — Antonio de retour du front de l’Est court dans la campagne pour échapper au destin d’Ulysse, au village, à la femme cousant, au bon chien de chasse qui lui reniflera l’entrejambe, il fuit l’avenir qu’il se devine, suer sang et eau pour maintenir dans la misère une famille nombreuse, émigrer, investir les immeubles de banlieue et de béton brut que l’urgence sème autour des villes du Nord, où le chien mourra le premier sans avoir plus coursé un lièvre : Antonio revenu de la guerre allongé auprès d’un figuier toscan dans la nuit écoute le train repartir, il a bien fait de descendre, semble-t-il, il a bien fait, c’est une si belle nuit de printemps, la première qui sente le foin après des années de graisse et de cordite et étendu ainsi entre deux vies, entre deux mondes, j’imagine que c’est le parfum de sa paysanne qui lui revient d’abord, s’il l’a déjà senti, à la sortie de la messe, ou pendant la récolte, aux alentours de Pâques, alors qu’elle frappait les olives avec une longue perche, ce mélange de sueur et de fleurs, cette chevelure exhalant sous le soleil, parle-t-il aux étoiles j’en doute, ce n’est pas un berger de Pirandello, c’est un homme qui revient de la guerre, couché là dans un champ parce que le train vient de s’immobiliser, un incident sur la voie, peut-être sont-ils nombreux ces soldats qui se demandent s’ils ont envie de rentrer chez eux, frémissant encore de la défaite allemande sous la caresse des blés en herbe, un peu apeurés, désarmés, dans des treillis loqueteux ou en civil, dans une chemise de drap grossier, aux pieds de lourds godillots, la Toscane il ne l’a jamais vue, toujours croisée en train en camion jamais il n’a réellement profité de ces paysages si civils, si domptés, si nobles, si humains que déjà les Etrusques et les Romains y avaient planté, les barbares aux barbes dorées batifolaient dans ses vignes comme des enfants, sur ces collines où les soldats de Napoléon couraient en riant derrière les filles, j’imagine Antonio entre deux montagnes d’ombre essayer de se débarrasser de la guerre en se roulant dans l’herbe, avec ces soldats italiens contraints par la RSI de Salò de se battre pour les Allemands, fin 1943 tous ceux qui refusent d’aller en Russie sont déportés, ils finissent dans d’autres trains, direction Mauthausen après un passage par le camp de Bolzano, Bozen l’autrichienne qui n’est déjà plus l’Italie, où l’on parle allemand — d’autres échappent aux SS et rejoignent les partisans, i banditi comme les appelle Radio Milan, beaucoup seront arrêtés et déportés à leur tour, Antonio marche dans la débâcle du front de l’Est le rouleau compresseur rouge sur les talons alors que mon grand-père, laissant les clés, la forge, le village devient lui aussi un bandit, attiré par les armes et le pouvoir qu’elles donnent il apprend à faire sauter les voies de chemin de fer aux alentours de Marseille, avant d’être arrêté par une escouade de gestapistes français fin 1943, torturé à l’eau et déporté en Thuringe dans un camp dépendant de Buchenwald, comment a-t-il échappé à l’exécution sommaire dans la cour, au peloton du petit matin, je le devine, je devine qu’il a dénoncé tous ses camarades pour échapper à la douleur, il a honte, il a craqué sous la torture et livré ses amis, il ira expier sa trahison en Allemagne comme esclave dans une usine d’armement souterraine REIMAHG, il fabriquera des chasseurs à réaction ME-262 jusqu’en avril 1945 — il ne rentrera jamais à Marseille, il s’établira en banlieue parisienne, fera venir sa famille, travaillera dans un petit atelier de mécanique jusqu’à sa mort en 1963, mort jeune, de culpabilité ou des souffrances endurées dans le camp souterrain, où arrivaient des milliers de civils italiens, déportés de la province de Bologne, raflés au cours d’opérations “anti-partisans” — dans les montagnes que nous traversons en aveugles tunnel après tunnel les Allemands faisaient, mi-1944, d’une pierre deux coups, ils évacuaient la population civile qui appuyait les partisans et fournissaient un contingent d’esclaves pour les usines d’armement, près de vingt mille personnes furent déportées de toute l’Emilie, hommes et femmes, seulement un tiers revirent l’Italie, complètement oubliés aujourd’hui les Italiens morts d’épuisement, de faim, de bastonnade ou coulés vivants dans le béton, ce qui faisait rire aux larmes leurs gardiens espiègles, Espagnols Français Italiens Yougoslaves Grecs toute la rive de la Méditerranée prit le chemin du Nord pour aller crever en terre tudesque terre ensemencée de tous ces os du Sud, contraints et forcés d’abord puis plus ou moins volontairement pour des raisons économiques, les Espagnols les Italiens les Maghrébins les Turcs tout ce petit monde ira peupler les banlieues débutantes de Paris ou de Munich, comme Antonio le père de mon barman flegmatique qui nettoie sa machine à café, tous ces hommes se sont croisés à Buchenwald, à Mauthausen, à Dachau, dans les convois du retour, dans des régiments de marche, certains victorieux d’autres vaincus, en 1945 embarquaient à Marseille les troupes coloniales françaises démobilisées après la victoire, les goumiers du Maroc, les tabors, les tirailleurs algériens, et dix ans plus tard ce sera le tour du contingent français de s’y embarquer pour aller combattre les fellagas en Algérie, mouvement de va-et-vient guerrier qui remplace la marée, Marseille la bien gardée port magique et secret où accoste, un peu avant seize heures, le 9 octobre 1934, un canot automobile venu du croiseur Dubrovnik avec à son bord Alexandre I er, le long bâtiment de guerre a mouillé au large, tout est prêt pour accueillir le roi de Yougoslavie, la ville est pavoisée, les officiels attendent, les chevaux du cortège piaffent autour de la décapotable qui doit emmener le souverain à la préfecture, il fait beau, mon grand-père a vingt-deux ans, il est venu avec sa toute jeune femme voir passer le monarque sur la Canebière, comme une bonne partie de la population marseillaise, Alexandre Karageorgévitch l’élégant est seul, la reine Maria le rejoint en train directement à Paris, car elle est sujette au mal de mer, le ministre des Affaires étrangères Louis Barthou est venu à sa rencontre, distingué, barbu, lunetté, tous deux prennent place dans la voiture qui remonte la Canebière, ma grand-mère m’a plus d’une fois raconté cette histoire, les deux gardes à cheval qui encadrent le véhicule, l’escadron devant, les policiers derrière, et soudain, au coin du square Puget après le palais de la Bourse un homme s’élance vers l’automobile royale, il monte sur le marchepied gauche, il a un lourd Mauser à la main, il tire sur le Karageorgévitch surpris qui s’évanouit, un étrange petit sourire à la bouche, le garde à cheval fait volte-face et sabre l’attaquant, les policiers sur le trottoir tirent à leur tour, des passants tombent, fauchés par les balles de la maréchaussée, l’assassin découpé au sabre, criblé de plomb piétiné par la foule en panique et les chevaux de l’escorte est transporté au poste de police tout proche, le roi à l’hôtel de ville et le ministre à l’hôpital : tous trois meurent presque immédiatement, Alexandre des projectiles du gigantesque Mauser, Barthou d’une balle d’un policier, et Velichko Kerin l’homme aux mille pseudonymes de dizaines de blessures différentes — Kerin ou Chernozemski alias Georguiev ou Kelemen dit Vlado “le Chauffeur” est un Macédonien, c’est à peu près tout ce que l’on sait de lui, il a assassiné le roi sur ordre conjoint d’un mouvement révolutionnaire de Macédoine et des activistes croates oustachis basés en Hongrie et en Italie, dont trois agents sont arrêtés en France quelques jours après l’attentat et reconnaissent y avoir participé, Mijo Kralj, Ivo Rajic et Zvonimir Pospisil, sur ordre des dirigeants oustachis dont le futur Poglavnik Ante Pavelic lui-même, que Mussolini fera embastiller quelques jours plus tard pour le mettre à l’abri — Kralj et Rajic meurent de tuberculose au bagne de Toulon en 1939, comme Gavrilo Princip leur confrère bosniaque quelque vingt ans auparavant, juste avant de voir triompher la cause des insurgés croates en 1941 et l’établissement du NDH sous la férule de Pavelic : Kralj et Rajic sont morts sans avoir vu le triomphe, mais Pospisil, condamné à perpétuité, sera remis en cadeau à la nouvelle Croatie nazie par Vichy, ironie du sort, comme on dit, mon grand-père paternel a été témoin, sur la Canebière à Marseille, de l’assassinat du roi Alexandre I erle pire ennemi de mon grand-père maternel Franjo Mirkovic, fonctionnaire du NDH et Oustachi de la première heure, qui ne dut son salut qu’à un prompt exil en France via l’Autriche en 1945, ma famille se constituait autour de cette mort royale sur la Canebière, et ma grand-mère a depuis si bien épousé la cause de sa belle-fille qu’elle raconte cette aventure à qui veut l’entendre, j’y étais, j’y étais , la vieillesse aidant elle pourrait certifier avoir tiré elle-même sur le Monténégrin en bicorne, ou avoir sabré l’assassin balafré, elle hésite, en tout cas la gentille Marseillaise à l’accent chantant est formelle, le roi était très beau, très jeune, il souriait à la foule rassemblée sur son passage ce 9 octobre 1934 qui est un peu ma date de naissance, j’ai tué pour la patrie soixante ans plus tard est-ce que j’aurais assassiné de sang-froid le souverain hiératique dans son carrosse à moteur, peut-être, convaincu de la nécessité d’abattre la tête de l’hydre de l’oppression, j’aurais retrouvé mes complices à Lausanne, ils m’auraient informé du plan, des instructions, Mijo Kralj la brute épaisse et Ivo Rajic le sournois, si j’échoue ils attenteront contre Karageorgévitch à la bombe à Paris tout est prêt le dictateur n’a qu’à bien se tenir, un gorgeon de gin à la santé de Vlado “le Chauffeur” sanguinaire, le visage balafré d’un coup de couteau au cours d’une rixe à Skopje la sombre, est-ce que j’aurais eu son aplomb, son courage, affronté les chevaux et les épées des dragons sans flancher, dans un hôtel de la Côte d’Azur, la veille, une jeune Croate blonde m’aurait remis les armes, un beau Mauser C96 flambant neuf qu’elle a récupéré à Trieste, gentiment fourni par les agents de Mussolini, avec deux boîtes de cartouches et un revolver de secours, pour le cas improbable où le Mauser s’enraye, elle est belle et dangereuse, elle sait qu’il y a peu de chances que j’en revienne vivant, qu’il y a même toutes les chances que j’y passe, tué ou arrêté par la police française, pour la Cause, pour la Croatie, Franjo Mirkovic le géniteur de maman est en exil depuis 1931, en Hongrie d’abord, puis en Italie, avec Pavelic et les autres ténors des “insurgés”, ces Oustachis dont l’assassinat du monarque constitue le premier coup d’éclat et vaudra à Pavelic sa première condamnation à mort par contumace, en France, il est étrange que mon grand-père ait justement choisi ce pays pour son exil, une coïncidence, il n’a jamais été inquiété en dehors de Yougoslavie, ni même, que je sache, poursuivi par les agents de Tito qui finiront par blesser Ante Pavelic de trois coups de feu dans son refuge argentin, mon grand-père était un simple intellectuel sans grandes responsabilités politiques en définitive, contrairement à son ami Mile Budak, l’écrivain rural grand massacreur de Serbes, idéologue de pacotille et ministre des Affaires étrangères du NDH — Budak n’échappera pas aux partisans, il finira avec douze balles dans la peau après un procès éclair, sa famille massacrée près de Maribor, le scribouillard moustachu n’a pas eu la chance de mon grand-père, parti un peu plus tôt avec maman et son frère en Autriche à travers les lignes croates et allemandes, en cette fin avril 1945 mois de la poussière, du mensonge et de la débandade, à la frontière slovène il faut choisir entre deux routes, celle de l’Italie et celle de la Carinthie tenue par les Britanniques, Franjo Mirkovic avec femme et enfants est arrêté par les Anglais puis relâché immédiatement, il a de l’argent, des cousins en France il arrive à Paris au moment où mon grand-père paternel revient de déportation, dans un train, tous les trains repartent dans l’autre sens, vers le Sud maintenant, les soldats les déportés les vaincus les vainqueurs reprennent la route en sens inverse, comme Antonio le père du barman affairé rentre en Calabre ou en Campanie et s’arrête au bord de la voie en plein champ, vais-je rentrer chez moi, qu’est-ce qui m’attend dans la paix Ulysse a peur de sa femme de son chien de son fils il ne veut pas rentrer à Ithaque il ne veut pas je sèche mon gin repose le gobelet sur le comptoir j’ai envie d’une clope le barman me sourit il me demande “un altro ?” j’hésite mais je vais être fin soûl si j’en prends un troisième, enivré comme disait Stéphanie la belle douloureuse, un couple entre dans le bar roulant ils demandent une eau gazeuse et une bière avant de repartir vers les secondes classes, j’hésite j’hésite j’aimerais descendre prendre l’air comme Antonio de retour de guerre, allez, jamais deux sans trois je dis va bene, un altro , quelle faiblesse, quelle faiblesse, se taper du gin tiède à six euros pièce dans un wagon de chemin de fer, è la ultima , c’est la dernière mignonnette quoi qu’il advienne il faudra que je change de boisson, que je passe au Campari soda, la dernière fois que je me suis soûlé dans un train c’était dans l’express de nuit qui nous ramenait vers la Croatie avec Vlaho et Andi, nous avons pris l’omnibus de Trieste jusqu’à un bled à la frontière slovène pour attraper le Venise-Budapest arrivée prévue à Zagreb vers quatre heures du matin, l’employé de notre wagon était un Hongrois il avait des provisions faramineuses de gnôle dans sa cabine, des trucs parfumés véritables eaux de Cologne alcool de clous de girofle ou Dieu sait quelle horreur magyare, mais il était drôle et généreux, il nous plaignait de devoir retourner à la guerre, il parlait un drôle de sabir latino-germano-hongrois orné de quelques mots slaves, un bonhomme rondouillard qui fumait comme une locomotive à vapeur dans son réduit, je me souviens bien de son visage comme je me souviendrai de la trogne basanée du barman du Pendolino Milan-Rome, trois jeunes tambours s’en revenaient de guerre, trois jeunes tambours s’en revenaient de guerre, et ri et ran, ranpataplan, s’en revenaient de gueeerre, j’avais appris cette chanson à Vlaho et Andrija à Trieste, ils la chantaient sans cesse, jusque dans le train de Budapest, jusque dans les montagnes de Bosnie, je chante à voix basse, trois jeunes tambours , plus si jeune, le dernier tambour valide, la fille du roi délaissée sur la route, en mon pays il en est de plus jolies disait la chanson, Stéphanie en poste à l’étranger, j’aimerais la croiser par hasard, ou pas, qu’elle revienne, mais non, je vais vers une nouvelle vie, je me sépare de moi-même, je ne suis plus Francis Servain l’espion je suis Yvan Deroy promis à un destin neuf un avenir brillant payé avec des morts des disparus des secrets dans cette valise de plus en plus lourde, cette culpabilité qui ne me lâche pas, pauvre Stéphanie que j’ai broyée malgré moi, je bois un coup de gin, elle ne se méfiait pas, elle aimait les spectacles, le cinéma, les livres, elle aimait rester des heures au lit à me caresser doucement, alors que je m’enfonçais dans la Zone, que je disparaissais non pas sous les draps mais dans la mallette et mes souvenirs, entre deux missions, deux contacts, deux rapports, j’ai emmené Stéphanie au cours de mes enquêtes privées, “mon hobby”, comme elle disait, sans bien comprendre ni la nature ni l’intérêt du travail, elle pensait que je voulais me transformer en Simon Wiesenthal ou Serge Klarsfeld amateur, je ne la détrompais pas — par paresse, par obsession du secret, moins elle en savait mieux c’était, après Barcelone elle m’a accompagné à Valence au parfum de poudre noire et de fleur d’oranger, elle avait insisté pour venir, toujours l’obsession des vacances, à Carcaixent à quarante kilomètres de là avait vécu Maks Luburic jusqu’à son assassinat en 1969, Luburic le boucher du camp de Jasenovac était lui aussi un Oustachi de la première heure, un compagnon de lutte de mon grand-père, pour ainsi dire, qui appréciait tout particulièrement le meurtre à la massue, l’énucléation et le démembrement, qu’il pratiqua sur un nombre indéterminé de Serbes, de juifs, de roms et d’opposants croates — quatre-vingt mille victimes sont identifiées, combien attendent encore d’être découvertes, sans doute quatre fois plus, tuées de toutes les façons possibles, fusillées pendues noyées affamées décapitées à la hache ou assommées au marteau, Luburic échappé par Rome trouva refuge en Espagne d’où il coordonna les “activités” oustachis d’après-guerre, je possède une lettre de lui, il demande à mon grand-père s’il accepterait d’être le responsable de la cellule française, ce que ce dernier s’empressa sans doute de refuser, ne souhaitant surtout pas attirer les services secrets de Tito sur ses traces, on retrouva le cadavre de Luburic en avril 1969 chez lui à Carcaixent le crâne défoncé et le torse percé de coups de couteau, vengeance, vengeance, dans ce village des environs de Valence où il avait choisi de s’établir, sur la route de Xàtiva, au milieu des orangers et des usines de céramique, à quelques kilomètres des rizières de l’Albufera où nous nous sommes arrêtés pour engloutir une paella délicieuse et des anguilles en matelote, Stéphanie conduisait la Seat de location, les paysages du début octobre ne ressemblaient pas du tout à ce que j’avais imaginé, la plaine fertile des rives du Júcar, les montagnes commençaient un peu plus loin vers le sud, l’onomastique était souvent maure, Algemesi, Benimuslem, Guadasuar, autant de bourgades vidées de leurs habitants par Philippe III et l’Inquisition en 1609 lors de la déportation des morisques, pauvres types transportés en galères depuis tous les ports du royaume jusqu’aux côtes africaines, paysans convertis au christianisme depuis plusieurs générations mais qui s’obstinaient à parler et écrire l’arabe en secret, premiers déportés en masse de Méditerranée, pour plaire à l’Eglise et aux sévères évêques espagnols : beaucoup des cinq cent mille expulsés moururent dans les marches forcées pour atteindre la mer, certains furent jetés à l’eau par des capitaines de vaisseau qui s’épargnaient ainsi le voyage jusqu’aux côtes barbares et d’autres finirent massacrés par des Berbères peu accueillants à l’arrivée — le royaume de Valence perdit ainsi le quart de sa population, laissant certaines zones rurales complètement désertes, il ne reste que le nom des villages de ces descendants des Arabes d’Andalousie, disparus les morisques, comme à Alzira que nous traversions avec Stéphanie en route pour Carcaixent, Alzira la belle patrie du poète arabe Ibn Khafaja n’est plus qu’un bloc d’immeubles hideux ceinturant les restes d’une vieille ville autrefois entourée de remparts, nous nous sommes arrêtés boire une horchata sur une place agréable plantée de palmiers, un bel après-midi de début d’automne, un peu plus loin subsistait un tronçon de muraille arabe et encore des palmiers, le tout portait le nom ironique de “square d’Arabie-Saoudite”, nous sommes repartis pour Carcaixent où une surprise nous attendait : le village était en fête, pavoisé décoré en liesse noir de monde ce samedi, nous avions réservé dans le seul hôtel du coin sans savoir, le réceptionniste était étonné, you didn’t know it was fiestas ? comme si sa ville natale ne méritait pas qu’on s’y arrêtât en dehors de ces dates fatidiques, les fêtes patronales, sur la grand-place était installé un marché “médiéval”, où de gentils Valenciens mimaient les Arabes disparus dans des costumes bigarrés et les chevaliers du Cid Campeador en armure sous nos fenêtres, nous étions encore dans la chambre quand une série d’explosions m’ont paralysé la trousse de toilette à la main, une rafale terrible qui faisait trembler les vitres ouvertes et résonner le cœur, un bombardement, j’ai eu une seconde de panique totale, les muscles tendus, les oreilles sifflantes, prêt à plonger sur le sol de la chambre, je ne reconnaissais pas cette arme, mon cerveau n’identifiait pas ce danger ce n’était pas une mitrailleuse pas des mortiers des grenades c’était sourd brutal vibrant rapide interminable Stéphanie était pétrifiée face à moi j’ai compris des pétards des pétards énormes reliés les uns aux autres sous nos fenêtres ils faisaient tout le tour de la place une explosion chaque demi-seconde la petite chambre se remplissait de fumée bleue à nous faire suffoquer Stéphanie a commencé à rire le matraquage n’en finissait pas boum boum boum régulièrement l’odeur était infernale et pour finir un gigantesque obus de marine a explosé une détonation formidable nous a pliés en deux de trouille laissant un silence froissé et aigu suivi immédiatement de cris de joie d’applaudissements et de bravos, j’étais tellement tendu que mon cou et mes épaules me faisaient mal, Stéphanie avait les larmes aux yeux, peut-être la fumée, ma bouche était asséchée par le goût de poudre noire, dans la rue montaient encore des clameurs d’allégresse, quelle pouvait être cette cérémonie d’une sauvagerie extraordinaire, à quel dieu du tonnerre sacrifiait-on ces kilos de pétards, avec Stéphanie nous nous sommes mis à rire de notre peur en cherchant un peu d’air à la fenêtre, le réceptionniste nous a appris que ce rituel s’appelait mascletà , et qu’il était très fréquent à Valence, patrie des feux d’artifice, du bruit et de la fureur, Zeus lui-même doit présider à ces jeux païens, nous sommes sortis faire quelques pas, qui sait peut-être Maks Luburic le boucher avait-il choisi ce coin d’Espagne à cause de cette tradition martiale, qui lui rappelait les enfants, les vieillards et les malades qu’il allongeait dans un fossé avant de les exploser à la dynamite ou à la grenade à Jasenovac sur la Save, paisible village croate où les Oustachis toujours soucieux de bien faire avaient installé leur contribution aux camps de la mort, afin de tuer Serbes, gitans et juifs au milieu des cigognes, au bord de l’eau, dans une ancienne briqueterie dont les fours se révéleraient bien pratiques pour se débarrasser des corps, Luburic avait été le commandant du réseau de camps autour de Jasenovac, les témoins le décrivaient comme un sadique et une brute épaisse, à Carcaixent il s’appelait Vicente Pérez propriétaire d’une petite imprimerie rue Santa-Anna où il imprimait de la propagande antititiste, fervent catholique il était très apprécié des gens du village, Stéphanie m’écoutait, dans un bar bondé, un verre de rouge à la main, en mangeant des croquettes de morue, elle ouvrait grands les yeux, comment est-ce possible, elle avait de la peine à croire que cette petite bourgade en fête ait caché pendant plus de vingt ans un criminel de cet acabit, au milieu des orangers, Luburic avait même épousé une Espagnole et a eu trois enfants dans les années 1950, sont-ils allés se battre comme moi pour libérer la Croatie du joug yougoslave c’est possible, les ruelles ombragées de Carcaixent sentaient le soufre, vers huit heures une grande partie de la foule s’est dirigée vers l’église où avait tant prié Maks Luburic, on y célébrait une messe en l’honneur de saint Boniface martyr, nous sommes entrés avec Stéphanie qui s’est même signée à l’eau bénite, Boniface selon le martyrologe qu’on nous servit était l’intendant d’une noble matrone appelée Aglaé, ils vivaient criminellement ensemble mais touchés l’un et l’autre par la grâce de Dieu ils décidèrent que Boniface irait chercher des reliques des martyrs dans l’espoir de mériter, au moyen de leur intercession, le bonheur du salut — après quelques jours de marche, Boniface arriva dans la ville de Tarse et, s’adressant à ceux qui l’accompagnaient, il leur dit allez chercher où nous loger : pendant ce temps j’irai voir les martyrs au combat, c’est ce que je désire faire tout d’abord , il se rendit en toute hâte au lieu des exécutions et il vit les bienheureux martyrs, l’un suspendu par les pieds sur un foyer ardent, un autre étendu sur quatre pièces de bois et soumis à un supplice lent, un troisième labouré avec des ongles de fer, un quatrième auquel on avait coupé les mains, et le dernier élevé en l’air et étranglé par des bûches attachées à son cou, en considérant ces différents supplices dont se rendait l’exécuteur un bourreau sans pitié, Boniface sentit grandir son courage et son amour pour Jésus-Christ et s’écria qu’il est grand le Dieu des saints martyrs ! puis il courut se jeter à leurs pieds et embrasser leurs chaînes, courage , leur dit-il, martyrs de Jésus-Christ et le juge Simplicien, qui aperçut Boniface, le fit approcher de son tribunal et lui demanda qui il était, je suis chrétien , répondit-il, et Boniface est mon nom alors le juge en colère le fit suspendre et ordonna de lui écorcher le corps, jusqu’à ce qu’on vît ses os à nu ensuite il fit enfoncer des roseaux aiguisés sous les ongles de ses mains, le saint martyr, les yeux levés au ciel, supportait ses douleurs avec joie, alors le juge farouche ordonna de lui verser du plomb fondu dans la bouche, mais le saint disait grâces vous soient rendues, Seigneur Jésus, fils du Dieu vivant , après quoi Simplicien fit apporter un chaudron qu’on emplit de poix bouillante et Boniface y fut jeté la tête la première, le saint ne souffrait toujours pas, alors le juge commanda de lui trancher la tête : aussitôt un affreux tremblement de terre se fit sentir et beaucoup d’infidèles, qui avaient pu apprécier le courage de Boniface, se convertirent, ses camarades achetèrent son corps ils l’embaumèrent et l’enveloppèrent dans des linges de prix puis, l’ayant mis dans une litière, ils revinrent à Rome où un ange du Seigneur apparut à Aglaé et lui révéla ce qui était arrivé à Boniface, elle se rendit au-devant du saint corps et fit construire, en son honneur, un tombeau digne de lui — quant à Aglaé, elle renonça au monde et à ses fastes, après avoir distribué tous ses biens aux pauvres et aux monastères elle affranchit ses esclaves et passa le reste de sa vie dans le jeûne et la prière, avant d’être enterrée auprès de saint Boniface le torturé décollé, pendant l’homélie je pensais à Maks Luburic le bourreau croate, à ceux qu’il avait décapités, écorchés, empalés, brûlés parce qu’ils étaient infidèles, combien de fois avait-il entendu la messe de saint Boniface martyr patron de Carcaixent sous le nom de Vicente Pérez, pensait-il encore à Jasenovac ou à Ante Pavelic grand collectionneur d’yeux humains quand son assassin lui avait éclaté le crâne à coups de bûche avant de le percer vingt fois avec un couteau de cuisine, par une tiède nuit d’avril, dans le parfum entêtant de la fleur d’oranger, je vide mon gin à la santé de Boniface le petit martyr de Tarse en Cilicie, Tarse ville de saint Paul et des Arméniens massacrés à leur tour par les Turcs infidèles sous les yeux de Doughty-Wylie le consul tombé aux Dardanelles, j’ai la tête qui tourne, j’ai la tête qui tourne une soudaine nausée je m’accroche au montant de la fenêtre, j’ai besoin d’air, le barman me regarde, le gin ne m’a fait aucun bien je vais aller me passer de l’eau sur la figure, je titube dans les mouvements du train jusqu’aux gogues tout proches, je ferme la porte derrière moi je m’asperge de flotte comme pour un baptême je m’assois dans le confort de l’acier brossé l’alcool était une erreur je n’ai rien mangé de la journée, qu’est-ce que je fous ici dans des chiottes ferroviaires je suis flapi je vais retourner m’asseoir essayer de dormir un peu mais d’abord je vais m’allumer une clope, et tant pis pour les lois anti-cancer, bientôt Florence, bientôt Florence et ensuite Rome, quelle lenteur malgré la vitesse, la sécheresse du tabac me relaxe, les toilettes minuscules sont immédiatement enfumées, comme la place de Carcaixent après la mascletà , au sortir de la messe de Boniface martyr une fanfare jouait des airs locaux avec de courts instruments à vent aigres et criards, un son horrible qui vrillait les tympans aussi sûrement que les pétards, les fidèles ont suivi la fanfare pendant que sur la place on tirait des feux d’artifice qui explosaient en gerbe dans le ciel du soir, on se serait cru à Naples un 31 décembre, à Naples ou à Palerme, ex æquo dans la démesure pyrotechnique, avec Barcelone à la Saint-Jean d’été, le tiercé des villes amoureuses du bruit, Carcaixent y mettait de la bonne volonté, la fête battait son plein, après trois ou quatre verres de plus et un dîner rapide Stéphanie a voulu aller se coucher, je l’ai laissée rentrer seule à l’hôtel moi j’avais affaire 25, avinguda Blasco-Ibáñez à l’extrémité sud du centre-ville, belle coïncidence, Blasco Ibáñez l’auteur des Quatre Cavaliers de l’Apocalypse et de Mare nostrum , quelle adresse, avec son grand âge j’étais à peu près sûr que l’homme que je cherchais serait chez lui, peut-être même endormi, s’il pouvait trouver le sommeil, un peu en dehors du centre j’ai avisé une cabine téléphonique, j’ai composé son numéro, au bout de quatre sonneries une voix d’homme a répondu, si ? j’ai raccroché immédiatement, d’après mon plan l’avenue se trouve cent mètres à peine vers le sud, Ljubo Runjas ne m’attend pas, il s’appelle d’ailleurs Barnabas Köditz maintenant, il réside en Espagne depuis 1947, à Madrid d’abord puis, à la mort d’Ante Pavelic dix ans plus tard, il s’est installé à Carcaixent, des années durant il a renseigné les services yougoslaves sur les activités de Luburic le boucher et des autres Oustachis protégés par Franco, il les a tous donnés, en échange de sa propre impunité — de qui se cacherait-il, Ljubo Runjas le sergent de Jasenovac, à vingt ans c’était l’homme des basses œuvres, des assassinats de femmes et d’enfants, par le poison le gaz la matraque ou le couteau, il avait le sang bouillant de jeunesse, Ljubo, né en 1922 il mourra dans son lit, contrairement à son mentor Maks Luburic qu’il a trahi, il a aidé son assassin à s’enfuir vers la France et je le soupçonne d’avoir planté aussi un ou deux coups de couteau dans le corps de son ami, par plaisir, prudent il a ensuite quitté Carcaixent pour Valence, avant de revenir s’y installer plus de vingt ans après les faits, pour des raisons que j’ignore, peut-être sentimentales, peut-être financières, il y est encore à près de quatre-vingts ans quand je me dirige vers l’avenue Blasco-Ibáñez l’écrivain amateur de duels, tout le village est à la fête les rues sont désertes, sombres, l’avenue est d’un côté bordée d’immeubles de l’autre de quelques villas qui donnent sur les vergers de la rive du Júcar, la nuit est bien noire, pas de lune, pas une étoile, les étoiles ne devaient pas briller souvent à Jasenovac sur la Save que les détenus traversaient en bac pour aller à Gradina où avaient lieu la plupart des exécutions, on raconte que Ljubo Runjas tua de ses mains dans un champ près de cent personnes en une soirée, au couteau, impossible de croire que ces condamnés se tenaient tranquilles dans leur champ, il devait falloir leur courir après comme des poulets, des femmes des enfants des vieillards, Ljubo Runjas avait inventé une méthode pour ne pas avoir de crampes dans les doigts il s’attachait l’arme par une pièce de cuir directement à la paume comme un gant, la main n’avait que peu d’efforts à faire, juste diriger la lame, tout le mouvement était dans le bras comme un joueur de tennis, coup droit, revers, combien d’humains a-t-il sacrifiés en trois ans à Jasenovac, bien plus que de bêtes à l’abattoir de son père, plus que tous les agneaux de Bosnie un jour de Kurban Bajram, même les nazis étaient horrifiés des méthodes Oustachis, eux qui cherchaient à protéger leurs soldats de la proximité des victimes, qui utilisaient la technologie pour le massacre depuis que Himmler lui-même, dans un fossé près de Riga, avait été éclaboussé par du sang juif : à Jasenovac il n’y avait pas de règle pas de technique pas d’ordre dans la mort elle venait selon le bon vouloir des assassins, armes à feu, armes blanches, massues surtout, les détenus franchissaient un à un une double porte, derrière laquelle ils prenaient un bon coup de maillet sur l’occiput, au suivant, au suivant, les exécuteurs se relayaient toutes les trente ou quarante victimes, de l’artisanat, de l’artisanat ou au plus une manufacture du XVIII esiècle — je sonne au numéro 25, la villa est blanche, avec un porche et une avancée, un jardin minuscule où trône un court palmier, pas de lumières, j’insiste, il est vingt-deux heures trente, un jour de fête, le porche s’illumine, l’interphone crépite, le même si ? qu’au téléphone, j’articule bien fort Dobar večer, gospon Runjas, kako ste ? il y a un long silence, a-t-il changé d’avis, j’imagine mon vieillard hésiter dans sa robe de chambre, un grésillement parcourt soudain le portail, je le pousse, il y a un homme à contre-jour sous le porche au haut des marches, je m’approche, j’ai devant moi Ljubo Runjas le petit, un mètre soixante-cinq tassé par l’âge, les cheveux blancs, le visage ridé, un nez saillant, des oreilles démesurées, le regard soupçonneux voire menaçant contraste avec la voix fluette qui me dit je vous attendais bien plus tôt, j’étais couché vous savez , je ne réponds rien, il me fait signe d’entrer, je discute quelques minutes avec Ljubomir Runjas le brutal que les ans ont plié, Ljubo le sous-fifre, le petit assassin mourra dans son lit, à Carcaixent, sans que personne se donne la peine de le retrouver, il me demande des nouvelles de mon grand-père, je lui apprends que Franjo Mirkovic est décédé en 1982 à Paris, il fait ah, nous partons tous, les patriotes disparaissent tous les uns après les autres , adieu premier Etat indépendant de Croatie, le NDH noir, sauvage et grand massacreur de Serbes, adieu, bon vent, le faux señor Köditz a l’air un peu triste, le salon dans lequel il me reçoit est typiquement espagnol, rempli de bibelots, de couleurs, une Vierge à l’Enfant sur un mur, une icône d’argent sur le buffet des années 1960, ici on pense que Barnabas Köditz est un retraité allemand, je lui demande pourquoi il est revenu vivre à Carcaixent, il me répond par un haussement d’épaules, il a l’air nerveux, pressé d’en finir — il se lève lentement, s’approche du buffet, ouvre un tiroir, prend un paquet carré entouré de papier kraft, il me le tend, sur le dessus il y a mon nom, tracé d’une belle calligraphie à l’encre bleue, à l’ancienne, Mirkovic Francis , je prends le paquet, le remercie, Ljubo reste debout pour me faire comprendre que l’entretien est terminé, adieu, adieu, bog, bog , il ne me tend pas la main, moi non plus, il n’y a rien dans son regard, il me reconduit jusqu’au perron, attend que j’aie franchi le portail pour refermer la porte, et voilà, je suis dans la rue un paquet sous le bras, les feux d’artifice illuminent de nouveau la nuit, des gerbes d’étincelles suivies d’une explosion sourde, des fusées sifflantes qui dépassent les toits, dans le paquet il y a une centaine de photographies annotées de Jasenovac, des lettres, et une longue liste de chiffres, le décompte des morts, sans noms ni origine, juste l’état journalier des décès, de 1941 à 1945, mille cinq cents jours, mille cinq cents lignes de calcul, tous les fusillés les empoisonnés les gazés les matraqués les éventrés les noyés les égorgés les brûlés tous regroupés en un nombre et une date, pour chacun des sous-camps autour de la Save, au milieu des cigognes et des carpes — à Carcaixent près de Valence la fête bat son plein, un orchestre a pris possession de la place, de temps en temps on tire une fusée, un pétard, il est tôt encore ce sont les vieillards et les enfants qui dansent, sur des paso doble d’autrefois, deux par deux ils dansent, je m’arrête pour les regarder un moment, les couples sont élégants, les hommes bombent le torse en balançant légèrement les épaules, les femmes se laissent guider d’un bout à l’autre de la piste, ceux qui sont trop vieux ou trop jeunes pour danser sont accoudés à la buvette ou assis sur des chaises pliantes, Ljubo Runjas alias Barnabas Köditz s’est peut-être déjà assoupi, je pense à Jasenovac, je pense à Maks Luburic, à Dinko Sakic que la nouvelle Croatie vient de condamner à vingt ans de prison à l’âge de soixante-dix-huit printemps, extradé par l’Argentine Dinko avait commandé Jasenovac en compagnie de Maks Luburic son beau-frère : ils ont dansé sur les bords de la Save, ils ont dansé dans ce village oublié d’Espagne, je serre le paquet je vais aller me coucher, le paso doble est terminé de nouvelles fusées illuminent le ciel, des fleurs bleues et rouges des détonations de fête pour les morts de Jasenovac, je monte me recroqueviller contre Stéphanie, en écoutant la rumeur de la musique, dans le noir, se mêler au fracas du feu d’artifice et à la respiration de la femme allongée, malgré tout elle dort, elle dort et j’ai beaucoup de mal, va savoir pourquoi, à me persuader qu’elle n’est pas morte, en dépit du souffle régulier qui parcourt sa poitrine alors que l’orchestre entonne A mi manera , douce version ibère de My Way — le lendemain matin, après un sommeil empli de cigognes volant au-dessus de charniers marécageux, après un petit-déjeuner rapide au milieu des débris festifs, après avoir récupéré la Seat au parking nous sommes passés par le cimetière de Carcaixent voir la tombe de Luburic-Pérez, belle et entretenue, Stéphanie n’en croyait pas ses yeux, les gens d’ici l’appréciaient disait-elle j’ai répondu c’est exact, ses enfants allaient même à l’école du coin sans qu’on leur lance la moindre pierre, adieu Maks le boucher, nous avons continué vers Xàtiva sans savoir que quelques jours plus tard Barnabas Köditz mourrait d’un accident vasculaire, adieu Ljubo le sergent sanguinaire, tes documents ont rejoint la valise, les photographies minutieuses, les chiffres, les lettres administratives de Zagreb, adieu — à une vingtaine de kilomètres la petite ville de Xàtiva hésitait entre la plaine, la montagne, les palmiers et les orangeraies, les ruelles du centre étaient agréables et les palais Renaissance rappelaient les grandes familles de l’endroit et notamment les Borgia, qui connurent la puissance et la gloire à Rome : le palais natal du pape Alexandre VI Borgia était sombre et fastueux, comme le pontificat de son propriétaire, que ses si nombreux enfants et ses passions pour le coït, le scandale et la politique rendent éminemment sympathique, Stéphanie l’Alsacienne s’offusquait du manque de respect de ce pontife pour l’institution papale, o tempora, o mores , les papes d’aujourd’hui voudraient être prudes mystiques falots et bien lavés, ceux d’autrefois sentaient le stupre et la conspiration, les Borgia parlaient le valencien entre eux jusqu’au cœur de Rome ce qui en fait des héros historiques de la cause locale, malgré le gentil parfum de soufre qu’exhale leur saga : Xàtiva était donc agréable et on y mangeait bien, un genre de paella cuite au four, souvent arrosée d’un vin de combat produit aux environs d’Alicante, ce breuvage avait quelque chose de médiéval et de sulfureux lui aussi, le paquet de Jasenovac était toujours enveloppé de son kraft et j’oubliai, dans la bonne chère et la fornication, les morts et les bourreaux — quatre jours de vacances, Valence Carcaixent Xàtiva Dènia Valence, Stéphanie était contente, elle avait la faculté enviable de pouvoir oublier Paris et le boulevard Mortier à peine la porte de l’avion refermée, elle effaçait ses rapports ses analyses de jeune cadre secrète en un clin d’œil, j’avais l’impression qu’elle en était encore plus belle, avec ses lunettes de soleil qu’elle utilisait comme un serre-tête pour retenir ses cheveux sombres, elle était calme, entièrement présente au monde, armée de Proust de Céline et de ses convictions soutenues par une grande culture, j’ai le sentiment que je la regrette tout d’un coup assis sur mon trône ferroviaire ma clope à la main, elle me manque parfois, mieux vaut ne pas y penser, ne pas penser à la catastrophe de la fin de notre relation, où est-elle à présent, en poste à Moscou ce dont elle rêvait, si je la croisais dans la rue je ne lui adresserais pas la parole, elle non plus, nous nous ignorerions comme nous nous sommes ignorés à la fin dans les couloirs du Boulevard, nous n’étions pas censés nous rencontrer j’étais promis à un autre destin j’étais en sursis Stéphanie n’était qu’une illusion, trois jeunes tambours s’en revenaient de guerre, trois jeunes tambours, et ri et ran ranpataplan, s’en revenaient de gueeerre , j’ai cet air dans la tête maintenant, la valise est bien lourde, et le gin n’y peut rien — je me repasse de l’eau sur la figure, la vitre des toilettes est opaque, je ne sens que la pression des tunnels interminables sur les tympans, entre Bologne et Florence, qui ne devrait plus être bien loin maintenant, sommes-nous déjà en Toscane, quelle heure est-il, sept heures quinze, encore une demi-heure avant Florence puis trois cents kilomètres pour Rome et la nouvelle vie, si je ne descends pas en route, si je ne profite pas d’un arrêt inopiné pour tenter d’échapper au Destin, mais les choix sont déjà faits depuis longtemps, je vais livrer la valise, j’irai jusqu’au bout, l’automne 1990 je commençais le voyage dans un train depuis la gare de Lyon, je traversais l’Italie pour la première fois, déterminé, un peu angoissé tout de même, fort de mes connaissances militaires prêt à mettre mon épée au service de mon pays, maintenant elle va retrouver son fourreau, adieu Francis Mirkovic le boucher de Bosnie, adieu, adieu Andrija le féroce, repose en paix, dans le train de Zagreb nous chantions trois jeunes tambours en buvant, maintenant j’ai bu seul et ri et ran, ranpataplan , maintenant je suis seul dans la nuit enfermé dans ce réduit, il va falloir que je trouve le courage de le quitter, la force, comme parfois dans la guerre on avait peur de sortir, une nuit sur le front en Bosnie il fallait deux types pour aller reconnaître les lignes ennemies, le plus près possible pour voir où les tchetniks s’étaient installés, Andi s’est porté immédiatement volontaire et il m’a choisi pour l’accompagner, en théorie j’étais plus gradé que lui mais qu’à cela ne tienne, j’ai accepté, nous nous sommes équipés, armes et munitions, je me souviens j’ai cassé un lacet en serrant trop fort mes godillots ce qui a fait rire Andrija évidemment mais m’a paru un mauvais présage, peut-être Athéna ne nous accompagnerait-elle pas cette fois-ci, la fille de Zeus regardait ailleurs, nous sommes partis au plus noir de la nuit vers deux heures, nous avons commencé à descendre la colline entre les arbres en glissant dans l’humus détrempé, j’avais la trouille, à cause de l’obscurité ou du lacet, je ne sais pas, mon fusil cliquetait contre les boutons de ma veste j’étais obsédé par ce bruit j’étais sûr qu’il allait nous faire repérer Andrija a dérapé s’est étalé sur le dos a juré comme un charretier à voix basse, on ferait mieux de rentrer, j’ai pensé, on ferait mieux de rentrer tout de suite avant la vraie catastrophe, elle paraissait imminente, putain on y voit comme dans le trou du cul d’un nègre a chuchoté Andrija ça ne m’a pas fait rire mais il avait raison on pouvait croiser tout un régiment sans s’en rendre compte, plus nous descendions plus la pente était raide, il faudrait s’accrocher aux troncs pour remonter, les Serbes devaient être juste en bas — nous nous sommes arrêtés pour écouter on n’entendait rien, à part une chouette dans le lointain, la déesse ne nous avait peut-être pas abandonnés finalement, la nuit sentait la terre l’herbe le froid humide le calme très loin du fracas de la guerre Andrija me regardait l’air de dire on remonte ? la vallée était plongée dans le noir il n’y avait pas un ennemi dans ces parages c’est sûr juste un bruissement de feuilles irrégulier comme des pas hésitants en contrebas j’ai saisi l’épaule d’Andi mis un doigt sur ma bouche quelqu’un approchait, la chouette s’est tue soudain, quelqu’un s’efforçait de remonter la colline en soufflant, sur notre droite — Andrija a souri, heureux finalement de ne pas avoir crapahuté pour rien, ma trouille est revenue, quelle poisse, des kilomètres de collines et nous tombions presque nez à nez avec des tchetniks, combien étaient-ils, j’avais beau tendre l’oreille je n’en entendais qu’un seul, un seul type soufflant et cassant des branches, voilà ce que doivent ressentir les cerfs et les biches à l’approche du chasseur, des bris de branchages et un serrement de poitrine Andrija m’a fait signe de nous déplacer vers la droite pour intercepter ce lourdaud bruyant, peut-être un civil, mais qu’est-ce que foutrait un civil en pleine nuit au milieu du front, peut-être un des nôtres perdu remontait vers nos lignes, Andi le brave s’est éloigné le plus silencieusement possible j’ai obliqué vers la droite l’inconnu allait se retrouver entre nous deux dans quelques secondes je l’entendais distinctement maintenant un gros gibier avançait péniblement vers Andrija je me suis caché derrière un arbre j’avais la bouche sèche j’ai retenu mon souffle le tchetnik m’a dépassé je lui ai attrapé les deux jambes il s’est effondré dans la boue Andi lui a sauté sur le râble l’a bâillonné de la main pour étouffer son cri de frayeur, je l’ai débarrassé de son arme, j’ai tendu l’oreille, à part le souffle affolé du Serbe la colline était silencieuse, Andi a mis son poignard sous la gorge du soldat pétrifié et l’a fait s’asseoir face à moi il avait une quarantaine d’années les yeux exorbités j’ai chuchoté si tu cries on t’égorge, compris ? il a hoché la tête Andrija a retiré sa main mais pas sa lame, qu’est-ce que tu fais ici ? j’ai demandé, il a balbutié on on m’a envoyé en reconnaissance il était si effrayé qu’il avait du mal à parler, son haleine puait l’oignon, j’ai demandé où sont les autres ? il a répondu je suis tout seul , avec un air de désespoir, menteur tu te fous de nous ou quoi ? le couteau a appuyé un peu plus fort sur sa pomme d’Adam il est devenu livide je vous jure, je vous jure, je suis tout seul, je devais aller repérer vos lignes, je me suis perdu , je l’ai cru, le front avait bougé la veille après leur offensive, ils voulaient savoir où nous nous étions retirés, tout comme nous voulions savoir où ils s’étaient arrêtés, je lui ai posé la question, en bas, de l’autre côté de la rivière , c’était logique, sans doute vrai, on allait pouvoir remonter notre pêche, ce poisson aux yeux exorbités parti pour nous espionner seul dans la nuit, Andi m’a demandé à voix basse on y va ? en me levant j’ai remarqué que notre Serbe avait une gibecière au côté, un sac de toile, je l’ai soupesée le soldat roulait des yeux apeurés, je l’ai ouverte, elle était remplie de portefeuilles ensanglantés, de chaînes en or, de gourmettes et d’alliances, un détrousseur de cadavres, il revenait la nuit dépouiller les morts qu’on n’avait pas eu le temps d’enterrer dans la journée, éparpillés dans le no man’s land, peut-être un espion mais surtout un vautour au regard affolé, j’ai entendu la chouette hululer dans le lointain, le Serbe a soudain essayé de se dégager, de s’enfuir, Andrija le furieux est tombé en jurant j’ai pressé la détente de mon arme par réflexe deux détonations ont déchiré la nuit suivies de gémissements douloureux je me suis approché du soldat il se contorsionnait dans la boue glacée j’ai pris sa musette son fusil Andi lui a tranché la gorge d’un geste rageur a essuyé son couteau sur la veste du mort allez on remonte , nous sommes remontés, péniblement, Andrija ronchonnant de son côté pestant contre les tchetniks j’écoutais la chouette chanter et emporter l’âme du défunt dans l’Hadès, trois jeunes tambours s’en revenaient de guerre , le troisième dormait là-haut comme un bébé, il ne s’est même pas réveillé quand nous sommes allés nous coucher, après avoir confié notre sombre butin à un officier, les dépouilles mortelles, papiers et bijoux des morts abandonnés — quelques mois avant qu’Andrija lui-même rejoigne les enfers, Andrija abattu déféquant derrière un bosquet par une escouade musulmane sortie de nulle part est mort comme il a vécu, ironiquement, tombé dans sa propre merde ainsi Robert Walser dans la neige, trois balles dans la poitrine propulsé en arrière en plein caca fumant, le pantalon aux genoux, immobilisé par la chiasse l’arme à la main, sûr qu’il rigolait tout seul et disait Za dom spremni en poussant, Andi tu me manques, dans le petit matin le brouillard le goût de bronze du combat je t’ai dit à voix basse “tu ne vas pas aller chier maintenant, neceš valjda sad da kenjaš fais ici si tu veux”, ça t’a bien fait marrer, pauvre con de Croate têtu et orgueilleux, tu m’avais déjà vomi dessus une nuit d’hiver j’aurais supporté ta merde, je l’aurais préférée à ta disparition, évanoui dans l’ironie Andrija j’appuie sur le bouton en plastique noir et l’eau qui surgit le long des parois d’acier du chiotte ferroviaire si moderne est un torrent, une maigre rivière qui emporte tout balance mon urine sur une voie et des traverses défilant à cent cinquante à l’heure pour souiller la Toscane éternelle avec un plaisir immense
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Zone»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Zone» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Zone» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.