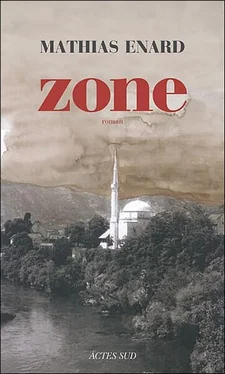Mathias Énard - Zone
Здесь есть возможность читать онлайн «Mathias Énard - Zone» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Город: Paris, Год выпуска: 2008, ISBN: 2008, Издательство: Éditions Actes Sud, Жанр: Современная проза, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Zone
- Автор:
- Издательство:Éditions Actes Sud
- Жанр:
- Год:2008
- Город:Paris
- ISBN:978-2-7427-7705-1
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Zone: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Zone»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Par une nuit décisive, un voyageur lourd de secrets prend le train de Milan pour Rome, muni d’un précieux viatique qu’il doit vendre le lendemain à un représentant du Vatican pour ensuite — si tout va bien — changer de vie. Quinze années d’activité comme agent de renseignements dans sa Zone (d’abord l’Algérie puis, progressivement, tout le Proche-Orient) ont livré à Francis Servain Mirkovic les noms et la mémoire de tous les acteurs de l’ombre (agitateurs et terroristes, marchands d’armes et trafiquants, commanditaires ou intermédiaires, cerveaux et exécutants, criminels de guerre en fuite…). Mais lui-même a accompli sa part de carnage lorsque la guerre en Croatie et en Bosnie l’a jeté dans le cycle enivrant de la violence.
Trajet, réminiscences, aiguillages, aller-retour dans les arcanes de la colère des dieux. Zeus, Athéna aux yeux pers et Arès le furieux guident les souvenirs du passager de la nuit. Le train démarre et, avec lui, commence une immense phrase itérative, circulatoire et archéologique, qui explore l’espace-temps pour exhumer les tesselles de toutes les guerres méditerranéennes. Car peu à peu prend forme une fresque homérique où se mêlent bourreaux et victimes, héros et anonymes, peuples déportés ou génocidés, mercenaires et témoins, peintres et littérateurs, évangélistes et martyrs… Et aussi les Parques de sa vie intérieure : Intissar l’imaginaire, la paisible Marianne, la trop perspicace Stéphanie, la silencieuse Sashka…
S’il fallait d’une image représenter la violence de tout un siècle, sans doute faudrait-il choisir un convoi, un transport d’armes, de troupes, d’hommes acheminés vers une œuvre de mort. Cinquante ans après
de Michel Butor, le nouveau roman de Mathias Enard compose un palimpseste ferroviaire en vingt-quatre “chants” conduits d’un seul souffle et magistralement orchestrés, comme une
de notre temps.
Né en 1972, Mathias Enard a étudié le persan et l’arabe et fait de longs séjours au Moyen-Orient. Il vit à Barcelone. Il a publié deux romans chez Actes Sud :
(2003) — Prix des cinq continents de la francophonie, 2004 — qui paraît en Babel, et
(2005). Ainsi que, chez Verticales,
(2007).
Zone — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Zone», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
VI
le trajet est prévisible, malgré la pénombre il y aura Reggio d’Emilie puis Modène Bologne Florence et ainsi de suite jusqu’à Rome, sa douceur de fruit trop mûr, Rome, ville pourrissante flamboyante et cadavérique dont on comprend trop bien la fascination qu’elle peut exercer sur certains, Rome et la valise que je vais y remettre le temps que je vais y passer peut-être le choix est fait le choix est fait depuis que la déesse chanta la colère d’Achille fils de Pélée, son choix guerrier son honneur l’amour que Thétis sa mère lui portait et Briséis son désir qu’Agamemnon détenait comme Pâris possédait Hélène, celle qui m’attend à Rome dans ses plus beaux péplos, peut-être, comme le train ralentit à présent à l’approche d’une gare, que l’ennui me prend, de l’autre côté du couloir un homme d’une cinquantaine d’années fait des mots croisés avec sa femme dans une revue intitulée La Settimana enigmistica , la semaine énigmatique ou peu s’en faut, sa femme a l’air bien plus jeune que lui, à l’âge d’homme tout est plus difficile, dans le néant de l’indécision qui est le monde des voies et des aiguillages, elle m’attend, j’aime à croire que Sashka m’attend, que son corps m’attend, je pense à la vie qu’on abandonne à celle qu’on se choisit soudain, aux habits qu’on retire, les belles cnémides, la cuirasse, le cuir qui maintient la cuirasse, la lance de hêtre jetée au feu, le bouclier, tous ces moments où l’on se déshabille, où l’on se montre, nu sans rien d’autre que le frémissement de la peau — ces hommes nus par centaines descendus de trains aveugles les vêtements amassés dans un coin de cour l’air glacé soudain les bras qui se croisent les mains qui se portent aux coudes pour vêtir de chair la chair nue marquée en son centre par la tache de naissance des pubis : l’ennemi se précipite toujours sur les vaincus pour les dépouiller, et nous-mêmes nous dépouillions nos ennemis pour de l’argent pour un souvenir pour une arme rare et nos prisonniers avant de les achever, par principe, dans le froid, nous leur ordonnions de se déshabiller parfois pour ne pas tacher ou trouer l’uniforme, la veste qui pouvait toujours servir certes, mais aussi pour jouir du pouvoir de l’homme sur la bête nue, l’homme debout contre la bête glabre et frémissante, et ainsi dérisoires il était plus facile de leur enlever la vie méprisable, le bonhomme de la Settimana enigmistica a une attitude très paternelle, il explique les mots, les lettres qui conviennent, sa compagne cherche dans un petit dictionnaire de poche, elle est plutôt brune, les cheveux longs et attachés, à l’âge d’homme on laisse ses valises, on s’accroche à la jeunesse des autres, on dépouille nos femmes, on les déshabille, il y a près de dix ans que j’ai quitté Venise que Marianne est partie et l’autre vie qui débutait sans que je le sache dans le train de Milan par une douleur sourde dans les testicules prend fin aujourd’hui, la démission donnée, la trahison consommée, l’effroi du monde maintenant, je me confie tout entier à un nouveau train, un de plus, je ne suis plus une espèce de fonctionnaire mouchard gratte-papier ou fouille-merde mais un homme libre, et cette liberté encombrante fruit de ma traîtrise je vais la dépenser en compagnie de Sashka qui m’attend peut-être, Marianne est si présente maintenant, refermer une existence rouvre la précédente, dix ans plus tard, plus vive que jamais, qu’a-t-elle pu devenir, je l’imagine professeur dans un lycée parisien, mère, bien sûr, elle dont le corps et l’éducation la poussaient vers l’enseignement et la maternité, tout comme moi vers la guerre car il était tout naturel, pour un garçon éduqué à la violence, habitué à l’idée des armes par l’enfance, l’école et les bandes dessinées, élevé dans l’idée de Dieu et de la nation opprimée par les jérémiades de sa mère, de se retrouver un jour un fusil d’assaut à la main, près d’Osijek, poussé par les pleurs de sa génitrice et tiré par l’appel de Franjo Tudjman, le Sauveur, c’est le visage inexpressif mais agréable du cruciverbiste qui m’y fait penser, abruti par le sommeil vain du rythme ferroviaire, Tudjman dont la photographie alla vite rejoindre celle d’Ante Pavelic en uniforme sur l’autel patriotique de ma mère, avec le Christ et une Vierge larmoyante, Tudjman arriva à Zagreb en Roi des Rois, pour transformer mon existence radicalement, me sauver ou me perdre, allez savoir, et depuis notre télévision du 15 earrondissement, dans le noir, religieusement, nous écoutions ses discours élégiaques dont je ne comprenais que la moitié, que maman me traduisait avec dévotion, en ce jour où le Christ arriva à Jérusalem, il fut accueilli en prophète , hurlait le présentateur, aujourd’hui la capitale croate est la nouvelle Jérusalem : Franjo Tudjman est venu pour les siens , la Croatie renaissait, elle sortait tout armée du casque de Tudjman, s’extirpait enfin de son sommeil titiste, retrouvait dans les blessures de la guerre une force un courage une jeunesse et au contact de ses ennemis une volonté une puissance une belle douleur dont les noms s’inscrivaient en lettres de feu sur les écrans de télévision, Knin, Osijek, Vukovar, les Serbes hirsutes et ivrognes marchaient contre l’innocence et la beauté, ils nous massacraient, nous narguaient en nous massacrant, et toute mon existence parisienne d’étudiant tranquille, ces trajets en métro, ces cours pour moi abscons de droit public, d’histoire et de politique, les rendez-vous quotidiens avec Marianne glissaient vers le vide que je découvrais en moi le vide silencieux de l’appel de la patrie en danger, la faim le désir l’appétit de sens de lutte de combat d’une autre vie qui m’apparaissait terriblement vraie, réelle, il fallait combattre l’injustice qui déchaînait sur le jeune Etat toutes les foudres de l’archer Apollon protecteur de l’Orient, et plus les images et les discours me parvenaient, plus ma mère pleurait à la fois de joie et de douleur, plus je glissais vers la Croatie, plus je disparaissais de Paris de l’université j’échappais à Marianne au présent je m’enfonçais dans les reportages dans les Krajinas dans Dubrovnik encerclée dans les provocations de l’armée yougoslave dans les chants patriotiques que je découvrais et même la langue même la langue que j’avais à moitié oubliée pas vraiment apprise méprisée en fait pendant des années même la langue me revenait plus réelle et plus forte que jamais au grand dam de mon père je me mettais à parler croate à la maison lui qui n’y comprenait goutte se sentait exclu de cette folie nationaliste comme il disait sans doute avec raison, tu ressembles à ton grand-père disait maman, podsjecaš me na djeda , tu ressembles à ton grand-père, c’était un piège, j’y suis tombé tout comme un train s’enfonce dans la nuit j’ai suivi les traces de mon grand-père sans savoir qui il était, deux ans de guerre, deux ans complets à part trois escapades, une à Trieste avec Andrija et Vlaho et deux à Paris, surtout pour revoir Marianne, ressentir ce que racontaient les poilus de 1914, l’incompréhension de l’arrière, l’impossibilité de raconter, de parler, comme ces enfants qui sortent de l’école et ne savent pas dire ce qu’ils ont fait de leur journée : quand Marianne m’interrogeait sur la guerre, allongés tous deux dans le noir dans sa chambre de bonne je répondais “rien”, je n’ai rien fait, rien vu rien appris je ne savais pas dire, c’était impossible, je racontais à ma mère que nous nous battions pour la glorieuse patrie, c’est tout, je n’ai rien vu à la guerre et ensuite je repartais, je reprenais le train de nuit d’Italie ou d’Autriche et le lendemain soir j’étais à Zagreb, je pensais aux poilus qui quittaient Paris, j’imaginais, dans ce train si civil, si confortable, que j’étais un permissionnaire habsbourgeois qui revenait au front, qui revenait combattre les Italiens là-bas sur l’Isonzo dans les contreforts des Alpes en 1917 alors que de l’autre côté du couloir les mots croisés battent leur plein, l’homme plus âgé que sa compagne lui parle comme un professeur, Hemingway et son infirmière, Hemingway qui passa par ici avant d’aller jouer aux ambulanciers dans la montagne, avait-il lui aussi ressenti le décalage, l’impossible fossé creusé par la guerre entre l’arrière et les soldats, ceux qui ont vu, qui savent, qui souffrent, ceux dont on a fait de la chair morte ou mortifère, et dans cette immense campagne plate étendue par la nuit je pense à ceux qui montaient au front dans la Somme après soixante-douze heures à Paris, après avoir bien sifflé leurs petits verres avoir été bien tristes après avoir bien forniqué tristement ils sont comme nous silencieux dans leur wagon ils n’échangent pas une parole au loin quelques éclairs vifs annoncent la zone des armées la zone on approche même si l’on n’entend pas encore le canon on le voit on approche, on a la gorge qui se serre, on descend du train, on traverse un groupe de blessés qui attendent l’évacuation en gémissant, on monte dans un camion conduit par un type un peu acariâtre, un rien brutal, jaloux du permissionnaire, ensuite on termine à pied, on salue les artilleurs qu’on envie d’être aussi bien planqués au chevet de leurs obusiers, même s’ils finissent tous à moitiés sourdingues c’est pas grave, on avance dans les lignes, dans les réseaux à demi enterrés en suivant les indications écrites sur des panneaux en bois ou sur des casques boches fichés dans la glaise, on espère que la première nuit soit calme, pour le moment ce sont les Anglais qui écopent là-bas en direction d’Ypres, on s’interdit de penser à celle qu’on vient de quitter, au dernier coup qu’on a tiré dans un meublé, au dernier coup qu’on a bu seul place de Clichy parce que tous les copains sont au front ou au boulot, le garçon de café trop jeune encore pour partir avait un respect envieux pour le poilu, mais son tour viendra, quand mourra-t-il, lui, tombera-t-il dans quelques mois au Chemin des Dames, coupé en deux par une mitrailleuse, décapité par un barbelé ou volatilisé par une mine dans sa tranchée, pleurera-t-il en prenant dans ses mains ses boyaux tièdes et odorants, appellera-t-il sa mère, cherchera-t-il comme un fantôme son bras planté quelque part dans la boue, on est dans la terre, dans les premières lignes qui sont de la terre remuée par les obus, à peine étayée, on arrive au 329 ed’infanterie que commande un officier qu’on n’a jamais vu, voilà Untel, voilà Untel, tous savent qu’il vaut mieux laisser le permissionnaire à son silence, tous sont terreux pouilleux affamés il y a soixante-douze heures qu’on ne les a pas vus on cherche inconsciemment ceux qui manquent on voit ceux qui manquent alors on ne dit rien, le lieutenant fait un bref signe de tête on pose son barda on cherche un poste on serre son Lebel assis comme dans un train on est de retour et une partie de soi la bonne est restée à l’arrière, à l’arrière où l’on savoure la fin du monde, le coup de pistolet de Gavrilo Princip à Sarajevo sonne le début de la course à l’horreur le 28 juin 1914, Gavrilo âgé de dix-neuf ans maigre et tuberculeux l’arme à la main le cyanure dans la poche recompose le monde détruit trois empires et me précipite sans le savoir dans ce train quatre-vingt-dix ans plus tard, près de Parme à en juger par les lumières de banlieue, Gavrilo Serbe de Bosnie croit à la Grande Serbie que je contribuerai à défaire, le petit activiste a de la chance, comme l’assassin de Jaurès rue Montmartre il est au café, les plans ont échoué, la bombe qui devait en finir avec François-Ferdinand n’a pas explosé sous la bonne voiture, l’archiduc est toujours vivant, pour son malheur Gavrilo Princip est aimé d’Héra, la déesse rusée va aveugler le chauffeur autrichien et c’est le cortège qui viendra jusqu’à Princip, jusqu’à son café, celui de Moritz Schiller au coin de la ruelle en face du pont minuscule c’est une belle journée il n’a qu’à sortir laisser sa tasse à moitié vide prendre la capsule de poison dans la main gauche l’arme dans la droite et tirer, a-t-il eu le temps d’observer les moustaches surprises du Habsbourg, les lèvres frémissantes de la belle Sophie sa femme tuée sur le coup, a-t-il entrevu les millions de morts qui giclaient avec le sang austro-hongrois, était-il content de son tir, le fils de Léto guida-t-il ses traits, était-il fier de ses quatre cartouches, a-t-il hésité, a-t-il pensé il fait beau aujourd’hui je suis dans un café je déclencherai le massacre un autre jour, sans doute n’a-t-il pas eu le temps de réfléchir, il est sorti, et d’après les rapports de police il a fait feu à un mètre cinquante de distance, les yeux dans les yeux — Gavrilo Princip mourra à son tour à Theresienstadt, dans la prison de la ville tchèque où le Reich installera en 1941 un ghetto modèle, rendant ainsi un hommage saugrenu à l’homme qui permit indirectement son avènement, ajoutant la mort à la mort, un ghetto pour artistes, pour intellectuels, un des pires camps de concentration qui superposa la farce à l’horreur, Gavrilo dans sa cellule du château de Theresienstadt mourut en 1918 sans avoir vu la naissance du royaume des Slaves du Sud pour lequel il avait indirectement combattu, et la capsule de cyanure n’y était pour rien, il est mort lentement de la tuberculose, ce pourquoi on l’avait recruté dès le départ : une bande de terroristes tubards, des condamnés à court terme, voilà l’idéal, on a bien moins de remords de les envoyer à l’abattoir — la première fois que je suis allé à Sarajevo je suis passé devant l’ancien café de Moritz Schiller au coin du pont, sur le quai il y a une plaque orgueilleuse, que signifie-t-elle aujourd’hui, que signifiait-elle alors, en plein siège, le long de la rivière où tombaient de temps à autre des mortiers serbes, ou bosniaques, pour rappeler à la communauté internationale que les temps étaient difficiles on n’hésitait pas longtemps à se tirer soi-même dessus, comme les recrues de 1917, comme le serveur de la place de Clichy parti au Chemin des Dames se tirerait une balle dans le pied pour échapper à l’hécatombe, l’armée musulmane s’est sans doute tiré dans le pied une ou deux fois, dans l’agonie de la ville où Gavrilo Princip, toussant, crachant du sang, avait tué le frère de l’empereur, un obus ressemble à un obus, il n’a plus de propriétaires une fois lancé, innombrables les automutilations pendant la guerre de 1914, qui dans la main, qui dans le gras du bide, et je comprends ces artilleurs bosniaques exaspérés par l’indifférence internationale qui utilisèrent sans doute la tactique du poilu épuisé espérant que l’aviation américaine qui leur tournait autour finisse par mettre les batteries serbes hors de combat et j’imagine, comme le jeune soldat plante son Lebel dans sa godasse et appuie sur la détente, qu’ils avaient dû hésiter longtemps avant de tirer sur les leurs, ou pas, peut-être comme Gavrilo Princip à dix-neuf ans étaient-ils déterminés, endurcis par la certitude de la mort qui était l’ambiance de Sarajevo pendant la dernière guerre — le bataillon des tuberculeux serbes de la Main noire préfigurait nombre de désespérés, de suicidaires, de sacrifiés, qui sont l’armée des ombres du siècle ou de l’histoire tout entière, peut-être y avait-il quelque chose de fondateur dans le calibre 32 de Princip, était-ce vraiment lui qui tirait, il était déjà moribond, condamné, un fantôme, un jouet aux mains des dieux courroucés, on donne la gloire un moment à Diomède fils de Tydée, aux Ajax, à Koca Seyit Çabuk l’artilleur des Dardanelles, Gavrilo a eu son moment de gloire avant d’aller pourrir à Theresienstadt, il déclenche de sa main les roulements de la guerre, la prison de Terezín où il clabote en s’étouffant lui survivra, elle, et verra bien d’autres condamnés, juifs, communistes tchèques, opposants de tout poil fusillés ou pendus dans une arrière-cour par les agents de la Gestapo, cousins des SS qui dirigeaient juste en face, de l’autre côté de la rivière, un ghetto des plus terrifiants, contenant près de cinquante mille internés, juifs de Prague, d’Allemagne, d’Autriche et d’ailleurs, dans la géographie complexe de la déportation un ghetto où l’on mourait en musique, où l’on créait, où l’on pouvait à loisir réfléchir à son épitaphe, inscrite en nuages bruns dans le ciel d’Auschwitz, le plus souvent, le grand espace du ciel après la crasse et la douleur de la concentration, Terezín modèle pour la bonne conscience du monde entier, regardez comme nous parquons bien nos bêtes, comme notre bétail est sain et bien pansé, et la Croix-Rouge ne trouva rien à redire à cette ferme modèle dont les images dûment estampillées “made in Third Reich Germany” furent diffusées dans l’Europe entière, montrant sans montrer ce que tout le monde savait sans savoir, que la concentration était le prélude à la destruction, comme le marquage — des bœufs, des bœufs laissés libres dans le corral — était le début de la fin, repérer pour abattre, contrôler, séparer le bien du mal le bon du mauvais le sien de l’autre pour se construire se fabriquer soi en creux les épaules appuyées contre la différence contre le juif l’orthodoxe le barbare les titans l’ordre contre le chaos ainsi Gavrilo Princip construit son royaume slave en abattant le Habsbourg : j’en ai fréquenté des dizaines, pendant des années, dans mes dossiers, des martyrs des candidats au martyre des bourreaux des illuminés des désespérés des activistes pénétrés par la cause ou par Dieu sans bien savoir lequel ils servaient, si c’était Arès Zeus porte-égide ou Pallas Athéna, accrochés à un Dieu unique qui est tout cela à la fois, l’ordre et le chaos le début et la fin, qui éparpille leurs corps avec un plaisir tout olympien, des Algériens des Egyptiens des Palestiniens des Afghans des Irakiens dans mes zones d’activité à moi entre 1996 et aujourd’hui combien sont morts je n’en ai aucune idée, ceux-là n’intéressent que peu ces victimes qui font des victimes les petits-enfants de Gavrilo Princip le grand déclencheur — le cruciverbiste qui ressemble vaguement à Hemingway à cause de la barbe a une quinte de toux à ce moment précis et je ne peux m’empêcher de sourire, l’histoire a toujours ses clins d’œil, je me retourne sur mon siège, je ferme les yeux non loin de Parme ville agréable dans mon souvenir je m’y suis arrêté une fois en route pour la Grèce mes premières vacances de jeune agent célibataire, le coup de pied de Marianne m’avait remis sur le droit chemin je suis retourné aux sciences politiques j’ai enfin obtenu le titre ma guerre est passée comme “stage de longue durée à l’international auprès du ministère de la Défense croate” et m’a valu des points en plus je crois, où ai-je bien pu trouver la force de me rasseoir sur les bancs de l’école, la douleur dans les couilles peut-être, la longue inaction de Venise, ma part de destin tout simplement — j’aurais pu soigner mes vignes tant bien que mal comme Vlaho l’infirme près de Dubrovnik, me décomposer comme Andrija, entrer à l’usine comme Ghassan l’exilé, ou rester assis devant la télévision chez mes parents, ne plus sortir du 15 earrondissement, ma mère avait rajouté ma photo en uniforme sur l’autel patriotique, Pavelic, sa photo de jeune fille avec Ante Pavelic en Espagne, le pape, le grand-père, Tudjman, le drapeau et moi, voilà son monde, mais je n’étais pas pressé d’y retourner, au contraire, je voulais repartir, et je préparai les concours des administrations les plus diverses et les plus exotiques : je voyais mon salut dans les beaux lustres en cristal du Quai d’Orsay, dans les cravates mordorées des plénipotentiaires, dans le bleu sombre des passeports diplomatiques et les formules surannées des lettres de créance, sans savoir de la Carrière autre chose que ce qu’on pouvait en apprendre dans Belle du Seigneur , qui me semblait un destin somme toute enviable, voire attrayant, chatoyant, pour tout dire, au cœur du monde, avec les plus hauts salaires de toute la fonction publique, les chauffeurs, les réceptions et les pays où l’on n’aurait jamais pensé s’établir, Mauritanie, Guinée-Bissau, Congo, Bhoutan, aussi m’efforçais-je d’apprendre, de m’entraîner à ces épreuves absconses, droit, synthèse, histoire, que sais-je, sans aucun succès, évidemment — soit à cause de mon passé douteux et guerrier, soit tout simplement parce que mes résultats n’étaient pas à la hauteur de ce prestigieux ministère la diplomatie me refusa lors de deux concours différents, malgré, c’est du moins ce qu’on m’apprit par la suite, une honnête prestation à l’oral , et ma grande déception me semble aujourd’hui, dix ans plus tard, à l’âge d’homme, dans ce train pour le Vatican, difficile à comprendre : je ne pouvais pas voir ce que Zeus tonnant me réservait, un destin dans une administration bien plus obscure que les Affaires étrangères, sise boulevard Mortier, maréchal d’Empire rescapé de toutes les campagnes napoléoniennes où l’on m’employa, contre toute attente, comme délégué de défense , ainsi que le spécifiait frileusement l’intitulé du concours administratif, et je suppose que les cent candidats présents dans cette salle d’examen absolument anodine savaient tous ce que signifiait délégué de défense , ou que du moins ils croyaient le savoir, agent de renseignements, agent plus ou moins secret, plus ou moins agent d’ailleurs, car l’action n’était pas à notre programme, purement administratif et linguistique, concours à peu de chose près identique à celui de la préfectorale, des Affaires sociales ou du commissariat de la marine, et alors que Parme défile derrière la fenêtre je revois mes premiers jours au Boulevard, la curiosité, la formation, l’étrange bâtiment sécurisé, sans machine à café pour ne pas favoriser les échanges à bâtons rompus au sein du personnel, les toilettes blindées, les bureaux insonorisés, les dossiers interminables, des dizaines de dossiers à traiter un par un, synthétiser, classer, recouper des sources, remplir des fiches pour demander des renseignements dans telle ou telle direction, sur tel ou tel patronyme apparu au détour de rapports provenant de “postes” ou de “correspondants” aux noms codés, transmettre, référer au supérieur, rédiger des notes, œuvrer pour la défense de la nation, dans l’ombre, à l’ombre d’une pile de chemises en carton, et mes seules compétences géographiques avaient été évidemment ignorées dans la plus pure logique militaire, pas de Balkans pour moi, pas de Slaves : j’ai été versé dans le monde arabe dont j’ignorais tout, à part les histoires de Ghassan, les mosquées de Bosnie et ce que les livres d’histoire voulaient bien en dire, je débutai dans l’enfer algérien en qualité de chef classeur de troisième rang, dans un monde d’égorgeurs d’enfants et de gentils massacreurs aux noms pour moi tous identiques, dans la folie des années 1990 les relents de guerre médiévale, éventrations, amputations, éparpillements de cadavres, maisons brûlées, femmes enlevées, villageois apeurés, bandits sanguinaires et Dieu, Dieu partout pour régler la danse de mort, j’apprenais petit à petit les noms des villes et des bourgades, Blida, Médéa, sauvagement, je commençai par sept têtes de moines décapités sept roses rouges les yeux entrouverts sur leur grand âge l’affaire de Tibhirine le 21 mai 1996 qui fut le début de mes deux années algériennes au boulevard Mortier, le maréchal au long sabre — lui aussi s’en était servi depuis Jemappes jusqu’à la Russie, peut-être avait-il décapité des religieux en robe, des femmes, des enfants, dans la tourmente impériale, chaque matin je pensais à lui, à son habit, à ses épaulettes en me rendant dans mon trou sécurisé traiter mes dossiers, dans l’atmosphère grise et pesante de ce monde du secret où je lisais mes rapports d’égorgements et de manigances militaires sans y comprendre goutte, sans en parler à personne, je m’enfonçais dans la Zone sans passion mais sans dégoût, avec une curiosité grandissante pour les agissements des dieux courroucés, patiemment dans ma tente blindée je gardais les nefs creuses, je défendais dans le noir l’Algérie d’elle-même, et juste ensuite, en reprenant le métro, au moment de regagner mes nouveaux pénates de la rue Caulaincourt, je saluais toujours Mortier sur la plaque du boulevard, mon ange gardien, en sachant qu’il y avait de grandes chances que je sois suivi et observé par mes propres collègues qui devaient s’assurer, tout au long de ma première année — élève fonctionnaire, espion débutant —, que je n’étais pas à la solde de l’Etranger ou de Dieu sait quel mouvement extrémiste, j’ai pu le vérifier récemment en lisant, presque dix ans plus tard, le rapport de l’enquête préliminaire de sécurité me concernant, un étrange miroir, une vie desséchée, une feuille dans un herbier informatique, dates lieux noms suspicions ébauches psychologiques relations coupables ou non famille appréciation du traitant et ainsi de suite jusqu’aux codes références ajouts classements affectations diverses notes absences demande de congés comme ceux qui me menèrent à Athènes en passant par Parme pour échapper quelques jours à l’horreur algérienne aux moines morts qu’on m’avait mis dans les pattes pour que j’archive le massacre que je donne une version plausible de l’incroyable confusion du poste d’Alger, Parme je me souviens j’y ai dîné pas très loin du baptistère et de la cathédrale, en pensant aux Farnèse ducs de Parme et de Piacenza, à Marie-Louise impératrice, surtout pas à l’Algérie ni à la Croatie ni à quoi que ce soit de belliqueux, à part le bûcher d’un moine étrange, Gherardo Segarelli brûlé par les inquisiteurs en 1300, un prédicateur de la pauvreté évangélique pour qui ce n’était pas pécher que de s’allonger nu au côté d’une femme sans être marié, et de se palper, Segarelli voulait retrouver la beauté de l’amour apostolique, la pauvreté la générosité et les caresses des corps féminins, il arpentait Parme avec ses fidèles en prêchant jusqu’à ce qu’un inquisiteur lui mette la main dessus le passe à la question et décide de le condamner au bûcher, Segarelli ne craignait pas la mort, il pensait que la décadence de l’Eglise était un des signes de la fin des temps, que tous allaient crever, tous les prélats les évêques tous finiraient en enfer, quand les flammes l’ont chatouillé Segarelli a hurlé pour le plus grand plaisir des spectateurs, sa tête est retombée sur sa poitrine, son corps s’est consumé longtemps, attaché au poteau, puis les deux bourreaux ont brisé ses os dans les bûches encore fumantes, ont jeté ses membres à demi carbonisés les uns par-dessus les autres et les ont recouverts d’une nouvelle fournée de bois, en prenant soin de récupérer le cœur encore intact du moine amoureux pour le placer sur le dessus du foyer et être ainsi certains qu’il brûle complètement, puis le lendemain matin, une fois le bonhomme complètement réduit en cendres, une fois assurés que Gherardo Segarelli ne pourrait plus participer à la résurrection des corps le jour du Jugement, les deux bedeaux patibulaires ont dispersé ses restes gris et poudreux dans la rivière Parma, en pouffant joyeusement — assis à une terrasse près de la place où l’Eglise éternelle avait supplicié le moine qui cherchait la perfection dans le rapprochement des corps, ma voiture garée dans un parking tout proche, je traversais l’Italie le pays apparemment le plus civil du monde pour prendre un ferry à Bari voir l’Acropole avant d’aller me perdre dans les îles, en mangeant de la salade de poulpes et des brochettes d’agneau, dans la chaleur du soir, les reflets des lamparos sur l’Egée et j’irais bien maintenant m’oublier dans l’hiver si venteux des Cyclades changer de train à Bologne retourner à Bari croiser au large de l’Albanie ou aller en Sicile île du bout du monde m’asseoir dans le théâtre grec de Taormine et regarder la baie de Naxos baigner les collines, mais je dois terminer le marché remettre la valise rester à Rome pour Sashka au sourire d’ange refaire ma vie comme on dit avec le prix de la trahison qui est bien peu de chose l’argent accumulé sur mon compte d’espion tout effacer me vider de ma vie d’homme achever ma part d’existence laisser les trains les voyages le mouvement en général écouter la météo marine bien loin en terre dans un fauteuil profond c’en est fini de l’aventure sans aventure des dossiers des sources des enquêtes interminables dans les réseaux du monde qui se croisent et se recroisent sans cesse, rails, faisceaux de lances, de fusils aux baïonnettes jointes, fascis des licteurs, dont les branchages fouettaient les condamnés et dont la hache les décapitait, ces mêmes faisceaux dont Mussolini fera son emblème et celui de son empire, le monde cerclé de pointes de verges et d’une hache, partout : je me croise moi-même à Milan ou à Parme, je me recoupe comme les sources boulevard Mortier, et hier, rangeant mon bureau pour la dernière fois avant d’aller errer seul dans Paris désert et de rater l’avion, mon bureau vide en fait car on n’y laisse jamais rien traîner à part le Bescherelle le Robert une boîte de trombones j’ai pensé à tous les noms que j’avais croisés tous les lieux toutes les affaires les dossiers sur place ou à l’étranger la longue liste de ceux que j’avais observés un instant comme j’observe à présent les voyageurs dans ce wagon oppressant de chaleur, le cruciverbiste et sa femme, je pourrais leur offrir mon dictionnaire pour leurs grilles s’ils n’étaient pas italiens, mon voisin le lecteur de Pronto , devant moi les têtes que j’aperçois, jeune fille blonde, homme chauve, plus loin scouts ou je ne sais quoi d’équivalent avec foulard et sifflet en sautoir, je les vois encore les yeux fermés, tic professionnel peut-être, quand la première chose qu’on vous apprend, dans une formation d’espion, est l’art de passer inaperçu sans que rien vous échappe, la théorie du filet à papillons, disait mon instructeur, il faut être transparent invisible discret mais aux mailles serrées, les agences de renseignements sont des établissements de chasseurs de papillons badins et le plus souvent bucoliques, ce qui a beaucoup amusé Sashka la première fois qu’elle m’a demandé ma profession, je suis entomologiste, historien naturel, chasseur d’insectes j’ai dit, elle a répondu en riant que je n’avais pas le physique, que j’étais bien trop grave pour une activité pareille, mais c’est une grave discipline, tout à fait sérieuse, j’ai dit, et j’ai ajouté que je partageais mon temps entre le bureau et les voyages d’études, comme tout bon scientifique, que j’étais fonctionnaire, comme tout bon scientifique français — elle m’a avoué qu’elle avait horreur des insectes, qu’ils lui faisaient peur, une peur déraisonnable, comme bien des gens, j’ai dit, bien des gens ont peur des insectes c’est parce qu’ils les connaissent mal j’aurais pu lui parler du phasme, le dormant qui se déguise en branche d’arbre et attend des années avant d’agir, ou du coléoptère, qu’il faut repérer quand il est encore une larve, avant qu’il ne s’envole et ne soit bien plus difficile à attraper, des bousiers porteurs de valises, des moucherons, minuscules informateurs, des grosses mouches bleu charogne, des fourmis avec ou sans ailes, de l’armée de cafards de tout ce monde invisible dans mon bureau mais je me suis tu, et maintenant dans ce train au large de Parme finis les insectes mais il reste encore les réflexes du spécialiste, la discrétion de l’observateur professionnel, homme de renseignements, attaché de défense, Fabre de l’ombre qui aimerait raccrocher son filet et sa loupe, ne plus voir les visages de ses compagnons de voyage, ne plus remarquer la tache de vin sur la chemise de l’Hemingway cruciverbiste ou l’air absolument soumis de sa jeune compagne, j’ai hâte d’arriver, j’ai hâte d’arriver maintenant que je pense à Sashka elle ne m’attend pas enfin pas vraiment que vais-je lui dire je suis encore tout gluant de la nuit passée encore tout tremblant d’alcool, un peu fébrile, hier soir me revient avec une grande vague de honte, la porte refermée sur l’obscur sur Hadès dévoreur de guerriers la vie entre parenthèses dans un train qui me ramène à Rome, à son regard clair — elle va faire une drôle de tête en me voyant, en me voyant dans cet état, transparent grand ouvert par l’alcool et la nuit, par les rencontres dans la nuit, hier en sortant pour la dernière fois du boulevard Mortier j’ai erré de bar en bar à Montmartre jusqu’à finir ivre mort soûl éthéré comme un devin un oracle prévoyant la fin du monde et tout ce qui s’ensuit, les rencontres les hésitations les guerres le réchauffement de la planète le froid plus froid le chaud plus chaud les Espagnols échappant au désert pour se réfugier à Dunkerque les palmiers à Strasbourg mais pour le moment dehors il gèle il pleut les Alpes débordaient de neige ce matin je n’ai presque rien vu je cuvais au rythme du train depuis la gare de Lyon après deux heures de sommeil un affreux réveil une aspirine et une demi-amphétamine pour rendre le voyage plus pénible — mais j’ignorais que j’allais rater l’avion, que je courrais attraper le train de neuf heures, tout juste et sans billet, mon haleine a dû effrayer le contrôleur, toujours les difficultés à partir, après le coup de pied dans les couilles de Marianne il y a dix ans un autre genre de douleur dans les testicules aujourd’hui, la honte me fait frissonner, je serre fort les paupières jusqu’à écraser une larme rageuse de regrets pour hier soir, cette nuit la rencontre absurde de l’alcool de la drogue et du désir, à la Pomponette rue Lepic le seul bar du quartier ouvert jusqu’à quatre ou cinq heures du matin, vieux rade montmartrois d’où l’on sort toujours en titubant, hier à part les habitués il y avait une femme d’une soixantaine d’années très maigre avec un long visage fin qu’est-ce qui m’a pris, elle était très surprise de mon intérêt, méfiante, je me suis introduit dans sa solitude lâchement, en souriant, elle se demandait si c’était du lard ou du cochon et je la désirais, elle s’appelait Françoise, elle buvait beaucoup elle aussi, je ne sais pas pourquoi je me suis rapproché d’elle, je préfère ne pas y penser, entomologiste de la nuit épingler cet insecte peut-être, j’aurais pu lui dire je veux t’épingler violemment si j’avais pensé à quoi que ce soit mais je l’ai seulement embrassée par malice en fait par défi par joie de ma dernière soirée parisienne sa langue était très épaisse et amère elle buvait de la Suze je détourne le regard de la fenêtre j’observe la compagne de l’Hemingway cruciverbiste, elle a une élégante lassitude dans les traits, elle a posé la tête contre l’épaule de l’homme ses cheveux détachés à présent recouvrent un peu la revue de mots croisés — Françoise ne parlait pas d’épingler, elle disait je veux bien que tu me bines, elle me parlait de la biner, à l’oreille, avec beaucoup de pudeur, elle disait je veux bien que tu me bines en pensant que c’était un euphémisme, parce que j’en ai envie disait-elle, et c’est ce qui s’est produit, un binage, rien de plus, ses yeux grands ouverts sur rien comme une aveugle, ses rides devenaient des sillons dans la pénombre, dans la faible lumière rasante de la rue, elle souhaitait rester dans le noir, rez-de-chaussée ancienne loge de concierge rue Marcadet un binage sans préambules elle est vite partie vers la salle de bains sans dire un mot ni même se retourner, et une fois l’hébétude de l’orgasme passée j’ai compris qu’elle n’en sortirait pas avant que je m’en aille, qu’elle avait aussi honte que moi le désir assouvi alors je me suis rhabillé en une minute j’ai claqué la porte pour me réfugier au grand air sous la pluie qui n’avait pas cessé, chien mouillé à l’appendice caudal collant dans le falzar, la nuit épaisse et le retour au comptoir tout plein de honte bête et crasseuse, envoyée par le fond avec une petite poire de plus, en cherchant ma monnaie je me suis légèrement entaillé la pulpe de l’index sur l’étui de la capote remis machinalement dans ma poche et maintenant quinze heures plus tard il y a une petite plaie diagonale sur le doigt que j’écrase contre la vitre froide : je regrette je ne sais pas pourquoi je regrette, on regrette tant de choses dans la vie des souvenirs qui parfois reviennent brûlants la culpabilité les regrets la honte qui sont le poids de la civilisation occidentale si j’avais attrapé l’avion je serais à Rome depuis des heures déjà, je me retourne une fois de plus sur le siège la tête vers la droite vers le grand vide du dehors, à reculons, je vais à reculons dos à la destination et dos au sens de l’histoire qui est le sens de la marche, histoire qui m’amène directement au Vatican, avec une valise pleine de noms et de secrets : je vais retrouver Sashka à Rome, son chat obèse, l’appartement, ses cheveux courts dans mes mains et ce silence étrange qu’il y a entre nous, comme si je pouvais effacer par son ignorance le poids des remords, les femmes, les insectes, les traces, la guerre, La Haye, les fantômes de mes dossiers du Service, Algérie d’abord, Moyen-Orient ensuite, et récemment je rêvais d’une affectation en Amérique du Sud, pour changer d’air vicié, de noms et de langues, c’est peut-être la raison de ce voyage, me déplacer dans les phonèmes comme dans un nouveau monde, ni la langue de mon père ni celle de ma mère, une troisième, une autre, et dans le rythme de ce train monocorde me récrire pour renaître en descendant — le voyageur fatigué s’invente des jeux idiots, des souvenirs, des rêveries, des compagnies pour passer le temps puisque le paysage est entièrement invisible dans la nuit, incapable de dormir, je revois malgré moi les photos des moines de Tibhirine visages sans corps dont j’avais une copie dans mon dossier, immortalisés par l’ambassade d’Alger, le premier choc de ma nouvelle vie d’espion qui me ramenait d’un coup aux blessures aux massacres aux vengeances à la colère froide de la vengeance les têtes terreuses noircies j’entrais dans la Zone dans la terre algérienne qui rendait des membres et des cadavres plus qu’en Bosnie, ensuite la longue liste soigneusement enregistrée ne fit que grandir, Sidi Moussa, Ben Talha, Relizane, l’un après l’autre, les récits de haches et de couteaux dans l’ombre dans les flammes les scénarios tous identiques : à quelques centaines de mètres d’un poste de l’armée algérienne une bande de terroristes s’est introduite dans le quartier a commencé systématiquement le massacre de la population les femmes les hommes les hommes les femmes les enfants les nouveau-nés égorgés éventrés brûlés fusillés jetés contre les murs les têtes éclatées les bijoux arrachés des doigts des poignets à la hache les belles vierges emportées dans les montagnes le butin la part d’honneur pour les vainqueurs sans ennemis dans la nuit et les guerriers tuaient tuaient tuaient des banlieusards aussi pauvres qu’eux ou des paysans plus pauvres encore, il n’y avait rien dans nos notes et nos rapports, rien de rien à part des flots de sang insensés des noms de villages et d’émirs de maquis touchés par la furie d’Arès, des barbus au discours de plus en plus incompréhensible, de plus en plus abscons, qui parlaient de Satan et de Dieu de la vengeance de Dieu de tous ces paysans ces Algériens qui étaient des impies et méritaient la mort, les traducteurs me transcrivaient en français les tracts les déclarations de guerre les anathèmes les injures contre l’Occident l’armée le gouvernement les fermiers les femmes l’alcool le bétail la vie et Dieu lui-même qu’ils finirent par excommunier car trop clément à leurs yeux, ils vénéraient leur sabre leur fusil leur chef et quand ils ne se battaient pas entre eux ils allaient gaiement massacrer et razzier dans l’obscurité, sous mes yeux de fonctionnaire, pourquoi ne fournissait-on pas d’équipements de vision nocturne à l’armée algérienne, c’était leur seule excuse pour ne pas intervenir, ils étaient aveugles, la nuit était la nuit elle appartenait aux guerriers et je savais moi mieux que personne la frayeur du combat dans le noir, au milieu des civils entre les maisons ils ne pouvaient rien faire — mais sans la provoquer la terreur leur convenait, le trouble les favorisait, l’Europe n’avait d’autre choix que de soutenir leur régime moribond contre la barbarie et l’extrémisme pour protéger le pétrole les mines les villageois les ouvriers les laïques les mécréants les libéraux la région les Tunisiens les Marocains qui n’en menaient pas large, il fallait tenir, les Troyens étaient auprès du rempart, près d’envahir le campement et de nous pousser à la mer dans nos nefs creuses, les islamistes étaient l’ennemi commun et ce déjà avant 2001, avant la Grande Entente qui allait nous faire échanger des terroristes à foison, le Grand Nettoyage, des suspects des activistes de tout poil expédiés à Guantánamo, balancés des avions au milieu de l’océan Indien, torturés dans des caves pakistanaises ou égyptiennes, des listes et des listes les plus larges possible jusqu’à la pomme de discorde irakienne, Troie met dix ans à tomber, et dans mon bureau bien gardé je débutai comme comptable des corps, comme qui devient arbitre après avoir été boxeur et ne touche plus lui-même les visages qui explosent sous les poings, il compte les coups, je donnais l’Algérie plusieurs fois battue par KO, et même levais haut le bras des vainqueurs dans des rapports interminables : Lebihan mon chef me félicitait sans cesse pour ma prose, on s’y croirait disait-il, vous êtes le champion toutes catégories de la note, mais ne pourriez-vous pas être un peu plus sec, aller un peu plus à l’essentiel, imaginez, si tout le monde faisait comme vous on ne saurait plus où donner de la tête, mais bravo mon cher bravo — pauvre Lebihan, il avait sans cesse des ennuis de santé, jamais très graves, toujours très ennuyeux, urticaire, prurit, pelade, champignons en tout genre, il m’était sympathique, il me vouvoyait, je n’ai jamais rien su de lui ou presque, à part qu’il était originaire de Lille comme son nom ne l’indiquait pas (si c’était vraiment son nom) et qu’il portait une alliance — c’était un spécialiste du FIS, des GIA, de toutes sortes de groupuscules plus ou moins violents, dont on retrouverait les noms et ceux de leurs membres des années durant éparpillés aux quatre coins de la planète, parfois avec une orthographe différente ou un surnom, parfois dans une liste de “supposés décédés”, à cause des problèmes de transcription de l’arabe il y avait des types chez nous qui avaient trois ou quatre fiches qu’il fallait regrouper, certains morts trois fois de suite dans trois endroits différents et retrouver un homme n’était pas toujours facile, même si ce n’était pas notre principal objectif, comme me faisait gentiment remarquer Lebihan, les menaces contre la sécurité intérieure regardent la DST, et les flics ne se gênaient pas pour nous mettre des bâtons dans les roues quand ils le pouvaient, persuadés que nous faisions de même, ce qui était sans doute le cas — dans l’embrouille incroyable de l’affaire des moines de Tibhirine chacun avait tiré la couverture à soi, les Affaires étrangères, le Service, tout le monde, et par la suite, quand la DST récupérait un officier algérien “passé en France” ou un islamiste qui demandait l’asile, ils gardaient les informations pour eux, distillant au compte-gouttes ce qui pouvait nous être utile, comme nous, plus ou moins, avec les renseignements que recueillait le poste, ces faux diplomates reclus, emmurés dans leur ambassade dont le seul contact avec l’extérieur était leurs précieuses “sources” : j’y suis allé une fois, avec un passeport de service et un nom d’emprunt, quarante-huit heures à peine, juste pour rencontrer les deux types que nous avions là-bas et un militaire autochtone dont j’ai oublié le nom, Alger la blanche était grise, morte dès le coucher du soleil, noyée sous les chômeurs et la poussière, Cervantès le rescapé de Lépante avait passé ici cinq ans en captivité, à rêver de plans d’évasion du même genre que ceux des islamistes dans les geôles gouvernementales, nous avions rendez-vous avec la “source” dans une magnifique villa des hauteurs de la ville, que soi-disant je devais louer, une villa immense et meublée, avec une piscine, propriété d’un commerçant qui s’était réfugié à Nice — le contact fut bref, je me souviens de son air bravache, presque méprisant à notre égard, et de la peur, la très grande peur qu’on sentait pourtant dans sa voix : le marché était clair, il voulait aller à Paris, une carte de séjour et de l’argent contre des informations sensibles, tous rêvaient de la même chose, ils avaient l’impression de se vendre très cher et ne se rendaient pas compte que pour nous le prix était dérisoire, que n’importe quel ingénieur dans la pharmacie ou les biotechnologies valait dix ou quinze fois plus qu’eux, le tiers-monde reste le tiers-monde même dans les tractations les plus spécialisées, l’avantage du coût de la vie, et moi-même si j’y pense en insistant j’aurais pu me vendre bien plus cher, qui sait, si j’avais proposé mes documents ailleurs, c’est la loi du métier, le vendeur fixe le prix, j’aurais pu y inclure ma chambre au Plazza et un morceau de la vraie Croix ils auraient accepté, qu’est-ce qu’un peu d’argent au regard de l’Eternité — Cervantès fut racheté par une congrégation de religieux pour cinq cents escudos alors qu’il était sur le point d’être déporté vers Istanbul, en 1996 Alger la blanche sentait la sueur le pneu brûlé l’huile chaude et le cumin, j’avais mis des lieux et des paysages sur mes notes, des visages, des parfums sur mes synthèses, la peur, des remugles de peur qui me rappelaient les odeurs de Mostar et de Vitez, les islamistes avaient peur de l’armée, l’armée avait peur des islamistes et les civils crevaient de trouille devant tout le monde, coincés entre le sabre de la vraie Foi et les chars de combat des toughât , les “tyrans” du gouvernement, Alger la blanche où mon père a servi, entre 1958 et 1960, je me revois échanger avec lui des impressions, des souvenirs — bien sûr contre toutes les règles de sécurité je lui avais parlé de mon voyage, il était bien surpris, par les temps qui courent, disait-il, depuis mon retour de Croatie il me regardait d’un air soupçonneux, cherchant toujours à me fixer dans les yeux, peut-être pour y chercher les traces de la guerre, je ne comprenais pas pourquoi, je comprendrais pourquoi plus tard, pour l’heure j’apprenais petit à petit à distinguer les partis, les émirs, les factions et les groupuscules et j’avais fort à faire, comme on dit, pour me former à ma Zone, je m’y enfonçais sans m’en rendre compte, maintenant je suis devenu un expert, un spécialiste de la folie politico-religieuse qui est une pathologie de plus en plus répandue, qui s’étend comme s’étendaient les champignons ou les pustules sur le corps de Lebihan mon supérieur d’alors, il n’y a plus un pays qui n’ait pas ses futurs terroristes, extrémistes, salafistes, jihadistes de tout poil et Parme qui s’enfuit dans la nuit avec sa noblesse napoléonienne me donne mal à la tête, ou peut-être est-ce la peur, la peur panique de l’obscurité et de la douleur
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Zone»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Zone» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Zone» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.