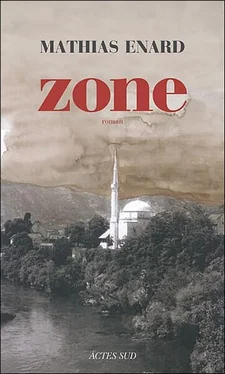Mathias Énard - Zone
Здесь есть возможность читать онлайн «Mathias Énard - Zone» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Город: Paris, Год выпуска: 2008, ISBN: 2008, Издательство: Éditions Actes Sud, Жанр: Современная проза, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Zone
- Автор:
- Издательство:Éditions Actes Sud
- Жанр:
- Год:2008
- Город:Paris
- ISBN:978-2-7427-7705-1
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Zone: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Zone»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Par une nuit décisive, un voyageur lourd de secrets prend le train de Milan pour Rome, muni d’un précieux viatique qu’il doit vendre le lendemain à un représentant du Vatican pour ensuite — si tout va bien — changer de vie. Quinze années d’activité comme agent de renseignements dans sa Zone (d’abord l’Algérie puis, progressivement, tout le Proche-Orient) ont livré à Francis Servain Mirkovic les noms et la mémoire de tous les acteurs de l’ombre (agitateurs et terroristes, marchands d’armes et trafiquants, commanditaires ou intermédiaires, cerveaux et exécutants, criminels de guerre en fuite…). Mais lui-même a accompli sa part de carnage lorsque la guerre en Croatie et en Bosnie l’a jeté dans le cycle enivrant de la violence.
Trajet, réminiscences, aiguillages, aller-retour dans les arcanes de la colère des dieux. Zeus, Athéna aux yeux pers et Arès le furieux guident les souvenirs du passager de la nuit. Le train démarre et, avec lui, commence une immense phrase itérative, circulatoire et archéologique, qui explore l’espace-temps pour exhumer les tesselles de toutes les guerres méditerranéennes. Car peu à peu prend forme une fresque homérique où se mêlent bourreaux et victimes, héros et anonymes, peuples déportés ou génocidés, mercenaires et témoins, peintres et littérateurs, évangélistes et martyrs… Et aussi les Parques de sa vie intérieure : Intissar l’imaginaire, la paisible Marianne, la trop perspicace Stéphanie, la silencieuse Sashka…
S’il fallait d’une image représenter la violence de tout un siècle, sans doute faudrait-il choisir un convoi, un transport d’armes, de troupes, d’hommes acheminés vers une œuvre de mort. Cinquante ans après
de Michel Butor, le nouveau roman de Mathias Enard compose un palimpseste ferroviaire en vingt-quatre “chants” conduits d’un seul souffle et magistralement orchestrés, comme une
de notre temps.
Né en 1972, Mathias Enard a étudié le persan et l’arabe et fait de longs séjours au Moyen-Orient. Il vit à Barcelone. Il a publié deux romans chez Actes Sud :
(2003) — Prix des cinq continents de la francophonie, 2004 — qui paraît en Babel, et
(2005). Ainsi que, chez Verticales,
(2007).
Zone — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Zone», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
V
crève-la-faim sublimes ces Palestiniens aux pesantes galoches quelle histoire je me demande si elle est vraie Intissar joli prénom je l’imagine belle et forte, je suis plus chanceux qu’elle, je suis allé en Palestine, en Israël, à Jérusalem j’ai vu des pèlerins paralysés des manchots des unijambistes des culs-de-jatte des curieux des bigots des touristes des mystiques des illuminés des borgnes des aveugles des prêtres des popes des pasteurs des moines des nonnes tous les habits toutes les congrégations des Grecs des Arméniens des Latins des Irlandais des melkites des syriaques des Ethiopiens des Allemands des Russes et quand il n’était pas trop occupé à se battre pour des queues de cerise tout ce beau monde pleurait la mort du Christ sur la croix les juifs pleuraient leur temple les musulmans leurs martyrs tombés la veille et toutes ces lamentations montaient dans le ciel de Jérusalem étincelant d’or au couchant, les cloches accompagnaient les muezzins à toute volée les sirènes des ambulances couvraient les cloches les militaires hautains criaient bo, bo aux suspects et armaient leurs fusils d’assaut un doigt sur le pontet prêts à faire feu sur des gamins de dix ans s’il le fallait, la peur étrangement était dans leur camp, les soldats israéliens suaient la trouille, aux barrages il y avait toujours un sniper prêt à loger une balle dans la tête des terroristes, planqué derrière des sacs de sable un appelé de vingt ans passait sa journée à tenir en joue des Palestiniens, leurs visages dans son réticule : les Israéliens savent que quelque chose va arriver un jour ou l’autre, le tout c’est de deviner où, qui et quand, les Israéliens attendent la catastrophe et elle finit toujours par venir, un bus, un restaurant, un café, Nathan disait que c’était l’aspect le plus décourageant de leur travail, Nathan Strasberg le chargé de “relations extérieures” du Mossad me faisait visiter Jérusalem et me gavait de falafels, ne croyez pas les Libanais ou les Syriens, disait-il, les meilleurs falafels sont israéliens, Nathan était né à Tel-Aviv dans les années 1950 ses parents rescapés de Łódz vivaient encore, c’est tout ce que je savais de lui, c’était un bon officier le Mossad est un excellent service, ne jamais perdre de vue ses objectifs, la coopération avec eux était toujours cordiale, parfois efficace — avec des dizaines de sources palestiniennes, libanaises, américaines ils étaient les meilleurs sur le terrorisme islamique international, sur les activités syriennes irakiennes ou iraniennes, ils surveillaient les trafics d’armes, de drogue, tout ce qui pouvait financer de près ou de loin des agences ou des partis arabes, jusqu’à la politique américaine et européenne, c’était le jeu, ils collaboraient volontiers avec nous sur certains dossiers tout en cherchant à nous contrer sur d’autres — le Liban notamment, où ils considéraient que tout appui politique au Hezbollah était un danger pour Israël, le Hezbollah était pour eux difficilement pénétrable, rien à voir avec les Palestiniens divisés et âpres au gain : les sources sur le Hezbollah étaient fragiles peu fiables très chères et toujours susceptibles d’être manipulées en amont, bien sûr avec Nathan nous n’en parlions jamais, il me montrait Jérusalem trois fois sainte avec un réel plaisir, dans la vieille ville on entendait parler des dizaines de langues du yiddish à l’arabe sans compter les langues liturgiques et dialectes contemporains des touristes ou des pèlerins venus du monde entier, la Ville sainte savait reproduire toutes les joies et tous les conflits, ainsi que nombre de cuisines d’odeurs de goûts du bortch et des kreplach d’Europe de l’Est à la bastourma et au soujouk ottomans dans un mélange de ferveur religieuse d’effervescence commerciale de lumières somptueuses de chants de cris et de haine où l’histoire de l’Europe et du monde musulman semblait déboucher malgré elle, Hérode Rome les califes les croisés Saladin Soliman le Magnifique les Britanniques Israël les Palestiniens s’affrontaient là se disputaient la place dans les murailles étroites que nous observions se couvrir de pourpre au couchant, devant un verre avec Nathan à l’hôtel King David, le somptueux palace qui lui aussi semblait au cœur du monde : célèbre pour l’attentat des terroristes sionistes de l’Irgoun qui avait tué cent personnes en 1946, l’hôtel avait aussi accueilli des exilés, d’infortunés monarques délogés de leurs trônes par un conflit ou l’autre, Hailé Sélassié pieux empereur d’Ethiopie chassé par les Italiens en 1936 ou Alphonse XIII d’Espagne le désastreux mis en fuite par la République en 1931 et qui finit ses jours au Grand Hôtel de la piazza Esedra à Rome, Alphonse XIII occupa quelques semaines une suite au cinquième étage du King David à Jérusalem où il avait vue sur les jardins et la vieille ville, je me demande à quoi pensait le souverain ibère quand il contemplait le paysage, au Christ sans doute, à la monarchie espagnole qu’il voyait s’éteindre dans un dernier reflet doré sur le Dôme du Rocher et qu’il espérait voir revivre : on raconte d’Alphonse XIII qu’il collectionnait les pantoufles, il en avait des dizaines, simples, brodées ou luxueuses et toutes ces laines ces fourrures ces molletons autour de ses pieds étaient sa vraie demeure dans l’exil, à Jérusalem Alphonse XIII acheta des sandales qu’il portait encore lorsqu’il expira dans son palace romain sans avoir revu Madrid, condamné aux hôtels internationaux ces châteaux de pauvres — au bar du King David joyau britannique je sirote mon bourbon en compagnie de Nathan sans savoir que Jérusalem allait bientôt s’embraser, nous parlions de la fin du conflit israélo-palestinien en ignorant que la violence reprendrait très bientôt sur ce mont du Temple qu’on devinait dans le lointain, c’est là que commence ma collecte, à Jérusalem en discutant avec Nathan dans le crépuscule mordoré, l’homme du Mossad complice malgré lui me donne quelques renseignements, les premiers, à propos de Harmen Gerbens le Batave alcoolique du Caire, par gentillesse, sans m’interroger sur mon intérêt pour cette affaire vieille de quarante ans, enclin à me faire plaisir, tout comme il m’offrait des falafels dans la vieille ville et des whiskies au King David il m’apprit que Harmen Gerbens n’avait bien entendu jamais travaillé pour Israël, pourtant son nom apparaissait au détour d’un vieux dossier sur l’expédition de Suez que Nathan avait obtenu du Shin Beth, débarrassé des considérations militaires toujours embarrassantes quatre décades plus tard — pourquoi cet intérêt pour le vieil Hollandais, pour les “étrangers” raflés en Egypte en 1956 et 1967, pour la prison de Qanâter, peut-être était-ce l’effet de Jérusalem, une volonté de pénitence ou de chemin de croix, sait-on toujours ce que les dieux nous réservent ce que nous nous réservons à nous-mêmes, le projet que nous formulons, de Jérusalem à Rome, d’une ville éternelle à l’autre, l’apôtre qui renia par trois fois son ami dans l’aube blafarde d’une nuit d’orage m’a peut-être guidé la main, qui sait, il y a tant de coïncidences, de chemins qui se recroisent dans la grande fractale marine où je patauge sans le savoir depuis des lustres, depuis mes ancêtres mes aïeux mes parents moi mes morts et ma culpabilité, Alphonse XIII chassé de chez lui par l’histoire et la collectivité, l’individu contre la foule, les pantoufles du monarque contre sa couronne, son corps face à la fonction de son corps : être à la fois un individu dans un train traversant l’Italie et porteur d’un triste morceau du passé dans une mallette en matière plastique tout à fait commune où s’inscrit le destin de centaines d’hommes morts ou sur le point de disparaître, travailler comme gratte-papier homme de l’ombre mouchard informateur après avoir été enfant puis étudiant puis soldat pour une cause qui m’apparaissait juste et qui l’était sans doute, être un brin de la bobine que la déesse file en avançant sur une voie rectiligne parmi des voyageurs chacun dans leur corps poussés vers le même terminus s’ils ne descendent pas en route, à Bologne ou à Florence, pour croiser un de ces fous qui hantent les quais des gares en annonçant la fin du monde : mon voisin a branché son walkman, j’entends des sons sans pouvoir distinguer réellement ce qu’il écoute, je perçois un rythme aigu qui se superpose à celui des rails, Sashka non plus ne peut pas vivre sans musique, des disques à foison des airs hébreux russes des mélodies anciennes ou modernes quand je l’ai rencontrée la nuit était bien sombre, un regard est plus solide que l’amarre d’un navire dit un proverbe dalmate on est tiré vers le large — dans les ruelles de Rome peintes de lierre, parfumées par la pluie, touchées elles aussi par la maladie de l’histoire et de la mort comme Jérusalem Alexandrie Alger ou Venise, je m’accroche au mensonge et au bras de Sashka, je feins d’oublier Paris le boulevard Mortier la violence et les guerres comme, enfant, un rai de lumière passait toujours sous la porte pour me rassurer, les conversations lointaines des adultes me berçaient d’un tumulte indistinct me poussant peu à peu dans le monde des rêves, Sashka est le corps proche d’un être lointain, entourés que nous sommes par tous ces fantômes mes morts et les siens auxquels nous résistons en nous tenant les épaules près du triste Tibre grand charrieur d’ordures, c’est fait, j’ai laissé Paris mon studio de fonctionnaire mes livres mes souvenirs mes habitudes mes déjeuners chez mes parents j’ai rempli quantité de sacs tout balancé ou presque pris une dernière cuite accidentelle dans le quartier enfilé la peau d’Yvan Deroy et adieu, en route pour la fin du monde et la nouvelle vie, tous flottent derrière la vitre dans la plaine noircie, Nathan Strasberg, Harmen Gerbens et les fantômes de la valise, les tortionnaires d’Algérie, les bourreaux de Trieste, toute cette écume sur la mer, une mousse blanche un peu nauséabonde produit de la décomposition d’une foule de cadavres, il a fallu de la patience pour la ramasser, de la patience, du temps, des intrigues, des pistes, ne pas perdre le fil, compulser des milliers d’archives, acheter des sources, les convaincre en suivant les règles de la collecte du renseignement apprises tant bien que mal au fil des années, traiter les informations, les compiler, les organiser en fichier facilement consultable, par noms, dates, lieux, et ainsi de suite, récits personnels récits de vie dignes de la meilleure administration communiste et paranoïaque, des archives comme il y en a des millions des fiches des traces — c’est peut-être à La Haye que j’ai commencé, en 1998 avant Jérusalem je prends quelques jours de congé pour me rendre au Tribunal pénal international où se tenait le procès du général Blaškic, commandant à Vitez du HVO l’armée des Croates de Bosnie, dans son box au début de l’audience Tihomir Blaškic me reconnaît et me fait un signe de tête, devenu général de brigade il fait face à vingt chefs d’inculpation, parmi lesquels six infractions aux conventions de Genève, onze violations des lois et coutumes de guerre et trois crimes contre l’humanité, commis dans le contexte de “violations graves du droit international humanitaire contre des musulmans de Bosnie” entre mai 1992 et janvier 1994, j’ai quitté la Bosnie le 25 février 1993, j’y étais arrivé en provenance de Croatie en avril 1992, et après un séjour de quelques mois sur le front près de Mostar j’ai rejoint Tihomir Blaškic et la Bosnie centrale, son quartier général se trouvait depuis novembre 1992 à l’hôtel Vitez, c’était un officier efficace et respecté, j’ai eu de la peine quand je l’ai vu au milieu de ce cirque multilingue et administratif du TPI où une grande partie du temps se perdait en discussions de procédures, en incompréhensions des arguties du procureur américain, en centaines de témoins d’heures d’atrocités dont je savais pertinemment qui les avait commises, je revoyais les lieux, les flammes, les combats, les expéditions punitives jusqu’à mon départ après la mort d’Andrija : au fond je n’étais tenu à rien, je dépendais théoriquement de l’armée croate mais nous étions censés avoir démissionné en partant en Bosnie pour ne pas embarrasser officiellement la Croatie, je suis allé voir le capitaine puis le commandant j’ai dit je m’en vais je n’en peux plus on m’a répondu mais on a besoin de toi j’ai dit considérez que je suis tombé au combat Blaškic m’a regardé d’une drôle de façon et m’a demandé ça va ? j’ai répondu on fait aller , puis il a donné l’ordre de me signer ma feuille de route et je suis reparti, j’ai traversé les lignes pour repasser à Mostar puis à Split d’où je suis arrivé à Zagreb, je me suis installé dans une pension minable j’ai acheté des baskets trop petites je m’en souviens je n’avais que des rangers, je ne savais pas où aller, je me rappelle avoir téléphoné à Marianne en pleurant comme un bébé je ne sais même plus si j’étais soûl, je me sentais coupable d’abandonner les camarades, coupable de ce que j’avais contribué à détruire, à tuer, je rêvais des heures et des heures en boucle sans réellement dormir, je rêvais de cérémonies funèbres où Andrija me reprochait d’avoir abandonné son corps je marchais des kilomètres dans les montagnes pour le retrouver pour le déposer sur un haut bûcher de bois et le brûler, son visage se dessinait alors dans la fumée qui montait au cœur du ciel de printemps — tout cela me revenait d’un coup en voyant Blaškic dans son box à La Haye entre les avocats les interprètes les procureurs les témoins les journalistes les curieux les militaires de la Forpronu qui analysaient les cartes pour les juges commentaient la possible provenance des obus d’après la taille du cratère déterminaient la portée de l’engin d’après le calibre ce qui donnait lieu à autant de contre-expertises le tout traduit en trois langues enregistré transcrit mécanographié à quatre mille kilomètres de l’hôtel Vitez et de la Lašva aux eaux bleutées, il fallait tout expliquer depuis le début, des historiens témoignaient du passé de la Bosnie, de la Croatie et de la Serbie depuis l’ère néolithique en montrant comment s’était formée la Yougoslavie, puis des géographes commentaient des statistiques démographiques, des recensements, des plans cadastraux, des politologues expliquaient les différentes forces politiques en présence dans les années 1990, c’était magnifique, autant de savoir de sagesse de connaissances au service de la justice, les observateurs internationaux prenaient alors tout leur sens, ils témoignaient des horreurs de la boucherie avec un réel professionnalisme, les débats étaient courtois, pour un peu je me serais proposé comme témoin, mais ni l’accusation ni la défense n’avaient intérêt à me faire comparaître et mes nouvelles occupations m’imposaient la discrétion, j’ai longtemps pensé à ce que j’aurais dit si l’on m’avait interrogé, comment aurais-je expliqué l’inexplicable, sans doute m’aurait-il fallu remonter moi aussi à la nuit des temps, à l’homme préhistorique effrayé qui peint dans sa caverne pour se rassurer, à Pâris s’emparant d’Hélène, à la mort d’Hector, au sac de Troie, à Enée parvenu aux rivages du Latium, aux Romains qui enlèvent les Sabines, à la situation militaire des Croates de Bosnie centrale début 1993, à l’usine d’armement de Vitez, aux tribunaux de Nuremberg et de Tokyo qui sont le père et la mère de celui de La Haye — Blaškic dans son box est un homme seul pour répondre de tous nos crimes, selon ce principe de responsabilité pénale individuelle qui le lie à l’histoire, c’est un corps dans un fauteuil avec un casque sur les oreilles, il est jugé à la place de tous ceux qui ont tenu une arme, il sera condamné à quarante-cinq ans de prison puis à neuf ans en appel et aujourd’hui il doit profiter de sa préretraite du côté de Kiseljak, pas très loin des villages où gisent les corps carbonisés des civils dont on lui reprochait la mort, ces gens qui attendent encore une justice qui ne viendra jamais, à La Haye très hollandaise il y avait un tel défilé d’ex-Yougoslaves que c’était un casse-tête d’organiser les comparutions sans que tout ce petit monde se croise dans les avions, les trains ou les voitures avant de se retrouver tous ensemble dans les luxueuses cellules du bâtiment de détention ou les antichambres des salles d’audience, le pays disparu était reconstitué une dernière fois par la justice internationale, des Serbes des Croates des Bosniaques de tout poil des Monténégrins se tombaient dans les bras ou faisaient semblant de ne pas se reconnaître, ils étaient là pour parler de leur guerre pour déballer leur linge sale à des juges qui bien sûr ne pouvaient être ni serbes ni croates ni bosniaques ni monténégrins ni même slovènes macédoniens ou albanais, seuls leurs défenseurs l’étaient, et cette communauté internationale qui les jugeait indirectement regardait d’un œil lointain tous ces barbares aux noms imprononçables, les centaines de milliers de pages des procédures devenaient un océan navrant, une marée de justice où pataugeaient les victimes venues témoigner, les déplacés les torturés les tabassés les violées les dépouillées les veuves pleuraient le plus souvent à huis clos dans une salle aux volets baissés et leurs récits ne sortaient pas des cages vitrées des interprètes, consignés en anglais ou en français pour la postérité dans les comptes rendus d’audience, sans que les juges entendent les accents les dialectes les expressions de leurs voix qui traçaient une vraie carte de la douleur — tous reprenaient ensuite l’avion avec un goût de bile dans la bouche pour retourner fréquenter leurs ennemis leurs bourreaux ou leurs souvenirs sans que ni leur haine ni leur amour ni leur loyauté ni leur souffrance ait servi à rien, personnages dans la Grande Procédure organisée par les juristes internationaux plongés dans les précédents et la jurisprudence de l’horreur chargés de mettre de l’ordre dans le droit du meurtre, savoir à quel moment une balle dans la tête était légitime de jure et à quel moment elle constituait une grave infraction au droit et coutumes de guerre, en se référant sans cesse aux arrêts Nuremberg, Jérusalem, Rwanda, précédents historiques reconnus comme tels par le statut du tribunal, retraçant le droit international coutumier dans l’interprétation des conventions de Genève, truffant leurs attendus d’expressions latines fleuries et bienvenues, appliqués, oui, tous ces gens étaient très appliqués à distinguer les différentes modalités des crimes contre l’humanité avant de dire messieurs je pense que nous allons suspendre pour déjeuner ou en raison de travaux dans la salle 2 la Chambre demande aux parties de reporter les auditions prévues cet après-midi à une date ultérieure, disons dans deux mois , le temps de la justice est comme celui de l’Eglise, on travaille pour l’éternité, au moins toutes ces palabres offraient une distraction aux prévenus, ils écoutaient pendant de longs mois l’histoire de leur pays et de leur guerre, intéressés comme par un bon film, ou peut-être ennuyés par son côté répétitif, je suis resté trois jours à La Haye je me demandais si quelqu’un allait me reconnaître et crier police ! Police ! en me voyant mais non — mon nom devait pourtant apparaître quelque part dans un rapport d’enquête, enfoui avec d’autres, couché noir sur blanc parmi les morts et les survivants de notre brigade, avec peut-être en vis-à-vis la liste de nos victimes civiles, volontaires ou accidentelles, pour aussi accidentel que puisse être un obus de mortier lorsqu’il enfouit une famille sous les décombres, j’ai l’impression de flotter tout d’un coup, le train passe des aiguillages successifs et danse, les lumières de la campagne virevoltent autour de nous dans un ballet aléatoire qui me donne un haut-le-cœur ou est-ce le souvenir de la guerre, j’ai profité du passage à La Haye pour aller jusqu’à Groningue, voir les maisons multicolores au bord du canal qui entoure le centre-ville, la grand-place avec une magnifique tour, la mer et les îles toutes proches, l’Allemagne à quelques kilomètres à l’est, une ville moyenne et tranquille au passé glorieux, j’ai déambulé au hasard dans les rues du centre avant de trouver un très bel hôtel près du canal dans un bâtiment du XVII eau nom évocateur d’ auberge du Corps de Garde , tel quel, en français, ce qui m’inclinait à penser qu’on y parlait cette langue, la première chose que je fis après m’être installé fut de me jeter sur l’annuaire, il y avait deux Gerbens, initiales A.J. et initiale T., l’un habitait un peu en dehors de la ville, et l’autre près de la vénérable faculté au sud du centre d’après le plan, si Harmen Gerbens le vieillard cairote avait eu deux filles elles s’étaient sans doute mariées et avaient pris le nom de leurs époux, la réceptionniste du Corps- de-Garde était sympathique mais soupçonneuse, que voulais-je à ces Gerbens, je lui demandai si le nom était courant elle me répondit que non, pas vraiment, je me résolus à lui expliquer l’histoire, j’avais rencontré au Caire un vieillard de Groningue du nom de Harmen Gerbens qui m’avait chargé de saluer sa famille, pieux mensonge le vieil ivrogne aurait plutôt craché par terre, elle eut tout d’un coup l’air émue et se décida à m’aider, à décrocher le téléphone et à demander à ma place si le premier Gerbens de l’annuaire connaissait un Harmen résidant au Caire, je ne comprenais goutte à la conversation mais la jeune femme me souriait et hochait la tête tout en parlant, avant de mettre sa main sur le combiné et de m’expliquer — il s’agit de son neveu, il a effectivement un oncle appelé Harmen qui est parti en Egypte après la guerre, elle en était tout excitée, demandez-lui si je peux le rencontrer, s’il vous plaît, elle a repris le téléphone et sa conversation néerlandaise — ce premier Gerbens de l’annuaire était médecin et recevait dans l’après-midi, j’ai pris rendez-vous pour seize heures et je suis allé manger des harengs dans un restaurant passable au bord de l’eau, par chance le temps était clair, une pâle lumière d’automne et une brise marine parfumaient le paysage, quelles questions allais-je poser à ce toubib, qu’est-ce qui m’attirait dans l’histoire de Harmen, dans la part d’ombre que je croyais y deviner, la tête pleine de souvenirs de guerre rallumés par La Haye, poursuivi par le visage impénétrable de Blaškic sur le banc des accusés, les héros, les combattants, les morts, les faits d’armes, c’est le temps que je tue en marchant le long du canal, quelques péniches à quai me rappellent que d’ici on peut rejoindre le Rhin puis le Rhône déboucher en Méditerranée et atteindre Alexandrie, les commerçants vénitiens rapportaient de Hollande des fourrures qu’ils échangeaient contre des épices et des brocarts, d’après mon guide illustré Groningue fut une ville commerçante et prospère où l’on importait du tabac des colonies, l’heure approche, l’agréable réceptionniste m’a indiqué comment rejoindre le cabinet du neveu : à seize heures sonnantes je suis face à un homme d’une cinquantaine d’années dans une blouse blanche, il sait l’anglais, il est courtois, plutôt surpris d’entendre parler d’un parent qu’il n’a jamais rencontré, je le croyais mort, dit-il, si je me souviens bien ma tante a raconté qu’il était mort, elle est décédée il y a quelques années, mes cousines sont mariées et vivent à Amsterdam — mon père n’est plus de ce monde, emporté par le tabac et l’alcool, que je sache depuis la guerre il n’a jamais été très proche de son frère, ils n’étaient pas dans le même camp, vous voyez, mon père était résistant et mon oncle, hum, not so much , je crois qu’ils se sont fâchés, à la Libération mon oncle a été contraint de fuir pour éviter la peine de mort, il s’est évadé de la prison militaire peu de temps avant son exécution, qu’est-ce qu’il avait fait pour mériter une telle peine ? demandé-je, je ne sais pas, bafouille le médecin, je n’en sais rien, il avait été nazi je suppose, j’avoue que je n’ai jamais trop cherché à savoir, vous comprenez, mes parents n’en parlaient jamais, c’est étrange de penser qu’il est encore en vie, là-bas en Egypte, c’est tout aussi étrange que les Britanniques ne l’aient pas arrêté à son arrivée en 1947, j’ai remercié le médecin et je suis ressorti en imaginant les deux filles de Gerbens, elles filles de traître et lui fils de héros, peut-être tous deux assassins mais pour des causes différentes, les deux enfants de Harmen le nazi cairote portaient sans doute la marque de l’absence d’un père honni de la patrie qu’elles n’avaient jamais cherché à revoir, tout comme elles n’avaient pas revu la famille de leur père, avaient changé de ville, de nom par le mariage et laissé à leur descendance ce creux dans sa généalogie, en rentrant en Hollande la femme de Gerbens avait dû déclarer mort le mari resté en Egypte, et l’avait condamné à crever seul et loin dans l’exil de Garden City et de l’alcool qui était une de ses nombreuses prisons, sans doute la plus solide avec son passé, Harmen Gerbens le vieux nazi enfermé à de si nombreuses reprises, en Hollande, à Qanâter, chez lui à Garden City dans la metaxa et le cognac égyptien, condamné à s’observer crever en se souvenant peut-être de la tête de mort sur son col SS, qui n’avait pas cessé de l’accompagner tout du long de son existence comme un tatouage invisible — se souvenait-il de ceux qu’il avait chargés dans des trains en direction de l’est, des femmes qu’il avait violées au camp de Westerbork, jusqu’où allait sa mémoire, Harmen Gerbens prenait sa place dans la liste de la valise — je suis retourné à l’hôtel du Corps-de-Garde, il a commencé à pleuvoir, j’ai remercié chaudement la réceptionniste, je lui ai dit mission accomplie et elle m’a souri en me tendant la clé de ma chambre, et ce soir au Plazza quand l’inconnu viendra prendre possession de la mallette et me remettre mon fric je boirai un verre à la santé de la réceptionniste et du médecin de Groningue, des filles de Gerbens, de Nathan Strasberg le juif de Łódz qui me traduisait à Jérusalem l’annexe au rapport du Shin Beth, il trouvait assez ironique que l’intervention israélienne ait eu pour effet d’envoyer en prison au Caire un ancien nazi, ça lui faisait une récréation, Nathan constituait des listes lui aussi, des listes interminables de cibles, d’hommes à abattre, de personnel palestinien hostile aux accords d’Oslo, FPLP, FDLP, Hamas, Jihad islamique, le nouveau “front du refus” constituait pour le Mossad un risque majeur, et Nathan regroupait des renseignements sur leurs agissements, sans savoir que très bientôt après le déclenchement de la deuxième Intifada il allait falloir assassiner la plupart de ces gens, selon la jolie doctrine du meurtre préventif à coups de missiles air-sol sur Gaza ou de tanks Merkava dans les ruelles des camps de Cisjordanie, Nathan était un peu gras très souriant et plein d’humour je me demande où il se trouve aujourd’hui, un peu plus près de la fin du monde, alors que le train traverse le Pô sans presque ralentir, une usine glisse dans des néons blancs derrière des murs de briques, une haute structure, des poutres métalliques éclairées çà et là de fanaux rouges comme un bateau — à Venise Ghassan Antoun travaillait au port de Marghera dans une pétrochimie toute semblable, un immense amas de tuyaux et de réservoirs illuminé lui aussi la nuit par des lampes rouges qui surgissaient du brouillard, il rentrait chez lui au petit jour en bus, par le pont dit “de la Liberté” qui unit Venise à la terre ferme et commémore la fin de la domination autrichienne, Ghassan répandait toujours un parfum bizarre, comme de cacahouète ou de maïs grillé, il avait beau se laver cette étrange odeur de chimie ne le quittait jamais, elle ne faisait que s’amoindrir au gré de sa distance avec l’usine, sans jamais disparaître tout à fait : le travail de nuit lui volait son corps sans le lui rendre complètement, contaminé par les effluves familiers et inquiétants, comme un soldat en campagne sent la sueur et la graisse, je l’ai rencontré à l’aube dans un bar où le petit jour me libérait d’une insomnie déambulatoire, nous rentrions tous deux comme des vampires fourbus et gelés, lui avec un anorak sur son bleu de travail moi mon éternel bonnet enfoncé jusqu’aux sourcils, il me rappela immédiatement Andrija le Slavon, allez savoir pourquoi, il n’y avait rien de semblable dans leurs traits, à part peut-être une inadéquation du corps à son costume, Andrija toujours mal fagoté l’uniforme ne lui allait jamais, ou trop grand ou trop petit, ses treillis étaient tachés et son barda pendouillait bizarrement il avait toujours l’air gêné, encombré par le sac, les munitions, les armes et Ghassan dans son bleu engoncé sous l’anorak avait la même démarche gauche qui allait de pair avec son éternel sourire et la petite moustache dont il était si fier, Andrija tué en Bosnie centrale près de Vitez se réincarnait dans l’aube humide et froide d’un café de Venise, un café prolétaire au bord de la lagune à quelques encablures du cimetière insulaire de San Michele si romantique — Stravinski, Diaghilev, Ezra Pound le vieux fou — que je n’avais pas encore cru bon de le visiter, Andrija dont l’absence se cherchait sans doute un remplaçant, un substitut dans le grand ennui solitaire de la Sérénissime : Ghassan habitait à deux pas dans un appartement humide et sombre qu’il partageait avec son cousin chef de rang dans un palace riva degli Schiavoni, ce matin-là nous prîmes un café côte à côte sans échanger un mot, c’est du moins ce dont je crois me souvenir, peut-être nos innombrables petits-déjeuners à l’aube au cours des mois qui suivirent se superposent-ils à cette première rencontre, je ne sais plus à quel moment exactement j’adressai pour la première fois la parole à Ghassan, je ne crois pas que notre amitié ait été immédiate, comme on dit, dans l’éclairage jauni de la gare de Piacenza et l’air conditionné du train qui m’empêche de sentir son odeur d’usine, l’amitié ou la camaraderie demande du temps, des expériences, et si en amour le rapprochement des corps donne l’illusion de la connaissance profonde de l’autre, comme les effluves des combattants, leur sueur et leur sang celle de l’intimité, Ghassan et moi nous sommes observés longtemps sans rien partager, malgré (ou peut-être à cause de) la similitude de nos récits personnels, les étranges points communs immédiatement devinés, l’empathie et la ressemblance, réelle ou imaginaire, avec Andrija et sa moustache, de la même façon que dans ce train surchauffé je n’adresse pas la parole à mon voisin, malgré les points de contact qui pourraient rejoindre nos existences et dont ce trajet immobile est un exemple, que va-t-il retrouver, où va-t-il descendre, Bologne, Florence ou Rome, il a l’air de s’ennuyer ferme, son Pronto à la main, il regarde lui aussi par la fenêtre Piacenza s’éteindre et la zone industrielle lancer ses feux intermittents, que nous cache la nuit de cette campagne plate et fertile à la frontière de l’Emilie, rayée par le train — Ghassan aura bientôt quarante ans, s’il est toujours en vie malgré la récente avalanche de cadavres à Beyrouth : est-il devenu un des gardes du corps d’Elie Hobeika ou d’un obscur sous-chef chrétien, a-t-il fini par reprendre les armes qu’il avait abandonnées en 1991, fuyant l’arrivée du Grand Frère syrien dans son morceau de montagne, qui sait, j’ai quitté Ghassan en quittant Venise, et par la suite, à Trieste ou lors de mes passages à Beyrouth pour affaires comme on dit, je n’ai pas cherché à le revoir, il m’avait pourtant expliqué où demeurait sa famille, au beau milieu de la colline d’Achrafiyyé qui domine le côté est de la ville, il m’avait expliqué que depuis le toit de son immeuble on pouvait apercevoir la mer, bien plus bleue qu’à Venise, bien plus marine que cette lagune interminablement plate : la Méditerranée orientale aux couleurs marquées par les saisons comme un arbre, du gris au turquoise, sous le ciel immense du Liban que les montagnes rendent encore plus vaste en le limitant, dans les reflets des cimes, Ghassan disparu comme Andrija, finalement évanoui à son tour et peut-être l’âge aidant n’ai-je pas cherché à le remplacer, à combler le vide laissé par la fin de cette amitié froide qui débuta dans un bar à l’aube face à l’île de San Michele le cimetière flottant de Venise avec son carré pour les étrangers, nous nous voyions chaque matin ou presque au petit jour, Ghassan sortait de son usine de fertilisants ou de Dieu sait quels résidus nauséabonds et moi de mes errances nocturnes, une façon d’échapper à celle qui m’avait rejoint à Venise et que je ne voulais plus voir, je crois, à moins que ce ne soit le contraire, elle refusait obstinément de coucher avec moi en alléguant que Venise la rendait neurasthénique, ce qui était sans doute vrai, elle avait toujours froid, elle mangeait peu, mais aujourd’hui je découvre qu’elle était mon reflet, que c’était moi le neurasthénique, très vraisemblablement, immobile à Venise comme maintenant dans ce train, en voie de guérison, d’oubli, des deux ans de guerre perdus à courir la Croatie et la Bosnie, j’avais souhaité que Marianne me rejoigne mais je préférais la solitude et la compagnie de Ghassan, de Nayef et des autres, nous nous croisions peu, elle dormait la nuit, elle, et moi le jour, épuisé par l’insomnie — il y avait peut-être là les conséquences de deux ans d’amphétamines, de deux années de culte du corps, de deux années de peur de crever dans la boue, la gueule de bois gigantesque de deux années de balles d’obus d’alcool et de drogue c’était un miracle croyais-je que Marianne m’ait attendu, qu’elle vienne me rejoindre à Venise qui n’était pas un choix romantique mais une façon de disparaître, une île hors du temps et hors de l’espace, une tombe pour moi et pour Andrija qui pourrissait dans mon souvenir comme il se décomposait dans la terre, le week-end avec Ghassan nous nous soûlions — souvent il me racontait des histoires de la guerre civile au Liban, sa guerre à lui, il était du côté des Forces libanaises, bien sûr, du côté du drapeau et du crucifix qui ressemblait tant à nous autres Croates, il avait eu seize ans à la chute de Beyrouth-Ouest, en 1982, quand Intissar et les combattants palestiniens quittent le Liban, Ghassan avait cru la guerre terminée, il s’était enrôlé quelques mois plus tard quand le massacre avait repris, inspiré par ses aînés qui lui racontaient les glorieuses années 1970, quand l’autre camp était gauchiste, chevelu et arborait un insigne de Mercedes à l’envers en guise d’écusson, l’ennemi fut par la suite druze, puis syrien, puis chrétien lors du dernier grand affrontement qui mit la montagne à feu et à sang pour rien, la ville brûlait, racontait-il, les bombardements étaient plus intenses que jamais, les Forces libanaises de Geagea se battaient contre le général Aoun, dans ce mélange d’orgueil, de pouvoir et d’argent qui résumait si bien son pays : il aurait pu se battre contre Marwan, Ahmad et Intissar, peut-être même contre Rafaël Kahla l’auteur du récit, qui sait, chaque fois que je suis allé à Beyrouth j’ai repensé aux histoires de Ghassan, et les nouveaux contacts de mon nouveau métier me racontaient de nouvelles histoires de guerre et d’espionnage, le Liban est un kiosque au bord de la mer , disait Kamal Joumblatt, et tout est à vendre , tout est à vendre, surtout les renseignements et la vie des indésirables, Kamal le père de Walid Joumblatt prince des druzes le plus drôle le plus rusé le plus cruel des seigneurs de guerre libanais, reclus dans son palais de Mukhtara pour échapper aux bombes syriennes et aux voitures piégées, Walid le boucher des chrétiens du Chouf est un homme plein d’esprit, cultivé et richissime, ses guerriers étaient les plus durs, les plus audacieux, les plus fous, les plus sanguinaires, ils faisaient enrager leur leader parce qu’ils étaient incapables de marcher au pas, mais ils n’avaient pas leur pareil pour laisser deux cents morts sur une place de village en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, et dans ce pays minuscule où tout se sait où tout se passe en famille on raconte sur le seigneur Walid les histoires les plus invraisemblables, qui font sourire et frémir à la fois, comme le Liban tout entier, patrie du grand rire et du grand frisson : un soir il invita à dîner un cousin et son épouse Nora, là-haut dans sa montagne, et à la fin du repas, alors que le couple était sur le point de s’en aller, Walid, sans même se lever de table dit-on, signifia à son parent qu’il pouvait repartir mais que sa femme, elle, restait et qu’il y avait alors deux issues possibles, soit elle était immédiatement divorcée, soit elle devenait veuve, cette Hélène de Phénicie, toujours la passion pour la femme des autres, fréquente chez les rois du Liban comme chez ceux d’ailleurs, témoin Ghazi Kanaan le colonel syrien qui utilisait toute la terreur du pouvoir de Damas non seulement pour s’enrichir, mais aussi pour coucher avec les dames bien mises de la haute société libanaise, et on raconte — des Rois, des Guerriers — qu’il était capable d’appeler un ministre au milieu de la nuit et de lui demander d’envoyer sur-le-champ sa compagne, qu’elle vienne le sucer, lui le responsable des forces syriennes, son revolver sur la tempe : les ogres veulent tout, prennent tout, mangent tout, le pouvoir, l’argent, les armes et les femelles, dans l’ordre, et ces histoires de monstres me rappelaient mes propres ogres, serbes, croates, qui avaient su déchaîner toute leur rage et assouvir toute leur soif d’humanité mythique, de violence et de désir, ces récits faisaient les délices de l’homme de la rue, des petits, des humbles, heureux de voir les puissants s’humilier à leur tour devant plus puissant qu’eux, perdre leur honneur leur femme comme eux avaient perdu leur maison leurs enfants ou leurs jambes dans un bombardement, ce qui après tout semblait moins grave que le déshonneur et l’humiliation, la défaite du puissant est retentissante, belle et bruyante, un héros fait toujours du bruit lorsqu’il s’effondre, cent kilos de muscles frappent le sol dans un grand coup mat, l’auditoire est debout pour voir charrier Hector, voir sa tête chanceler et le sang gicler, l’ogre vaincu par plus ogre encore : Ghassan ne pouvait s’empêcher d’être fasciné par ces héros, les Joumblatt, Kanaan ou Geagea, admiratif de leurs faits d’armes et de leurs frasques qu’il racontait comme de bonnes blagues, en se tapant sur les cuisses, en souriant d’une oreille à l’autre, devant un spritz ou un Campari soda sur une de ces places vénitiennes qui pourtant paraissaient à l’opposé de toute violence, à l’envers du monde, un morceau d’histoire flottant sur la lagune immobile, un des centres de la Méditerranée politique et économique coupé de l’actualité et rongé par les touristes comme par la vermine et les mousses, doucement mais sûrement, l’armée des sans-grade a pris la ville, ils déambulent entre les palais morts, envahissent les somptueuses églises, heureux de contempler de près le cadavre du géant, la coquille vide de l’escargot desséché — avec Ghassan nous étions absolument insensibles à toutes les beautés de Venise, lui l’émigré, le travailleur, moi le dépressif sans doute qui n’appréciait de la Sérénissime que le silence des rues désertes envahies par la nuit et le brouillard, désorienté, incapable de faire un pas vers la terre ferme, il fallut que Marianne me quitte un beau matin sur le ponte delle Guglie pour que je me réveille, nous revenons ivres d’une nuit de palabres, Ghassan et moi, il doit être six ou sept heures du matin, je n’ai presque pas vu Marianne les deux ou trois jours précédents, elle dans la clarté et moi dans la nuit et voilà qu’elle apparaît sur le pont, dans l’aube grise, en pyjama sous son manteau, les cheveux détachés pâle les yeux cernés, et lorsque je m’approche d’elle inquiet elle me décoche un coup de pied rageur en plein dans les couilles qui me plie en deux me suffoque et elle disparaît, elle s’en va sous les yeux ébahis de Ghassan qui n’ose même pas rire pendant quelques minutes, pétrifié alors que je me tiens le bas-ventre la tête contre le parapet sans comprendre ce qui vient de se produire sans réaliser que mes testicules endoloris sonnent le réveil, que ce shoot inattendu de Marianne me propulse hors de Venise, je ne la reverrai plus, elle a pris le premier train, elle est partie, et moi aussi, secoué d’un coup par son désespoir dont la douleur me fait prendre conscience, au point du jour, Ghassan médusé voit Marianne s’éloigner sans y croire, que faisait-elle dehors à cette heure à moitié habillée je suppose qu’elle me cherchait, elle me cherchait pour m’apprendre qu’elle s’en allait, que c’était fini, elle n’a rien pu dire elle m’a envoyé sa chaussure dans les parties j’en ai eu mal jusqu’aux oreilles, les yeux pleins de larmes, j’ai pris acte : j’ai pris acte, je me suis réveillé, secoué, tiré de l’ivresse et de l’attente, j’ai fait mes valises dans l’ombre du parfum disparu de Marianne, Achille le guerrier orgueilleux rassemble ses dépouilles, ses belles cnémides et ses armes de bronze dans ses nefs creuses, j’ai dit au revoir à Ghassan tout en sachant que je ne le reverrais sans doute pas et trois jours plus tard, plus de six mois après mon arrivée, je prenais un train presque comme celui-ci en direction du nord en passant par Milan : il y a des points géographiques dont on se rend compte, une fois le chemin parcouru, qu’ils ont été des carrefours, des nœuds peut-être, des déviations, des passages obligés sans qu’on puisse deviner — les trains et leur marche aveugle vous y conduisent toujours — qu’ils détiennent une part importante du trajet, qu’ils le définissent autant qu’ils le contiennent, modestes, ces gares où l’on transite sans même en sortir, ce qu’est pour moi la gare de Milan, ville en fait inconnue mais où, à chaque changement d’existence, j’ai transité pour monter dans un nouveau train, de Paris à Zagreb, de Venise à Paris et aujourd’hui de Paris à Rome pour aller livrer — comme toute marchandise, des pizzas, des fleurs — des secrets vieux de cinquante ans et d’autres plus récents à des prélats tremblotants, moyennant espèces sonnantes et trébuchantes, j’ai fixé la somme à trois cent mille dollars, pensant que l’ironie n’échapperait pas aux hommes d’Eglise, trente deniers, ils n’ont soufflé mot, ont acquiescé sans piper, sans oser marchander avec le pécheur le prix de la trahison, Rome reste Rome, quel que soit son maître, je me retourne sur mon siège et je ferme les yeux, Milan, à chaque pli de la vie, sans jamais vraiment m’y arrêter : je n’ai jamais vu le Dôme, ni la Cène de Vinci, ni la galerie Victor-Emmanuel, ni l’emplacement du gibet où l’on exposa Mussolini mort pendu par les chevilles comme un vulgaire cochon, rendant à son visage porcin l’hommage qu’on lui devait, ce visage au front immense qui orne aujourd’hui tant d’objets fantaisistes dans tous les marchés d’Italie, tee-shirts tabliers de cuisine jeux de cartes canifs au manche ciselé allumettes de collection flasques à alcool ou ballons de football, l’économie du fascisme semble bien se porter et j’ai vu tout récemment, après un rendez-vous au Vatican, de l’autre côté du fleuve, place du Peuple, une cérémonie mussolinienne en bonne et due forme, pour je ne sais quelles élections législatives ou pas, les nouveaux fascistes étaient là avec les anciens fascistes, chemises brunes, noires, chansons drapeaux bras levés aigles déployées inscriptions latines cris dans les micros portevoix autoritaires violence voitures tournant pneus hurlant autour de la place et j’ai immédiatement pensé à la Croatie bien sûr mais surtout à la fin de la RSI de Salò rongée petit à petit par les partisans exterminés pourtant en masse de Bolzano à Mauthausen, qu’on envoyait en train au-delà du Brenner crever en terre tudesque, quand les SS ne se chargeaient pas eux-mêmes de les achever à coups de matraque dans les cellules de la Risiera à Trieste — les trains transportent les soldats et les déportés, les bourreaux et les victimes, les armes et les munitions et pour le moment dans la noirceur du paysage que je devine au gré des mouvements du wagon derrière mes yeux fermés, du désert d’usines ciel de lucioles d’apocalypse dans la poussière de l’immense zone industrielle qui cache, à l’ouest, les contreforts du Piémont, bercé par les souvenirs aussi bien que par les rails, j’ai quitté Venise comme Marianne m’a quitté et je me suis endormi, je me suis endormi dans un train Intercity qui allait à Milan pour me ramener à Paris, tout se mêle tout s’embrouille je rajeunis dans mon sommeil troublé par le souvenir de Marianne je revois ses sous-vêtements toujours blancs parfois dentelés ses formes lourdes aux hanches et aux seins la simplicité de son sourire sa générosité un peu naïve ou la naïveté que l’on attribue aujourd’hui à la générosité, l’abîme entre nous creusé avec la pelle militaire de mon départ en Croatie, la première nuit à Alexandrie qui revient toujours avec l’éclat d’un phare, dans cette chambre face à la Méditerranée il pleuvait, un lampadaire jaune illuminait les traits de pluie c’était la seule lumière elle se déshabillait dans le noir, elle était en vacances avec ses parents au Club Méditerranée du Caire et s’était offert une excursion à Alexandrie en solitaire, à l’aventure, je l’ai rencontrée par hasard dans le train qui va du Caire à Alexandrie, dans un luxueux wagon de première classe extraordinairement lent, vrai cliché de la paresse orientale, et au fil du delta du Nil, si vert, je lorgnais la transparence blanche de sa chemise en coton, déjà, plus porté par la concupiscence que par un réel intérêt pour son âme, attiré par ses courbes de Vénus préhistorique, cherchant dans les formes tendres un refuge, comme un enfant suce son pouce, un biberon maternel dans ses mamelles dont je n’arrivais pas à décrocher le regard, nous habitions le même quartier à Paris, allions à la même boulangerie, et bien que nous ne nous fussions jamais vus cette coïncidence prenait, dans un train égyptien cahotant à quatre mille kilomètres de la rue de la Convention, des allures de signe divin et déclenchait la complicité, l’amitié immédiate de ceux que l’étranger pousse l’un vers l’autre, les enfermant dans la proximité grâce au cercle d’inconnu et d’altérité qui les entoure : elle était en vacances, et moi aussi, je cherchais dans la fuite adolescente un sens à ma vie que je crus trouver dans les seins imposants de Marianne, dans ses sous-vêtements blancs cette illusion, ce cadeau d’Aphrodite la dissimulatrice qui cachent au désir lui-même l’identité de la chair qu’ils recouvrent, sa banalité, une fausse transparence un jeu de cache-cache et endormi rêvassant au large de ce que j’imagine être Piacenza je la revois une fois de plus se dévêtir au creux de la pénombre humide, je la quitte elle me quitte sur un magistral coup de pied dans les couilles, dans ces organes cause de notre rencontre, la boucle était bouclée, mes testicules origine de ma passion finissaient par recevoir leur dû, par s’écraser sous la chaussure de Marianne jusqu’à remonter se cacher au fond de ma gorge, elle avait châtié les responsables de la méprise première et nous reprîmes chacun un train différent un train bien plus rapide que celui qui gambadait dans la campagne égyptienne entre ces vaches maigres et velues appelées gamous , au milieu des pigeonniers et des paysans dont l’araire et la houe n’ont pas changé depuis Ramsès, un train de plus, à Venise je m’étais mis à lire, à lire passionnément, à me décrocher du monde pour m’enfoncer dans les pages, alors qu’en deux ans de guerre je n’avais pas eu un livre en main pas même une Bible dans l’apathie vénitienne je me gavais de romans d’aventures, de romans maritimes, d’histoires de corsaires de pirates de batailles navales tout ce que les touristes francophones abandonnaient dans les hôtels de la lagune et qui finissait chez le petit bouquiniste derrière le campo Santa Margarita, des polars, des romans d’espionnage, des romans historiques et à part mes expéditions nocturnes et mes conversations avec Ghassan je passais le plus clair de mon temps allongé dans le canapé à lire, Marianne était obsédée par la guerre, plus que moi peut-être, elle voulait savoir, m’interrogeait sans cesse, lisait des traités sur l’ex-Yougoslavie, elle avait même entrepris d’apprendre le croate ce qui me mettait hors de moi, j’ignore pourquoi, son accent, sa prononciation m’irritait, j’avais besoin de silence, j’avais besoin de son corps et de silence, la seule personne avec qui j’arrivais à parler de la guerre était Ghassan : indirectement, petit à petit, en commentant les qualités de tel fusil, de tel lance-roquettes nous en sommes venus, comme des amants se fabriquent peu à peu une intimité, à échanger des anecdotes, des récits de guerre et à comparer nos vies de soldats, elles n’avaient rien à voir — Ghassan beau guerrier, lunettes de soleil, treillis neuf, M16 à la main, trônait à un barrage ou traînait à la plage à Jounieh avec ses camarades, les affrontements étaient violents et rapides, la guerre durait depuis dix ans et était bien rodée, comme il disait, la seule bataille réelle à laquelle il participa fut contre l’armée libanaise en février 1990 dans le Metn et à Nahr el-Kalb, sanglante boucherie finale, d’une colline à l’autre l’artillerie massacrait les civils en fuite, les combattants se jetaient les uns contre les autres dans une mêlée furieuse : Ghassan me raconta comment il avait tué son propre cousin, caporal dans l’armée, d’une grenade lancée sur sa Jeep qui transportait des munitions, les trois occupants s’étaient envolés dans une gerbe de chair, de métal et de feu, là-bas personne ne sait que c’est moi qui ai lancé cette grenade, disait Ghassan, comment veux-tu que je parle à ma tante normalement après ça, il se souvenait d’avoir dévalé des collines en hurlant pour se donner du courage, d’avoir pissé sur le canon d’une mitrailleuse pour la refroidir, sans succès, d’avoir mis hors de combat un blindé avec un LAW à deux cents mètres et d’avoir vu le commandant du char réussir à s’extirper de la carcasse pour se consumer comme une vieille semelle noircie pliée en deux sur le canon, d’avoir pleuré des heures sans rémission (il le racontait en riant) après la mort d’un cheval, fauché accidentellement par une rafale, et surtout, surtout il racontait comment il avait été blessé, comment il s’était cru mort, découpé tout à coup par des dizaines d’éclats après l’explosion d’un obus, il avait vu sa veste de treillis s’ouvrir, se boursoufler d’impacts de mitraille, il était soudain couvert de sang percé de la cheville à l’épaule par des morsures innombrables, une matière infecte et visqueuse lui recouvrait tout le côté droit, Ghassan s’était effondré dans des spasmes de douleur et de panique, persuadé que c’était la fin, l’obus était tombé à quelques mètres à peine, les médecins lui ont retiré du corps huit dents étrangères et dix-sept fragments d’os incrustés dans sa chair, débris du pauvre type devant lui volatilisé par l’explosion et transformé en grenade humaine, morceaux de crâne fumant propulsés dans un panache de sang, dont le seul éclat métallique était une prémolaire en or, Ghassan s’en était bien sorti, il en avait encore des frissons dans le dos et des haut-le-cœur de dégoût, disait-il, rien que d’y penser j’en ai la chair de poule , je ne savais pas s’il fallait rire ou me lamenter de cette histoire, Ghassan transformé en tombeau vivant accueillant les reliques du martyr enchâssées directement dans sa peau, l’union des guerriers réalisée par la magie des explosifs, le récit de Ghassan n’était pas un cas unique, pour aussi inouï qu’il paraisse, en Syrie Larrey chirurgien de la Grande Armée raconte avoir retiré du ventre d’un soldat un débris d’os planté droit comme un couteau, aigu comme une baïonnette, horrifiés nous crûmes un moment , raconte-t-il, que les canons de la place avaient été chargés d’ossements, avant d’apprendre de la bouche même du blessé que ce fragment provenait du cadavre desséché d’un chameau, dispersé par un boulet — Marcel Maréchal le violoncelliste raconte aussi, dans ses Mémoires de la guerre de 14, qu’une montre à gousset de Besançon, une médaille de baptême et deux doigts (index et majeur, encore attachés l’un à l’autre) atterrirent sur ses genoux après l’explosion d’une torpille dans le remblai, et qu’il ne savait pas ce qui l’avait le plus attristé, si c’était la chair ou les deux objets, infiniment plus humains, au milieu de la boucherie, que de simples phalanges sanguinolentes — Ghassan avait encore sous la peau, dans le cou principalement, de minuscules fragments d’os invisibles ou presque aux rayons X et qui, on ne sait pourquoi, des années plus tard, se manifestaient de temps en temps sous la forme de kystes et de durillons qu’il devait alors faire opérer, ce qui l’ennuyait le plus c’était de devoir raconter, expliquer au médecin pourquoi son corps vomissait des osselets comme d’autres les éclats de verre d’un pare-brise : pauvres corps des guerriers, j’avais eu de la chance, à part quelques éraflures, brûlures superficielles et une entorse je m’en étais bien tiré, ma chair ne me rappelait pas la guerre à longueur de temps, j’ai deux petites cicatrices mais elles sont dans le dos et à l’arrière de l’épaule, je ne les vois jamais, il me faudrait deux miroirs pour les détailler à loisir — Sashka les caresse du doigt, je le sais, quand je suis allongé sur le ventre, elle ne m’a jamais demandé d’où elles provenaient, contrairement à Marianne et Stéphanie qui m’interrogeaient si souvent, l’histoire des blessures de Ghassan me rappelait mes romans de marine, sur les navires les blessés étaient farcis d’éclats de bois, du plat-bord, des poulies, des agrès, de la mâture, les boulets ou la mitraille hachaient le pont en projetant des milliers d’échardes, autant d’aiguilles sauvages qui lardaient l’équipage, comme celles qui atterrirent dans la main gauche et le thorax de l’arquebusier Miguel de Cervantès Saavedra à Lépante le 7 octobre 1571, à bord de la galère Marquise , placée en réserve à l’arrière-garde du dispositif chrétien et qui fut engagée aux environs de midi pour contrer l’attaque audacieuse d’Uluch Pacha le brave, il cherchait à tourner le centre tenu par dom Juan d’Autriche le commandant de la Sainte Ligue qui s’était levé de bonne humeur ce jour-là dit-on, à l’aube vers six heures du matin, un beau matin d’automne, et ce bien que la saison soit déjà avancée, dans la puanteur infâme de la galère où vivaient plus de trois cents personnes entassées les unes sur les autres, dom Juan d’Autriche avait revêtu son plastron et son armure lorsque, vers sept heures du matin, les premiers vaisseaux turcs furent aperçus, à portée dans deux heures plus ou moins, ce qui laissait au jeune bâtard de vingt-cinq ans le temps d’organiser son camp, la journée sera longue, l’embouchure du golfe de Patras étincelle plein est dans le soleil levant, elle est devenue un piège mortel où sont enfermées les 208 galères turques et les 120 vaisseaux légers qui les accompagnent, portant 50 000 marins et 27 000 soldats, des janissaires, des spahis, des volontaires, dans douze heures 30 000 cadavres soit plus de 1 800 tonnes de chair et d’os auront rejoint les poissons dans les eaux pacifiques et bleutées, je racontais à Ghassan la bataille de Lépante en visitant l’arsenal de Venise la belliqueuse tranquille, qui négociera sans états d’âme une paix séparée avec les Ottomans quelques années plus tard, mettant ainsi un terme à cette fameuse Sainte Ligue que commande dom Juan d’Autriche premier bâtard de Charles Quint, difficile d’imaginer la pestilence répandue par cinq cents galères et leurs chiourmes, les maladies, les parasites, les nuisibles qu’elles transportent, les premiers canons tonnent vers neuf heures du matin, vitesse moyenne cinq nœuds, ne nous précipitons pas, essayons de conserver l’ordre de marche, à l’arrière-garde à bord de la Marquise Cervantès est fiévreux, couché, il réclame de participer à la bataille, sur le pont — mieux vaut mourir debout au grand air que noyé ou brûlé vif dans une cale fétide, Cervantès rejoint son arquebuse, les galères ennemies sont à quelques milles devant lui, derrière le centre du camp chrétien où trône le vaisseau amiral de l’Autrichien qui tire un coup de canon et hisse son drapeau pour se signaler, le navire porte-drapeau turc la Sultane avec à son bord Ali Pacha en fait autant, les coutumes sont chevaleresques, les hommes moins, d’ici peu ils se massacreront en oubliant toutes les politesses de la guerre, déjà les galéasses vénitiennes, véritables cuirassés de l’époque, plus hautes et mieux armées, brisent les lignes centrales turques et causent de terribles dégâts, il est onze heures quinze du matin, l’aile gauche chrétienne est sous le feu et semble sur le point d’être tournée, Barbarigo son commandant est atteint d’une flèche dans l’œil, son neveu et officier Contarini est déjà mort, coulé avec la Sainte Madeleine — à droite, face à Andrea Doria le condottiere rusé, Uluch Pacha se décale vers le sud, pour ne pas être débordé Doria le suit, laissant un vide dans la ligne de défense, les galères de l’arrière-garde s’avancent pour le combler, depuis son arquebuse Cervantès aperçoit don Álvaro de Bazán donner les ordres : les rameurs frappent la plaine marine, la vitesse augmente à dix nœuds, dans quelques minutes ce sera l’affrontement avec les galères turques qui se sont détachées de l’escadre d’Uluch Pacha, déjà les flèches volent, la mitraille aussi, au moment même où Cervantès fait feu de son arquebuse sur des soldats turcs tombés à la mer je vide mon verre de vin, comme le capitaine Haddock au beau milieu des aventures du chevalier François son aïeul, et Ghassan me prie de continuer, comment Cervantès fut-il blessé, quelle fut l’issue de la bataille, il a beau être chrétien il ne peut s’empêcher d’être du côté des Ottomans, ce qui après tout est compréhensible mais bientôt le centre turc s’effondrera, la tête d’Ali Pacha ornera la galère de dom Juan, celle de Murat Dragut suivra, déjà leur flanc droit n’est plus qu’un souvenir, les galères sont prises une à une par la flotte vénitienne, abordées dans une mêlée sauvage, drossées contre la côte et bombardées du rivage, les archers turcs font face aux mousquets et aux canons de la Sérénissime et dom Juan d’Autriche, du haut de ses vingt-cinq ans et de toute sa noblesse, voit avec plaisir le feu et la bataille sur la Sultane dont ses galéasses détruisent l’escorte bâtiment par bâtiment, les esclaves chrétiens soudainement libérés ramassent des haches d’abordage et massacrent leurs anciens maîtres avec furie, Uluch Pacha l’infidèle s’est emparé du vaisseau étendard des chevaliers de Malte, l’escadre de don Álvaro de Bazán s’élance pour le délivrer, sur la Marquise l’artilleur Cervantès charge sa pièce en compagnie de cinq soldats, il la pointe sur la galère de Saïd Ali Raïs le pirate d’Alger, sans savoir que quelques années plus tard leurs destins se croiseront à nouveau, à l’inverse, que Cervantès sera emprisonné et à la merci du noble corsaire, déjà vers le centre de la bataille retentissent les cris de victoire, les galères turques survivantes cherchent à s’enfuir, un des vaisseaux ouvre le feu sur la Marquise pour dégager Saïd Ali, une salve de mitraille balaie le haut du pont où les pièces sont en batterie, et un éclat de bois pénètre le poignet de Cervantès, tranche un nerf et le prive à jamais de l’usage de sa main gauche, pour le plus grand honneur de la droite — que se serait-il produit si le canonnier musulman n’avait pas eu le soleil de midi dans l’œil, si Cervantès avait trépassé, anonyme sur une galère oubliée, effacée par la Gloire de dom Juan d’Autriche, il aurait sans doute été remplacé, s’il y a toujours quelqu’un pour reprendre un canon il y aura bien un homme pour reprendre une plume et un chevalier à la triste figure, son frère Rodrigue qui sait, son frère que la fortune postérieure de l’auteur du Quichotte a rayé de l’histoire, j’imagine qu’il aurait relaté la mort de son aîné avec panache, et aujourd’hui, sur les ferries qui vont à Patras en provenance d’Italie, de Bari ou de Brindisi, des haut-parleurs signaleraient aux passagers le monument au frère aîné de celui qui imagina le vieux marin fou de récits de corsaires, à bord d’une galère dont je préfère oublier le nom , et ainsi de suite, les soldats sont pour la plupart inconnus, où sont les noms des trente mille noyés, brûlés, décapités de Lépante, où est le nom de celui dont les dents et le crâne faillirent tuer Ghassan, qui sait comment s’appelle le soldat turc qui fut sur le point, sans le savoir, de changer le cours de la littérature occidentale et qui mourut à Smyrne ou à Constantinople, tremblant encore de rage au souvenir du désastre de Lépante, la moustache dans le brouet — à dix-neuf heures ce 7 octobre 1571 les prises turques et l’armada chrétienne sont à l’abri dans l’anse de Porta Petala, dom Juan d’Autriche fait jouer un Te Deum immense dans la nuit étoilée, le musulman est défait, le Turc vaincu, les alliés de la Sainte Ligue chantent la gloire de Dieu et de leur capitaine, ce jeune bâtard impérial de vingt-cinq ans qui vient de gagner la plus importante bataille navale depuis Actium en 31 avant Jésus-Christ : quelques milles au nord de Lépante, dans ces mêmes eaux gouvernées par Poséidon, le sort du monde s’est déjà joué une fois, le divin Antoine et Cléopâtre l’Egyptienne affrontèrent Octave le terrien, les deux anciens triumvirs jetèrent eux aussi leurs flottes et leurs dieux dans la bataille, Isis et Anubis contre Vénus et Neptune, autre bataille entre l’Est et l’Ouest, entre le Nord et le Sud, sans que personne sût très clairement encore où se trouvaient les barbares : tous ces récits fascinaient Ghassan, il souscrivait à la propagande chrétienne et croyait volontiers que les Libanais étaient des Phéniciens, descendants des adorateurs d’Astarté et de Baal, originaire de Byblos il imaginait ses ancêtres à son image, cultivés, cosmopolites et marchands, grands fondateurs de cités, Carthage et Leptis Magna, Larnaka et Málaga, de grands navigateurs et des combattants redoutables, dont les éléphants franchirent les Alpes : Hannibal fils d’Hamilcar le dompteur de guerriers vainquit les Romains une première fois au Tessin et blessa Scipion le cavalier son ennemi — par la fenêtre, alors que s’allonge la plaine du Pô au large de Piacenza, à cent kilomètres de Milan, je me demande si je ne vais pas apercevoir un des éléphants d’Hannibal, qui moururent de froid et de leurs blessures après avoir écrasé les légions romaines à quelques kilomètres d’ici, à Trebbia, au cours de cette bataille de la Trébie où périrent vingt mille légionnaires et auxiliaires, vingt mille cadavres pillés par les autochtones — sous les sédiments de la rivière, sous les morts d’une des premières batailles de Bonaparte en Italie, sous les tonnes de poussière apportées par le temps se trouvent les squelettes des pachydermes victorieux des Romains mais vaincus par la neige, abondante cette année-là aussi, j’ai envie de demander à mon voisin s’il sait qu’il y a des os d’éléphants enfouis tout près de nous, il ne regarde jamais par la fenêtre, il se contente de somnoler sur sa revue, un jour de décembre peut-être semblable à celui-ci en 218 avant Jésus-Christ, le jour du solstice d’hiver dit Tite-Live le savant, 80 000 hommes 20 000 chevaux et 30 éléphants s’affrontèrent : Tite-Live le juste dénombre les légions, les centuries, les cohortes de cavaliers, nomme les chefs de chaque camp, ceux qui s’acquirent de la gloire et ceux qui méritèrent l’opprobre, il décrit Hannibal l’opiniâtre qui, après plus de quinze ans de guerre sur le sol romain, ne réussit pas à arracher la capitulation au sénat et au peuple de Rome, malgré une suite de massacres uniques dans l’histoire antique : à Tunis près de Carthage assis porte de France je commande un express qu’ici on appelle direct en lisant le journal, en 1996 je m’arrête quelques jours en Tunisie pour y rencontrer des Algériens en exil, dans le cadre de mes nouvelles fonctions, comme on dit, je me rends à Carthage résidentielle et balnéaire, encombrée de villas luxueuses, à Mégara les jardins d’Hamilcar sont toujours plantés de sycomores, de vignes, d’eucalyptus et surtout de jasmin, avec ma source, un barbu repenti et sympathique, nous nous promenons sur la plage, je pense aux vaisseaux carthaginois venus de Sicile, d’Espagne ou du Levant qui débarquaient là, avant que, cédant aux injonctions guerrières du sénat enflammé par le souvenir des morts de la bataille de Cannes, on ne décidât de la réduire en cendres, Ceterum censeo Carthaginem esse delendam , et rien de plus, Caton l’Ancien le fossoyeur de Carthage portait certainement la barbe, comme mon islamiste algérien repenti qui arrondit ses fins de mois en mouchardant, au nom du Bien, ses anciens camarades égarés sur le chemin de Dieu, sur le mauvais sentier, Ceterum censeo Carthaginem esse delendam , il y a toujours des Carthages à détruire, de l’autre côté de la mer, depuis Ilion la bien gardée, dans ce mouvement de va-et-vient, comme une marée qui donne tour à tour la victoire à Constantinople, Carthage ou Rome : sur la plage de Mégara on trouve encore, ramenées par les vagues, des tesselles de mosaïques arrachées aux palais puniques qui dorment au fond de la mer, comme les épaves des galères de Lépante, les cuirassés coulés aux Dardanelles, les cendres jetées dans des sacs de ciment par les SS de la Risiera le long du dock n o 7 du port de Trieste, je ramasse ces cailloux carrés et multicolores, je les mets dans ma poche comme par la suite je ramasserai des noms et des dates pour les ranger dans ma mallette, avant de reconstruire la mosaïque entière, le tableau, l’état des lieux de la mort violente commencé par hasard avec Harmen Gerbens le SS du Caire, enfermé à la prison de Qanâter avec les juifs d’Egypte soupçonnés de collaborer avec Israël, ce qui faisait bien rire Nathan au bar de l’hôtel King David à Jérusalem, je me demande ce qui a bien pu passer par la tête des Egyptiens, disait-il, combien de temps dis-tu qu’ils l’ont gardé ? Huit ans ? Ils se sont rendu compte de qui il était, je suppose, ils ne savaient pas quoi en faire, finalement ils l’ont libéré peu avant la guerre de 67, les ennemis de mes ennemis sont mes amis, et lui ont octroyé la nationalité égyptienne, toujours sous son vrai nom, sans que personne s’inquiète de savoir si on le retrouverait un jour, enfoui sous les manguiers poussiéreux de Garden City, prisonnier alcoolique de l’Egypte éternelle, comme Antoine le vaincu d’Actium s’il n’avait pas préféré la mort à la prison et dit adieu d’un coup de glaive à Alexandrie qui le quittait à jamais, en 1956 et 1967 la communauté juive d’Egypte avait été contrainte à l’exil, aujourd’hui elle compte moins d’une cinquantaine de membres — la grande synagogue de la rue Nébi-Daniel à Alexandrie n’est plus qu’une coquille vide, le vieux concierge qu’il faut corrompre pour la visiter singe les prières et les cérémonies, il fait mine de sortir les rouleaux, de lire, de chanter, rendant par son simulacre l’absence encore plus réelle, encore plus tangible, personne ne prie plus dans les synagogues d’Egypte, seuls quelques-uns, venus de France d’Israël ou des Etats-Unis, organisent des cérémonies pour les fêtes, en 1931 pourtant Elia Mosseri directeur de la Banque d’Egypte, un des plus riches banquiers du Caire, propriétaire d’un magnifique palais Art déco à Garden City, investit avec son frère et des amis à Jérusalem sur un terrain sis sur l’antique voie julienne et construit un hôtel immense et luxueux qui deviendrait le King David : étrange de penser que l’appartement de Harmen Gerbens se trouve à quelques mètres de l’ancienne villa du fondateur de l’hôtel où Nathan et moi parlons du SS batave relogé par les Egyptiens à sa sortie de prison dans un appartement abandonné par une famille juive, comme les parents de Nathan, débarqués en 1949 à Haïfa après bien des douleurs, occuperont la maison d’une famille palestinienne chassée vers la Jordanie ou le Liban, dans une étrange roue du Destin où les dieux donnent et reprennent ce qu’ils ont donné — Isabelle de Castille promulgua le décret de l’Alhambra en 1492 et expulsa les juifs d’Espagne, décret qu’abolit Manuel Fraga à la pâle figure ministre du Tourisme de Franco le Duce ibère en 1967 lorsqu’il offrit des passeports aux juifs apatrides d’Egypte en alléguant le fait qu’ils étaient séfarades et donc d’origine espagnole, permettant par un coup de nationalisme forcené la reprise des relations diplomatiques avec Israël : à l’automne 1967 les juifs égyptiens qui ne possédaient pas de lien avec une des Puissances, France, Grande-Bretagne ou Italie, débarquèrent donc en bateau à Valence dans le port chargé d’oranges où leurs ancêtres avaient peut-être appareillé cinq cents ans plus tôt, abandonnant derrière eux maisons, or, bijoux et surtout le mythe de la culture andalouse des trois religions du livre, pour s’éparpiller du Maroc à Istanbul, sur les rives de cette mer que je parcours avec mon islamiste algérien en ramassant des tesselles carthaginoises en 1996, Lebihan mon supérieur d’alors m’envoyait souvent moi rencontrer les “sources”, vous inspirez confiance, disait-il, on vous donnerait le bon Dieu sans confession, avec cet air franc que vous avez, il vaut mieux que vous y alliez vous, aussi parce qu’il avait horreur de la nourriture arabe, amoureux de la blanquette de veau des huîtres du muscadet et du céleri rémoulade, qui plus est il ne supportait pas le piment, pour lui la Tunisie était une calamité digestive et circulatoire, le feu de Baal — considérations alimentaires à part dans le renseignement d’origine humaine le contact est primordial, la confiance, surtout quand la “source” ne se présente pas d’elle-même pour collaborer, qu’il faut l’approcher la circonvenir la caresser dans le sens du poil un jeu de renard et de Petit Prince, la bête sait qu’elle veut être apprivoisée, elle se laisse faire, elle revient toujours en arrière une fois ou deux en vierge effarouchée, il faut bien cerner ses motivations, idéologiques familiales vénales crapuleuses ou revanchardes et garder toujours un atout dans sa manche pour l’estocade, “servir la patrie” fonctionne encore bien avec quelques Français, surtout dans le scientifique ou l’économique, où les risques sont somme toute moindres, “lutter contre les rouges” ne fait plus recette, on s’en doute, remplacé par “combattre la montée de l’islam”, qui revient à peu près au même, mais dans mon expérience les motivations des informateurs sont la plupart du temps pécuniaires, l’argent le sexe le pouvoir voilà la sainte Trinité de l’officier traitant, il vaut mieux porter une pince à billets qu’une arme, même si, pour des raisons psychologiques évidentes, les sources préfèrent croire qu’elles travaillent “pour la bonne cause”, plus valorisant que “je suis un vendu” : le sympathique islamiste barbu servait à présent la cause de Dieu par la non-violence, comme il disait, j’ai vu trop de massacres, trop d’horreurs, il faut que cela cesse, c’était un ancien de la branche armée du FIS, proche des négociateurs de Rome sous les auspices de la communauté de Sant’ Egidio, Saint-Gilles du Transtévère à deux pas de chez Sashka — l’hiver 1995–1996, alors que j’étais encore un espion débutant, les différents partis politiques d’Algérie avaient signé grâce à cette entremise catholique un accord de principe, une plateforme de revendications censées mettre un terme à la guerre civile, ils étaient tous là, sauf l’armée bien sûr, depuis Ben Bella l’historique jusqu’aux islamistes, en passant par les Kabyles, les démocrates libéraux, et même Louisa Hanoune la rouge du Parti des travailleurs, seule femme de la réunion, ils appelaient à la démocratie au respect de la Constitution à la fin de la torture et des agissements des militaires, tout cela était bien sûr voué à l’échec mais offrait une belle base pour négocier une paix à venir, au même moment en Algérie l’AIS et le GIA massacraient les mécréants tandis que les soldats torturaient et exécutaient tout ce qui leur tombait sous la main, ma source me confiait des renseignements concrets, ma première source à l’étranger, mon premier voyage dans ma Zone, des noms, des principes d’organisation, des fractures, des tensions internes, que je recoupais par la suite dans mon bureau avec d’autres fiches, d’autres sources, pour en tirer une note, un papier inclus dans un rapport hebdomadaire envoyé aux ministères concernés, au cabinet du Premier ministre et à la présidence de la République, bulletin météorologique du danger, cette semaine averse probable sur l’Afrique du Nord, beau temps dans les Balkans, menaçant au Moyen-Orient, orages en Russie, etc., un service spécial s’occupait de compiler les renseignements des différentes sections pour cette publication secrète et régulière, sans compter les notes spéciales ou les demandes précises d’Untel ou d’Untel, inquiétudes économiques, géopolitiques, mondaines ou scientifiques fini terminé enfin pour moi le temps de l’ombre, une dernière valise et je vais rejoindre Sashka au regard transparent, m’allonger en silence auprès d’elle et enfouir mes lèvres dans ses cheveux courts, plus de listes plus de victimes de bourreaux d’enquêtes officielles ou non je change de vie de corps de souvenirs d’avenir de passé je vais tout jeter des yeux par la fenêtre hermétiquement close dans la grande masse noire du paysage, me purifier, plonger, à Venise la Sérénissime un soir de décembre j’avais bu, je rentrais titubant du bout du quai de l’Oubli, tout au nord de Cannaregio j’avais trois cents mètres à parcourir pour retrouver mon Vieux Ghetto, autant dire cent kilomètres, autant dire mille, je balançais de droite à gauche, je tanguais, j’ai pris la mauvaise direction, j’ai tourné vers la place des Deux-Maures, je me suis vautré sur le puits sculpté au milieu de la petite esplanade, puis relevé les genoux douloureux comme on s’extirpe d’une tranchée dans la guerre, je me revoyais le fusil à la main courbé en deux j’ai fait trois pas de plus vers le pont de la Madonna dell’Orto, deux à gauche, un à droite, emporté vers l’avant par mon propre poids, par celui de mon bonnet noir ou de mes souvenirs dans l’odeur de vase gelée du brouillard vénitien, en respirant fort le plus fort possible pour reprendre mes esprits, la bouche grande ouverte les poumons glacés, avance, avance droit si tu tombes tu ne te relèveras pas tu finiras mort abattu par les tchetniks derrière toi par les Turcs par les Troyens aux rapides cavales je respire je respire j’avance je m’accroche à la rambarde du pont c’est un arbre dans les montagnes bosniaques je grimpe, je grimpe dans la nuit je redescends je vois la haute façade de briques de l’église qu’est-ce que je fous là j’habite de l’autre côté de l’autre côté je fais demi-tour en trébuchant rate le pont et me colle la tête la première dans le canal obscur, une main m’agrippe, je suffoque, c’est le contrôleur qui me réveille, il me secoue, me demande mon billet que je lui tends machinalement, il me sourit, il a l’air agréable, dehors il fait toujours aussi noir, je colle les yeux à la vitre, rase campagne, il ne pleut plus
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Zone»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Zone» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Zone» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.