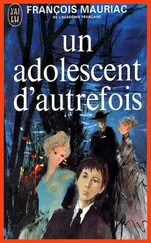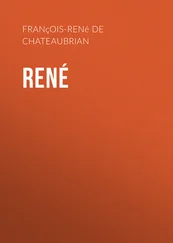Je doute qu’aucun de vous ait senti l’horreur du testament de ce misérable : il laissait à sa femme une fortune énorme à condition qu’elle ne se remariât pas. Dans le cas contraire, la plus grosse part en devait revenir à des neveux.
« Il va falloir beaucoup l’entourer, répétait ta mère. Heureusement que nous sommes une famille où l’on se tient les uns les autres. Il ne faut pas laisser seule cette petite. »
Marinette avait une trentaine d’années, à cette époque, mais rappelle-toi son aspect de jeune fille. Elle s’était laissée marier docilement à un vieillard, l’avait subi sans révolte. Vous ne doutiez pas qu’elle dût se soumettre aisément aux obligations du veuvage. Vous comptiez pour rien la secousse de la délivrance, cette brusque sortie du tunnel, en pleine lumière.
Non, Isa, ne crains pas que j’abuse de l’avantage qui m’est ici donné. Il était naturel de souhaiter que ces millions demeurassent dans la famille, et que nos enfants en eussent le profit. Vous jugiez que Marinette ne devait pas perdre le bénéfice de ces dix années d’asservissement à un vieux mari. Vous agissiez en bons parents. Rien ne vous paraissait plus naturel que le célibat. Te souvenais-tu d’avoir été naguère une jeune femme ? Non, c’était un chapitre fini ; tu étais mère, le reste n’existait plus, ni pour toi, ni pour les autres. Votre famille n’a jamais brillé par l’imagination : sur ce point, vous ne vous mettiez à la place ni des bêtes, ni des gens.
Il fut entendu que Marinette passerait à Calèse le premier été qui suivit son veuvage. Elle accepta avec joie, non qu’il y eût entre vous beaucoup d’intimité, mais elle aimait nos enfants, surtout la petite Marie. Pour moi, qui la connaissais à peine, je fus d’abord sensible à sa grâce ; plus âgée que toi d’une année, elle paraissait de beaucoup ta cadette. Tu étais demeurée lourde des petits que tu avais portés ; elle était sortie en apparence intacte du lit de ce vieillard. Son visage était puéril. Elle se coiffait avec le chignon haut, selon la mode d’alors, et ses cheveux d’un blond sombre moussaient sur sa nuque. (Cette merveille oubliée aujourd’hui : une nuque mousseuse.) Ses yeux un peu trop ronds lui donnaient l’air d’être toujours étonnée. Par jeu, j’entourais de mes deux mains « sa taille de guêpe » ; mais l’épanouissement du buste et des hanches aurait paru aujourd’hui presque monstrueux : les femmes d’alors ressemblaient à des fleurs forcées.
Je m’étonnais que Marinette fût si gaie. Elle amusait beaucoup les enfants, organisait des parties de cache-cache dans le grenier, jouait aux tableaux vivants. « Elle est un peu trop évaporée, disais-tu, elle ne se rend pas compte de sa situation. »
C’était déjà trop que d’avoir consenti à ce qu’elle portât des robes blanches dans la semaine ; mais tu jugeais inconvenant qu’elle assistât à la messe sans son voile et que son manteau ne fût pas bordé de crêpe. La chaleur ne te semblait pas être une excuse.
Le seul divertissement qu’elle eût goûté avec son mari était l’équitation. Jusqu’à son dernier jour, le baron Philipot, sommité du concours hippique, n’avait presque jamais manqué sa promenade matinale à cheval. Marinette fit venir à Calèse sa jument et comme personne ne pouvait l’accompagner, elle montait seule, ce qui te semblait doublement scandaleux : une veuve de trois mois ne doit pratiquer aucun exercice, mais se promener à cheval sans garde du corps, cela dépassait les bornes.
« Je lui dirai ce que nous en pensons en famille », répétais-tu. Tu le lui disais, mais elle n’en faisait qu’à sa tête. De guerre lasse, elle me demanda de l’escorter. Elle se chargeait de me procurer un cheval très doux. (Naturellement tous les frais lui incomberaient.)
Nous partions dès l’aube, à cause des mouches, et parce qu’il fallait faire deux kilomètres au pas avant d’atteindre les premiers bois de pins. Les chevaux nous attendaient devant le perron. Marinette tirait la langue aux volets clos de ta chambre, en épinglant à son amazone une rose trempée d’eau, « pas du tout pour veuve », disait-elle. La cloche de la première messe battait à petits coups. L’abbé Ardouin nous saluait timidement et disparaissait dans la brume qui flottait sur les vignes.
Jusqu’à ce que nous ayons atteint les bois, nous causions. Je m’aperçus que j’avais quelque prestige aux yeux de ma belle-sœur, — bien moins à cause de ma situation au Palais que pour les idées subversives dont je me faisais, en famille, le champion. Tes principes ressemblaient trop à ceux de son mari. Pour une femme, la religion, les idées sont toujours quelqu’un : tout prend figure à ses yeux, — figure adorable ou haïe.
Il n’eût tenu qu’à moi de pousser mon avantage auprès de cette petite révoltée. Mais voilà ! tant qu’elle s’irritait contre vous, j’atteignais sans peine à son diapason, mais il m’était impossible de la suivre dans le dédain qu’elle manifestait à l’endroit des millions qu’elle perdrait en se remariant. J’aurais eu tout intérêt à parler comme elle et à jouer les nobles cœurs ; mais il m’était impossible de feindre, je ne pouvais même pas faire semblant de l’approuver quand elle comptait pour rien la perte de cet héritage. Faut-il tout dire ? je n’arrivais pas à chasser l’hypothèse de sa mort qui ferait de nous ses héritiers. (Je ne pensais pas aux enfants, mais à moi.)
J’avais beau m’y préparer d’avance, répéter ma leçon, c’était plus fort que ma volonté : « Sept millions ! Marinette, vous n’y songez pas, on ne renonce pas à sept millions. Il n’existe pas un homme au monde qui vaille le sacrifice d’une parcelle de cette fortune ! » Et comme elle prétendait mettre le bonheur au-dessus de tout, je lui assurai que personne n’était capable d’être heureux après le sacrifice d’une pareille somme.
— Ah ! s’écriait-elle vous avez beau les haïr, vous appartenez bien à la même espèce.
Elle partait au galop et je la suivais de loin. J’étais jugé, j’étais perdu. Ce goût maniaque de l’argent, de quoi ne m’aura-t-il frustré ! J’aurais pu trouver en Marinette une petite sœur, une amie… Et vous voudriez que je vous sacrifie ce à quoi j’ai tout sacrifié ? Non, non, mon argent m’a coûté trop cher pour que je vous en abandonne un centime avant le dernier hoquet.
Et pourtant, vous ne vous lassez pas. Je me demande si la femme d’Hubert, dont j’ai subi la visite dimanche, était déléguée par vous, ou si elle est venue de son propre mouvement. Cette pauvre Olympe ! (Pourquoi Phili l’a-t-il surnommée Olympe ? Mais nous avons oublié son vrai prénom…) Je croirais plutôt qu’elle ne vous a rien dit de sa démarche. Vous ne l’avez pas adoptée, ce n’est pas une femme de la famille. Cette personne indifférente à tout ce qui ne constitue pas son étroit univers, à tout ce qui ne la touche pas directement, ne connaît aucune des lois de la « gens » ; elle ignore que je suis l’ennemi. Ce n’est pas de sa part bienveillance ou sympathie naturelle : elle ne pense jamais aux autres, fût-ce pour les haïr. « Il est toujours très convenable avec moi », proteste Olympe quand on prononce mon nom devant elle. Elle ne sent pas mon âpreté. Et comme il m’arrive, par esprit de contradiction, de la défendre contre vous tous, elle se persuade qu’elle m’attire.
À travers ses propos confus, j’ai discerné qu’Hubert avait enrayé à temps, mais que tout son avoir personnel et la dot de sa femme avaient été engagés pour sauver la charge. « Il dit qu’il retrouvera forcément son argent, mais il aurait besoin d’une avance… Il appelle ça une avance d’hoirie… »
Je hochais la tête, j’approuvais, je feignais d’être à mille lieues de comprendre ce qu’elle voulait. Comme j’ai l’air innocent, à ces moments-là !
Читать дальше