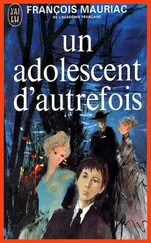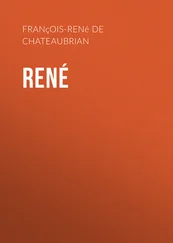Le lendemain matin, elle ne monta pas à cheval. Je me rendis à Bordeaux (j’y allais passer deux jours chaque semaine, malgré les vacances du Palais, afin de ne pas interrompre mes consultations).
Lorsque je repris le train pour rentrer à Calèse, le Sud-express était en gare et mon étonnement fut vif d’apercevoir, derrière les glaces du wagon sur lequel était écrit Biarritz, Marinette, sans voile, vêtue d’un tailleur gris. Je me souvins qu’une amie la pressait depuis longtemps de venir la rejoindre à Saint-Jean-de-Luz. Elle regardait un journal illustré et ne vit pas mes signes. Le soir, lorsque je te fis mon rapport, tu prêtas peu d’attention à ce que tu ne croyais être qu’une courte fugue. Tu me dis que Marinette avait reçu, peu après mon départ, un télégramme de son amie. Tu semblais surprise que je ne fusse pas au courant. Peut-être nous avais-tu soupçonnés d’une rencontre clandestine à Bordeaux. La petite Marie, d’ailleurs, était couchée avec la fièvre ; elle souffrait, depuis plusieurs jours, d’un dévoiement qui t’inquiétait. C’est une justice à te rendre, lorsqu’un de tes enfants était malade, rien ne comptait plus.
Je voudrais passer vite sur ce qui a suivi. Après plus de trente années, je ne saurais, sans un immense effort, y arrêter ma pensée. Je sais ce dont tu m’as accusé. Tu as osé me déclarer en face que je n’avais pas voulu de consultation. Sans aucun doute, si nous avions fait venir le professeur Arnozan, il aurait reconnu un état typhique dans cette prétendue grippe. Mais rappelle tes souvenirs. Une seule fois, tu m’as dit : « Si nous appelions Arnozan ? » Je t’ai répondu : « Le Dr Aubrou assure qu’il soigne plus de vingt cas de la même grippe dans le village… » Tu n’as pas insisté. Tu prétends m’avoir supplié, le lendemain encore, de télégraphier à Arnozan. Je m’en souviendrais si tu l’avais fait. Il est vrai que j’ai tellement remâché ces souvenirs, pendant des jours et des nuits, que je ne m’y retrouve plus. Mettons que je sois avare… mais pas au point de lésiner quand il s’agissait de la santé de Marie. C’était d’autant moins vraisemblable que le professeur Arnozan travaillait pour l’amour de Dieu et des hommes : si je ne l’ai pas appelé, c’est que nous demeurions persuadés qu’il s’agissait d’une simple grippe « qui s’était portée sur l’intestin ». Cet Aubrou faisait manger Marie pour qu’elle ne s’affaiblît pas. C’est lui qui l’a tuée, ce n’est pas moi. Non, nous étions d’accord, tu n’as pas insisté pour faire venir Arnozan, menteuse. Je ne suis pas responsable de la mort de Marie. C’est horrible que de m’en avoir accusé ; et tu le crois ! et tu l’as toujours cru !
Cet été implacable ! le délire de cet été, la férocité des cigales… Nous ne pouvions pas arriver à nous procurer de la glace. J’essuyais, pendant des après-midi sans fin, sa petite figure suante qui attirait les mouches. Arnozan est venu trop tard. On a changé le régime alors qu’elle était cent fois perdue. Elle délirait, peut-être, quand elle répétait : « Pour papa ! pour papa ! » Tu te rappelles de quel accent elle criait : « Mon Dieu, je ne suis qu’une enfant… » et elle se reprenait : « Non, je peux encore souffrir. » L’abbé Ardouin lui faisait boire de l’eau de Lourdes. Nos têtes se rapprochaient au-dessus de ce corps exténué, nos mains se touchaient. Quand ce fut fini, tu m’as cru insensible.
Veux-tu savoir ce qui se passait en moi ? C’est une chose étrange que toi, la chrétienne, tu n’aies pu te détacher du cadavre. On te suppliait de manger, on te répétait que tu avais besoin de toutes tes forces. Mais il aurait fallu t’entraîner hors de la chambre par violence. Tu demeurais assise tout contre le lit, tu touchais le front, les joues froides d’un geste tâtonnant. Tu posais tes lèvres sur les cheveux encore vivants ; et parfois tu tombais à genoux, non pour prier, mais pour appuyer ton front contre les dures petites mains glacées.
L’abbé Ardouin te relevait, te parlait de ces enfants à qui il faut ressembler pour entrer dans le royaume du Père : « Elle est vivante, elle vous voit, elle vous attend. » Tu hochais la tête ; ces mots n’atteignaient même pas ton cerveau ; ta foi ne te servait à rien. Tu ne pensais qu’à cette chair de ta chair qui allait être ensevelie et qui était au moment de pourrir ; tandis que moi, l’incrédule, j’éprouvais devant ce qui restait de Marie, tout ce que signifie le mot « dépouille ». J’avais le sentiment irrésistible d’un départ, d’une absence. Elle n’était plus là ; ce n’était plus elle. « Vous cherchez Marie ? elle n’est plus ici… »
Plus tard, tu m’as accusé d’oublier vite. Je sais pourtant ce qui s’est rompu en moi lorsque je l’ai embrassée, une dernière fois, dans son cercueil. Mais ce n’était plus elle. Tu m’as méprisé de ce que je ne t’accompagnais pas au cimetière, presque chaque jour. « Il n’y met jamais les pieds, répétais-tu. Et pourtant Marie était la seule qu’il parût aimer un peu… Il n’a pas de cœur. »
Marinette revint pour l’enterrement, mais repartit trois jours après. La douleur t’aveuglait, tu ne voyais pas la menace qui, de ce côté-là, se dessinait. Et même tu avais l’air d’être soulagée par le départ de ta sœur. Nous apprîmes, deux mois plus tard, ses fiançailles avec cet homme de lettres, ce journaliste rencontré à Biarritz. Il n’était plus temps de parer le coup. Tu fus implacable — comme si une haine refoulée éclatait soudain contre Marinette ; tu n’as pas voulu connaître cet « individu » — un homme ordinaire, pareil à beaucoup d’autres ; son seul crime était de frustrer nos enfants d’une fortune dont il n’avait d’ailleurs pas le bénéfice, puisque les neveux Philipot en recevaient la plus grande part.
Mais tu ne raisonnes jamais ; tu n’as pas éprouvé l’ombre d’un scrupule ; je n’ai connu personne qui fût plus que toi sereinement injuste. Dieu sait de quelles peccadilles tu te confessais ! et il n’est pas une seule des Béatitudes dont tu n’aies passé ta vie à prendre le contrepied. Il ne te coûte rien d’accumuler de fausses raisons pour rejeter les objets de ta haine. À propos du mari de ta sœur, que tu n’avais jamais vu et dont tu ne connaissais rien : « Elle a été, à Biarritz, la victime d’un aigrefin, d’une espèce de rat d’hôtel… » disais-tu.
Quand la pauvre petite est morte en couches (ah ! je ne voudrais pas te juger aussi durement que tu m’as jugé moi-même à propos de Marie !) ce n’est pas assez de dire que tu n’as guère manifesté de chagrin. Les événements t’avaient donné raison ; ça ne pouvait pas finir autrement ; elle était allée à sa perte ; tu n’avais rien à te reprocher ; tu avais fait tout ton devoir ; la malheureuse savait bien que sa famille lui demeurait toujours ouverte, qu’on l’attendait, qu’elle n’avait qu’un signe à faire. Du moins tu pouvais te rendre justice : tu n’avais pas été complice. Il t’en avait coûté de demeurer ferme : « mais il y a des occasions où il faut savoir se marcher sur le cœur. »
Non, je ne t’accablerai pas. Je reconnais que tu as été bonne pour le fils de Marinette, pour le petit Luc, lorsque ta mère n’a plus été là qui, jusqu’à sa mort, s’était occupée de lui. Tu t’en chargeais pendant les vacances ; tu allais le voir, une fois chaque hiver, dans ce collège aux environs de Bayonne : « Tu faisais ton devoir, puisque le père ne faisait pas le sien… »
Je ne t’ai jamais dit comment je l’ai connu, le père de Luc, à Bordeaux, en septembre 1914. Je cherchais à me procurer un coffre dans une banque ; les Parisiens en fuite les avaient tous pris. Enfin le directeur du Crédit Lyonnais m’avertit qu’un de ses clients regagnait Paris et consentirait peut-être à me céder le sien. Quand il me le nomma, je vis qu’il s’agissait du père de Luc. Ah ! non, ce n’était pas le monstre que tu imaginais. Je cherchai en vain, dans cet homme de trente-huit ans, étique, hagard, rongé par la terreur des conseils de révision, celui que quatorze ans plus tôt, j’avais entrevu à l’enterrement de Marinette et avec qui j’avais eu une conversation d’affaires. Il me parla à cœur ouvert. Il vivait maritalement auprès d’une femme dont il voulait épargner le contact à Luc. C’était dans l’intérêt du petit qu’il l’avait abandonné à sa grand-mère Fondaudège… Ma pauvre Isa, si vous aviez su, toi et les enfants, ce que j’ai offert à cet homme, ce jour-là ! Je peux bien te le dire maintenant. Il aurait gardé le coffre à son nom ; j’aurais eu sa procuration. Toute ma fortune mobilière aurait été là, avec un papier attestant qu’elle appartenait à Luc. Tant-que j’aurais vécu, son père n’aurait pas touché au coffre. Mais après ma mort, il en aurait pris possession et vous ne vous seriez douté de rien…
Читать дальше