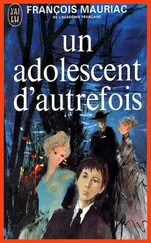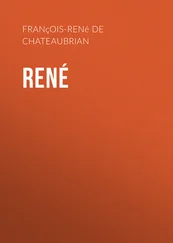Mais, pour ton malheur, il y avait là le précepteur des enfants, un séminariste de vingt-trois ans, l’abbé Ardouin, dont j’invoquais sans pitié le témoignage et que j’embarrassais fort, car je ne le faisais intervenir que lorsque j’étais sûr d’avoir raison, et il était incapable, dans ces sortes de débats, de ne pas livrer toute sa pensée. À mesure que l’affaire Dreyfus se développa, j’y trouvai mille sujets de dresser contre toi le pauvre abbé : « Pour un misérable Juif, désorganiser l’armée… » disais-tu. Cette seule parole déchaînait ma feinte indignation et je n’avais de cesse que je n’eusse obligé l’abbé Ardouin à confesser qu’un chrétien ne peut souscrire à la condamnation d’un innocent, fût-ce pour le salut du pays.
Je n’essayais d’ailleurs pas de vous convaincre, toi et les enfants, qui ne connaissiez l’Affaire que par les caricatures des bons journaux. Vous formiez un bloc inentamable. Même quand j’avais l’air d’avoir raison, vous ne doutiez pas que ce ne fût à force de ruse. Vous en étiez venus à garder le silence devant moi. À mon approche, comme il arrive encore aujourd’hui, les discussions s’arrêtaient net ; mais quelquefois vous ne saviez pas que je me cachais derrière un massif d’arbustes, et tout à coup j’intervenais avant que vous ayez pu battre en retraite et vous obligeais à accepter le combat.
— C’est un saint garçon, disais-tu de l’abbé Ardouin, mais un véritable enfant qui ne croit pas au mal. Mon mari joue avec lui comme le chat avec la souris ; voilà pourquoi il le supporte, malgré son horreur des soutanes.
Au vrai, j’avais consenti d’abord à la présence d’un précepteur ecclésiastique, parce qu’aucun civil n’aurait accepté cent cinquante francs pour toutes les vacances. Les premiers jours, j’avais pris ce grand jeune homme noir et myope, perclus de timidité, pour un être insignifiant et je n’y prêtais pas plus d’attention qu’à un meuble. Il faisait travailler les enfants, les menait en promenade, mangeait peu, et ne disait mot. Il montait dans sa chambre, la dernière bouchée avalée. Parfois, quand la maison était vide, il se mettait au piano. Je n’entends rien à la musique, mais, comme tu disais : « Il faisait plaisir. »
Sans doute n’as-tu pas oublié un incident dont tu ne t’es jamais douté qu’il créa, entre l’abbé Ardouin et moi, un secret courant de sympathie. Un jour, les enfants signalèrent l’approche du curé. Aussitôt selon ma coutume, je pris la fuite du côté des vignes. Mais Hubert vint m’y rejoindre de ta part : le curé avait une communication urgente à me faire. Je repris, en maugréant, le chemin de la maison, car je redoutais fort ce petit vieillard. Il venait, me dit-il, décharger sa conscience. Il nous avait recommandé l’abbé Ardouin comme un excellent séminariste dont le sous-diaconat avait été remis pour des raisons de santé. Or il venait d’apprendre, au cours de la retraite ecclésiastique, que ce retard devait être attribué à une mesure disciplinaire. L’abbé Ardouin, quoique très pieux, était fou de musique, et il avait découché, entraîné par un de ses camarades, pour entendre, au Grand Théâtre, un concert de charité. Bien qu’ils fussent en civil, on les avait reconnus et dénoncés. Ce qui mit le comble au scandale, ce fut que l’interprète de Thaïs, M me Georgette Lebrun, figurait au programme ; à l’aspect de ses pieds nus, de sa tunique grecque, maintenue sous les bras par une ceinture d’argent (« et c’était tout, disait-on, pas même de minuscules épaulettes ! »), il y avait eu un « oh ! » d’indignation. Dans la loge de l’ Union, un vieux monsieur s’écria : « C’est tout de même un peu fort… où sommes-nous ? » Voilà ce qu’avaient vu l’abbé Ardouin et son camarade ! L’un des délinquants fut chassé sur l’heure. Celui-ci avait été pardonné : c’était un sujet hors ligne ; mais ses supérieurs l’avaient retardé de deux ans.
Nous fûmes d’accord pour protester que l’abbé gardait toute notre confiance. Mais le curé n’en témoigna pas moins, désormais, une grande froideur au séminariste qui, disait-il, l’avait trompé. Tu te rappelles cet incident, mais ce que tu as toujours ignoré, c’est que ce soir-là, comme je fumais sur la terrasse, je vis venir vers moi, dans le clair de lune, la maigre silhouette noire du coupable. Il m’aborda avec gaucherie et me demanda pardon de s’être introduit chez moi sans m’avoir averti de son indignité. Comme je lui assurais que son escapade me le rendait plutôt sympathique, il protesta avec une soudaine fermeté et plaida contre lui-même. Je ne pouvais, disait-il, mesurer l’étendue de sa faute : il avait péché à la fois contre l’obéissance, contre sa vocation, contre les mœurs. Il avait commis le péché de scandale ; ce ne serait pas trop de toute sa vie pour réparer ce qu’il avait fait… Je vois encore cette longue échine courbée, son ombre, dans le clair de lune, coupée en deux par le parapet de la terrasse.
Aussi prévenu que je fusse contre les gens de sa sorte, je ne pouvais soupçonner, devant tant de honte et de douleur, la moindre hypocrisie. Il s’excusait de son silence à notre égard sur la nécessité où il se fût trouvé de demeurer pendant deux mois à la charge de sa mère, très pauvre veuve qui faisait des journées à Libourne. Comme je lui répondais qu’à mon avis rien ne l’obligeait à nous avertir d’un incident qui concernait la discipline du séminaire, il me prit la main et me dit ces paroles inouïes, que j’entendais pour la première fois de ma vie et qui me causèrent une sorte de stupeur :
— Vous êtes très bon.
Tu connais mon rire, ce rire qui, même au début de notre vie commune, te portait sur les nerfs, — si peu communicatif que, dans ma jeunesse, il avait le pouvoir de tuer autour de moi toute gaîté. Il me secouait, ce soir-là, devant ce grand séminariste interdit. Je pus enfin parler :
— Vous ne savez pas, monsieur l’abbé, à quel point ce que vous dites est drôle. Demandez à ceux qui me connaissent si je suis bon. Interrogez ma famille, mes confrères : la méchanceté est ma raison d’être.
Il répondit avec embarras qu’un vrai méchant ne parle pas de sa méchanceté.
— Je vous défie bien, ajoutai-je, de trouver dans ma vie ce que vous appelez un acte bon.
Il me cita alors, faisant allusion à mon métier, la parole du Christ : « J’étais prisonnier et vous m’avez visité… »
— J’y trouve mon avantage, monsieur l’abbé. J’agis par intérêt professionnel. Naguère encore, je payais les geôliers pour que mon nom fût glissé, en temps utile, à l’oreille des prévenus… ainsi, vous voyez !
Je ne me souviens plus de sa réponse. Nous marchions sous les tilleuls. Que tu aurais été étonnée si je t’avais dit que je trouvais quelque douceur à la présence de cet homme en soutane ! c’était vrai pourtant.
Il m’arrivait de me lever avec le soleil et de descendre pour respirer l’air froid de l’aube. Je regardais l’abbé partir pour la messe, d’un pas rapide, si absorbé qu’il passait parfois à quelques mètres de moi sans me voir. C’était l’époque où je t’accablais de mes moqueries, où je m’acharnais à te mettre en contradiction avec tes principes… Il n’empêche que je n’avais pas une bonne conscience : je feignais de croire, à chaque fois que je te prenais en flagrant délit d’avarice ou de dureté, qu’aucune trace de l’esprit du Christ ne subsistait plus parmi vous, et je n’ignorais pas que, sous mon toit, un homme vivait selon cet esprit, à l’insu de tous.
Il y eut pourtant une circonstance où je n’eus pas à me forcer pour te trouver horrible. En 96 ou 97, tu dois te rappeler la date exacte, notre beau-frère, le baron Philipot, mourut. Ta sœur Marinette, en s’éveillant, le matin, lui parla et il ne répondit pas. Elle ouvrit les volets, vit les yeux révulsés du vieillard, sa mâchoire inférieure décrochée, et ne comprit pas tout de suite qu’elle avait dormi, pendant plusieurs heures, à côté d’un cadavre.
Читать дальше