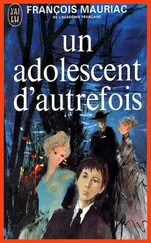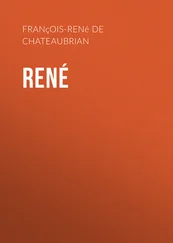Les petits étaient gentils avec moi, mais sur leur garde. Tu avais occupé d’avance ces trois cœurs, tu en tenais les issues. Impossible d’y avancer sans ta permission. Trop scrupuleuse pour me diminuer à leurs yeux, tu ne leur avais pas caché qu’il fallait beaucoup prier pour « pauvre papa ». Quoi que je fisse, j’avais ma place dans leur système du monde : j’étais le pauvre papa pour lequel il faut beaucoup prier et dont il faut obtenir la conversion. Tout ce que je pouvais dire ou insinuer touchant la religion, renforçait l’image naïve qu’ils se faisaient de moi.
Ils vivaient dans un monde merveilleux, jalonné de fêtes pieusement célébrées. Tu obtenais tout d’eux en leur parlant de la Première Communion qu’ils venaient de faire, ou à laquelle ils se préparaient. Lorsqu’ils chantaient, le soir, sur le perron de Calèse, ce n’était pas toujours des airs de Lulli qu’il me fallait entendre, mais des cantiques. Je voyais de loin votre groupe confus et, quand il y avait clair de lune, je distinguais trois petites figures levées. Mes pas, sur le gravier, interrompaient les chants.
Chaque dimanche, le remue-ménage des départs pour la messe m’éveillait. Tu avais toujours peur de la manquer. Les chevaux s’ébrouaient. On appelait la cuisinière qui était en retard. Un des enfants avait oublié son paroissien. Une voix aiguë criait : « C’est quel dimanche après la Pentecôte ? »
Au retour, ils venaient m’embrasser et me trouvaient encore au lit. La petite Marie, qui avait dû réciter à mon intention toutes les prières qu’elle avait apprises, me regardait attentivement dans l’espoir, sans doute, de constater une légère amélioration de mon état spirituel.
Elle seule ne m’irritait pas. Alors que ses deux aînés s’installaient déjà dans les croyances que tu pratiquais, avec cet instinct bourgeois du confort qui leur ferait, plus tard, écarter toutes les vertus héroïques, toute la sublime folie chrétienne, il y avait au contraire, chez Marie, une ferveur touchante, une tendresse de cœur pour les domestiques, pour les métayers, pour les pauvres. On disait d’elle : « Elle donnerait tout ce qu’elle a ; l’argent ne lui tient pas aux doigts. C’est très joli, mais ce sera tout de même à surveiller… » On disait encore : « Personne ne lui résiste, pas même son père. » Elle venait d’elle-même sur mes genoux, le soir. Une fois, elle s’endormit contre mon épaule. Ses boucles chatouillaient ma joue. Je souffrais de l’immobilité et j’avais envie de fumer. Je ne bougeais pas cependant. Quand, à neuf heures, sa bonne vint la chercher, je la montai jusqu’à sa chambre, et vous me regardiez tous avec stupeur, comme si j’avais été ce fauve qui léchait les pieds des petites martyres. Peu de jours après, le matin du 14 août, Marie me dit (tu sais comme font les enfants) :
— Promets-moi de faire ce que je vais te demander… promets d’abord, je te dirai après…
Elle me rappela que tu chantais, le lendemain, à la messe d’onze heures, et que ce serait gentil de venir t’entendre.
— Tu as promis ! tu as promis ! répétait-elle en m’embrassant. C’est juré !
Elle prit le baiser que je lui rendis pour un acquiescement. Toute la maison était avertie. Je me sentais observé. Monsieur irait à la messe demain, lui qui ne mettait jamais les pieds à l’église ! C’était un événement d’une portée immense.
Je me mis à table, le soir, dans un état d’irritation que je ne pus longtemps dissimuler. Hubert te demanda je ne sais plus quel renseignement au sujet de Dreyfus. Je me souviens d’avoir protesté avec fureur contre ce que tu lui répondis. Je quittai la table et ne reparus pas. Ma valise prête, je pris, à l’aube du 15 août, le train de six heures et passai une journée terrible dans un Bordeaux étouffant et désert.
Il est étrange qu’après cela vous m’ayez revu à Calèse. Pourquoi ai-je toujours passé mes vacances avec vous au lieu de voyager ? Je pourrais imaginer de belles raisons. Au vrai, il s’agissait pour moi de ne pas faire double dépense. Je n’ai jamais cru qu’il fût possible de partir en voyage et de prodiguer tant d’argent sans avoir, au préalable, renversé la marmite et fermé la maison. Je n’aurais pris aucun plaisir à courir les routes, sachant que je laissais derrière moi tout le train du ménage. Je finissais donc par revenir au râtelier commun. Du moment que ma pitance était servie à Calèse, comment serais-je allé me nourrir ailleurs ? Tel était l’esprit d’économie que ma mère m’avait légué et dont je faisais une vertu.
Je rentrai donc, mais dans un état de rancœur contre lequel Marie même demeura sans pouvoir. Et j’inaugurai contre toi une nouvelle tactique. Bien loin d’attaquer de front tes croyances, je m’acharnais, dans les moindres circonstances, à te mettre en contradiction avec ta foi. Ma pauvre Isa, bonne chrétienne que tu fusses, avoue que j’avais beau jeu. Que charité soit synonyme d’amour, tu l’avais oublié, si tu l’avais jamais su. Sous ce nom, tu englobais un certain nombre de devoirs envers les pauvres dont tu t’acquittais avec scrupule, en vue de ton éternité. Je reconnais que tu as beaucoup changé sur ce chapitre : maintenant, tu soignes les cancéreuses, c’est entendu ! Mais, à cette époque, les pauvres — tes pauvres — une fois secourus, tu ne t’en trouvais que plus à l’aise pour exiger ton dû des créatures vivant sous ta dépendance. Tu ne transigeais pas sur le devoir des maîtresses de maison qui est d’obtenir le plus de travail pour le moins d’argent possible. Cette misérable vieille qui passait, le matin, avec sa voiture de légumes, et à qui tu aurais fait la charité largement si elle t’avait tendu la main, ne te vendait pas une salade que tu n’eusses mis ton honneur à rogner de quelques sous son maigre profit.
Les plus timides invites des domestiques et des travailleurs pour une augmentation de salaire suscitaient d’abord en toi une stupeur, puis une indignation dont la véhémence faisait ta force et t’assurait toujours le dernier mot. Tu avais une espèce de génie pour démontrer à ces gens qu’ils n’avaient besoin de rien. Dans ta bouche, une énumération indéfinie multipliait les avantages dont ils jouissaient : « Vous avez le logement, une barrique de vin, la moitié d’un cochon que vous nourrissez avec mes pommes de terre, un jardin pour faire venir des légumes. » Les pauvres diables n’en revenaient pas d’être si riches. Tu assurais que ta femme de chambre pouvait mettre intégralement à la Caisse d’Épargne les quarante francs que tu lui allouais par mois : « Elle a toutes mes vieilles robes, tous mes jupons, tous mes souliers. À quoi lui servirait l’argent ? Elle en ferait des cadeaux à sa famille… »
D’ailleurs tu les soignais avec dévouement s’ils étaient malades ; tu ne les abandonnais jamais ; et je reconnais qu’en général tu étais toujours estimée et souvent même aimée de ces gens qui méprisent les maîtres faibles. Tu professais, sur toutes ces questions, les idées de ton milieu et de ton époque. Mais tu ne t’étais jamais avoué que l’Évangile les condamne : « Tiens, disais-je, je croyais que le Christ avait dit… » Tu t’arrêtais court, déconcertée, furieuse à cause des enfants. Tu finissais toujours par tomber dans le panneau : « Il ne faut pas prendre au pied de la lettre… » balbutiais-tu. Sur quoi je triomphais aisément et t’accablais d’exemples pour te prouver que la sainteté consiste justement à suivre l’Évangile au pied de la lettre. Si tu avais le malheur de protester que tu n’étais pas une sainte, je te citais le précepte : « Soyez parfaits comme votre père céleste est parfait. »
Avoue, ma pauvre Isa, que je t’ai fait du bien à ma façon et que si aujourd’hui tu soignes les cancéreux, ils me le doivent en partie ! À cette époque, ton amour pour tes enfants t’accaparait tout entière ; ils dévoraient tes réserves de bonté, de sacrifice. Ils t’empêchaient de voir les autres hommes. Ce n’était pas seulement de moi qu’ils t’avaient détournée, mais du reste du monde. À Dieu même, tu ne pouvais plus parler que de leur santé et de leur avenir. C’était là que j’avais la partie belle. Je te demandais s’il ne fallait pas, du point de vue chrétien, souhaiter pour eux toutes les croix, la pauvreté, la maladie. Tu coupais court : « Je ne te réponds plus, tu parles de ce que tu ne connais pas… »
Читать дальше