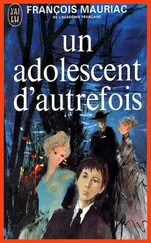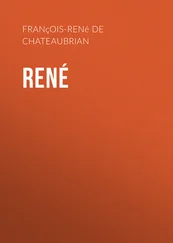Non, j’appuie sur le trait ; je me salis moi-même : j’ai aimé, peut-être ai-je été aimé… En 1919, au déclin de ma jeunesse. À quoi bon passer cette aventure sous silence ? Tu l’as connue, tu as su t’en souvenir le jour où tu m’as mis le marché en main.
J’avais sauvé cette petite institutrice à l’instruction (elle était poursuivie pour infanticide). Elle s’est d’abord donnée par gratitude ; mais ensuite… Oui, oui, j’ai connu l’amour, cette année-là ; c’est mon insatiabilité qui a tout perdu. Ce n’était pas assez de la maintenir dans la gêne, presque dans la misère ; il fallait qu’elle fût toujours à ma disposition, qu’elle ne vît personne, que je pusse la prendre, la laisser, la retrouver, au hasard de mes caprices, et durant mes rares loisirs. C’était ma chose. Mon goût de posséder, d’user, d’abuser, s’étend aux humains. Il m’aurait fallu des esclaves. Une seule fois, j’ai cru avoir trouvé cette victime, à la mesure de mon exigence. Je surveillais jusqu’à ses regards… Mais j’oubliais ma promesse de ne pas t’entretenir de ces choses. Elle est partie pour Paris, elle n’en pouvait plus.
« S’il n’y avait que nous avec qui tu ne pusses t’entendre, m’as-tu souvent répété, mais tout le monde te redoute et te fuit, Louis, tu le vois bien ! » Oui, je le voyais… Au Palais, j’ai toujours été un solitaire. Ils m’ont élu le plus tard possible au Conseil de l’Ordre. Après tous les crétins qu’ils m’ont préférés, je n’aurais pas voulu du Bâtonnat. Au fond, en ai-je jamais eu envie ? Il aurait fallu représenter, recevoir. Ce sont des honneurs qui coûtent gros ; le jeu n’en vaut pas la chandelle. Toi, tu le désirais à cause des enfants. Jamais tu n’as rien désiré pour moi-même : « Fais-le pour les enfants. »
L’année qui suivit notre mariage, ton père eut sa première attaque, et le château de Cenon nous fut fermé. Très vite, tu adoptas Calèse. De moi, tu n’as vraiment accepté que mon pays. Tu as pris racine dans ma terre sans que nos racines se puissent rejoindre. Tes enfants ont passé dans cette maison, dans ce jardin, toutes leurs vacances. Notre petite Marie y est morte ; et bien loin que cette mort t’en ait donné l’horreur, tu attaches à la chambre où elle a souffert un caractère sacré. C’est ici que tu as couvé ta couvée, que tu as soigné les maladies, que tu as veillé près des berceaux, que tu as eu maille à partir avec des nurses et des institutrices. C’est entre ces pommiers que les cordes tendues supportaient les petites robes de Marie, toutes ces candides lessives. C’est dans ce salon que l’abbé Ardouin groupait autour du piano les enfants et leur faisait chanter des chœurs qui n’étaient pas toujours des cantiques, pour éviter ma colère.
Fumant devant la maison, les soirs d’été, j’écoutais leurs voix pures, cet air de Lulli : « Ah ! que ces bois, ces rochers, ces fontaines… » Calme bonheur dont je me savais exclu, zone de pureté et de rêve qui m’était interdite. Tranquille amour, vague assoupie qui venait mourir à quelques pas de mon rocher.
J’entrais au salon, et les voix se taisaient. Toute conversation s’interrompait à mon approche. Geneviève s’éloignait avec un livre. Seule, Marie n’avait pas peur de moi ; je l’appelais et elle venait ; je la prenais de force dans mes bras, mais elle s’y blottissait volontiers. J’entendais battre son cœur d’oiseau. À peine lâchée, elle s’envolait dans le jardin… Marie !
Très tôt, les enfants s’inquiétèrent de mon absence à la messe, de ma côtelette du vendredi. Mais la lutte entre nous deux, sous leurs regards, ne connut qu’un petit nombre d’éclats terribles, où je fus le plus souvent battu. Après chaque défaite, une guerre souterraine se poursuivait. Calèse en fut le théâtre, car à la ville je n’étais jamais là. Mais les vacances du Palais coïncidant avec celles du collège, août et septembre nous réunissaient ici.
Je me rappelle ce jour où nous nous heurtâmes de front (à propos d’une plaisanterie que j’avais faite devant Geneviève qui récitait son Histoire Sainte) : je revendiquai mon droit de défendre l’esprit de mes enfants, et tu m’opposas le devoir de protéger leur âme. J’avais été battu, une première fois, en acceptant qu’Hubert fût confié aux Pères Jésuites, et les petites aux Dames du Sacré-Cœur. J’avais cédé au prestige qu’ont gardé toujours à mes yeux les traditions de la famille Fondaudège. Mais j’avais soif de revanche ; et aussi, ce qui m’importait, ce jour-là, c’était d’avoir mis le doigt sur le seul sujet qui pût te jeter hors des gonds, sur ce qui t’obligeait à sortir de ton indifférence, et qui me valait ton attention, fût-elle haineuse. J’avais enfin trouvé un lieu de rencontre. Enfin, je te forçais à en venir aux mains. Naguère, l’irréligion n’avait été pour moi qu’une forme vide où j’avais coulé mes humiliations de petit paysan enrichi, méprisé par ses camarades bourgeois ; je l’emplissais maintenant de ma déception amoureuse et d’une rancune presque infinie.
La dispute se ralluma pendant le déjeuner (je te demandai quel plaisir pouvait prendre l’Être éternel à te voir manger de la truite saumonée plutôt que du bœuf bouilli). Tu quittas la table. Je me souviens du regard de nos enfants. Je te rejoignis dans ta chambre. Tes yeux étaient secs ; tu me parlas avec le plus grand calme. Je compris, ce jour-là, que ton attention ne s’était pas détournée de ma vie autant que je l’avais cru. Tu avais mis la main sur des lettres : de quoi obtenir une séparation. « Je suis restée avec toi à cause des enfants. Mais si ta présence doit être une menace pour leur âme, je n’hésiterai pas. »
Non, tu n’aurais pas hésité à me laisser, moi et mon argent. Aussi intéressée que tu fusses, il n’était pas de sacrifice à quoi tu n’aurais consenti pour que demeurât intact, dans ces petits, le dépôt du dogme, cet ensemble d’habitudes, de formules, — cette folie.
Je ne détenais pas encore la lettre d’injures que tu m’adressas après la mort de Marie. Tu étais la plus forte. Ma position, d’ailleurs, eût été dangereusement ébranlée par un procès entre nous : à cette époque, et en province, la société ne plaisantait pas sur ce sujet. Le bruit courait déjà que j’étais franc-maçon ; mes idées me mettaient en marge du monde ; sans le prestige de ta famille, elles m’eussent fait le plus grand tort. Et surtout… en cas de séparation, il aurait fallu rendre les Suez de ta dot. Je m’étais accoutumé à considérer ces valeurs comme miennes. L’idée d’avoir à y renoncer m’était horrible (sans compter la rente que nous faisait ton père…).
Je filai doux, et souscrivis à toutes tes exigences, mais je décidai de consacrer mes loisirs à la conquête des enfants. Je pris cette résolution au début d’août 1896 ; ces tristes et ardents étés d’autrefois se confondent dans mon esprit, et les souvenirs que je te rappelle ici s’étendent environ sur cinq années (1895–1900).
Je ne croyais pas qu’il fût difficile de reprendre en main ces petits. Je comptais sur le prestige du père de famille, sur mon intelligence. Un garçon de dix ans, deux petites filles, ce ne serait qu’un jeu, pensai-je, de les attirer à moi. Je me souviens de leur étonnement et de leur inquiétude, le jour où je leur proposai de faire avec papa une grande promenade. Tu étais assise dans la cour, sous le tilleul argenté ; ils t’interrogèrent du regard.
— Mais, mes chéris, vous n’avez pas à me demander la permission.
Nous partîmes. Comment faut-il parler aux enfants ? Moi qui suis accoutumé à tenir tête au Ministère public, ou au défenseur quand je plaide pour la partie civile, à toute une salle hostile, et qu’aux assises le président redoute, les enfants m’intimident, les enfants et aussi les gens du peuple, même ces paysans dont je suis le fils. Devant eux je perds pied, je balbutie.
Читать дальше