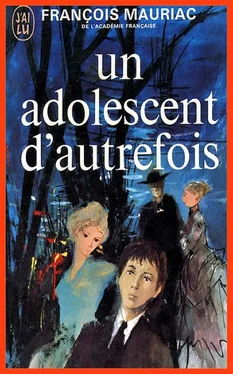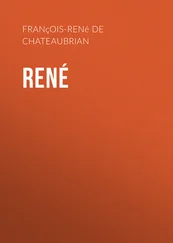— J’ai honte, lui dis-je, de vous avoir donné cette idée atroce de ma pauvre maman. L’histoire que je vous ai racontée, je vois bien ce qu’elle a d’insoutenable. Comment vous faire comprendre ce qu’est ma mère ? L’unique fois où j’ai osé moi-même lui parler de son projet touchant cette petite Séris, lui donner les raisons de ma répulsion, elle n’est entrée dans aucune, parce qu’en toute bonne foi, et si incroyable que cela vous paraîtra, elle a toujours été persuadée que ce que j’appelle l’amour physique n’existe pas pour les êtres d’une certaine race dont nous sommes elle et moi, que c’est une invention des romanciers, qu’il est un devoir exigé de la femme par Dieu pour la propagation de l’espèce, et comme remède à la bestialité des hommes ; elle ne m’a pas caché que c’est ce qui la déroute le plus dans la création. Je tombai d’accord avec elle que d’avoir si étroitement lié une âme capable de Dieu à un corps de chien, ouvrait devant l’esprit un abîme. Elle protesta avec violence que c’était une épreuve qu’un chrétien devait surmonter et d’abord en ne se laissant pas séduire par ce que racontent les livres, qui étaient toute ma vie : « … Mais tu es mon fils, ajouta-t-elle, et je te connais, et je sais bien que tu auras le même dégoût de ces choses, de cette chose… Tu ne peux pas savoir… »
À ce moment-là, je pensai à mon père, ce père que je n’avais pas connu, le plus doux et le plus tendre des hommes. Je murmurai : « Pauvre papa… » Elle dit avec rancune presque à voix basse : « Oh ! Je te jure qu’il ne m’a rien épargné. Je n’ai jamais reculé. » Je répétai : « Pauvre papa. » Après un silence, je me souviens d’avoir demandé à ma mère si elle ne se faisait pas scrupule de livrer cette misérable Jeannette à un mari tel que moi qui à coup sûr la fuirait. « Mais mon pauvre petit, heureusement pour elle ! après qu’elle t’aura donné un fils, tu lui laisseras la paix et il lui restera l’orgueil d’avoir servi à créer ce domaine qui sera le plus important du Bazadais par l’étendue, par la qualité des terres, qui lui permettra, à cette petite Séris, d’agir pour le bien sur toute une population dépendant d’elle : le seul plaisir légitime qui soit accordé en ce monde à une femme de nos familles… »
Ma pauvre mère ! Comme Marie s’étonnait que je ne lui eusse pas mis le nez dans cette idolâtrie de la terre scandaleuse chez une chrétienne aussi affichée qu’elle était :
— Oh ! De ce côté-là, elle était pourvue de raisons et le devoir d’état a bon dos. Le mal pour maman tient dans cette convoitise que précisément elle ne ressent pas et qu’elle appelle concupiscence, qui correspond chez elle à une répulsion. Elle ne conçoit pas que le péché puisse être lié à cet orgueil de posséder et de régner. A-t-elle jamais lu, enfin je veux dire médité, certaines paroles du Seigneur qui, moi, me font trembler ?… Non, ce n’est pas vrai : je ne tremble pas plus qu’elle.
Nous nous tûmes à ce moment-là.
Un peu plus tard, je murmurai : « Que dirait maman, si elle nous voyait ? »
— Est-ce que tu n’as pas froid ?
— Non, tu es chaude comme un nid.
Marie dit à voix basse : « Le premier tu qui sort des lèvres bien-aimées. » Je corrigeai : « Le premier oui… »
Encore un peu plus tard, elle rejeta mes cheveux en arrière, y posa les lèvres et ce fut mon tour de lui rappeler Verlaine : « … et qui parfois vous baise au front, comme un enfant » .
Nous demeurâmes un peu de temps sans faire d’autre geste. Tout à coup elle se redressa, prit ma tête à deux mains :
— Laisse-la ! Oui, ta mère, quitte-la, abandonne-lui tout et va vivre seul.
Je dis tristement : « Rien ne peut faire que tout ne soit à moi. »
— Tu es la propriété de tes propriétés. Tu seras le mari de Pou.
Je me blottis contre elle. Je dis après un silence : « Comment quitter maman ? Elle a été toute ma vie. Le drame pour moi, comprends-le, ce n’est pas qu’elle accapare les propriétés qui m’appartiennent, c’est qu’elle les préfère à moi. »
— C’est qu’elle te trompe avec elles !
— C’est si vrai que peut-être avec ton aide je finirai par lui échapper.
— Que puis-je pour toi, mon pauvre petit ? Te rendre plus conscient, donc plus malheureux, mais non t’insuffler la volonté que tu n’as pas…
Je lui protestai qu’elle m’avait changé pourtant plus que je n’eusse pu seulement l’imaginer il y a quelques semaines, que maintenant, je concevais que le bonheur serait d’échapper à ma mère, mais que je ne voyais pas comment je pourrais me passer d’elle, incapable de m’occuper du domaine. Certes j’y tenais, je n’en rougissais pas, plus que tout au monde. Maltaverne était tout ce que j’aimais. En revanche, les terres de Numa Séris ne représentaient rien à mes yeux. Pourtant le Pou me faisait peur. J’avais toute ma vie entendu ma mère se glorifier d’avoir toujours atteint ses buts. Quand elle avait envie d’une pièce de pins, elle attendait parfois des années mais finissait par l’obtenir. La moindre parcelle à vendre, le notaire l’en avertissait, ou Numa Séris. Ils étaient à deux de jeu, l’un s’effaçant devant l’autre à tour de rôle. Je me trouvais être la carte maîtresse de leur suprême combinaison — celle à laquelle, depuis la mort de Laurent, ma mère tenait avec une passion qu’elle ne dissimulait plus, mais qui éclatait parfois si violemment qu’il ne paraissait pas de l’ordre du possible que j’y échappe jamais.
Marie me demanda l’âge du Pou et se rassura quand elle sut qu’elle n’avait que douze ans.
— Mais mon pauvre petit, tu as au moins sept ou huit ans pour parer le coup, et d’abord en te mariant. Le Pou ne vaudrait même pas que tu arrêtes sur lui une seule pensée si tu n’étais à la fois le fils de ta mère et celui de cette terre, Maltaverne : elles te tiennent toutes les deux.
— Oui, mais maintenant, tu es là.
Elle s’écarta un peu et chantonna « Il faut nous séparer. C’est l’heure du sommeil », et m’ouvrit la porte de la rue.
Je marchais à grands pas au milieu de la chaussée déserte.
Cette joie, cette force en moi, ma mère en devenait la victime. Il y avait eu à son égard comme un retard de mes sentiments sur le jugement que j’avais prononcé contre elle. Voici que ce soir tout concordait : la répulsion que Marie n’avait pu se défendre de manifester, je l’éprouvais, moi aussi, et en plus, tandis que mon pas retentissait dans notre vieil escalier solennel, une rancune démesurée à cause de cet abandon où maman me laissait : le crime de ne pas me préférer à tout…
Mais c’était pire encore. Elle me préférait infiniment le bonheur de régner, vieille régente, sur le royaume de son fils — et ce fils, elle l’immolait d’avance, elle l’avait déjà immolé en pensée, en l’accouplant au Pou, sans excuse, sans même l’excuse d’ignorer ce qu’est l’amour des corps. Elle avait vu souffrir mon père. Mon père ! Père ! Inconnu bien-aimé. Je me souviens, j’avais dix ou douze ans, un soir, au retour du collège, l’idée me vint, me posséda que tu n’étais pas mort. Je ne sais plus quelle histoire j’inventai, que tu étais revenu d’un long voyage, que j’allais te retrouver à la maison. Je courus comme un fou, bousculant les passants. Je montai quatre à quatre ce même escalier que j’étais en train de gravir. Sous la lampe chinoise, maman faisait réciter le catéchisme à Laurent. En face d’elle le fauteuil du pauvre papa était vide. Père, il ne restait de toi accrochée au-dessus du lit de maman que ta photographie agrandie par Nadar…
Читать дальше