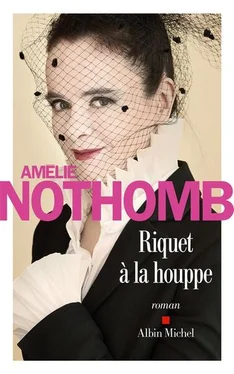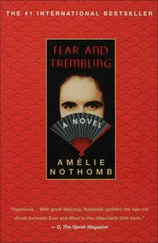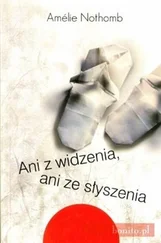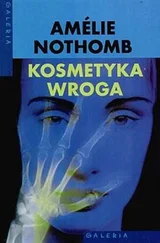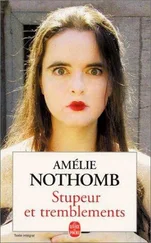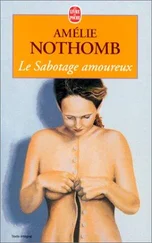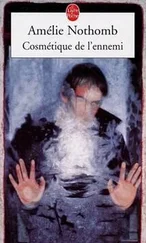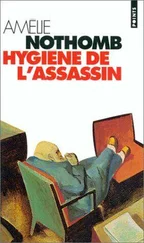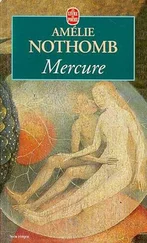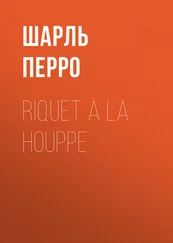Ce surnom lui allait d’autant mieux que, comme le personnage de Perrault, il plaisait à tous, et particulièrement aux femmes. Avec le temps, il cessa d’accepter leurs si nombreuses avances et devint même très inaccessible, ce qui ne fit que renforcer sa réputation.
Quand il eut vingt-trois ans, le médecin qui le suivait décréta qu’il pouvait désormais se passer du corset qu’il portait depuis huit années :
— Le mal est stabilisé, dit le docteur en l’observant.
— Je suis guéri, traduisit Déodat.
— On ne guérit pas d’une cyphose. Mais votre adolescence s’est terminée sans que le mal empire. C’est un succès.
Le jeune homme ne parvint pas à se réjouir d’un tel constat.
— Ne tirez pas cette tête. Vous allez pouvoir vivre sans corset. N’est-ce pas une bonne nouvelle ?
— Je sens arriver une clause qui me plaira moins.
— Vous allez devoir faire cinq heures de kinésithérapie par semaine.
— Nous y voilà.
— Il faut vous muscler le dos, conclut le médecin en inscrivant le nom et les coordonnées d’un kiné sur l’ordonnance.
En sortant du cabinet, Déodat ressentit un vertige à marcher dans la rue sans cette camisole de force qui le rigidifiait. Au bout de deux heures, il dut convenir que quelque chose clochait : il était épuisé de devoir compenser par ses pauvres muscles l’absence de l’armure qu’il commençait à regretter. La position assise ne le reposait même pas.
Il prit rendez-vous chez le kiné. Une secrétaire lui répondit que le docteur Leyde le recevrait le lendemain à dix-sept heures.
Le docteur Leyde était une Hollandaise d’une trentaine d’années, au beau visage sérieux, juché sur un long corps de sportive.
Elle examina le dos du patient. Il frémit au contact des grandes mains pleines de science.
Elle se posta avec lui sur un tatami, face à un immense miroir.
— Je vais vous apprendre les exercices. Faites comme moi.
Face au miroir géant, Déodat exécuta les mêmes mouvements que le docteur Leyde. La comparaison entre leurs deux corps était humiliante pour lui ; il en eût conçu de la honte s’il n’était pas tombé presque aussitôt amoureux de l’imperturbable kinésithérapeute.
Après une cinquantaine de minutes d’exercices, elle lui ordonna de s’allonger sur une couche de cuir molletonné et elle lui massa le dos. Il en éprouva un plaisir tétanisant.
— J’aurais voulu que vous n’arrêtiez jamais, dit-il quand elle le fit se relever puis s’asseoir devant son bureau.
Sans sourciller, elle prit des notes dans un carnet.
— Vous ne devriez pas vous appeler Leyde, dit-il encore.
— On prononce Leÿde, répondit-elle, en femme habituée à de telles réflexions.
Elle lui fixa rendez-vous chaque jour de la semaine à dix-sept heures pour une heure. Lui qui avait envisagé cela comme une épreuve regretta qu’il n’y eût pas plus de rendez-vous.
— Ça ne suffira pas, déclara-t-il.
— En effet. C’est pourquoi vous ferez vingt minutes d’exercices chez vous, chaque jour. Ceux que je vous ai enseignés en début de séance.
Ce n’était pas là la réponse qu’il espérait. Dans la rue, il regarda l’enseigne. Sur la plaque de métal, il était inscrit : « S. Leyde — kinésithérapeute ».
Le lendemain, vêtu comme elle d’un jean stretch et d’un tee-shirt, il lui dit pendant l’échauffement :
— Cent pour cent des femmes qui ont compté pour moi avaient un prénom commençant par un S.
Elle n’eut aucune réaction. Il se sentit lourd mais poursuivit :
— Et se terminant par A.
— Gardez les pieds parallèles.
— Comment vous appelez-vous ?
— Saskia.
Il en fut estomaqué.
— Que c’est beau ! Je n’ai jamais entendu ce prénom.
— La femme de Rembrandt s’appelait Saskia.
Cette nouvelle le plongea dans l’émerveillement. Pour qui aime, découvrir que l’aimée porte un prénom admirable équivaut à un adoubement. On ne cristallise pas de la même façon selon que l’élue s’appelle Saskia ou Samantha.
— S’il vous plaît, concentrez-vous. Rappelez-vous que vous devrez reproduire ces exercices chez vous.
Il raffolait de la manière douce et neutre avec laquelle elle donnait ses instructions. Elle n’était jamais autoritaire, en femme habituée à être écoutée. Et comment n’aurait-on pas voulu écouter sans cesse cette voix grave et ce curieux accent ?
— Il faut regarder mon corps et non mon visage, dit-elle encore.
Il s’y efforça. Certes, elle avait un corps svelte et gracieux, mais c’était surtout son visage qui l’aimantait. Très brune de peau et de cheveux, une coupe courte avec une frange, coiffure qu’il n’aimait guère mais qui lui allait très bien, des yeux verts aux grandes paupières, des traits immobiles, une expression sérieuse et douce en permanence, une attention aiguë portée au corps du patient, au détriment de ce qu’il disait.
Le massage était un moment de pur bonheur : elle le touchait, le brassait, le malaxait et il pouvait lui parler librement.
— Pourquoi vivez-vous en France ?
— J’ai épousé un Français.
— Depuis combien de temps êtes-vous à Paris ?
— Huit ans.
Il avait honte de lui poser des questions aussi banales.
— Ma maladie est-elle fréquente ?
— De plus en plus rare.
— Combien de temps vais-je devoir avoir besoin de vos services ?
— Deux années.
— Seulement ?
— C’est beaucoup, deux ans.
— Ça ne me suffira pas.
— Vous ferez vingt minutes d’exercices chez vous tous les jours de votre vie.
La séance se poursuivit en silence. « Deux années. J’ai deux années pour la rendre amoureuse de moi », pensa-t-il.
Il n’avait jamais dû conquérir l’amour d’une femme. Les filles avaient toujours pris l’initiative depuis ses quinze ans. Pour la première fois de sa vie, la proie devait endosser le rôle du prédateur.
Déodat n’aima pas cette prédation. Il aurait voulu s’inspirer de la parade nuptiale de l’oiseau jardinier qui créait un véritable parc floral miniature pour séduire l’oiselle. Il se contentait de passer chez le fleuriste avant chaque rendez-vous et d’acheter la fleur qui exprimait le mieux son sentiment du jour. Saskia remerciait poliment, mettait le cadeau dans un vase et commençait la séance.
— Cela ne vous fatigue pas, d’exécuter toujours les mêmes exercices avec moi ?
— C’est mon métier. Non, ça ne me fatigue pas.
Son égalité d’humeur le déconcertait. Les seuls moments où il pouvait discuter avec elle étaient ceux des massages. Cela le désolait, car il aurait préféré profiter en silence du plaisir qu’elle lui donnait. Mais il fallait bien qu’il parvienne à l’intéresser.
— Je suis ornithologue, annonça-t-il au bout de quelques séances.
Il avait l’habitude que cette déclaration produise son effet. Saskia se contenta de répondre :
— C’est un beau métier.
Rebondir là-dessus ne fut pas facile.
— Vous au moins, vous ne me demandez pas à quoi cela sert. C’est une question qui me hérisse. Nous vivons dans une société où il faut que les choses servent. Or, le verbe servir a pour étymologie être l’esclave de. Et s’il y a bien un animal qui incarne l’idée de liberté, c’est l’oiseau. On croit habituellement qu’un ornithologue travaille à la protection de l’espèce aviaire : ce n’est qu’une partie de son travail. Pour moi, l’ornithologie consiste aussi à suggérer à l’homme d’autres pistes. Saint François d’Assise est à ce titre un ornithologue selon mon cœur, lui qui proposait à l’homme l’insouciance des oiseaux. Le problème est qu’il n’y connaissait pas grand-chose, car en vérité la liberté des oiseaux ne repose sur aucune insouciance. Ce que l’oiseau nous apprend, c’est que l’on peut être libre pour de bon, mais que c’est difficile et anxiogène. Ce n’est pas pour rien que cette espèce est toujours sur le qui-vive : la liberté, c’est angoissant. Contrairement à nous, l’oiseau accepte l’angoisse.
Читать дальше