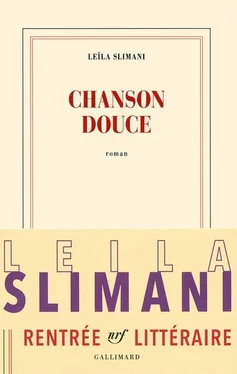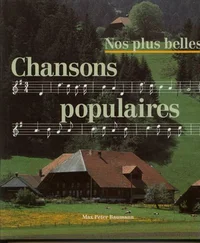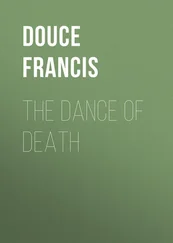Dans la voiture, alors qu’il s’apprête à démarrer, Paul enlève la montre qu’il porte au poignet gauche.
« Tu peux la ranger dans ton sac, s’il te plaît ? » demande-t-il à Myriam.
Il s’est payé cette montre il y a deux mois, grâce au contrat signé avec son chanteur célèbre. C’est une Rolex d’occasion qu’un ami lui a obtenue pour une somme très raisonnable. Paul a beaucoup hésité avant de se l’offrir. Il en avait très envie, il la trouvait parfaite mais il avait un peu honte de ce fétichisme, de ce désir futile. La première fois qu’il l’a portée, elle lui a semblé à la fois magnifique et énorme. Il la trouvait lourde, clinquante. Il n’arrêtait pas de tirer sur la manche de sa veste pour la cacher. Mais très vite, il s’est habitué à ce poids au bout de son bras gauche. Au fond, ce bijou, l’unique qu’il ait jamais possédé, était plutôt discret. Et puis, il avait bien le droit de se faire plaisir. Il ne l’avait volé à personne.
« Pourquoi tu enlèves ta montre ? lui demande Myriam, qui sait combien il y tient. Elle ne marche plus ?
— Si, elle marche très bien. Mais tu connais ma mère. Elle ne comprendrait pas. Et je n’ai pas envie de passer la soirée à m’engueuler pour ça. »
Ils arrivent en début de soirée dans la maison glaciale, dont la moitié des pièces sont encore en travaux. Le plafond de la cuisine menace de s’écrouler et dans la salle de bains des fils électriques pendent à nu. Myriam déteste cet endroit. Elle a peur pour ses enfants. Elle les suit dans chaque recoin de la maison, les yeux paniqués, les mains en avant, prête à les retenir dans leur chute. Elle rôde. Elle interrompt les jeux. « Mila, viens mettre un autre pull. » « Adam respire mal, vous ne trouvez pas ? »
Un matin, elle se réveille transie. Elle souffle sur les mains glacées d’Adam. Elle s’inquiète de la pâleur de Mila et lui impose de garder son bonnet à l’intérieur. Sylvie préfère se taire. Elle voudrait rendre aux enfants la sauvagerie et la fantaisie qui leur sont interdites. Pas de règles avec elle. Elle ne les couvre pas de cadeaux frivoles, comme les parents qui essaient de compenser leurs absences. Elle ne fait pas attention aux mots qu’elle prononce et sans cesse elle s’attire les réprimandes de Paul et de Myriam.
Pour faire râler sa belle-fille, elle les appelle « mes petits oiseaux tombés du nid ». Elle aime les plaindre de vivre en ville, de subir l’incivilité et la pollution. Elle voudrait élargir l’horizon de ces enfants voués à devenir des gens corrects, à la fois serviles et autoritaires. Des froussards.
Sylvie prend sur elle. Elle se retient, autant qu’elle le peut, d’aborder le sujet de l’éducation des enfants. Quelques mois auparavant, une violente dispute a opposé les deux femmes. Le genre de disputes que le temps ne suffit pas à faire oublier et dont les mots, très longtemps après, continuent de résonner en elles chaque fois qu’elles se voient. Tout le monde avait bu. Beaucoup trop. Myriam, sentimentale, a cherché en Sylvie une oreille compatissante. Elle s’est plainte de ne jamais voir ses enfants, de souffrir de cette existence effrénée où personne ne lui faisait de cadeau. Mais Sylvie ne l’a pas consolée. Elle n’a pas posé sa main sur l’épaule de Myriam. Au contraire, elle s’est lancée dans une attaque en règle contre sa belle-fille. Ses armes, apparemment, étaient bien affûtées, prêtes à être utilisées quand l’occasion se présenterait. Sylvie lui a reproché de consacrer trop de temps à son métier, elle qui pourtant a travaillé pendant toute l’enfance de Paul et s’est toujours vantée de son indépendance. Elle l’a traitée d’irresponsable, d’égoïste. Elle a compté sur ses doigts le nombre de voyages professionnels que Myriam avait faits alors même qu’Adam était malade et que Paul terminait l’enregistrement d’un album. C’était sa faute, disait-elle, si ses enfants étaient insupportables, tyranniques, capricieux. Sa faute et celle de Louise, cette nounou de pacotille, cet ersatz de mère sur qui Myriam se reposait par complaisance, par lâcheté. Myriam s’était mise à pleurer. Paul, stupéfait, ne disait rien et Sylvie levait les bras en répétant : « Et elle pleure maintenant ! Regardez-la. Elle pleure et il faudrait la plaindre parce qu’elle n’est pas capable d’entendre la vérité. »
Chaque fois que Myriam voit Sylvie, le souvenir de cette soirée l’oppresse. Elle a eu la sensation, ce soir-là, d’être assaillie, jetée à terre et criblée de coups de poignard. Myriam gisait, les tripes découvertes, devant son mari. Elle n’a pas eu la force de se défendre contre des accusations qu’elle savait en partie vraies mais qu’elle considérait comme son lot et celui de beaucoup d’autres femmes. Pas un instant il n’y a eu de place pour l’indulgence ni pour la tendresse. Pas un seul conseil n’a été prodigué de mère à mère, de femme à femme.
Pendant le petit déjeuner, Myriam a le regard rivé sur son téléphone. Elle essaie désespérément de consulter ses mails mais le réseau est trop lent et elle est furieuse au point qu’elle pourrait jeter son portable contre le mur. Hystérique, elle menace Paul de rentrer à Paris. Sylvie soulève les sourcils, visiblement excédée. Elle rêvait pour son fils d’un autre genre de femme, plus douce, plus sportive, plus fantasque. Une fille qui aurait aimé la nature, les promenades en montagne et qui ne se serait pas plainte de l’inconfort de cette charmante maison.
Pendant longtemps, Sylvie a radoté, racontant toujours les mêmes histoires sur sa jeunesse, ses engagements passés, ses compagnons révolutionnaires. Avec l’âge, elle a appris à se tempérer. Elle a surtout compris que tout le monde se fiche de ses théories fumeuses sur ce monde de vendus, ce monde d’idiots finis nourris aux écrans et à la viande d’abattage. Elle, à leur âge, ne rêvait que de faire la révolution. « Nous étions un peu naïfs, quand même », avance Dominique, son mari, qui s’attriste de la voir malheureuse. « Naïfs peut-être mais on était moins cons. » Elle sait que son mari ne comprend rien aux idéaux qu’elle nourrit et que tous tournent en dérision. Il l’écoute gentiment confier ses déceptions et ses angoisses. Elle se lamente de voir ce que son fils est devenu — « C’était un petit garçon si libre, tu te souviens ? » —, un homme vivant sous le joug de sa femme, esclave de son appétit d’argent et de sa vanité. Elle a cru, longtemps, à une révolution menée par les deux sexes et dont serait né un monde bien différent de celui dans lequel grandissent ses petits-enfants. Un monde où l’on aurait eu le temps de vivre. « Ma chérie, tu es naïve. Les femmes, lui dit Dominique, sont des capitalistes comme les autres. »
Myriam fait les cent pas dans la cuisine, cramponnée à son téléphone. Dominique, pour détendre l’atmosphère, propose d’aller en promenade. Myriam, radoucie, couvre ses enfants de trois couches de pulls, d’écharpes et de gants. Une fois dehors, les pieds dans la neige, les petits courent, émerveillés. Sylvie a apporté deux vieilles luges, qui ont appartenu à Paul et à son frère Patrick quand ils étaient enfants. Myriam fait un effort pour ne pas s’inquiéter et elle regarde, le souffle coupé, les petits dévaler une pente.
« Ils vont se briser le cou », pense-t-elle, et elle en pleurerait. « Louise, elle, me comprendrait », ne cesse-t-elle de se répéter.
Paul s’enthousiasme, il encourage Mila qui lui fait de grands signes et qui dit : « Regarde, papa. Regarde comme je sais faire de la luge ! » Ils déjeunent dans une auberge charmante, où crépite un feu dans la cheminée. Ils s’installent à l’écart, contre une vitre à travers laquelle un soleil éclatant vient lécher les joues roses des enfants. Mila est volubile et les adultes rient des pitreries de la petite fille. Adam, pour une fois, mange avec grand appétit.
Читать дальше