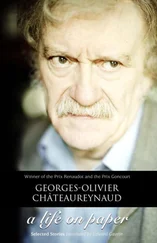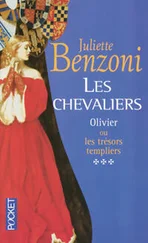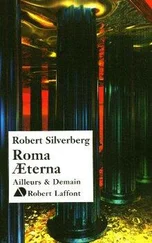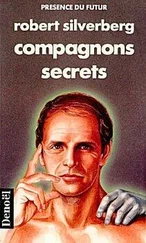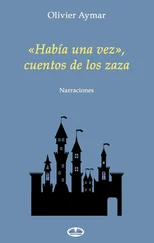— Si tu ne sais pas lire l’heure, tu vas carrément rater tout le train ! avait-elle dit pour faire rire les autres enfants sur mon dos.
Elle avait encore convoqué ma mère pour lui parler de mes problèmes de transport en oubliant totalement de lui parler de la pointure de ses chaussures. Alors ma mère, qui avait aussi des problèmes d’horloge, s’était énervée et lui avait rétorqué :
— Mon fils sait déjà lire l’heure sur la montre de son père, c’est bien suffisant ! A-t-on déjà vu des agriculteurs apprendre à labourer avec un cheval de trait après l’invention du tracteur, ça se saurait !
C’était une réponse de bon sens mais, a priori, pour la maîtresse, ça n’allait pas dans la bonne direction. Elle répondit à ma mère en hurlant qu’on était une famille de cinglés, qu’elle n’avait jamais vu ça, et qu’à l’avenir elle me laisserait comme ça, au fond de la classe sans plus s’occuper de moi.
« Le midi même, quelques secondes après la sonnerie, tandis que le tic-tac de papier exigeait d’être déchiffré, les yeux tournés vers la fenêtre, de ses yeux ébahis, notre fils vit, soulagé, laissant le préau embrumé par les fumées dispersées de sa locomotive, s’évanouir à allure vive, le petit train de l’autre vie. »
Après m’avoir retiré de l’école, mes parents me disaient souvent qu’ils m’avaient offert une belle retraite anticipée.
— Tu es certainement le retraité le plus jeune du monde ! disait mon père avec ce rire d’enfant qu’ont parfois les grands, du moins mes parents.
Ils avaient l’air enchanté de m’avoir toujours à leurs côtés, et moi je n’étais plus angoissé à cause de ces wagons qui passaient et de ces trains toujours ratés. J’avais quitté sans regret ma classe, mon institutrice à la coiffure tourmentée et son faux cancer de la manche. Afin de m’instruire, mes parents ne manquaient pas d’idées. Pour les mathématiques, ils me déguisaient avec des bracelets, des colliers, des bagues, qu’ils me faisaient compter pour les additions, et après ils me faisaient tout enlever jusqu’au caleçon pour les soustractions. Ils appelaient cela « le chiffre-tease », c’était d’un tordant. Pour les problèmes, Papa me mettait en situation, disait-il. Il remplissait la baignoire, enlevait des litres, avec une bouteille, une demi-bouteille et me posait une foultitude de questions techniques. À chaque mauvaise réponse il me vidait la bouteille sur la tête. C’était souvent une grande fête aquatique ces cours de mathématiques. Ils avaient inventé un répertoire de chansons pour la conjugaison, avec une gestuelle pour les pronoms personnels, et j’apprenais ma leçon sur le bout des doigts, en dansant de bon cœur la chorégraphie du passé composé. Le soir, j’allais leur lire les histoires qu’on avait inventées et couchées sur papier dans la journée ou faire les résumés des histoires déjà écrites par les grands classiques.
L’avantage avec ma retraite anticipée, c’est qu’on pouvait partir en Espagne sans attendre tout le monde, et parfois ça nous prenait comme une envie de faire pipi, en quand même un peu plus long à préparer. Le matin, Papa disait :
— Henriette, faisons les valises, ce soir je veux prendre l’apéritif sur le lac !
Alors on jetait des milliards de choses dans les valises, ça volait dans tous les sens. Papa hurlait :
— Pauline, où sont mes espadrilles ?
Et Maman répondait :
— À la poubelle, Georges ! C’est encore là qu’elles vous vont le mieux !
Et Maman lui lançait :
— Georges, n’oubliez pas votre bêtise, on en a toujours besoin !
Et mon père répondait :
— Ne vous en faites pas, Hortense, j’ai toujours un double sur moi !
On oubliait toujours des trucs, mais on était souvent pliés en quatre pour faire nos bagages, en deux temps trois mouvements.
Là-bas, c’était vraiment très différent, la montagne aussi était pliée en quatre. Avec la neige de l’hiver, en névés au sommet ; le roux et le marron de l’automne en dessous, sur les terres sèches et les rochers ; les couleurs fruitières du printemps sur les terrasses ; et la chaleur, les senteurs de l’été, étouffées près du lac dans la vallée. Papa disait qu’avec une montagne comme celle-là, je pouvais dévaler toute une année en moins d’une journée. Comme nous partions quand ça nous chantait, nous allions souvent chanter quand les amandiers étaient en fleurs et nous partions quand celles des orangers finissaient de tomber. Entre-temps on faisait des tours de lac, des bronzettes sans gras sur nos serviettes, des barbecues géants, on recevait des gens qui buvaient des apéritifs avec mes parents. Le matin, avec le reste des verres, je me faisais des salades de fruits qui débordaient du saladier. Les invités s’exclamaient que c’était vraiment la fiesta tout le temps, et Papa répondait que la vie c’était bon comme ça.
Pendant ses grandes vacances parlementaires, l’Ordure venait nous rendre visite, il disait que les sénateurs c’était comme les enfants, ils avaient besoin d’énormément de repos. Pour montrer qu’il était en vacances, il mettait un beau chapeau de paille et restait toute la journée torse nu, ce qui était impressionnant compte tenu de la taille de son ventre très dodu et de tous les poils dessus. Il restait assis à longueur de temps sur la terrasse à regarder la vue, à manger, à boire des fruits. Le soir venu, il criait le nom de sa petite amie et ça résonnait dans toute la vallée : « Caïpirowska aa aaaa aa ! » Il prétendait que sa vie serait pleinement réussie quand il arriverait à faire tenir une assiette et des couverts sur son ventre, alors il mangeait et buvait tout le temps, il se donnait vraiment tous les moyens de réussir sa vie. Au début du séjour, avec le soleil, il devenait beaucoup plus rouge que d’habitude, Papa disait que « ça dépassait l’entendement », qui devait être, selon moi, un rouge très puissant, difficile à dépasser sur le nuancier, et puis au fil de ses grandes vacances parlementaires le sénateur devenait complètement marron. Quand il roupillait, j’adorais regarder son ventre suer, il y avait toujours de minuscules rivières qui coulaient entre ses poils pour finir dans son nombril. Avec l’Ordure on se tapait de bonnes « bavettes ». Il avait inventé ce jeu spécialement pour moi. Je m’installais en face de lui, on ouvrait grand notre bouche et on devait s’y envoyer des olives aux anchois ou des amandes salées. Il fallait viser juste parce que l’anchois dans les yeux ça pique, et le sel aussi. Comme ça durait longtemps on finissait toujours par baver énormément.
Quand Papa écrivait, l’Ordure nous accompagnait dans la montagne, Maman et moi. Ça commençait toujours pareil, il marchait loin devant, en disant qu’il avait l’habitude avec ses souvenirs de l’armée, mais nous le rattrapions quand ses souvenirs s’éloignaient et puis nous le laissions derrière quand il n’avait plus de souvenir du tout et qu’il coulait de partout. Alors on le laissait sur un rocher, et nous allions manger des asperges sauvages, des figues de barbarie, cueillir du thym, du romarin, des pignons de pin et on le récupérait plus tard en descendant, quand il avait complètement séché. Il lui arrivait d’être sérieux, par exemple lorsqu’il me donnait des conseils pour ma vie future. Il y en a un qui m’avait beaucoup marqué car « frappé au coin du bon sens », disait-il pour en souligner la logique et l’importance.
— Mon petit, dans la vie, il y a deux catégories de personnes qu’il faut éviter à tout prix. Les végétariens et les cyclistes professionnels. Les premiers, parce qu’un homme qui refuse de manger une entrecôte a certainement dû être cannibale dans une autre vie. Et les seconds, parce qu’un homme chapeauté d’un suppositoire qui moule grossièrement ses bourses dans un collant fluorescent pour gravir une côte à bicyclette n’a certainement plus toute sa tête. Alors, si un jour tu croises un cycliste végétarien, un conseil mon bonhomme, pousse-le très fort pour gagner du temps et cours très vite et très longtemps !
Читать дальше