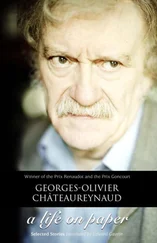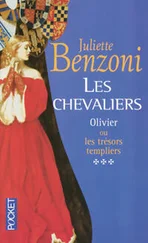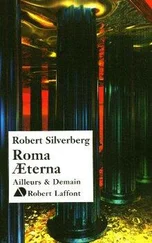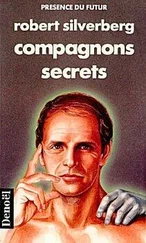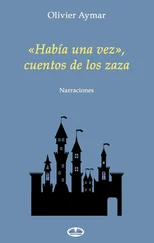Maman me racontait souvent l’histoire de Mister Bojangles. Son histoire était comme sa musique : belle, dansante et mélancolique. C’est pour ça que mes parents aimaient les slows avec Monsieur Bojangles, c’était une musique pour les sentiments. Il vivait à la Nouvelle-Orléans, même si c’était il y a longtemps, dans le vieux temps, il n’y avait rien de nouveau là-dedans. Au début, il voyageait avec son chien et ses vieux vêtements, dans le sud d’un autre continent. Puis son chien était mort, et plus rien n’avait été comme avant. Alors il allait danser dans les bars, toujours avec ses vieux vêtements. Il dansait Monsieur Bojangles, il dansait vraiment tout le temps, comme mes parents. Pour qu’il danse, les gens lui payaient des bières, alors il dansait dans son pantalon trop grand, il sautait très haut et retombait tout doucement. Maman me disait qu’il dansait pour faire revenir son chien, elle le savait de source sûre. Et elle, elle dansait pour faire revenir Monsieur Bojangles. C’est pour ça qu’elle dansait tout le temps. Pour qu’il revienne, tout simplement.
— Donnez-moi le prénom qui vous chante ! Mais je vous en prie, amusez-moi, faites-moi rire, ici les gens sont tous parfumés à l’ennui ! avait-elle affirmé en s’emparant de deux coupes de champagne sur le buffet.
— Si je suis ici, c’est pour trouver mon assurance-vie ! avait-elle proclamé avant de vider d’un trait la première coupe, ses yeux, légèrement déments, plongés dans les miens.
Et tandis que je tendais naïvement la main pour recevoir le verre que je croyais m’être destiné, elle le siffla cul sec, puis me toisant du regard en se caressant le menton, elle m’affirma avec une insolence rieuse :
— Vous êtes assurément le plus beau contrat de ce sinistre gala !
La raison aurait dû m’inciter à fuir, à la fuir. D’ailleurs, je n’aurais jamais dû la rencontrer.
Pour fêter l’ouverture de mon dixième garage, mon banquier m’avait invité dans un palace de la Côte d’Azur pour un pince-fesses de deux jours étrangement nommé « les week-ends de la réussite ». Une sorte de séminaire pour jeunes entrepreneurs pleins d’avenir. À l’intitulé absurde s’ajoutait une assemblée lugubre et toutes sortes de colloques dispensés par de savants cloportes aux visages chiffonnés par le savoir et les données. Comme souvent depuis mon enfance, j’avais tué le temps en m’inventant des vies auprès de mes condisciples et de leurs épouses. Ainsi, la veille, au dîner, j’avais embrayé dès l’entrée sur ma filiation avec un prince hongrois, dont un lointain aïeul avait fréquenté le comte de Dracula :
— Contrairement à ce que l’on veut nous faire croire, cet homme était d’une courtoisie et d’une délicatesse rares ! J’ai chez moi des documents qui attestent que le malheureux a essuyé une campagne de calomnie sans égale, guidée par une crasse et basse jalousie.
Comme toujours en pareil cas, il faut ignorer les regards dubitatifs et se concentrer sur les plus crédules de la tablée. Une fois le regard du plus naïf capté, il faut l’abreuver de détails d’une précision méticuleuse afin de lui arracher un commentaire qui valide la fable. Ce soir-là, ce fut l’épouse d’un viticulteur bordelais qui opina du chef en déclarant :
— J’en étais sûre, cette histoire est trop grosse, trop monstrueuse pour être vraie ! C’est une fable !
Elle fut suivie par son mari qui entraîna le reste de la table, et la suite du dîner tourna autour de ce sujet. Chacun y allait de son expertise, de ses doutes qu’il avait toujours eus, les uns et les autres se persuadaient entre eux, construisant un scénario autour de mon mensonge, et au terme du repas, personne n’aurait osé reconnaître qu’il avait crû une seule seconde à l’histoire, pourtant vraie, de Dracula le Comte du pal. Le lendemain midi, grisé par mon succès de la veille, j’avais récidivé avec de nouveaux cobayes. J’étais cette fois-ci le fils d’un riche industriel américain qui détenait des usines de construction automobile à Détroit et dont l’enfance s’était déroulée dans le vacarme industriel des ateliers. J’avais corsé l’affaire en m’affublant d’un autisme profond qui m’avait fait rester muet jusqu’à l’âge de sept ans. Gagner les cœurs par un exercice de mythomanie qui touche la sensibilité de ses victimes est vraiment ce qu’il y a de plus aisé.
— Mais quel fut votre premier mot ?! s’exclama ma voisine, devant son filet de sole intact et froid.
— Pneu ! lui répondis-je avec sérieux.
— Pneu ?! répétèrent de concert mes compagnons de table.
— Oui, pneu, dis-je une nouvelle fois, c’est incroyable, non ?
— Ahhhh, mais c’est pourquoi vous avez monté des garages, tout s’explique, c’est fou tout de même le destin ! avait enchaîné ma voisine au moment où son assiette repartait en cuisine aussi pleine qu’à son arrivée.
Le reste du déjeuner fut consacré aux miracles de la vie, à la destinée de chacun, au poids de l’héritage sur l’existence de tous et j’avais savouré, avec mon cognac aux amandes, ce plaisir fou et égoïste de monopoliser, l’espace d’un instant, l’attention des gens avec des histoires aussi solides qu’un coup de vent.
J’allais prendre congé de cette belle assemblée — avant que mes folles histoires ne se télescopassent sur le mur des confrontations, autour de la piscine, où devaient se retrouver tous les invités — lorsqu’une jeune femme, la tête emplumée, en robe blanche et légère, tenant à l’extrémité de son bras ganté, le coude levé et la main inclinée, une fine et longue cigarette non allumée, se mit à danser les yeux fermés. Alors que l’autre main jouait avec un châle en lin blanc dans une frénésie de mouvements qui le transformait en partenaire de danse vivant, j’étais resté fasciné, par l’ondulation de son corps, les mouvements cadencés de sa tête remuant les plumes de sa coiffe, ce drôle de toupet qui virevoltait silencieusement. Alternant au gré des rythmes entre la grâce d’un cygne et la vivacité d’un rapace, ce spectacle m’avait laissé bouche bée et pétrifié sur place.
J’avais pensé que c’était une animation payée par la banque pour distraire les invités, une manière d’égayer un cocktail d’une banalité mortelle, distraire au mieux des gens très ennuyeux. J’avais observé ce mélange de cocotte des années folles et de Cheyenne sous l’influence du peyotl déambuler en sautillant de groupe en groupe, faire rosir les hommes de plaisir par ses poses suggestives et déranger les femmes pour les mêmes raisons. Elle s’emparait des bras des maris sans leur demander leur avis, les faisait tourner comme des toupies avant de les renvoyer vers leurs épouses aigries de jalousie, retrouver leurs tristes vies. Je ne sais pas exactement combien de temps j’étais resté là, sous la tonnelle, tirant sur ma pipe et m’emparant de chaque verre que le ballet des serveurs en livrées mettait à ma portée. J’étais déjà passablement ébrieux, lorsqu’elle vint poser son regard dans mes yeux timides et probablement vitreux. Les siens étaient vert céladon, suffisamment ouverts pour avaler toute mon originalité et me faire balbutier une suite de mots d’une tragique banalité :
— Comment vous appelez-vous ?…
— J’ai chez moi une toile représentant un beau cavalier prussien accrochée au-dessus de ma cheminée, figurez-vous que vous êtes coiffé comme lui ! J’ai rencontré la terre entière et je peux assurer que plus personne ne se coiffe comme ça depuis la guerre ! Comment faites-vous pour vous faire couper les cheveux depuis que la Prusse a disparu ?
Читать дальше