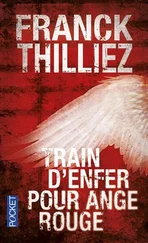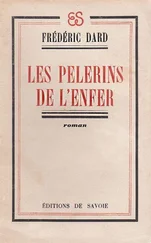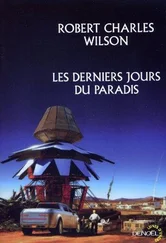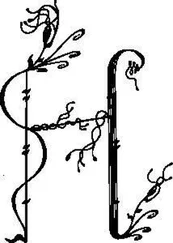Sa hauteur ne l’empêchait nullement de donner, de temps à autre, des coups bas aux nains qui l’entouraient.
«Pas Œdipe, mais Sisyphe.
– C’est qui cet Œdipe? demanda Tatiana, avide de savoir.
– Celui qui a sauté sa maman», lui expliqua la savante Margot.
Tatiana s’écarta prudemment de moi.
Je protestai avec vigueur:
«Je ne gaspille pas. À vrai dire, ce ne sont pas deux filles, mais une seule et unique, c’est ma divinité estivale bicéphale.»
À ce moment-là, mon porte-clefs, posé discrètement sur une table de «Chez Napo», commença à sonner. J’expliquai à mes auditeurs surpris que mes fiancées et moi devions les quitter pour quelques minutes.
Après avoir transporté nos bagages dans la maisonnette de mon père et nous être changés, nous retournâmes dans la cour de la paillote, où les curieux m’obligèrent à expliquer non seulement le rôle salvateur de mon gadget sonnant, mais aussi ma maladie rarissime. Alors que les yeux des femmes se mettaient à briller, la plupart des hommes eurent l’air de sortir tout juste d’une jaunisse infectieuse.
Pour les consoler, je les invitai à dîner.
C’est par un superbe banquet que nous fêtâmes notre arrivée, mais aussi celle d’Inès, tour à tour boulimique et anorexique. Ayant retrouvé une fois de plus une rondeur digne d’un pot à tabac, elle venait de débarquer de l’aéroport, accompagnée de son jeune fiancé, Boris, photographe russe. C’était déjà le troisième Russe qu’Inès importait en France, «ayant arraché Bobo aux griffes des ex-communistes pour en faire un homme libre». Nous observions Bobo de loin, car un Boris, même myope comme une taupe, était capable d’assener à son entourage un sérieux coup de patte.
Nous éventrâmes l’énorme boîte de caviar qu’ils avaient rapportée de leurs fiançailles moscovites et l’arrosâmes de vodka, afin que Boris, en terre étrangère, se sente comme chez lui. Reconnaissant, il clignait de ses petits yeux d’oiseau, pour finalement, de bonheur, fondre en pleurs.
«Je me sens comme chez moi!» s’exclama-t-il à travers ses larmes russes.
Plusieurs personnes, en particulier Napo et nos amis corses, échangèrent un regard, alarmées par cette adaptation si rapide d’un nouvel allogène à l’île de Beauté. Pour noyer ces idées noires, nous passâmes de la vodka à un vin corsé qui transporta vite la plupart des allogènes dans les vignes du seigneur.
Tard dans la nuit, notre confrérie commença à se disperser. Margot et Tatiana se retirèrent parmi les premiers, alléguant un mal de tête commun. Je constatai que ma divinité s’entendait de mieux en mieux en tête-à-tête, et que même la migraine attaquait ses deux crânes simultanément. Finalement, Willi le Long et moi nous retrouvâmes seuls dans la cour, un an après notre dernière rencontre, en Algérie, où je tournais un documentaire pour la télévision sur le retour heureux des émigrés, et lui échangeait des missiles terre-air tchèques contre du fromage de brebis.
«Cartes sur table!» lui dis-je.
Il haussa les épaules.
Ce geste signifiait qu’une nouvelle bataille était perdue pour William de Poisson, mais pas la guerre, joyeuse, qui recommençait pour lui chaque matin, au moment où il finissait de raser son visage rose, sans toucher à sa moustache. Argentée, hérissée, la moustache de Willi n’avait pas de prix pour son propriétaire. Elle lui servait d’antenne, pouvant renifler au loin une transaction avantageuse, le plus souvent le troc des armes d’occasion contre du pétrole brut.
Une fois terminé son tour du monde, Willi se retrouvait fréquemment les poches à moitié vides, mais le cœur plein d’une odeur de poudre, la même odeur capiteuse que le vent nocturne, soufflant du maquis, apportait dans notre paillote corse.
«Cartes sur table!» redis-je.
En guise de réponse, Willi trempa sa moustache dans le reste de son vin.
« Nema veze », lâcha-t-il.
Il s’agissait des deux seuls mots serbes qu’il avait appris quelque part dans les Balkans, lors de ses pérégrinations de marchand d’armes. En langue populaire, ils signifiaient «aucune importance» et se rapportaient sans doute au bombardement de Sarajevo, ville natale de ma défunte mère.
J’eus envie de lui lancer une carafe en pleine gueule, mais, me maîtrisant, je marmonnai:
«C’est une langue dont je ne me sers plus.»
En somme, Willi méritait d’être surnommé notre dénominateur commun , celui de tous les membres de notre confrérie. Éternel adolescent, cet homme de passion et de désordre était déterminé à être lui-même et à y exceller, avec tous ses défauts, vices et péchés. Ce veuf mélancolique, fasciné par l’œuvre de la mort, proie facile de l’érotisme de l’autodestruction, était le seul parmi nous à pouvoir se targuer d’avoir mis au monde un enfant, s’assurant ainsi une sorte d’immortalité génétique au sein d’une lignée ingrate et oublieuse.
Nous avions devant nous toute une chaude nuit d’été, assez de temps pour regarder la vérité droit dans les yeux, armés tous deux de près d’un demi-siècle de tristes expériences. Heure de vérité dans un temps arrêté où notre apparente insouciance se métamorphosait en une énumération amère de tout ce que nous avions perdu à jamais, de nos rêves trahis, de nos promesses non tenues et de nos amours gaspillées.
«J’ai reçu un mot de Louis, son dernier mot», lâcha-t-il subitement en sortant de sa poche un billet chiffonné.
Louis, son fils unique, s’était exilé à Los Angeles depuis belle lurette, après le suicide de sa mère.
«“Faites une croix sur moi, monsieur de Poisson, lut-il d’une voix éraillée. Oubliez que vous avez eu un fils”.
– Il ne te pardonne pas ton divorce ni la mort de ta femme?»
Willi haussa les épaules, l’air résigné.
La perte définitive de son fils fit de lui plus que jamais notre dénominateur commun. Pour le réconforter, je m’empressai de citer mon sage oriental dont je prononçais volontiers les maximes tout en taisant son nom:
«Sur la mer de mélancolie, on ne voit point la terre ferme.»
Willi poussa un soupir de père inconsolable. À en juger d’après ses lèvres crispées, il avait, comme moi, un goût de cendre dans la bouche. Il me répondit par des paroles de son sage préféré, en oubliant lui aussi de mentionner les droits d’auteur. À l’égal de moi, il collectionnait les aphorismes caustiques.
«La mélancolie, dit-il, se guérit par la mélancolie, de même que l’ivrogne se guérit avec du vin.»
Nous nous tûmes et, longtemps, nous gardâmes un silence qui en disait long. De temps en temps, j’accrochais mon regard au ciel étoilé en pensant à notre petite lueur terrestre en face de cette gigantesque absence de vie. Cette nuit-là, tout me semblait mort ou alors en train de mourir, même la terre sur laquelle nous balancions nos chaises d’avant en arrière, comme si nous cherchions à savoir jusqu’où nous pouvions nous pencher sans nous rompre le cou. Je songeai aussi au livre que j’écrirais un jour, dès que j’aurai un peu de temps libre, un livre sur la mort facile en Corse, sur la disparition de Michel, Claude et Dominique, un livre sur la mort avant la mort, dont j’avais déjà le titre.
«Sais-tu, demandai-je soudain à Willi, qu’en une seule journée une bouche humaine perd tellement de cellules vivantes que l’on pourrait en remplir une assiette creuse? Nous faisons notre paquet sans discontinuer.»
Mon ami rit jaune et leva les épaules une fois de plus.
Pour conclure, je décidai de me parer de nouveau de mon sage, le gardant dans l’ombre:
«En tout cas, dis-je, il est moins pénible d’être mort que d’être sur le point de mourir. Rares sont les hommes qui ne meurent qu’une seule fois.»
Читать дальше