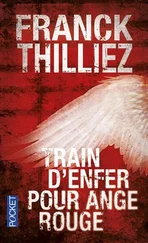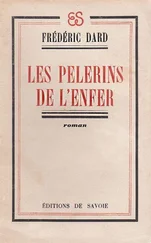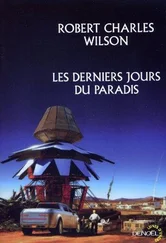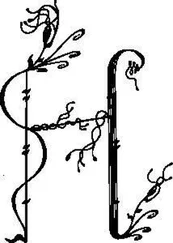Pendant qu’Inès lavait quelque part sa «fleur mi-éclose», sa place fut prise par Sandrine et Petit Loup qui se joignirent enfin à nous. Marie-Loup s’était à peu près remis, mais sa tête s’inclinait toujours de temps à autre vers l’épaule de Sandrine. Comme ils étaient les seuls sans costume ni maquillage dans un groupe de fêlés déguisés, ils avaient l’air de deux excentriques.
Nous commençâmes à déjeuner à 16 heures 14 et terminâmes à 22 heures 38. Entre-temps, faute d’avoir un esprit sain dans un corps sain, je négligeai mon hygiène corporelle d’une manière tout à fait inconsidérée et impardonnable – je ne m’étais lavé les mains et frictionné la poitrine avec de l’alcool qu’une seule et unique fois – et oubliai même la question obsessionnelle qui me tourmentait depuis mon départ de Paris: avais-je, oui ou non, éteint la cafetière électrique, avais-je, oui ou non, fermé à double tour la serrure inférieure de la porte d’entrée?
Au cours de ce repas, nous mangeâmes en entrée des oursins violets «à la coque», cuits pendant trois minutes tels les œufs. Suivit une omelette farcie aux glandes reproductrices de ce même animal marin et potage à la crème d’oursins, extrêmement chargée en iode, avant un risotto noir d’oursins et une salade à la romaine, assaisonnée d’une sauce aux oursins verts. À la fin du déjeuner, je faillis commander un gâteau d’oursins , mais je me retins pour ne pas vexer notre aimable hôte, Marco, qui croquait à belles dents ces «châtaignes de mer».
Le plus vieux des deux frères corses qui tenaient la ferme se déplaçait à l’aide d’une canne, bien qu’il s’agît d’un homme dans la fleur de l’âge. D’après Marco, cet homme lent et pâle avait naguère survécu à une grave crise cardiaque. Je me demandais quel cri intérieur avait pu mener ce monsieur à un infarctus du myocarde dans le doux silence de sa crique. J’aurais voulu caresser sa main droite, lente et pâle, avec laquelle il nous servait ses plats aux oursins, pendant que de la gauche il s’appuyait à sa canne et aux dossiers de nos chaises.
À la tombée de la nuit, nous nous tûmes, oppressés par le poids de la nourriture ingurgitée et un vague à l’âme inexplicable. Nous parlions à mi-voix, presque en chuchotant, comme par crainte de perturber un équilibre fragile dans la nature qu’elle pouvait à tout instant métamorphoser en tempête.
Peu à peu, je commençai à comprendre ce cri intérieur conduisant l’homme lent et pâle à la crise cardiaque. Sur cette crique, telle une malédiction, était suspendu une épée de Damoclès gigantesque, invisible, menace permanente planant au-dessus de la mer en apparence paisible. La nature qui nous entourait me faisait penser à un mourant, maintenu artificiellement en vie, dans l’attente de son dernier râle.
«Cette nuit, nous aurons de l’orage», dit le courageux Capitaine Carcasse.
Il répétait cette phrase toutes les demi-heures, à chaque fois que l’un des frères aubergistes posait devant lui un nouveau pichet de vin.
«Cette nuit, un sale orage se prépare», disait le Capitaine.
Nous buvions plus que jamais depuis que nous avions posé les pieds sur cette île, nous buvions avec tant de désespoir et si peu de mesure que la nuit à venir nous promettait un raz de marée d’une mélancolie plus dangereuse que celle de la veille au soir. En effet, la nuit arrivait de la mer accompagnée d’une vague noire, colossale. L’anxiété submergea rapidement les alentours de la buvette, un brouillard épais de fines gouttelettes se coucha sous nos pieds, au bord même du petit embarcadère où se trouvait notre table, décorée d’un bouquet de coraux rouges, de «sang de bœuf» pétrifié, l’un des plus beaux coraux de la Méditerranée.
Pour chasser les fantômes, nous commandions de nouvelles boissons.
«Cette nuit, il y aura une grande tempête», rabâchait le Capitaine Carcasse.
Je remarquai que Petit Loup buvait de nouveau, et qu’à deux reprises il repoussa Sandrine, qui tentait de lui retirer son verre. Je remarquai aussi que les épaules de Sandrine tremblaient lorsqu’elle se tournait avec un rire forcé vers ses voisins et que l’insensé en profitait pour boire à longs traits. Je me demandais quel nouveau démon envahissait son esprit, quel nouveau silence que devait peupler La Mort , sa vie, son œuvre, ce tâtonnement désespéré dans le labyrinthe de son passé. Je le chérissais plus que jamais, doutant soudain que nous vieillissions ensemble dans notre maison normande. Nimbé d’une sombre amertume, notre frère, chasseur de fantômes, ressemblait de plus en plus à ce Gascon légendaire pour lequel chaque blessure était mortelle, puisque tout entier il n’était que cœur.
Quand nous quittâmes enfin la table, le monsieur lent et pâle à la canne et son frère cadet nous raccompagnèrent jusqu’à la sortie de leur cour. Nous nous serrâmes la main comme de vieux amis, et le monsieur lent et pâle me posa une question en corse que Marco dut me traduire.
«On dirait que monsieur Alfonsi te trouve fort sympathique, dit Marco. Il demande si, dans tes veines, malgré ton origine québécoise, il ne coulerait pas quelques gouttes de sang corse.»
Je ne compris pas la question.
«Monsieur Alfonsi est persuadé que les gens très cordiaux, et même s’il s’agit de Québécois, doivent avoir au moins quelques gouttes de sang corse, m’expliqua Marco.
– Malheureusement, ce n’est pas mon cas», dus-je reconnaître en promettant au monsieur lent et pâle de rechercher sans faute un donneur de sang corse si jamais le besoin d’une transfusion se faisait sentir.
À cet instant, nous nous tendions une main amicale pour la troisième fois.
«Vive le Québec libre! me dit en français le monsieur lent et pâle avec un sourire malicieux.
– Vive la Corse libre!» répondis-je du même ton badin.
Pour retourner au «château» de Marco, nous traversâmes de nouveau le village, cette fois désert, les habitants dormant déjà à poings fermés derrière leurs persiennes. Quand nous passions sous les quelques réverbères, nos ombres jouaient avec le monde réel, longs spectres semblables à des animaux disparus depuis la nuit des temps. Les observant avec une certaine appréhension, je songeai que notre Arche de Noé , hélas! n’avait pas emmené en voyage les premiers êtres d’un monde futur, mais plutôt les derniers représentants d’une ménagerie de dégénérés, condamnés à une extinction inexorable.
Nous marchions en file indienne sur nos jambes mal assurées, chacun seul avec lui-même et sa suite silencieuse singeant derrière son dos sa démarche et son allure. Je n’avais jamais vu, comme cette nuit, mon ombre dans l’étreinte de celles de Sandrine et de Petit Loup sur une façade aveugle. Nous nous arrêtâmes à cet endroit pour soutenir notre frère épuisé. Lorsque, par hasard, je jetai un regard sur ce mur, j’y aperçus une chose qui me fit dresser les cheveux sur la tête: entre moi et Sandrine, l’ombre de Petit Loup pâlissait très rapidement, pour disparaître comme si son propriétaire n’avait jamais existé.
Je faillis crier, bien que sachant que mes sens devaient me tromper. Par bonheur, Sandrine ne remarqua pas ce phénomène, occupée à essuyer la bouche de Marie-Loup après qu’il eut encore vomi. «C’est un signe de mauvais augure! me répétais-je fiévreusement. Mais que veut-il dire?»
Sous le figuier de Marco, le Capitaine Carcasse me tira de ces réflexions mornes pour me demander du feu.
«Cette nuit, un orage se prépare», me dit-il.
Il sembla alors que nous allions tous nous retirer dans nos cellules respectives pour dormir, roués de fatigue, quand se produisit quelque chose qui n’était possible que dans un univers corse. Nous étions déjà en train de bâiller, de nous déchausser, de nous gratter sous les aisselles et de déboutonner ce que nous avions à déboutonner, lorsque, venant de la pénombre, du bord de l’eau, se fit entendre un son très agréable à l’oreille, un chant silencieux émanant de la bouche du neveu de Napo.
Читать дальше