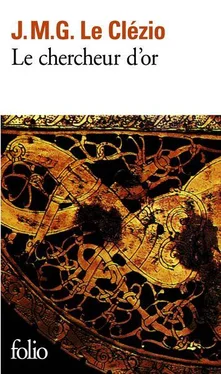En mer, vers Mahé
Le vent a tourné pendant la nuit. Maintenant il souffle à nouveau vers le nord, rendant toute navigation de retour impossible. Le capitaine a choisi de fuir le vent, plutôt que de se résigner à attendre à Agalega. C’est le timonier qui m’apprend cela, sans émotion. Irons-nous un jour à Rodrigues ? Cela dépend de la durée de la tempête. Grâce à elle nous avons touché Agalega en cinq jours, mais maintenant nous devons attendre qu’elle nous laisse revenir.
Je suis bien le seul à m’inquiéter de l’itinéraire. Les marins, eux, continuent de vivre et de jouer aux dés comme si rien n’importait. Est-ce le goût de l’aventure ? Non, pas cela. Ils n’appartiennent à personne, ils ne sont d’aucune terre, voilà tout. Leur monde, c’est le pont du Zeta , la cale étouffante où ils dorment la nuit. Je regarde ces visages sombres, brûlés par le soleil et le vent, pareils à des cailloux polis par la mer. Comme la nuit du départ, je ressens cette inquiétude sourde, irraisonnée. Ces hommes appartenaient à une autre existence, à un autre temps. Même le capitaine Bradmer, même le timonier sont avec eux, de leur côté. Eux aussi sont indifférents au lieu, aux désirs, à tout ce qui m’inquiète. Leur visage est aussi lisse, leurs yeux ont la dureté métallique de la mer.
Le vent nous chasse vers le nord, à présent, toutes les voiles gonflées, l’étrave fendant la mer sombre. Heure après heure nous avançons, jour après jour. Moi, je dois me faire à cela, accepter l’ordre des éléments. Chaque jour, quand le soleil est au zénith, le timonier descend à fond de cale pour se reposer sans fermer les yeux, et c’est moi qui prends la barre.
Peut-être qu’ainsi j’apprendrai à ne plus poser de questions. Est-ce qu’on interroge la mer ? Est-ce qu’on demande des comptes à l’horizon ? Seuls sont vrais le vent qui nous chasse, la vague qui glisse, et quand vient la nuit, les étoiles immobiles, qui nous guident.
Aujourd’hui, pourtant, le capitaine me parle. Il me dit qu’il compte vendre sa cargaison d’huile aux Seychelles, où il connaît bien M. Maury. C’est M. Maury qui s’occupera de la faire transporter dans les c argo s en partance pour l’Angleterre. Le capitaine Bradmer me parle de cela d’un air indifférent, en fumant sa cigarette de tabac vert, assis dans son fauteuil vissé au pont. Puis, alors que je ne m’y attends pas, il me parle à nouveau de mon père. Il a entendu parler de ses expériences et de ses projets d’électrifïcation de l’île. Il connaît aussi les différends qui l’ont opposé jadis à son frère, et qui ont causé sa ruine. Il me parle de cela sans émotion ni commentaire. De l’oncle Ludovic il dit seulement : « A tough man », un dur. C’est tout. Ici, sur cette mer si bleue, racontés par la voix monotone du capitaine, ces événements me semblent lointains, presque étrangers. Et c’est bien pour cela que je suis à bord du Zeta , comme suspendu entre le ciel et la mer : non pour oublier — que peut-on oublier ? Mais pour rendre la mémoire vaine, inoffensive, pour que cela glisse et passe comme un reflet.
Après ces quelques mots sur mon père et le Boucan, le capitaine reste silencieux. Les bras croisés, il fermé les yeux en fumant, et je pourrais croire qu’il s’est à moitié endormi. Mais soudain il se tourne vers moi, et de sa voix étouffée qui domine à peine le bruit du vent et de la mer ;
« Êtes-vous fils unique ? »
« Monsieur ? »
Il répète sa question, sans hausser la voix :
« Je vous demande si vous êtes fils unique : N’avez-vous pas de frères ? »
« J’ai une sœur, monsieur. »
« Comment s’appelle-t-elle ? »
« Laure. »
Il semble réfléchir, puis :
« Est-elle jolie ? »
Il n’attend pas ma réponse, il continue, pour lui-même :
« Elle doit être comme votre mère, belle et mieux que cela, courageuse. Avec de l’intelligence. »
Cela fait en moi comme un vertige, ici, sur le pont de ce navire, si loin de la société de Port Louis et de Curepipe, si loin ! J’ai cru si longtemps que nous avions vécu, Laure et moi, dans un autre monde, inconnu des gens fortunés de la rue Royale et du Champ-de-Mars, comme si dans la maison décrépite de Forest Side, comme dans la vallée sauvage du Boucan, nous étions restés invisibles. Tout à coup cela fait battre mon cœur plus vite, de colère, ou de honte, et je sens mon visage rougir.
Mais où suis-je donc ? Sur le pont du Zeta , un vieux schooner chargé de barriques d’huile, plein de rats et de vermine, perdu sur la mer entre Agalega et Mahé. Qui se soucie de moi et de mes rougeurs ? Qui voit mes vêtements tachés par la graisse de la cale, mon visage brûlé par le soleil, mes cheveux emmêlés par le sel, qui voit que je suis pieds nus depuis des jours ? Je regarde la tête de vieux forban du capitaine Bradmer, ses joues couleur lie-de-vin, ses petits yeux fermés par la fumée de sa cigarette puante, et devant lui le timonier noir, et encore les silhouettes des marins indiens et comoriens, certains accroupis sur le pont en train de fumer leur kandja, d’autres jouant aux dés ou rêvant, et je ne sens plus de honte.
Le capitaine a déjà oublié tout cela. Il me dit :
« Aimeriez-vous voyager avec moi, monsieur ? Je me fais vieux, j’ai besoin d’un second. »
Je le regarde surpris :
« Vous avez votre timonier ? »
« Lui ? Il est vieux aussi. Chaque fois que je fais escale, je me demande s’il reviendra. »
L’offre du capitaine Bradmer retentit un moment en moi. J’imagine ce que serait ma vie, sur le pont du Zeta , à côté du fauteuil de Bradmer. Agalega, Seychelles, Amirantes, ou Rodrigues, Diego Garcia, Peros Banhos. Parfois jusqu’à Farquhar, ou aux Comores, peut-être au sud, vers Tromelin. La mer, sans fin, plus longue que la route à parcourir, plus longue que la vie. Est-ce pour cela que j’ai quitté Laure, que j’ai brisé le dernier lien qui me retenait au Boucan ? Alors la proposition de Bradmer me semble dérisoire, risible. Pour ne pas lui faire de peine, je dis :
« Je ne peux pas, monsieur. Je dois aller à Rodrigues. »
Il ouvre les yeux :
« Je sais, j’ai entendu parler de cela aussi, de cette chimère. »
« Quelle chimère, monsieur ? »
« Eh bien, cette chimère. Ce trésor. On dit que votre père a beaucoup travaillé là-dessus. »
Dit-il « travaillé » par ironie, ou est-ce moi qui m’irrite ?
« Qui dit cela ? »
« Tout se sait, monsieur. Mais n’en parlons plus, cela n’en vaut pas la peine. »
« Vous voulez dire que vous ne croyez pas à l’existence de ce trésor ? »
Il secoue la tête.
« Je ne crois pas que dans cette partie du monde — il montre d’un geste circulaire l’horizon — il y ait eu d’autre fortune que celle que les hommes ont arrachée à la terre et à la mer au prix de la vie de leurs semblables. »
Pendant un instant, je ressens l’envie de lui parler des plans du Corsaire, des papiers que mon père a ramassés et que j’ai recopiés et apportés avec moi dans ma malle, tout cela qui m’a aidé et consolé dans le malheur et la solitude de Forest Side. Mais à quoi bon ? Il ne comprendrait pas. Il a déjà oublié ce qu’il m’a dit, et il se laisse aller aux balancements du navire, les yeux fermés.
Moi aussi, je regarde la mer étincelante, pour ne plus penser à tout cela. Je sens dans tout mon corps le mouvement lent du bateau, qui bouge en traversant les vagues, comme un cheval qui franchit un obstacle.
Je dis encore :
« Merci de cette offre, monsieur. J’y réfléchirai. »
Lui entrouvre les yeux. Peut-être ne sait-il plus de quoi je parle. Il grogne :
Читать дальше