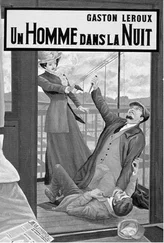— Ben, merde alors, parvint-il à dire dans un hoquet.
— Vraiment ! s’exclama la serveuse en retirant du robinet un verre à bière à moitié plein et sans mousse. Vraiment ! Qu’est-ce que c’est que ces outres pleines de bière et de schnaps !? (Elle secoua la tête.) Et qui va les nettoyer, ces saletés ? Moi, naturellement !
Elle fit la grimace et passa devant le comptoir armée d’un seau et d’une serpillière.
Quelques clients se mirent à rire, levèrent leurs verres et saluèrent :
— À la tienne, camarade !
— Il est tard, déclara Kälterer, venez, camarade, je vais vous monter dans votre chambre.
Il aida le Panzeroffizier à se remettre sur ses pieds et le conduisit vers la porte.
— Ils vont nous tirer comme des lapins, demain, avec leurs putains de T-34.
L’homme pleurnichait presque, cramponné à l’épaule de Kälterer, tandis qu’ils cherchaient les marches en tâtonnant dans l’obscurité.
— Adieu, Berlin !
Quand il se leva, il savait déjà qu’il avait surmonté le vide, le choc et cette paralysie qui avait duré des jours. Tout en se lavant et se rasant, il fredonna même le vieux refrain de Buchenwald qui ne lui était pas monté aux lèvres depuis longtemps : « O Buchenwald, nous ne gémissons pas, ni ne nous plaignons, et quel que soit notre sort… »
Non, il ne voulait pas se plaindre et surtout ne pas abandonner, quoique la déception l’eût terrassé. Mais Fritzschen était en cause aussi, son fils avait mérité qu’il continuât, qu’il allât au bout de sa vengeance. Même si l’on avait fait porter des cornes au mari, il était père et demeurait père. Lotti l’avait trompé, sa femme bien-aimée avait eu un amant. Tout était écrit noir sur blanc dans les lettres que ce salopard lui avait envoyées, ce salopard dont la Fiegl lui avait parlé aussi, cette relation d’affaires de Karasek, celui qui avait été assis en bas, dans la cave, responsable du fait que Lotti et Fritzschen aient été interdits d’abri. Il avait la mort de sa famille sur la conscience. Raison suffisante pour envoyer cette crevure dans l’au-delà, mais ça n’était pas tout. C’était ce même type qui l’avait dénoncé. Vraisemblablement avec Karasek, cette repoussante face de porc, cet infernal avorton, ce…
Il aspira profondément. Il venait de se couper sous le menton avec son rasoir. Le sang se mêlait au savon à barbe, laissant sur son cou une tramée rosâtre. Il arracha un morceau de papier journal et le pressa sur la coupure jusqu’à ce qu’il y colle, stoppant le saignement.
Il avait fait un serment et avait passé au fil de l’épée les salauds qui l’avaient mis dans la merde, les responsables de la mort de sa famille. Il avait cogné sur ses voisins jusqu’à ce qu’ils crachent la vérité, morceau par morceau, faisant remonter au jour toutes les odieuses manigances qui suivirent son arrestation. Pour lui aussi, la vérité était devenue amère. Il ne restait plus à présent sur sa liste que ce chien galeux, un dernier nom pour un dernier acte.
Il s’essuya le visage, tourna le bouton de la radio du peuple et s’habilla lentement. La voix étonnamment calme et retenue du Führer retentit aussitôt : « … Nous écarterons le destin cruel qui se joue aujourd’hui à l’Est et finirons par le vaincre… grâce à des efforts inouïs, malgré tous les revirements et les épreuves les plus terribles… Mais si tout cela est possible, c’est grâce au changement advenu dans le cœur du peuple allemand depuis 1933… Dans ce combat pour la délivrance de notre peuple, il est de notre inébranlable volonté… de ne reculer devant rien… Quoi que nos ennemis puissent inventer, quels que soient les dommages et les peines qu'ils infligent aux villes allemandes, aux campagnes allemandes et, avant tout, à notre peuple, tout cela pâlit face aux calamités et aux malheurs qui nous affligeraient si d’aventure le complot ploutocrato-bolchevique devait vaincre. En ce douzième anniversaire de la prise de pouvoir, il est d’autant plus nécessaire d’affermir notre détermination sacrée, de nous battre aussi jusqu'à ce que la victoire finale vienne couronner nos efforts… »
Il éteignit la radio et boutonna son manteau. Après avoir vérifié le trafic de la rue, il se faufila prudemment par le portail en fer et allongea le pas vers l’entrée du bistrot.
Les fenêtres sur rue avaient été condamnées avec des planches et toute la façade était constellée d’impacts d’éclats d’obus. Le trottoir, avec ses pavés arrachés, était changé en un parcours d’obstacles et les lampadaires sans verre avaient pris des formes bizarres. D’un coup d’épaule dans la porte d’entrée coincée, il força le passage et pénétra dans le local.
Il y faisait sombre et il y régnait un froid vif. Il n’y avait plus d’électricité, les bougies qui brûlaient sur le comptoir et les tables donnaient l’impression d’une chaude atmosphère vespérale alors qu’on était au petit matin. Depuis longtemps, les clients étaient plus rares qu’au jour de sa première venue. Il remarqua au comptoir beaucoup de femmes d’âge moyen, avec des bonnets de laine, des fichus, engoncées dans d’épais manteaux, portant des bas et des souliers grossiers. Karine lui avait raconté qu’il n’y avait plus assez de travail, trop d’usines d’armements avaient été bombardées, et la machine de guerre ne tournait plus aussi facilement que quelques mois auparavant.
L’ambiance était feutrée, compassée même. La majorité des clients étaient des blessés de guerre, quelques-uns assis aux tables, la tête enveloppée de gros pansements, d’autres avec des béquilles appuyées au mur derrière eux. On ne servait plus à manger depuis longtemps et il n’y avait plus de bière. Il ne restait que du schnaps et du vin, les réserves de la cave.
Il se glissa discrètement dans le coin le plus reculé et prit place à la table où il s’était assis la première fois. Carine s’entretenait avec sa sœur derrière le comptoir. Elle vint vers lui, prit une chaise et dit à voix basse :
— Heureusement, il n’y a pas grand monde aujourd’hui. Mais tout de même, il ne faut pas que tu viennes ici, c’est trop dangereux.
Elle rapprocha son siège.
— Sinon, tu vas mieux ?
Il opina.
— Qu’est-ce que tu avais ? Ces derniers temps, tu parlais à peine et tu n’as presque pas mangé.
Elle le regardait tout en lui caressant prudemment le bras.
Il lui devait une explication. Elle s’était occupée de lui avec tant de gentillesse, sans l’assaillir de questions alors que la trahison de Lotti le terrassait. Karine avait le droit de savoir. Tandis qu’il racontait, sa sœur posa sur la table une théière avec deux tasses. Tout ce qu’il lui confia ce jour-là n’était pas la stricte vérité ; celle-là, il la gardait pour lui. Mais il voulait parler de Lotti.
— Je suis allé voir mon ancienne voisine, celle qui a gardé la valise de Lotti après sa mort. Cette valise est la seule…
Sa voix le trahit. Il se passa la main sur le visage, puis poursuivit dans un murmure :
— Cette valise est tout ce qui me reste de Lotti et Fritzschen. Le pire, c’est que… j’y ai trouvé un paquet de lettres, toutes adressées à Lotti. De la part d’un homme que je ne connais pas…
Karine se versa la méchante tisane, lui demanda d’un geste s’il voulait de cette eau tiède, lui laissa le temps.
— Et qu’est-ce qu’il y a dans ces lettres ? finit-elle par demander.
— Pour la plupart, ce sont des lettres d’amour ampoulées, très verbeuses. Je ne comprends pas comment Lotti a pu s’y laisser prendre… Elle a dû rencontrer ce type au printemps 42, ou en été, et ils ont dû coucher ensemble. Là-haut, j’ai essayé de classer les lettres par ordre chronologique. Je veux savoir ce qui s’est passé dans mon dos. Au début, il était seulement question d’affaires, je t’ai déjà raconté qu’une de mes voisines trafiquait avec des biens aryanisés saisis à des Juifs.
Читать дальше