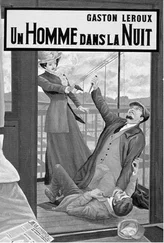Mais cette sentence parut manifestement trop légère à la Gestapo : six mois après sa déportation à Bautzen, on transféra Ruprecht Haas à Buchenwald. La Gestapo avait corrigé le verdict du tribunal. Le criminel disparut dans le camp de concentration pour une durée indéterminée.
Kälterer continua à feuilleter. Il n’y avait plus rien d’important dans le dossier, sinon que Haas avait fini par tout avouer après avoir d’abord protesté.
Il était en train d’examiner les papiers personnels de Haas quand Inge, en robe de chambre, l’air endormi, fit son entrée dans la cuisine. Elle grommela un bonjour et mit aussitôt de l’eau à chauffer pour le café.
Il découvrit encore deux actes de décès, l’un au nom de Lieselotte Haas, née Mudra, l’autre de leur fils Friedrich-Christian, tous deux tués dans un bombardement le 25 mars 1944.
La bouilloire s’était mise à siffler et il dirigea ses regards vers la gazinière. Inge versait l’eau chaude dans la cafetière sur l’ersatz de café.
— Apparemment, il n’y aura pas de raid ce matin, dit-il en reprenant l’examen du dossier.
Elle ne réagit pas et attendit en silence que le marc descende au fond.
Il empila les feuillets déjà dépouillés. Il contempla longuement la photo de la carte d’identité de Haas. Un front haut, des cheveux plats, bruns foncés, un visage triste aux joues légèrement arrondies, le nez un peu fort, sans autre signe particulier.
— Hans, qui est Merit ?
Inge s’était accoudée à la table de la cuisine, bras croisés.
Il sursauta.
— Pardon ?
— Tu as parlé d’elle dans ton sommeil.
— Merit, dit-il à voix basse, cela ne nous concerne pas.
— Cela ne nous concerne pas, répéta Inge dans un rictus. Qui est-ce ?
— C’est du passé.
Kälterer s’appuya à la table et se leva. Il était assis là depuis cinq heures du matin, cette affaire ne le laissait plus en paix.
— Tu es au lit avec moi et tu parles d’elle !
Elle était outrée et blessée à la fois. Elle se recula quand il prétendit s’approcher d’elle.
— Merit était ma femme. Nous sommes séparés, depuis longtemps déjà.
Il avait dû parler pendant un cauchemar. Il se plaça devant elle, lui prit la taille et l’embrassa tendrement sur les lèvres.
— Rien de grave. Désolé, Inge, mais il faut que je termine ce travail.
Elle approuva, se détourna et disparut dans la chambre à coucher.
Il se versa de l’ersatz de café et alluma une cigarette. Les femmes avec leurs questions. C’était la cause de tous les problèmes. Le tabac sec lui piqua la gorge.
Toute la vie de Haas était étalée sous ses yeux sur la table de la cuisine. Une vie courte, terne. Rien de notable, rien d’extraordinaire. Quelques marks d’épargne pour acheter une voiture. Haas avait mené une vie retirée, repliée sur sa famille qui semblait avoir été tout pour lui. Les comptes rendus d’interrogatoires semblaient crédibles. Rien n’avait dû échapper à la Gestapo.
Un court laps de temps, il eut la vision des papiers de sa propre carrière étalés eux aussi sur le bureau d’un officier de renseignements allié. Depuis un an, la rumeur avait filtré que les ennemis avaient l’intention de traduire les officiers de la Wehrmacht devant les tribunaux comme criminels de guerre. Mais il n’était pas un criminel de guerre. Comme tout bon soldat, il n’avait fait qu’obéir aux ordres. Les Alliés ne pourraient rien retenir contre lui. Il n’était qu’un petit rouage de la machine. Et on avait besoin de policiers compétents partout ; on en aurait aussi besoin après la guerre. Même si on ne savait pas comment tout cela allait finir, résoudre cette belle affaire criminelle ne pouvait certainement pas faire de tort.
Ruprecht Haas avait été un homme prévoyant. Depuis le premier jour de son apprentissage, il avait soigneusement collé ses vignettes, toutes proprement alignées dans son carnet d’assurance-retraite. Chaque année avait ainsi été consignée, même durant la période où il avait été commerçant. Cet homme avisé n’était sorti qu’une seule fois de sa réserve, et ce pour sa perte.
Attestations d’assurance, récépissé de libération de Bautzen, certificat de transfert pour Buchenwald. Puis il eut à nouveau en mains les documents de l’administration du camp de concentration, ceux aussi où l’on informait succinctement le procureur de la mort de Ruprecht Haas. Il y avait bien une date, mais les causes du décès manquaient. Une communication téléphonique avec Buchenwald avait tiré un point au clair : après le raid aérien sur le camp, la plupart des morts n’avaient pu être identifiés. Les bombes explosives avaient fait leur œuvre, et l’administration ne s’était plus donné la peine de mettre de l’ordre dans les divers membra disjecta des cadavres. On n’avait même pas pu établir avec certitude le nombre exact de tués. Il était clair que Haas avait réussi à s’évader durant le bombardement de Buchenwald et qu’il avait été déclaré mort par erreur.
Il déposa la pile de documents sur le sol pour faire de la place à Inge qui dressait la table du petit déjeuner. Il se leva pour couper du pain, posa la miche sur la planche de la machine, en laissa dépasser quelques centimètres et appuya avec force sur le manche du couteau. Une tranche de pain tomba. Il souleva de nouveau la lame en acier, avança la miche, coupa la tranche suivante. On les poursuivrait « jusqu’au coin le plus reculé de la planète ». C’est ainsi, disait-on, que s’étaient exprimés les ennemis dans une déclaration signée par Staline, Churchill et Roosevelt. Il fallait livrer les criminels de guerre à leurs accusateurs, pour que « la justice règne ».
Wörthstrasse. La bataille de Reichshoffen, près de Wœrth dans le nord de l’Alsace, 1871. Des Wurtembourgeois et des Badois montent vaillamment à l’assaut des troupes françaises. Kälterer grimpait les escaliers quatre à quatre. Après chaque raid aérien, une fine poussière de crépi se détachait des murs gris du sombre bâtiment. Les femmes de ménage n’arrivaient plus à suivre. Les travaux de nettoyage commençaient tout en haut de la hiérarchie. Le bunker du Führer, propre. La chancellerie du Reich, propre. Prinz-Albrecht-Strasse 8, toujours bien propre. Dans la Wörthstrasse ou dans des annexes comme celles de la Kochstrasse ou à son domicile, le ménage ne suivait plus. C’est pourquoi, selon le jour ou l’heure, les escaliers étaient poussiéreux.
Il était deux heures de l’après-midi. Heure à laquelle s’étaient dessinées des demi-lunes claires dans la poussière grise des marches. Mais la rampe de l’escalier était toujours sale. Personne ne posait la main sur un garde-fou sale. Il passa une porte battante et pénétra dans un couloir sombre. La deuxième porte de gauche était la bonne. Il entra dans le bureau sans frapper.
Avec un individu du genre de Bechthold, il ne fallait pas hésiter à être un peu brusque.
Deux fenêtres, deux bureaux encombrés de papiers, deux fonctionnaires, une fleur en pot desséchée, un poêle dans un angle. Il ne tint pas compte de l’assistant assis sur la gauche, Scholz ou Scholl et, main droite glissée dans la poche de son pantalon, pan de la veste relevé, celui du manteau crânement rejeté en arrière il se planta devant l’homme plus âgé.
— Bonjour, commissaire Bechthold, dit-il en ricanant, toisant de haut le fonctionnaire qui griffonnait sur un morceau de papier. Toujours appliqué au travail ?
Il approcha une chaise, s’assit sans vergogne devant le bureau de Bechthold, repoussa quelques chemises d’un revers de l’avant-bras et déposa son chapeau sur la place ainsi libérée.
Читать дальше