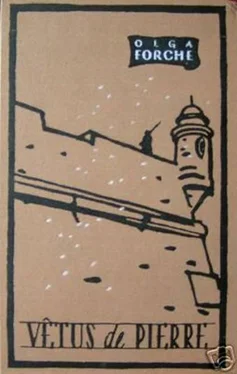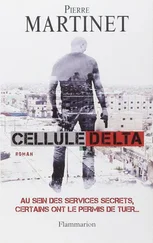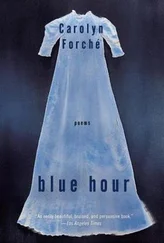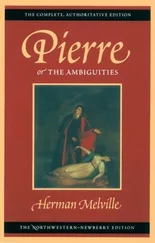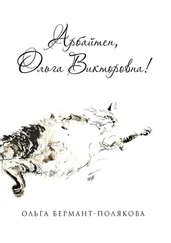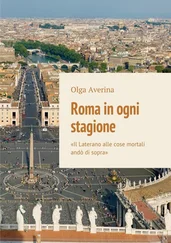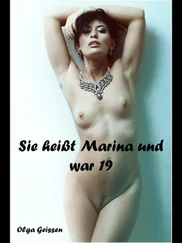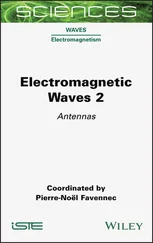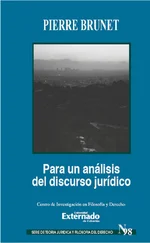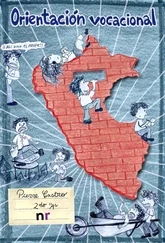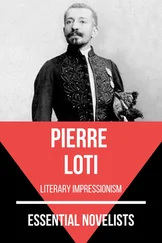Mais, la tête farcie de rêves, je ne comprenais pas la vie réelle.
Bien que ce fût pour Mikhaïl une nouveauté et pour moi une chose accoutumée, j’étais plus ému que lui en me rendant au bal. Tantôt je trouvais mes parfums trop vulgaires, tantôt je craignais que mon menton ne fût mal rasé, tantôt j’avais l’appréhension de glisser sur le parquet et de tomber en entraînant ma danseuse.
Si souvent que je l’aie vu, le couvent Smolny, cette merveille d’architecture du comte Rastrelli, a toujours ravi mon âme sensible aux chefs-d’œuvre des arts plastiques.
En ce jour mémorable, les pilastres blancs sur fond gris bleu semblaient continuer l’atmosphère du soir hivernal et donnaient à l’édifice, si aérien déjà, l’aspect d’un mirage.
Les chapelles en forme de tour et les bâtiments conventuels évoquaient le souvenir de l’architecture italienne et les légendes des belles princesses, des dragons, des chevaliers. Derrière le jardin, par delà la glace bleue de la Néva, clignotaient les rares lumières du faubourg.
Au printemps, les dimanches de sortie, j’aimais traverser en canot le large fleuve, en admirant les proportions incomparables de la cathédrale, bleuâtre dans la clarté du soleil couchant. Je m’amusais à exécuter en imagination certain projet de Rastrelli, abandonné parce que son devis se montait à un prix exorbitant, même pour le siècle prodigue d’Elisabeth.
Rastrelli voulait élever sur la berge de la Néva un clocher de soixante toises de haut, couvert d’or et d’argent, avec des ornements d’un blanc neigeux sur fond d’azur éclatant. On avait déjà créé pour le chantier des briqueteries auxquelles plusieurs villages étaient rattachés, et on coulait les tuiles de bronze sous la direction d’un spécialiste étranger.
Ah, que ne suis-je né à l’époque de la Renaissance, lorsque les trois Parques, sur l’ordre du Destin, tissèrent d’un fil d’or, dans l’histoire de l’humanité, l’éveil du sentiment esthétique! Je n’y aurais pas été le dernier des pontifes.
Mais aujourd’hui le sort capricieux s’amuse à intervertir les étiquettes. L’homme naît dans un siècle qui n’est pas le sien, dans un entourage hétérogène, à une place qui ne lui convient pas. Iakov Stépanovitch, le plus sage des vieillards, que j’introduirai par la suite dans mon récit, m’a du reste expliqué les embarras de ma pensée:
– L’esprit qui préside à l’édification du monde est contraire à la justice humaine, et tout notre malheur c’est que nous n’avons rien pour le comprendre. Or, si nous le comprenions, nous ne serions plus étonnés que le rôle de meurtrier revienne à celui qui, dans le secret de son cœur, répugne à verser le sang, tandis que l’homme sanguinaire peut se poser en bienfaiteur. L’intelligent gagne péniblement sa vie, et le riche est pauvre d’esprit… Mais songe un peu: l’homme consentirait-il, de son plein gré, à s’atteler au joug ou à se pencher attentivement sur la vie d’un autre? Non, telle une flèche tirée à l’arc, il ne suivra que sa trajectoire. Les hommes ne sont pourtant pas des flèches, ce sont des gouttelettes destinées à former un vaste océan. Pour pouvoir élargir nos rives, chacun devrait sortir de sa coquille.
– Au demeurant, a ajouté Iakov Stépanovitch, il faut concevoir la chose de façon particulière, sans quoi on risque d’aggraver le non-sens de la vie.
Mais l’abus des digressions est ruineux pour mon écrit. C’est qu’il est défendu maintenant de prendre du papier à la cave. Hier, les fillettes m’en apportaient plein leur tablier, lorsque le gérant, survenu à l’improviste, leur a fait remettre les feuillets dans le tas. Je dirai pourtant quelques mots de l’Institut Smolny.
J’ai appris de ma tante, la comtesse Kouchina, que le dessein initial de Catherine II avait été de fonder un établissement pour l’éducation d’une «race nouvelle», avec le concours de nonnes instruites, comme cela se faisait en France.
À cette fin, le Saint Synode intimait au métropolite de Moscou l’ordre d’examiner personnellement les abbesses et les nonnes, pour choisir les plus dignes. Mais il y en avait si peu de lettrées et même d’aptes à soigner les malades, qu’on en garda un petit nombre seulement, pour le décor, si l’on peut dire. Dans ses recherches d’influences sur la «race nouvelle», Catherine se passionna bientôt pour une méthode plus conforme à ses goûts personnels: la participation de Voltaire et de Diderot.
Ma tante qui haïssait les encyclopédistes, racontait à ce propos une anecdote sur Voltaire: il s’était chargé d’écrire une comédie morale pour les jeunes filles, mais, habitué à ne produire que des blasphèmes, il avait la colique dès qu’il se mettait à cette œuvre décente. Catherine se plaignit à Diderot que le vieillard en décrépitude n’était plus capable de créer de jolies œuvres pour les exercices scéniques des demoiselles, à quoi Diderot, non moins athée, répondit textuellement: «C’est moi qui ferai les comédies pour les demoiselles, et avant que je ne vieillisse».
Or, on le sait, Diderot déplut à la tsarine en exigeant qu’au pensionnat on enseignât en premier lieu l’anatomie, matière qui, de l’avis de ma tante, faisait presque perdre leur innocence aux jeunes filles.
Jusqu’à la fin de son existence, l’Institut Smolny garda dans ses traditions le contraste original de ces deux notes adoptées par Catherine lors de sa fondation: une vague odeur de couvent et l’adorable verve du voltairianisme mondain. Les pensionnaires pieusement portaient leurs robes en gros tissu vert, bleu ciel, marron ou blanc, avec pèlerines, manchettes et tabliers blancs. Ajoutez à cela une dévotion apparente, d’innombrables icônes, des superstitions, des reliques, la coutume de tenir dans la bouche un morceau de pain bénit aux examens les plus difficiles, de fourrer du coton miraculeux dans le porte-plume à l’épreuve écrite de mathématiques. En même temps, on se transmettait de promotion en promotion d’ingénieux moyens de correspondance amoureuse et de galanterie légère avec les soupirants «de sous les fenêtres». Cela se faisait sans distinction de caste ni de rang, libéralité qui n’existait plus dès qu’il s’agissait de la grave question du mariage. Pour épouser un civil ou un officier qui n’était pas de la garde, il fallait un amour «fatal» ou des avantages particuliers, purement matériels, offerts par le prétendant.
Dès l’enfance et jusqu’à la promotion, les pensionnaires étaient isolées de leur foyer. Elles apprenaient diverses matières sous la direction de professeurs choisis avec soin et s’exerçaient aux arts de la danse et des ouvrages à main. À part l’enseignement, il était prescrit, d’après l’idée de la fondatrice, «d’égayer l’esprit» des élèves et de leur fournir des «distractions innocentes». Voilà pourquoi le brillant pinceau de Lévitski a rendu à maintes reprises le charme coquet des demoiselles Khovanskaïa, Khrouchtchéva ou Levchina en travesti ou en robe de bal.
Depuis le règne de Catherine, l’Institut restait proche de la cour; c’est pourquoi les demoiselles qui fréquentaient souvent les palais et jouissaient de l’attention de la famille impériale, étaient pénétrées de sentiments monarchistes un peu exaltés; mais Véra, sous l’influence de son oncle Linoutchenko, dont je reparlerai en détail, ne partageait nullement cette adoration des souverains. Bien qu’en voie d’obtenir le prix d’excellence, elle suppliait son père de la reprendre avant la fin des études. Or, le vieux Lagoutine, si voltairien qu’il fût, trouvait flatteur que l’impératrice en personne agrafât à l’épaule gauche de sa fille l’insigne qui lui donnerait accès aux bals de la cour et poserait sa candidature au titre de demoiselle d’honneur. Ce titre faisait tourner plus d’une petite tête ambitieuse, surtout à cette époque où la beauté et la grâce attiraient l’attention du tsar et valaient de grandes faveurs non seulement à la demoiselle, mais à tous les siens. Aussi l’intérêt poussait-il souvent ces derniers à jouer le rôle honteux d’entremetteurs. Dans le cas que je vais citer, la personne intéressée n’était autre que le père de la jeune fille, riche et titrée, mais séduite par l’éclat de la vie de cour.
Читать дальше