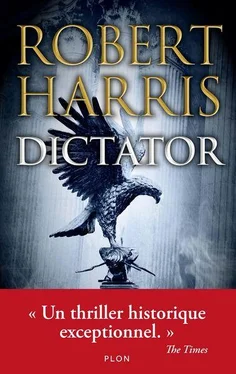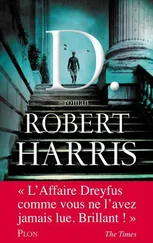Dans le cinquième livre, Cicéron proposait ses solutions pratiques. Un être humain ne peut se préparer à la mort qu’en menant une vie bonne d’un point de vue moral ; c’est-à-dire : ne rien désirer outre mesure ; se contenter de ce qu’on a ; trouver toutes ses ressources au fond de soi, de sorte que, quoi que l’on perde, on pourra continuer de vivre quand même ; ne faire aucun mal ; prendre conscience qu’il est préférable d’être blessé plutôt que de blesser autrui ; accepter que la vie est un prêt accordé par la Nature sans date d’échéance, et que le remboursement peut intervenir à tout moment ; que le personnage le plus tragique du monde est un tyran qui a violé tous ces préceptes.
Telles étaient les leçons que Cicéron avait apprises, et qu’il désirait partager avec le monde lors du soixante-deuxième été de son existence.
Nous travaillions aux Tusculanes depuis environ un mois quand, à la mi-juin, Dolabella passa nous voir. Il arrivait d’Espagne, où il avait de nouveau combattu aux côtés de César, et il rentrait à Rome. Le dictateur avait remporté la victoire ; les restes de l’armée pompéienne étaient pulvérisés. Mais Dolabella avait été blessé à la bataille de Munda. Il avait une entaille qui descendait de l’oreille à la clavicule et boitait en marchant : son cheval avait été tué sous lui d’un coup de lance, le projetant au sol avant de s’effondrer sur lui. Il était pourtant toujours animé par le même entrain. Il avait particulièrement envie de voir son fils, qui vivait à l’époque avec Cicéron, et voulait aussi se recueillir à l’endroit où reposaient les cendres de Tullia.
À quatre mois, le petit Lentulus était un beau bébé rose, aussi vigoureux que sa mère avait été frêle. On aurait dit qu’il avait aspiré toute la vie de sa mère, et je suis certain que c’est pour cela que je n’ai jamais vu Cicéron le prendre dans ses bras ni lui accorder beaucoup d’attention. Il ne pouvait réellement lui pardonner d’être en vie quand elle était morte. Dolabella prit l’enfant des bras de sa nourrice et l’examina comme si c’était un vase, avant d’annoncer qu’il aimerait le ramener avec lui à Rome. Cicéron n’y vit pas d’objection.
— J’ai prévu de quoi assurer son avenir dans mon testament. Si tu veux discuter de son éducation, viens me voir quand tu veux.
Ils se rendirent ensemble sur la tombe de Tullia, près de sa fontaine préférée, dans un endroit ensoleillé de l’Académie. Cicéron me raconta ensuite que Dolabella s’était agenouillé, avait déposé des fleurs sur la pierre et avait pleuré.
— Quand j’ai vu ses larmes, j’ai cessé de lui en vouloir. Comme Tullia l’a toujours dit, elle savait qui elle épousait. Et si son premier mari avait été un ami d’étude plus que tout autre chose, son deuxième une façon commode d’échapper à sa mère, au moins a-t-elle aimé passionnément ce troisième époux, et je suis heureux qu’elle ait connu cela avant de mourir.
Pendant le dîner, Dolabella, qui ne pouvait s’allonger à cause de sa blessure et devait donc rester assis sur une chaise pour manger comme un barbare, nous parla de la campagne d’Espagne, et nous avoua qu’ils avaient frôlé le désastre : leur première ligne avait été enfoncée, et César lui-même avait été contraint de mettre pied à terre, de saisir un bouclier et de rameuter ses légionnaires en fuite.
— Après la bataille, il m’a dit : « Aujourd’hui, pour la première fois, j’ai combattu pour ma vie. » Nous avons tué trente mille de nos ennemis et n’avons pas fait de prisonniers. Sur ordre de César, la tête de Gnaeus Pompée a été plantée sur une pique et exposée en place publique. C’était affreux, je t’assure, et je crains que lorsqu’il sera rentré, tes amis et toi ne trouviez pas le dictateur aussi aimable qu’avant.
— Tant qu’il me laissera écrire mes livres, je ne lui causerai aucun ennui.
— Mon cher Cicéron, tu es de tous les hommes celui qui a le moins de raisons de t’inquiéter. César t’aime. Il dit toujours que lui et toi êtes les deux derniers qui restent.
Plus tard cet été-là, César rentra en Italie, et tous les ambitieux de Rome se précipitèrent à sa rencontre. Cicéron et moi restâmes travailler à la campagne. Nous terminâmes les Tusculanes , et Cicéron les envoya à Atticus afin que son équipe d’esclaves pussent les copier et les distribuer — il demanda expressément qu’un exemplaire en fût remis à César —, puis il entreprit la rédaction de deux nouveaux traités, De la nature des dieux et De la divination . Il lui arrivait encore de ressentir les épines du chagrin, et il se retirait alors pendant quelques heures dans un coin reculé de la propriété. Mais dans l’ensemble, il était gagné par une sorte d’apaisement.
— Combien d’ennuis l’on évite en refusant de se mêler à la foule ! N’occuper aucune fonction et consacrer tout son temps à la littérature est la meilleure chose du monde.
Cependant, même à Tusculum, nous avions conscience, tel un orage grondant dans le lointain, du retour du dictateur. Dolabella avait raison. Le César qui revint d’Espagne n’était plus le César qui y était parti. Il ne s’agissait pas seulement de son intolérance à toute contradiction. On aurait dit qu’il avait perdu une part de la conscience des réalités qui avait fait sa force. Il fit d’abord circuler, en riposte au panégyrique de Caton écrit par Cicéron, un texte qu’il intitula Anti-Caton , plein de railleries vulgaires cherchant à faire passer Caton pour un ivrogne et un fanatique insensé. Étant donné que pratiquement tous les Romains respectaient pour le moins Caton, quand ils ne lui vouaient pas une véritable admiration, la mesquinerie de l’opuscule nuisit davantage à la réputation du dictateur qu’à celle de Caton lui-même. (« Quelle est cette nécessité de toujours tout dominer, qui pousse César à piétiner ainsi la poussière des morts ? » se demanda à voix haute Cicéron en le lisant.) Ensuite, le dictateur décida de triompher encore, cette fois pour célébrer sa victoire en Espagne, alors que beaucoup de citoyens estimaient que l’annihilation de milliers de Romains, dont le fils de Pompée, n’était pas quelque chose dont on dût se glorifier. S’ajoutait à cela sa liaison durable avec Cléopâtre : on acceptait déjà mal qu’il l’eût installée dans une somptueuse maison entourée d’un parc au bord du Tibre, et, lorsqu’il fit ériger une statue d’or de sa maîtresse étrangère dans le temple de Vénus, il offensa à la fois les dévots et les patriotes. Il alla même jusqu’à se faire passer pour un dieu — « le divin Jules » — avec son temple, son prêtre et ses images, et, tel un dieu, commença à interférer dans tous les aspects de la vie quotidienne : il limita les voyages outre-mer pour les sénateurs, interdit les repas trop raffinés et les biens trop luxueux… au point de poster des espions sur les marchés, lesquels faisaient irruption dans les foyers au milieu du dîner pour fouiller, confisquer et procéder à des arrestations.
Enfin, comme si son ambition n’avait pas déjà fait couler assez de sang au cours des dernières années, il annonça qu’au printemps il lancerait, à la tête d’une gigantesque armée de trente-six légions, une offensive contre les Parthes afin de venger la mort de Crassus. Une fois la Parthie vaincue, il comptait contourner la mer Noire et soumettre tour à tour l’Hyrcanie, le long de la mer Caspienne et du mont Caucase, la Scythie, puis tous les pays voisins de la Germanie et la Germanie elle-même, avant de revenir en Italie par les Gaules avec sa moisson de conquêtes. Il serait parti trois années, et le Sénat n’avait sur ce projet pas son mot à dire. À l’instar des hommes qui construisaient les pyramides des pharaons, les sénateurs n’étaient que des esclaves dans le grand dessein conçu par leur maître.
Читать дальше