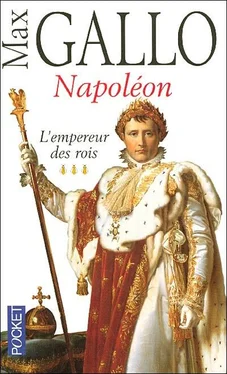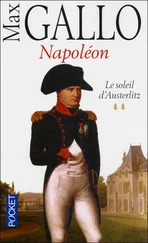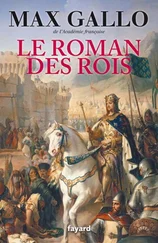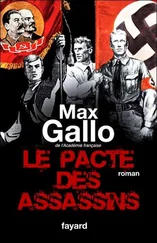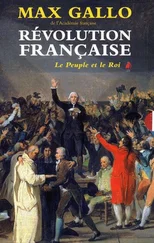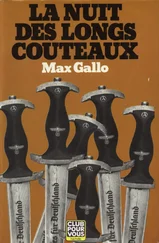Peut-être la dernière guerre, pense-t-il.
Il parcourt les galeries du château. Joséphine vient à sa rencontre. Elle insiste pour partir avec lui s'il rejoint l'armée, si la guerre éclate comme elle le craint. Elle s'installera à Mayence, elle l'attendra dans cette ville. Il donne son accord. Il a du mal à partir, et c'est la première fois.
Il convoque Cambacérès. C'est lui, durant l'absence de l'Empereur, qui sera chargé de présider la réunion des ministres chaque mercredi.
Mais - Napoléon lève la main - les ministres correspondront directement avec l'Empereur, quel que soit le lieu où il se trouve. Il veut continuer de gouverner la France comme s'il était à Paris.
Combien de temps sera-t-il absent ? Il chevauche seul dans la forêt de Saint-Cloud. Il a besoin de cette solitude pour que se mettent en place dans sa tête tous les rouages de cette machine militaire qui va broyer l'ennemi. Il rentre, commence aussitôt à dicter plus de dix lettres qui précisent la marche des différents corps de la Grande Armée.
Puis il reçoit un aide de camp du général Augereau, qui rentre de Berlin. Napoléon tourne autour du lieutenant Marbot, l'examine, le questionne.
Marbot a été reçu dans les salons berlinois. Que pense-t-il de cette reine Louise, qui insulte l'Empereur ? Belle ? Elle veut, dit-on, assister à la guerre ? Blonde, n'est-ce pas ? demande Napoléon.
Il sourit en écoutant le jeune lieutenant qui dit d'abord que la reine Louise a défilé à Berlin à la tête du régiment des dragons de la reine, et que, selon le général von Blücher, elle entrera avec ses dragons à Paris.
- Belle femme ? questionne à nouveau Napoléon.
Marbot le confirme. Mais une seule chose la dépare, dit-il. Elle porte toujours une grosse cravate, afin, dit-on, de cacher un goitre assez prononcé qui, à force d'être tourmenté par les médecins, s'est ouvert et répand une matière purulente, surtout lorsque la reine danse, ce qui est son divertissement de prédilection.
Napoléon baisse la tête. Ce n'est donc que cette femme-là, la reine Louise, elle dont on dit qu'elle a fasciné le tsar Alexandre ?
- Et les Prussiens ? demande Napoléon.
Ce maréchal Brunswick, qui a commandé l'armée qui voulait punir Paris en 1792, et qui a été battu à Valmy, que vaut-il ?
Marbot hésite, puis rapporte simplement que les gendarmes de la Garde noble ont parcouru les rues de Berlin en criant qu'il n'y avait pas besoin de sabres pour ces chiens de Français, qu'il suffisait de gourdins. Ils sont allés affûter leurs sabres sur les marches de l'ambassade de France...
Napoléon porte la main à la poignée de son épée.
- Fanfarons ! lance-t-il. Insolents !
Puisque le duc de Brunswick commande à nouveau l'armée prussienne, comme il y a quatorze ans, il va découvrir que les armes françaises sont en bon état. Napoléon souhaite au lieutenant Marbot une guerre glorieuse.
Il se souvient de sa jeunesse d'officier. Il se sent soldat de la Révolution.
À 16 h 30, le jeudi 25 septembre 1806, il monte dans sa voiture et quitte Saint-Cloud. Joséphine est dans l'une des voitures qui suivent la berline de l'Empereur. La nuit tombe. On dîne à Châlons puis on repart dans l'obscurité et l'on roule jusqu'à Metz, le lendemain vendredi à 14 heures. Puis ce seront Saint-Avold, Sarrebruck, Kaiserslautern, et enfin Mayence, tôt le dimanche 28 au matin, alors que le jour pointe seulement.
Il est las. Il consulte les dépêches. La Grande Armée est déjà concentrée autour de Bamberg. Il vérifie la position de chaque corps, le nombre des hommes : il doit disposer de près de cent soixante-six mille soldats. Mais est-ce la guerre ?
Tout est prêt pour le déclenchement. Les Prussiens, commandés par le maréchal duc de Brunswick et le prince de Hohenlohe, se sont rassemblés autour d'Iéna. Et cependant le conflit n'a pas encore éclaté.
« La guerre n'est pas encore déclarée, dit Napoléon à Berthier le 29 septembre. On ne doit commettre aucune hostilité. »
Mais il ne faut jamais se laisser surprendre. Il ordonne l'achat de milliers de chevaux, fait reconnaître les chemins de Leipzig et de Dresde. Il examine minutieusement les rapports des officiers qu'il a envoyés en reconnaissance en Thuringe et en Saxe. La guerre est bien là. Les intentions prussiennes sont claires. Brunswick avance par la vallée du Main vers le Rhin. Napoléon dicte des ordres pour Berthier, écrit à Fouché.
« Les fatigues ne sont rien pour moi, dit-il. Je regretterais la perte de mes soldats si l'injustice de la guerre que je suis obligé de soutenir ne faisait retomber tous les maux que l'humanité va encore éprouver sur les rois faibles qui se laissent conduire par de brouillons vendus. »
Il est tendu. « Il est possible que les événements actuels ne soient que le commencement d'une grande coalition contre nous, et dont les circonstances feront éclore tout l'ensemble », écrit-il à Louis.
Il faut faire face. Dans la journée du 1 er octobre, il donne ses dernières directives. Il va lui-même partir pour Würzburg en fin de journée. L'armée doit achever de converger vers cette ville et Bamberg.
Il voit s'avancer vers lui Joséphine en compagnie de Talleyrand, qui a rejoint lui aussi Mayence. Il s'approche d'eux en marchant lentement. Il va quitter la ville, dit-il, il roulera de nuit, traversera Francfort pour atteindre Würzburg.
Joséphine est en larmes, et tout à coup Napoléon sent ses jambes fléchir. C'est comme si son corps fondait. Il s'accroche à Talleyrand et à Joséphine. Il ne peut retenir ses larmes. La tension accumulée, les fatigues de ce labeur de dizaines d'heures pour préparer la guerre l'écrasent tout à coup.
On le porte dans une chambre. Il est saisi de convulsions et de spasmes. Il vomit. Son visage est terreux.
Il reste ainsi plusieurs minutes, le corps tendu, couvert de sueur, secoué de soubresauts, les mâchoires serrées.
Puis, peu à peu, il retrouve son calme, regarde autour de lui et, sans un mot, il se lève, écartant ceux qui l'entourent.
Il se dirige vers sa voiture d'un pas alerte, comme s'il ne s'était rien produit.
Il part pour Würzburg, ainsi qu'il l'avait prévu. Il est 22 heures.
Que s'est-il passé en lui ?
Il y songe alors que la berline roule dans la nuit vers Francfort où il devrait arriver à 1 heure du matin, ce jeudi 2 octobre 1806. Il a décidé de dîner rapidement avec le prince primat, puis de poursuivre jusqu'à Würzburg.
Il étend ses jambes. Il déteste que son corps le trahisse. Quel est ce signe ? Faut-il qu'il voie le docteur Corvisart ? Mais il se sent bien maintenant. Et cette énergie qui rayonne à nouveau en lui le rassure, le met de bonne humeur. Il chantonne.
Tout au long du dîner à Francfort, il est gai, et quand il arrive à Würzburg, à 22 heures, il se sent dispos. Il plaisante avec ses aides de camp, entre d'un pas alerte dans le palais du grand-duc, qui est l'ancienne demeure des évêques de la ville.
Devant le grand escalier, il s'arrête. Il regarde cette foule de princes allemands qui se pressent autour de lui. Il reconnaît le roi de Wurtemberg, s'approche de lui, le prend familièrement par le bras.
Il a appris à être aussi seul, aussi libre dans une foule que dans une forêt. Les regards des autres ne l'atteignent pas. Et, quand il croise des yeux, ceux-ci se baissent. Il domine. Il est au-dessus du grouillement des hommes, au sommet, dans l'atmosphère rare de ceux qui disposent du sort des peuples et inscrivent leur nom dans l'Histoire.
Il dit au roi de Wurtemberg que, chef de la famille impériale, il a décidé de marier son frère Jérôme à la fille du roi, Catherine de Wurtemberg. À cet effet, il a, par un sénatus-consulte, fait de Jérôme - qui a renoncé à son épouse américaine et s'est ainsi plié à la volonté de Napoléon - un prince français qui entre en ligne de compte dans l'hérédité impériale. Le roi de Wurtemberg s'incline, fait état des pressions prussiennes, d'une lettre qu'il a reçue du duc de Brunswick le menaçant de faire flotter les aigles de Prusse sur Stuttgart si le Wurtemberg ne quitte pas la Confédération du Rhin.
Читать дальше