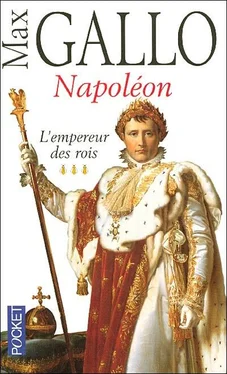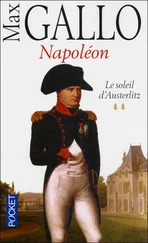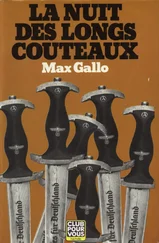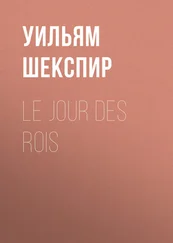Et il ajoute pour Augusta, l'épouse d'Eugène : « Ménagez-vous bien dans votre état actuel, et tâchez de ne pas nous donner une fille. Je vous dirai la recette pour cela, mais vous n'y croirez pas : c'est de boire tous les jours un peu de vin pur. »
Il se souvient avec plaisir d'Augusta de Bavière. Elle lui écrit souvent. « Votre femme a été plus aimable que vous », dit-il à Eugène. Et parfois, quand Napoléon voit s'avancer, dans le salon de Joséphine, Stéphanie de Beauharnais, la nièce de l'Impératrice, il retrouve le plaisir qu'il a eu à côtoyer Augusta.
Plus il vieillit, et plus il aime les jeunes femmes, et Stéphanie n'a que dix-sept ans en 1806.
C'est une adolescente gaie, espiègle, aux traits réguliers que couronnent des cheveux blonds.
Napoléon aime la contempler, plaisanter avec elle, et il devine, dans les regards que lancent Joséphine ou Caroline Murat, l'inquiétude et la jalousie.
Un soir, alors qu'il entre dans le salon de l'Impératrice, il découvre Stéphanie en larmes. Caroline a exigé, apprend-il, que Stéphanie reste debout, conformément à l'étiquette impériale qui interdit que l'on s'asseye devant les « princesses sœurs de Sa Majesté ».
Napoléon prend Stéphanie par la taille, la fait asseoir sur ses genoux et passe la soirée à chuchoter à l'oreille de l'adolescente sous les regards courroucés de Caroline Murat.
Le lendemain, parce qu'il est celui qui peut tout, il décide d'adopter la jeune fille qui, désormais, dicte-t-il au comte de Ségur, grand maître des cérémonies, « jouira de toutes les prérogatives de son rang dans tous les cercles, fêtes et à table. Elle se placera à Nos côtés et dans le cas où Nous ne Nous y trouverons pas, elle sera placée à la droite de l'Impératrice ».
Ainsi l'on montre que l'on décide de tout .
Quelques jours plus tard, Napoléon choisira le mari de Stéphanie, Charles, le prince héritier de Bade, qui a été fiancé à Augusta puis écarté au bénéfice d'Eugène de Beauharnais.
Voilà ce que je veux .
Stéphanie aussi doit plier. Paris illumine pour son mariage. Les cérémonies sont fastueuses. Napoléon dote sa fille adoptive d'une rente de 1 500 000 francs et d'un trousseau de 500 000 francs. Mais, quand il apprend que Stéphanie refuse sa porte à son mari, il lui intime l'ordre de quitter Paris pour Karlsruhe.
« Soyez agréable à l'Électeur de Bade, il est votre père, dit-il. Aimez votre mari pour tout l'attachement qu'il vous porte. »
C'est moi qui dicte le comportement des membres de ma famille et j'entends qu'on m'obéisse .
Mais il faut chaque jour - et presque chaque heure - ordonner, conseiller, morigéner, rappeler à ceux qu'on a fait roi ou prince qu'ils ne sont que des vassaux, des exécutants de la pensée impériale, des rouages du Grand Empire.
C'est Murat, le munificent prince Joachim maintenant grand-duc de Berg, qui réclame des garanties pour ses enfants. Oublie-t-il celui grâce à qui il est prince ? Et qui tient seul entre ses mains l'avenir de l'Empire et des États fédératifs qui lui sont associés ?
« Quant à la garantie de vos enfants, lui lance Napoléon, c'est un raisonnement pitoyable et qui m'a fait hausser les épaules : j'en ai rougi pour vous. Vous êtes français, j'espère, vos enfants le seront ; tout autre sentiment serait si déshonorant que je vous prie de ne m'en jamais parler. »
Napoléon s'interrompt. L'aveuglement de ces hommes, qu'il a couverts de titres, d'honneurs et d'argent, l'étonne et le révolte. Il a des accès de mépris pour eux et de la commisération. Il pressent que la plupart d'entre eux se détacheraient de lui s'il était vaincu ou même seulement affaibli. C'est pour cela aussi qu'il faut les tenir dans une poigne de fer, les harceler, les surveiller, les contraindre.
Il ajoute à l'intention de Murat :
« Il serait fort extraordinaire qu'après les bienfaits dont le peuple français vous a comblé vous pensiez à donner à vos enfants le moyen de lui nuire ! Encore une fois, ne me parlez plus de cela, c'est trop ridicule. »
Mais ils sont tous, autour de Napoléon, semblables à Murat et à son épouse Caroline Bonaparte - tous avides, se préoccupant de leur sort plutôt que du sort de l'Empire.
La mère de l'Empereur elle-même réclame, alors qu'elle est couverte d'or, une rente apanagère sur le Trésor public, ce qui signifie que Letizia Bonaparte envisage la mort de son fils Napoléon et prend ses précautions pour s'assurer des revenus après son décès éventuel !
Napoléon n'a qu'un haussement d'épaules lorsqu'il apprend cette démarche, puis, avec une grimace d'amertume, il donne son accord pour que sa mère soit satisfaite !
Elle aussi, comme les autres, est incapable de voir au-delà de son intérêt immédiat et personnel.
Ainsi Louis, devenu roi de Hollande, accable-t-il l'Empereur de demandes d'assistance.
N'est-il pas roi, pourtant ? N'a-t-il pas un État ?
« Je n'ai point d'argent, lui répond Napoléon. Que le moyen qu'on vous propose d'avoir recours à la France est commode ! Mais ce n'est pas le temps des jérémiades, c'est de l'énergie qu'il faut montrer... »
Mais ont-ils de l'énergie, ces frères que j'ai faits rois, ces hommes que j'ai faits princes, ces généraux auxquels j'ai donné ma confiance ?
Il faut donc que Napoléon les guide, par des dépêches quotidiennes.
Les courriers partent plusieurs fois par jour de la Malmaison, de Saint-Cloud, des Tuileries, pour Naples, Parme, Düsseldorf, Amsterdam.
Il dit au général Junot : « Vous ne sauriez être clément qu'en étant sévère, sans quoi ce malheureux pays et le Piémont sont perdus et il faudra des flots de sang pour assurer la tranquillité de l'Italie... »
Junot exécute les ordres, détruit les villages rebelles.
« Je vois avec plaisir, commente Napoléon, que le village de Mezzano qui a pris le premier les armes sera brûlé... Il y aura beaucoup d'humanité et de clémence dans cet acte de rigueur, parce qu'il préviendra d'autres révoltes. »
Mais la tentation de ces hommes est toujours de se faire aimer plutôt que de gouverner avec la force nécessaire .
Napoléon s'indigne quand il lit les rapports que Joseph lui envoie de Naples. Il n'a que peu de confiance en ce frère aîné qui n'a jamais affronté les combats.
Il lui répète : « Quand on a de grands États, on ne les maintient que par des actes de sévérité », alors que Joseph s'imagine que les Napolitains le portent dans leur cœur !
Il se croit roi de toute éternité. Il a déjà effacé de son esprit qu'il n'est souverain de Naples que par la volonté et les armes de l'Empereur ! Pour qui se prend-il ?
« Vous comparez l'attachement des Français à ma personne à celui des Napolitains pour vous, lui écrit Napoléon. Cela paraîtrait une épigramme. Quel amour voulez-vous qu'ait pour vous un peuple pour qui vous n'avez rien fait, chez lequel vous êtes par droit de conquête avec quarante mille à cinquante mille étrangers ? »
Mais Joseph veut-il voir cette réalité en face ?
Napoléon ricane, amer.
Ils ne comprennent rien !
« Mettez bien ceci dans vos calculs, dit-il à Joseph, que quinze jours plus tôt ou plus tard vous aurez une insurrection... Quelle que chose que vous fassiez, vous ne vous soutiendrez jamais dans une ville comme Naples par l'opinion... Mettez de l'ordre, désarmez, désarmez. »
Il faut lui répéter : « Faites condamner à mort les chefs des masses... Tout espion doit être fusillé ; tout chef d'émeute doit être fusillé ; tout lazzarone qui donne des coups de stylet à un soldat doit être fusillé. »
Mais Joseph comprendra-t-il que gouverner est un art plein d'exigence et de rigueur ?
Читать дальше