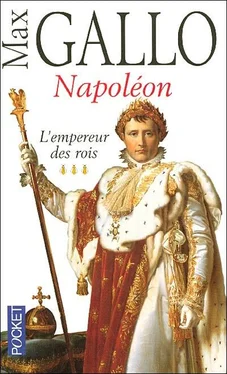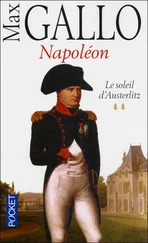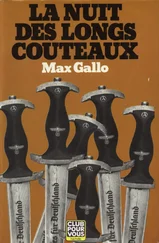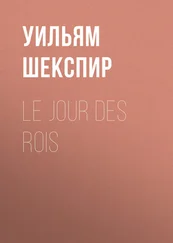Napoléon entre dans les détails : la cuisine d'un souverain doit être surveillée, sinon gare au poison. Aucune précaution ne doit être négligée dans la vie quotidienne d'un roi. « Personne ne doit entrer chez vous la nuit, que votre aide de camp qui doit coucher dans la pièce qui précède votre chambre à coucher ; votre porte doit être fermée en dedans et vous ne devez ouvrir à votre aide de camp que lorsque vous avez bien reconnu sa voix, et lui-même ne doit frapper à votre porte qu'après avoir eu soin de fermer la porte de la chambre où il se trouve... »
Il faut tout enseigner à Joseph. La prudence d'un roi et l'art de la guerre. Et pour quel résultat ?
« Votre gouvernement n'est pas assez vigoureux, vous craignez d'indisposer les gens », doit encore écrire Napoléon le 5 juillet 1806. Et quelques jours plus tard, quand il apprend que les Anglais ont débarqué, battu le général Reynier, son indignation éclate, plus cinglante : « Ce serait vous affliger inutilement que de vous dire tout ce que je pense, écrit-il. Si vous vous faites roi fainéant au lieu de m'être utile, vous me nuirez car vous m'ôterez de mes moyens... » Et, lorsque Joseph sollicite une audience à Saint-Cloud, la réponse jaillit comme un soufflet : « Un roi doit se défendre et mourir dans ses États. Un roi émigré et vagabond est un sot personnage. »
Ce que voudraient Joseph et Louis, et tous, princes, maréchaux, c'est la paix, de façon à pouvoir jouir de leur pouvoir et de leurs biens.
Napoléon le sait. Il a le même désir, dit-il.
Un jour de février 1806, il accorde une audience à Talleyrand. Le ministre des Relations extérieures est rayonnant. Il vient de recevoir une dépêche en provenance de Londres. Fox, qui a succédé à William Pitt, lui annonce qu'il a eu connaissance d'une tentative d'assassinat contre le « Chef des Français » et qu'il a fait arrêter son auteur. Un signe, n'est-ce pas, des intentions pacifiques de Fox ? Peut-être va-t-on retrouver le climat qui conduisit, en 1802, à la paix d'Amiens, ce grand moment d'espoir.
- Remerciez Fox de ma part, dit Napoléon. La guerre entre nos deux nations est une querelle inutile pour l'humanité...
Il le pense, mais il faudrait, pour parvenir à la paix, des concessions réciproques. Or, chacun se méfie.
En mai, lorsque Napoléon apprend que les Anglais ont décidé le blocus de tous les ports de l'Elbe à Brest, il s'indigne. Comment répondre à cette mesure, sinon en montrant que le Continent est unifié, ce qui suppose que l'on obéit et que l'on accepte la domination de l'Empereur, que l'on approuve cette réorganisation des États qui, du royaume de Naples à celui de Hollande, fait de Napoléon l'Empereur des rois ? Il est le souverain qui dicte sa loi, exige que tous les ports soient fermés aux Anglais.
Mais déjà le pape, en ce qui concerne ses ports, s'y refuse.
« Il verra, tonne Napoléon, si j'ai la force et le courage de soutenir ma couronne impériale. Les relations du pape avec moi doivent être celles de ses prédécesseurs avec les empereurs d'Occident. »
L'engrenage se met en route une nouvelle fois. Les négociateurs anglais, lord Yarmouth et lord Lauderdale, sont à Paris mais ils refusent de céder la Sicile, de renoncer au blocus. Et Fox meurt le 13 septembre 1806. Est-ce la fin du parti de la paix ? Napoléon s'interroge.
Le continent européen est son arme. Mais chaque pas qu'il fait pour le réunir sous son autorité déclenche des inquiétudes, suscite des ripostes.
Aux mois d'août et septembre 1806, alors qu'il séjourne au château de Saint-Cloud, puis à Rambouillet, Napoléon est plus impatient qu'à l'habitude de recevoir les dépêches de Berlin et de Saint-Pétersbourg.
Il sait que la Prusse est inquiète depuis qu'il a constitué la Confédération du Rhin sous son autorité. Quant à la Russie, elle a refusé de signer le traité de paix. Une quatrième coalition s'esquisse, regroupant la Prusse, la Russie et, naturellement, l'Angleterre. Mais Napoléon veut être prudent.
« Vous ne savez pas ce que je fais, dit-il à Murat. Restez donc tranquille. Avec une puissance telle que la Prusse, on ne saurait aller trop doucement. »
Point de guerre, la paix, voilà son vœu. Les soldats de la Grande Armée sont encore cantonnés en Allemagne et rêvent de rentrer en France.
« Je veux être bien avec la Prusse », répète Napoléon à Talleyrand. Que le ministre donne des consignes en conséquence à Laforest, l'ambassadeur de France à Berlin. Mais celui-ci envoie des dépêches alarmantes.
Napoléon les lit à mi-voix. Berlin arme. Les troupes prussiennes font mouvement vers la Hesse et la Saxe pour y devancer Napoléon et enrôler les armées de ces États dans les rangs prussiens.
Est-il possible que Frédéric-Guillaume et son épouse, la belle reine Louise, prennent ainsi le risque de la guerre ? Là où les armées russes et autrichiennes n'ont pas réussi, les Prussiens espèrent-ils vaincre ?
Le 10 septembre 1806, Napoléon dit à Berthier :
- Les mouvements de Prusse continuent à être fort extraordinaires. Ils veulent recevoir une leçon. Je fais partir demain mes chevaux et dans peu de jours ma Garde.
3.
Ce jeudi 11 septembre 1806, Napoléon, dans sa chambre du château de Saint-Cloud, reste longuement immobile devant la fenêtre ouverte.
Il est à peine 7 heures. Il s'est levé plus tôt que d'habitude. Il a convoqué le grand écuyer Caulaincourt, qui attend dans l'antichambre. Il doit lui ordonner de préparer toutes les lunettes, les portemanteaux, une tente avec un lit de fer, des tapis, de nombreux tapis épais pour le bivouac en campagne, et le petit cabriolet de guerre, puis de faire partir pour l'Allemagne une soixantaine de chevaux.
Napoléon a déjà établi que son quartier général s'installera à Würzburg, puis à Bamberg, au sud de l'Allemagne, à la jointure de la Prusse et de la Saxe. Là se rassemblera la Grande Armée, afin d'empêcher les troupes russes de rejoindre les troupes prussiennes. On pourra, à partir de là, remonter vers le nord, tourner les troupes de Frédéric-Guillaume et entrer dans Berlin.
Napoléon s'appuie au rebord de la fenêtre. Il réside au château de Saint-Cloud depuis le début du mois d'août. Il aime la forêt qui entoure les bâtiments. Il y chasse à sa guise, sur un coup de tête, quant tout à coup il est pris du besoin d'agir, de respirer.
Ce matin, la brume enveloppe la forêt. L'air est humide et frais. Il songe à cet hiver qui s'approche et qu'il vivra dans des chambres inconnues, apprêtées à la hâte, ou sous la tente.
Il faut que Caulaincourt pense aux tapis épais, aux pelisses, au vin de chambertin, aux fourgons qui doivent se trouver à chaque étape, avec la vaisselle, les provisions de bouche, de manière à reconstituer en quelques heures un décor familier.
L'Empereur regarde la forêt. Il a dirigé trop d'armées en campagne pour s'illusionner. Il devra marcher au milieu des soldats, subir l'averse, chevaucher, coucher sur un manteau, affronter le vent. Il s'étonne lui-même de ces pensées. Il se retourne, fait quelques pas dans la chambre, se découvre dans le miroir qui occupe toute une cloison.
A-t-il changé à ce point ? Est-ce la jeunesse qui s'en est allée avec la maigreur, et la lassitude qui vient avec l'embonpoint ? Peut-être est-il comme ses maréchaux et ses frères, désireux d'avoir la paix pour jouir des palais, du luxe, des jeunes femmes ?
Il se détourne, appelle Caulaincourt.
Il apprécie ce marquis d'ancienne noblesse qu'il a fait général de division, choisi comme écuyer et qui sait faire preuve d'initiative. Caulaincourt ose même parfois défendre son point de vue. Indépendance d'esprit utile, car elle permet à Napoléon d'aiguiser sa propre pensée.
Читать дальше