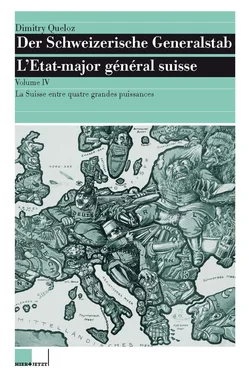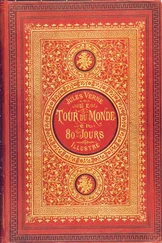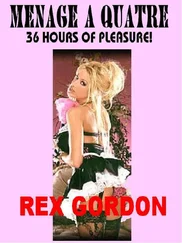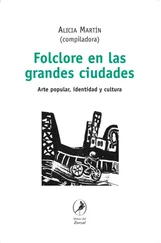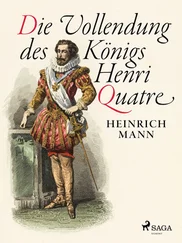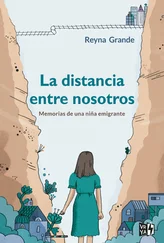Un deuxième chapitre étudie l’une des plus importantes activités de l’Etat-major général: l’élaboration des plans de mobilisation de l’armée. Cette activité a été régie successivement par deux documents essentiels qui structurent la première moitié du chapitre: l’instruction sur la mise sur pied de l’armée du 18 novembre 1878 et l’ordonnance sur la mobilisation du 18 novembre 1884. Ce dernier texte législatif fut complété trois ans plus tard par une ordonnance sur le Service territorial, le Service des étapes et celui des chemins de fer, formant ainsi un ensemble cohérent qui sera amélioré constamment sous l’ère Keller, qui forme la deuxième partie du chapitre.
Le chapitre III s’intéresse à la formation des officiers de l’Etat-major général et à leurs activités. Il analyse les différents documents régissant les modalités de recrutement et de formation – sélection, cursus et enseignements des différentes écoles –, ainsi que les carrières, avec le lancinant problème du retour périodique à la troupe. Il met en lumière les différences existant entre les textes législatifs et la réalité des pratiques quotidiennes dans ces divers domaines, ainsi que les différentes conceptions relatives à la fonction d’officier EMG. L’approche est largement quantitative, avec l’utilisation de nombreuses données statistiques sur les carrières et les activités des membres de l’Etat-major général au sein ou en dehors de l’institution.
Enfin, le dernier chapitre aborde la double question des compétences de l’Etat-major général et de ses relations avec les autres instances militaires. Organisation naissante au début de la période étudiée, l’Etat-major général ne possédait que des pouvoirs limités. Il partageait certaines compétences particulièrement importantes avec d’autres services du Département militaire fédéral, comme le chef d’arme de l’infanterie. Les habitudes antérieures, notamment la constitution de commissions, ne furent, par ailleurs, que peu à peu abandonnées. Ultérieurement, l’ère Keller fut marquée par une nouvelle répartition des pouvoirs, avec la consolidation de la position institutionnelle de l’Etat-major général et l’apparition de nouveaux acteurs en la personne des commandants de corps d’armée. La seconde partie du chapitre s’intéresse aux critiques faites à l’encontre de l’Etat-major général. Celui-ci fut accusé de cultiver un esprit bureaucratique et de caste. Des attaques plus violentes, qui ne visaient pas prioritairement l’Etat-major général, et que l’histoire a retenues sous le nom d’affaire de l’hydre, font l’objet de la fin du chapitre.
La seconde partie de l’ouvrage est consacrée aux relations politico-militaires de la Suisse avec ses quatre grands voisins. Le plan est articulé selon le principe chronologico-thématique. Nous avons divisé l’ensemble de la période en deux, avec l’année 1890 comme césure. Cette date constitue en effet une rupture à plus d’un titre. Tout d’abord, au niveau international, elle marque la fin de l’ère bismarckienne en Allemagne et le début d’une nouvelle politique, la Weltpolitik, avec l’avènement de Guillaume II et de Leo von Caprivi. De plus, le début des années 1890 voit aussi la Russie se détacher de l’Allemagne et se rapprocher de la France. Enfin, dès 1891, Alfred von Schlieffen remplace Alfred von Waldersee à la tête du Grand Etat-major allemand.
Sur le plan national, l’année 1890 représente un double tournant. Arnold Keller devient chef de l’Etat-major général, fonction qu’il occupera jusqu’en 1905. Cette nomination a donné une impulsion nouvelle à l’Etat-major général. En effet, la compétence technique de Keller, la durée de son activité et le fait que, pour la première fois, le chef de l’EMG soit nommé à titre permanent ont permis un développement significatif de l’institution. L’arrivée de Keller à la tête de l’Etat-major général a toutefois aussi marqué la fin de la bonne coopération entre ce dernier et le Département des affaires étrangères. Celle-ci avait commencé quelques années plus tôt, au moment de la crise boulangiste et était le fait de la bonne entente personnelle entre Alphons Pfyffer et Numa Droz. Enfin, au point de vue de la diplomatie, le début de la décennie marque la fin du «système Droz» et le retour aux pratiques anciennes en matière de relations extérieures, après le départ du Conseiller fédéral neuchâtelois en 1892.
Les deux périodes ont été abordées de manière thématique. Nous avons essentiellement travaillé par front. En raison du contexte politique international et de la situation géographique, nous avons distingué le front nord-ouest et le front sud. Le premier d’entre eux correspond bien évidemment au cas d’une guerre franco-allemande au cours de laquelle la Suisse pouvait être impliquée. Toutefois, l’Etat-major général a aussi envisagé la possibilité d’une action militaire directe de la part de la France ou de l’Allemagne. Nous verrons que la France a été perçue, pour diverses raisons, comme une menace particulièrement aiguë jusqu’au milieu des années 1880. Quant à l’Allemagne, une certaine méfiance est née à la suite de l’affaire Wohlgemuth, qui a montré que la neutralité helvétique pouvait être remise en cause par les Puissances.
La question du front sud est plus complexe. Elle ne se limite pas à la seule menace d’un conflit direct avec l’Italie. En raison de sa position géographique, la Suisse pouvait être directement impliquée en cas de guerre entre l’Italie et la France ou l’Autriche. Ce danger était particulièrement grand dans la première hypothèse, car les plus importantes lignes d’opérations entre les deux pays se trouvaient sur sol helvétique. De plus, la neutralisation de la Savoie pouvait également entraîner la Suisse dans les hostilités. Par ailleurs, la signature de la Triplice a fait naître un nouveau danger: celui d’un passage des armées italiennes à travers le territoire suisse, dans le but de coordonner l’action militaire germano-italienne contre la France. Dès lors, les chapitres relatifs au front sud comprennent également les thèmes en rapport avec le problème de la neutralité savoyarde et celui de la Triplice. Enfin, il faut encore dire deux mots du front est. Des quatre voisins de la Suisse, l’Autriche a été celui qui a été considéré comme le moins menaçant. L’Etat-major général a peu travaillé à l’hypothèse d’une guerre contre ce pays et la place qui revient à cette question se limite à la portion congrue.
La partie consacrée à la période 1890–1905 contient également deux autres chapitres. Le premier se rapporte à la nouvelle conception de la neutralité développée à la fin des années 1880, qui est née de la menace qui a commencé à peser sur son respect par les Puissances. Le second étudie les plans généraux de défense établis par l’Etat-major général. Ces plans correspondent aux préparatifs stratégiques destinés à jouer un rôle dans n’importe quelle situation de guerre. Ils comprennent les fortifications semi-permanentes en plaine, ainsi que les travaux découlant de l’importance stratégique du massif alpin.
Le fonds E 27 des Archives fédérales représente la première source employée pour cette étude. Il contient l’ensemble des documents émis par les différentes instances militaires au cours de la période: Département militaire fédéral, Etat-major général, chefs d’arme et de service, etc. Cette documentation a été complétée au moyen des informations recueillies dans les rapports annuels de gestion du DMF qui ont été dépouillés de manière systématique. La Revue militaire suisse, qui figure parmi les plus importantes publications militaires de l’époque, a également fait l’objet d’un traitement identique. Présentant de manière détaillée les différentes questions abordées, citant ou reproduisant, intégralement ou partiellement, des articles publiés dans d’autres périodiques militaires, la RMS a constitué une source particulièrement précieuse pour notre travail. Enfin, diverses publications de contemporains, livres, articles, ont également été consultées.
Читать дальше