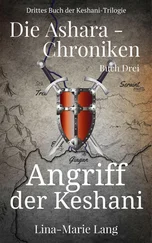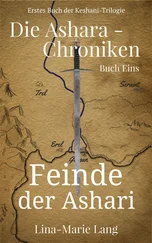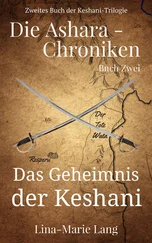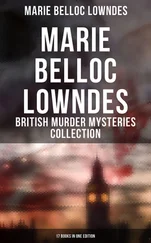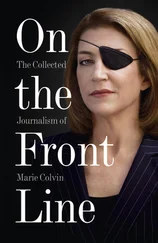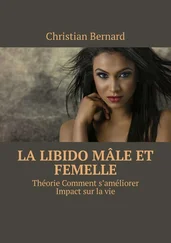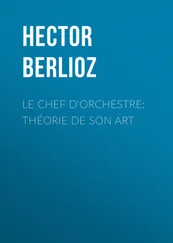De tout cela se dégage une vision ethnologique, tragique et pessimiste du monde. La finalité dernière est de se détourner du combat contre le néocolonialisme critiqué par Césaire, Nkrumah, Fanon, Cabral, Machel, Towa, etc. Pour ces penseurs en effet, sa liquidation et son dépassement signifient la condition ultime du renouvellement culturel des sociétés africaines, car la lutte nationale est un acte de création culturelle par excellence, en tant qu’elle purifie, unifie et redonne cohérence et continuité aux anciennes formes éclatées de la nation à la suite de la domination politique. En enlevant à l’ancienne culture les repères stables et signifiants qui lui donnaient de l’intelligibilité, la domination politique appauvrit le monde majestueux d’hier avec ses dieux. Ce dernier, sans sève cohérente qui l’irrigue, accouche d’un univers terrifiant de monstres, d’esprits maléfiques, de magiciens et des sorcelleries et installe la vulgarité. La créativité d’une esthétique de la vulgarité est donc la fille de toute domination politique. Dès lors, hâter « une bonne décolonisation », c’est éviter que la servitude ne soit intériorisée, réadaptée. Par elle, il s’agit de restructurer la culture, loin du chaos culturel, en se nourrissant de toute la culture universelle, refondue et transcendée.
Cette analyse nous éloigne de l’actuel discours sur l’appropriation culturelle dans la pensée décoloniale. En revenant à une forme subtile de ségrégation, ce courant de pensée balkanise, segmente et fragmente l’humanité par la race. Il biologise le culturel. Or, Frantz Fanon a fermement refusé toute racialisation de la pensée et de la culture. En posant le problème culturel en termes de race ou de couleur de peau, la pensée décoloniale ne pose plus le problème en termes de choix entre la liberté et la servitude ; elle fait donc le jeu du capitalisme qui évite de rapprocher, mais disloque et sépare les hommes et les cultures. En fait, elle subvertit la culture pour maintenir l’asservissement. De ce point de vue aussi, la stylistique de l’obscénité reprend de façon mécanique les déchets culturels ou la sous-culture (grossièreté des mœurs africaines) sélectionnés pour nous par la civilisation dominante elle-même, en vue de nous manipuler ; ce qui est un accident de l’histoire devient un trait fondamental de l’Africain substantialisé.
Pour montrer l’irruption de l’esthétique postcoloniale, Nkolo Ndjodo élabore des aperçus historiques qui portent sur Nietzsche qui produit une critique ironique de la modernité consacrant le rire, le simulacre, l’illusion, la fable et le mythe. Heidegger pour sa part décentre le sujet logique aristotélicien, devenu a-conceptuel, a-catégorial – de telle sorte que c’est dans la rhétorique et la poésie que la Destruktion trouve sa fin. Ce sont de telles tendances que les sciences mathématiques et physiques affirment dans l’incomplétude ; Freud dans l’inconscient ; Bergson dans la critique du sujet rationnel voué au mécanique ; le dadaïsme, le cubisme, le surréalisme où se préforme une profonde révolte contre l’esprit ; enfin la fin et la délégitimation de ce que Lyotard appelle les « métarécits » et les grands projets de la modernité (le sujet, la vérité, la raison, l’État, le sens, l’art, la nation, la beauté, la liberté, l’émancipation). De là est né le nivellement de tous les discours ; l’expérience logique et historique a alors été convertie en expérience esthétique. Cette esthétisation a cassé les codes classiques en ramenant l’art dans la « rue », à travers un abaissement culturel qui se méfie des styles (comme on le voit chez le musicien nihiliste Franko, pour lequel il n’y a ni Dieu ni maître, ni père ni mère, ni sœur), des écoles, des avant-gardes artistiques modernes, au profit du kitsch . Le postcolonialisme esthétique, dans sa vision excrémentielle et scatophile de l’Afrique, sollicite comme le postmodernisme les idéologies de la différence logique, historique et culturelle. Aussi valorise-t-il l’obscène, en montrant les Africains à partir de traits physiques glauques (le sexe, les fesses, l’anus), leurs traits psychologiques, intellectuels et moraux (l’ignorance, la gourmandise et la concupiscence). Est par là suggérée l’idée qu’il faut fuir la crasse et la boue de cette Afrique-là – par l’errance et l’exil dans un monde enchevêtré, sans frontières, cosmopolite. Il s’agit, dit Nkolo Ndjodo, de la quête en larbin d’une « nouvelle liberté » dirigée, corsetée : « L’intellectuel postcolonisé africain clame son attachement à la « culture internationale » et professe la « déclosion du monde » ; il affiche ses convictions « cosmopolites » et affirme appartenir à une humanité transfrontalière ; il récité le bréviaire postmoderne sur le flottement du monde, la volatilité des identités et le démantèlement des pratiques théoriques et esthétiques classiques fondées sur la primauté de la raison universelle et le triomphe des Lumières.
Il reste que la guerre livrée aux individus, aux sociétés et aux peuples implique tout à la fois de grandes souffrances psychiques et d’importants dysfonctionnements socio-culturels qui brident le potentiel créateur de la société. Elle a poussé à rompre avec la notion de goût, d’équilibre, d’harmonie dans les choses. Aussi la beauté, dans une Afrique malade du marché mondial, devient-elle l’objet d’un anathème furieux : « La notion de style se dilue dans la superficialité et le public, réduit au rang de simple consommateur avide de « s’enjailler », adopte un suivisme hostile au sublime. Les « petites préoccupations » de sexe, d’argent et de luxe dominent le centre de la production artistique. La bassesse devient la norme du goût ».
La force du propos de Nkolo Ndjodo est de souligner qu’une approche académique et universitaire, sous la forme d’un ensemble de courants, de doctrines, de méthodologies et de concepts forgés dans les champs de la philosophie, des sciences humaines et sociales et des sciences esthétiques, accompagne et cornaque les œuvres pour borner l’horizon dans la concentration flexible du capital au sein du marché mondial. Une autre thèse forte de cet essai est que les forces qui composent la dialectique historique sont certes matérielles, mais elles sont aussi théoriques, les forces intellectuelles étant concrètes, vivantes, réelles. Aussi une conceptualisation pertinente de l’imaginaire africain « postcolonial » doit-elle discuter les mutations qui ont marqué le monde de la pensée, surtout celles qui transparaissent dans le postmodernisme , la French Theory , les Cultural studies , les Subaltern studies , le mouvement de la négritude, l’école de la créolité, des écritures migrantes, diasporiques et métasporiques, les philosophies et esthétiques culturelles de la « double conscience », le courant des « épistémologies du Sud » et des « savoirs endogènes », la pensée postcoloniale et son renouveau dans le débat sur la décolonialité. L’objectif de ces courants de pensée est d’ébranler les fondements intellectuels de la modernité : ils sont en effet anti-Lumières, critiques de la pensée des fondements et des fins, tout en faisant assaut d’antihumanisme et d’aversion pour l’idée de progrès, etc.
La perspective théorique de la défondation a une finalité pratique : il s’agit de faire de l’homme postmoderne et « postcolonial » un sujet flottant, déterritorialisé, désaffilié, hybride, afin qu’il s’adapte aux formes globalisées de l’économie, de l’art et de la culture. Cela remonte à la conception de l’art dans une civilisation moderne marquée par la folie de la déraison, de la violence, de la mort, de la sexualité transgressive qui exprime le sauvage et le chaos, avec les œuvres esthétiques d’Antonin Artaud, Samuel Beckett, Georges Bataille, H. Pinter, Gilles Deleuze, Michel Maffesoli. C’est ce qui culmine dans les « modes populaires d’action », la « politique par le bas », le « quotidien », à partir de la théorisation foucaldienne des « savoirs assujettis » ou des « savoirs locaux » avec Bayart, Mbembe, etc.
Читать дальше
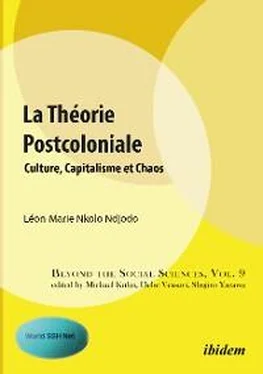
![Fredrik Backman - Britt-Marie Was Here [Britt-Marie var här]](/books/61260/fredrik-backman-britt-marie-was-here-britt-thumb.webp)