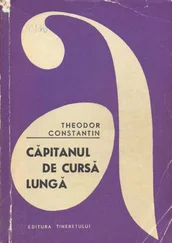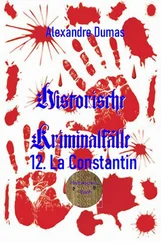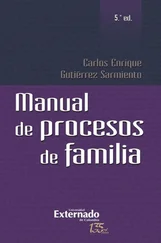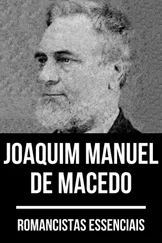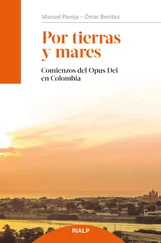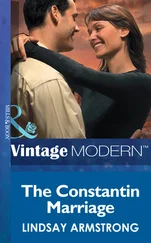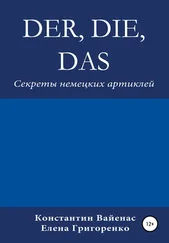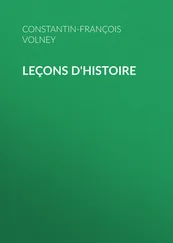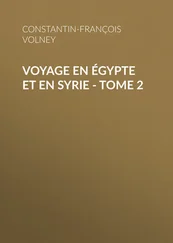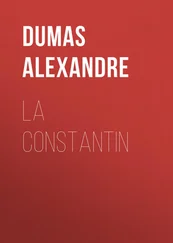Si le visa humanitaire est accordé, la Confédération peut, selon l’art. 53 al. 3 OA 2, prendre en charge les frais nécessaires à l’entrée directe en Suisse et une demande dans ce sens peut être déposée. Toutefois, il n’existe pas un droit à la prise en charge de ces frais.
3.6.4 Problématique du visa humanitaire
Le visa humanitaire est censé garantir que des personnes menacées directement dans leur vie ou dans leur intégrité corporelle puissent trouver protection en Suisse malgré l’abrogation de la procédure à l’ambassade. 43Toutefois, les conditions d’octroi d’un visa humanitaire sont plus restrictives que celles de l’ancienne procédure à l’ambassade. 44Le fait de retenir qu’une personne qui se trouve déjà dans un pays tiers n’est plus en danger est hautement problématique lorsqu’il n’y a pas ou plus d’ambassades [71]ouvertes dans le pays en crise. Si la personne en danger fuit dans un Etat voisin et qu’elle dépose une demande de visa humanitaire à l’ambassade suisse qui s’y trouve, il lui sera objecté qu’au moment de sa demande, elle ne réside pas dans une zone en crise et qu’elle n’est dès lors plus en danger. 45En pratique, une telle situation met en échec le sens du visa humanitaire. En effet, les personnes provenant de pays frappé par la guerre civile ou qui subissent d’autres crises, violences ou catastrophes, n’ont guère de chances d’obtenir un visa humanitaire pour leur permettre de fuir en Suisse légalement. Les ressortissants d’un pays où il n’y a pas ou plus de représentation suisse sont pratiquement exclus de la procédure de visa humanitaire.
Dans un arrêt concernant une femme de 80 ans originaire de la ville syrienne de Homs, le Tribunal administratif fédéral a jugé que la présence personnelle auprès de la représentation n’était pas une condition impérative pour le dépôt d’une demande de visa humanitaire. 46Cette décision laisse espérer une approche plus flexible du visa humanitaire.
A titre de comparaison, entre 2006 et 2012, environ 377 entrées en Suisse en moyenne par année ont été autorisées dans le cadre d’une procédure à l’ambassade 47alors qu’en 2013, seuls 35 visas humanitaires ont été accordés. En 2014, 84 cas, dont environ 20 en lien avec la guerre en Syrie, ont été recensés.
4 Les centres d’enregistrement et de procédure (CEP)
4.1 Généralités
Au début de leur séjour en Suisse, les requérants d’asile sont en règle générale logés dans un CEP. Au moment de la mise sous presse, cinq CEP sont en service. Ceux-ci sont situés à Altstätten, Bâle, Chiasso, Kreuzlingen et Vallorbe. Le nombre de places disponibles dans chacun de ces centres varie entre 134 (Chiasso) et 400 (Bâle), pour atteindre un total d’environ 1200 places. 48En incluant les sites délocalisés, quelque 3000 personnes au total se trouvent dès lors dans des structures [72]d’hébergement de la Confédération. La composition de celles-ci change sans cesse au gré des nouveaux arrivants.
Les CEP sont gérés par le SEM qui peut toutefois charger des tiers 49de tâches ne relevant pas de la puissance publique pour assurer le fonctionnement des centres (art. 17 OA 1).
Les CEP sont ouverts du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00. En dehors de ces heures, les requérants d’asile ne sont accueillis qu’en cas de circonstances particulières. Les CEP et les autres centres de la Confédération sont réservés aux requérants d’asile et aux personnes à protéger. Ils ne sont en principe pas ouverts au public. 50
Le séjour dans les CEP dure 90 jours au maximum (art. 16 al. 2 OA 1). Selon l’art. 16a OA 1, en cas de situation particulière due à l’augmentation passagère ou durable du nombre de demandes d’asile, des « sites délocalisés gérés par la Confédération » 51peuvent être ouverts afin de garantir l’hébergement des requérants d’asile. Le séjour y dure jusqu’à ce que les autorités cantonales disposent des infrastructures nécessaires, mais au maximum douze mois. Au sujet du choix de localisation des centres, il faut veiller à ce qu’ils ne se trouvent pas dans des endroits totalement reculés empêchant tout contact social et rendant pratiquement impossible l’accès à une représentation juridique en raison de leur éloignement. Si tel était le cas, il pourrait y avoir une restriction disproportionnée à la liberté des personnes concernées, voire même une mesure équivalant à une privation de liberté. 52
4.2 Fonction des CEP
Au CEP, la demande d’asile est enregistrée ; les requérants d’asile remplissent une fiche avec leurs données personnelles et un questionnaire détaillé sur leur état de santé, ils sont photographiés et leurs empreintes digitales sont prélevées. Celles-ci sont comparées électroniquement avec les données dont disposent le SEM, la police fédérale et les corps de gardes-frontières ainsi qu’avec les données d’Eurodac. Les documents de voyage ou autres documents attestant de l’identité du requérant sont versés au dossier. Les requérants qui n’ont pas de documents de voyage valables sur [73]eux sont priés d’en déposer dans les 48 heures. Ils doivent confirmer par écrit avoir reçu cette injonction. Ils reçoivent une notice les informant de leurs droits et de leurs devoirs dans le cadre de la procédure (voir art. 19 al. 3 LAsi ; plus de détails au pt 7.4et au chap. XII, pt 3). Pendant leur séjour au CEP, les requérants doivent en principe se tenir à la disposition des autorités (art. 16 al. 1 OA 1). Au CEP, ils sont en règle générale sommairement interrogés sur leur identité, l’itinéraire suivi et leurs motifs de fuite (audition sommaire, art. 26 al. 2 LAsi). L’audition sommaire constitue la base de la décision sur la suite de la procédure, à savoir s’il faut envisager une procédure de réadmission dans un Etat tiers, une procédure Dublin (pt 7.1.2) ou une procédure en Suisse. En présence d’indices selon lesquels la minorité alléguée d’un requérant ne correspondrait pas à la réalité, une expertise de détermination de l’âge peut être ordonnée (art. 17 al. 3 bisLAsi ; autres informations au sujet des requérants mineurs au chap. XVIIII, pt 3). Cette décision est également déterminante pour savoir si l’attribution du requérant à un canton est effectuée ou si la procédure peut être menée à terme dans le CEP. Le point 7 examinera de plus près la procédure de première instance.
4.3 Règlement intérieur
Selon l’art. 18 OA 1, l’exploitation du CEP est réglée par une ordonnance édictée par le DFJP. 53Cette ordonnance s’applique aussi aux centres spécifiques visés à l’art. 26 al. 1 bisLAsi, aux centres de la Confédération exploités dans le cadre de phases de test, aux sites délocalisés gérés par la Confédération ainsi qu’aux logements situés dans les aéroports de Genève-Cointrin et de Zurich-Kloten (art. 1). Elle porte principalement sur les points suivants :
Art. 3 : la fouille des requérants par du personnel (de sécurité) de même sexe est autorisée. Les documents de voyage, les objets dangereux, les valeurs patrimoniales, les appareils électroniques bruyants, l’alcool, les drogues, les armes, etc. sont saisis. Les armes interdites et les drogues sont remises à la police.
Art. 4 : les requérants sont logés dans des dortoirs non mixtes. Il est tenu compte des besoins particuliers des familles, des enfants et des personnes avec un handicap.
Art. 5 : pendant leur séjour, les requérants ont accès aux soins médicaux de base.
Art. 6 : les requérants peuvent être contraints d’accomplir des travaux ménagers.
Art. 6a et 6b : des programmes d’occupation sont proposés aux personnes de plus de 16 ans (sauf dans les logements aux aéroports), mais ces personnes n’ont pas un droit à y participer.
Читать дальше