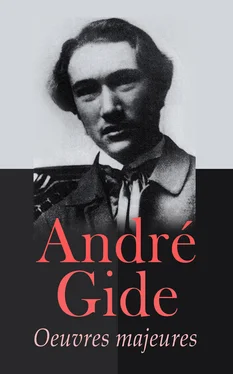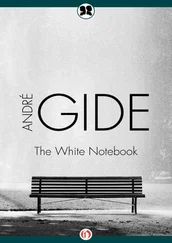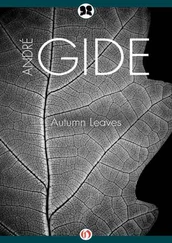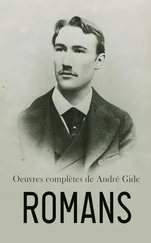Depuis longtemps déjà le mauvais temps avait cessé ; la saison s’avançait ; et brusquement les amandiers fleurirent. — C’était le premier mars. Je descends au matin sur la place d’Espagne. Les paysans ont dépouillé de ses rameaux blancs la campagne, et les fleurs d’amandiers chargent les paniers des vendeurs. Mon ravissement est tel que j’en achète tout un bosquet. Trois hommes me l’apportent. Je rentre avec tout ce printemps. Les branches s’accrochent aux portes, des pétales neigent sur le tapis. J’en mets partout, dans tous les vases ; j’en blanchis le salon, dont Marceline pour l’instant, est absente. Déjà je me réjouis de sa joie... Je l’entends venir. La voici. Elle ouvre la porte. Elle chancelle... Elle éclate en sanglots.
— Qu’as-tu ? ma pauvre Marceline.
Je m’empresse auprès d’elle ; la couvre de tendres caresses. Alors, comme pour s’excuser de ses larmes :
— L’odeur de ces fleurs me fait mal, dit-elle...
Et c’était une fine, fine, une discrète odeur de miel... Sans rien dire, je saisis ces innocentes branches fragiles, les brise, les emporte, les jette, exaspéré, le sang aux yeux. — Ah ! si déjà ce peu de printemps elle ne le peut plus supporter !...
Je repense souvent à ces larmes et je crois maintenant que, déjà se sentant condamnée, c’est du regret d’autres printemps qu’elle pleurait. — Je pense aussi qu’il est de fortes joies pour les forts, et de faibles joies pour les faibles que les fortes joies blesseraient. Elle, un rien de plaisir la soûlait ; un peu d’éclat de plus, et elle ne le pouvait plus supporter. Ce qu’elle appelait le bonheur, c’est ce que j’appelais le repos, et moi je ne voulais ni ne pouvais me reposer.
Quatre jours après nous repartîmes pour Sorrente. Je fus déçu de n’y trouver pas plus de chaleur. Tout semblait grelotter. Le vent qui n’arrêtait pas de souffler fatiguait beaucoup Marceline. Nous avions voulu descendre au même hôtel qu’à notre précédent voyage ; nous retrouvions la même chambre... Nous regardions avec étonnement, sous le ciel terne, tout le décor désenchanté, et le morne jardin de l’hôtel qui nous paraissait si charmant quand s’y promenait notre amour.
Nous résolûmes de gagner par mer Palerme dont on nous vantait le climat ; nous rentrâmes à Naples où nous devions nous embarquer et où nous nous attardâmes encore. Mais à Naples du moins je ne m’ennuyais pas. Naples est une ville vivante où ne s’impose pas le passé.
Presque tous les instants du jour je restais près de Marceline. La nuit, elle se couchait tôt, étant lasse ; je la surveillais s’endormir, et parfois me couchais moi-même, puis, quand son souffle plus égal m’avertissait qu’elle dormait, je me relevais sans bruit, je me rhabillais sans lumière ; je me glissais dehors comme un voleur.
Dehors ! oh ! j’aurais crié d’allégresse. Qu’allais-je faire ? Je ne sais pas. Le ciel, obscur le jour, s’était délivré des nuages ; la lune presque pleine luisait. Je marchais au hasard, sans but, sans désir, sans contrainte. Je regardais tout d’un œil neuf ; j’épiais chaque bruit, d’une oreille plus attentive ; je humais l’humidité de la nuit ; je posais ma main sur des choses ; je rôdais.
Le dernier soir que nous restions à Naples je prolongeai jusqu’au matin cette débauche vagabonde. En rentrant je trouvai Marceline en larmes. Elle avait eu peur, me dit-elle, s’étant brusquement réveillée et ne m’ayant plus senti là. Je la tranquillisai, expliquai de mon mieux mon absence et promis de ne plus la quitter. — Mais, dès la première nuit de Palerme, je n’y pus tenir ; je sortis... Les premiers orangers fleurissaient ; le moindre souffle en apportait l’odeur...
Nous ne restâmes à Palerme que cinq jours ; puis, par un grand détour, regagnâmes Taormine que tous deux désirions revoir. Ai-je dit que le village est assez haut perché dans la montagne ; la gare est au bord de la mer. La voiture qui nous conduisit à l’hôtel dut me ramener aussitôt vers la gare où j’allais réclamer nos malles. Je m’étais mis debout dans la voiture pour causer avec le cocher. C’était un petit Sicilien de Catane, beau comme un vers de Théocrite, éclatant, odorant, savoureux comme un fruit.
— Com’è bella la Signora ! dit-il d’une voix charmante en regardant s’éloigner Marceline.
— Anche tu sei bello, ragazzo, répondis-je ; et, comme j’étais penché vers lui, je n’y pus tenir et, bientôt, l’attirant contre moi, l’embrassai. Il se laissa faire en riant.
— I Francesi sono tutti amanti, dit-il.
— Ma non tutti gli Italiani amati, répartis-je en riant aussi... Je le cherchai les jours suivants, mais je ne pus parvenir à le revoir.
Nous quittâmes Taormine pour Syracuse. Nous redéfaisions pas à pas notre premier voyage, remontions vers le début de notre amour. Et de même que, de semaine en semaine lors de notre premier voyage, je marchais vers la guérison, de semaine en semaine à mesure que nous avancions vers le Sud, l’état de Marceline empirait.
Par quelle aberration, quel aveuglement obstiné, quelle volontaire folie, me persuadai-je, et surtout tâchai-je de lui persuader qu’il lui fallait plus de lumière encore et de chaleur, invoquai-je le souvenir de ma convalescence à Biskra... L’air s’était attiédi pourtant ; la baie de Palerme est clémente et Marceline s’y plaisait. Là, peut-être, elle aurait... Mais étais-je maître de choisir mon vouloir ? de décider de mon désir ?
À Syracuse l’état de la mer et le service irrégulier des bateaux nous força d’attendre huit jours. Tous les instants que je ne passai pas près de Marceline, je les passai dans le vieux port. Ô petit port de Syracuse ! odeurs de vin suri, ruelles boueuses, puante échoppe où roulaient débardeurs, vagabonds, mariniers avinés. La société des pires gens m’était compagnie délectable. Et qu’avais-je besoin de comprendre bien leur langage, quand toute ma chair le goûtait. La brutalité de la passion y prenait encore à mes yeux un hypocrite aspect de santé, de vigueur. Et j’avais beau me dire que leur vie misérable ne pouvait avoir pour eux le goût qu’elle prenait pour moi... Ah ! j’eusse voulu rouler avec eux sous la table et ne me réveiller qu’au frisson triste du matin. Et j’exaspérais auprès d’eux ma grandissante horreur du luxe, du confort, de ce dont je m’étais entouré, de cette protection que ma neuve santé avait su me rendre inutile, de toutes ces précautions que l’on prend pour préserver son corps du contact hasardeux de la vie. J’imaginais plus loin leur existence. J’eusse voulu plus loin les suivre, et pénétrer dans leur ivresse... Puis soudain je revoyais Marceline. Que faisait-elle en cet instant ? Elle souffrait, pleurait peut-être... Je me levais en hâte ; je courais ; je rentrais à l’hôtel, où semblait écrit sur la porte : Ici les pauvres n’entrent pas.
Marceline m’accueillait toujours de même ; sans un mot de reproche ou de doute, et s’efforçant malgré tout de sourire. — Nous prenions nos repas à part ; je lui faisais servir tout ce que le médiocre hôtel pouvait réserver de meilleur. Et pendant le repas je pensais : un morceau de pain, de fromage, un pied de fenouil leur suffit et me suffirait comme à eux. Et peut-être que là, là tout près, il en est qui ont faim et qui n’ont même pas cette maigre pitance... Et voici sur ma table de quoi les soûler pour trois jours ! J’eusse voulu crever les murs, laisser affluer les convives... Car sentir souffrir de la faim me devenait angoisse affreuse. Et je regagnais le vieux port où je répandais au hasard les menues pièces dont j’avais les poches remplies.
La pauvreté de l’homme est esclave ; pour manger elle accepte un travail sans plaisir ; tout travail qui n’est pas joyeux est lamentable, pensais-je, et je payais le repos de plusieurs. Je disais : — Ne travaille donc pas : ça t’ennuie. Je rêvais pour chacun ce loisir sans lequel ne peut s’épanouir aucune nouveauté, aucun vice, aucun art.
Читать дальше