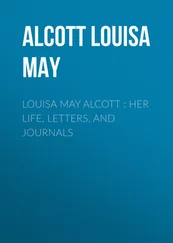— Allons, je vais vous montrer. Joignez les mains comme cela et parcourez la chambre en criant avec désespoir : « Oh ! sauvez-moi ! sauvez-moi ! »
Et Jo lui donna l’exemple en poussant un cri perçant qui était vraiment tragique.
Amy essaya de l’imiter ; mais elle leva les mains avec raideur et se secoua comme une marionnette. Quant à son oh ! au lieu d’être l’expression de l’angoisse et de la crainte, il faisait plutôt penser qu’elle venait de se piquer le doigt en cueillant une rose. Jo gémit d’un air découragé, et Meg se mit à rire, tandis que Beth s’apercevait que, dans sa préoccupation de regarder les acteurs, elle avait laissé brûler une rôtie.
« C’est inutile ! faites le mieux possible quand le moment sera arrivé, dit Jo à Amy ; mais, si on vous siffle, ne m’en accusez pas. Allons, à vous, Meg. »
Le drame, intitulé par Jo, son auteur : la Caverne de la Sorcière, continua d’une manière splendide. Le tyran, don Pedro, défia le monde dans un monologue de deux pages sans une seule interruption ; Hagar, la sorcière, penchée sur une chaudière où des crapauds et des serpents étaient supposés en train de cuire, chanta une invocation terrible.
« C’est certainement la meilleure pièce que nous ayons jamais eu à jouer, dit Meg très satisfaite.
— Je ne comprends pas comment vous pouvez composer et jouer des choses aussi étonnantes, Jo ; vous êtes un vrai Shakespeare ! s’écria Beth, qui croyait fermement que ses sœurs étaient douées d’un génie étonnant pour toutes choses.
— Pas encore, répondit modestement Jo. Je pense que la Caverne de la Sorcière est assez réussie ; mais il n’y a pas assez de meurtres ; j’adore en commettre avec des couteaux de bois. Est-ce un poignard, que je vois devant moi ? murmura Jo en roulant les yeux et attrapant quelque chose d’invisible, comme elle l’avait vu faire à un célèbre tragédien.
— Non, Jo ! Jo, rendez-moi ma fourchette, ce n’est pas un poignard, et ne piquez pas la pantoufle de maman à la place d’une rôtie », s’écria Beth.
La répétition finit par un éclat de rire général.
« Je suis bien aise de vous trouver si gaies, mes enfants », dit une admirable voix sur le seuil de la porte.
Et les acteurs et l’auditoire se retournèrent pour accueillir avec bonheur une dame dont l’air était extrêmement sympathique.
Elle n’était plus ce qu’on peut appeler belle, car, sans être vieille, elle n’était plus jeune, et son aimable et doux visage portait l’empreinte de plus d’une souffrance. Mais les quatre jeunes filles pensaient que le châle gris et le chapeau passé de leur chère maman recouvrait la plus charmante personne du monde.
« Eh bien, mes chéries, qu’avez-vous fait toute la journée ? J’ai eu tant de courses à faire aujourd’hui, que je n’ai pu revenir pour l’heure du dîner. Y a-t-il eu des visites, Beth ? Comment va votre rhume, Meg ? Jo, vous avez l’air horriblement fatigué. Venez m’embrasser, Amy. »
Pendant que Mme Marsch faisait ces questions maternelles, elle se débarrassait de ses vêtements mouillés, mettait ses pantoufles chaudes, et, s’asseyant dans son fauteuil avec Amy sur ses genoux, se préparait à jouir du meilleur moment de sa journée. Ses enfants essayaient, chacune à sa manière, de rendre chaque chose confortable : Meg disposa les tasses à thé, Jo apporta du bois et mit les chaises autour de la table, en renversant et frappant l’une contre l’autre les choses qu’elle tenait ; Beth, tranquillement active, allait et venait de la cuisine au parloir, tandis qu’Amy, pelotonnée dans les bras de sa mère, donnait ses avis à tout le monde.
Comme elles se mettaient à table, Mme Marsch dit avec un sourire qui trahissait une grande joie intérieure :
« Mes enfants, je vous garde, pour après le souper, quelque chose qui vous rendra très heureuses. »
Aussitôt une vive curiosité illumina toutes les figures ; un rayon de soleil n’eut pas mieux éclairé tous les yeux. Beth frappa ses mains l’une contre l’autre sans faire attention au pain brûlant qu’elle tenait, et Jo, jetant sa serviette en l’air, s’écria :
« Je devine : une lettre de papa ! Trois hourrahs pour papa !
— Oui, une bonne et longue lettre. Votre père se porte bien et pense qu’il passera l’hiver mieux que nous ne le supposions. Il vous envoie toutes sortes d’affectueux souhaits de Noël ; et il y a dans sa lettre un passage spécial pour ses enfants, dit MmeMarsch, frappant plus respectueusement sa poche que si elle eût contenu un trésor.
— Dépêchons-nous de finir de manger. Amy, ne perdez pas votre temps à mettre vos doigts en ailes de pigeon et à choisir vos morceaux », s’écria Jo, qui, dans sa précipitation, se brûlait en buvant son thé trop chaud et laissait rouler son pain beurré sur le tapis.
Beth ne finit pas de souper, mais s’en alla dans un coin habituel rêver au bonheur qu’elle aurait quand ses sœurs auraient fini.
« Comme c’est beau à papa d’être parti pour l’armée comme médecin, puisqu’il a passé l’âge et qu’il n’aurait plus la force d’être soldat ! dit Meg avec enthousiasme.
— Quel dommage que je ne puisse pas aller tout au moins comme vivan… vivandi… ah ! vivandière ! Ou même comme infirmière à l’armée, pour l’aider ! s’écria Jo.
— Cela doit être très désagréable de dormir sous une tente, de manger toutes sortes de mauvaises choses et de boire dans un gobelet d’étain, dit Amy.
— Quand reviendra-t-il, maman ? demanda Beth, dont la voix tremblait un peu.
— Pas avant plusieurs mois. À moins qu’il ne soit malade, votre père remplira fidèlement sa part de devoir, et nous ne devons pas lui demander de revenir une minute plus tôt qu’il ne le doit. Maintenant, je vais vous lire sa lettre. »
Elles se groupèrent toutes autour du feu. Meg et Amy se placèrent sur les bras du grand fauteuil de leur mère, Beth à ses pieds, et Jo s’appuya sur le dos du fauteuil, afin que, si la lettre était émouvante, personne ne put la voir pleurer.
Dans ces temps de guerre, toutes les lettres étaient touchantes, et surtout celles des pères à leurs enfants. Celle-ci était non pas gaie, mais pleine d’espoir ; elle contenait des descriptions animées de la vie des camps et quelques nouvelles militaires. Il pensait que cette guerre, plus funeste qu’aucune autre, puisqu’elle avait le malheur d’être une guerre civile, prendrait fin plus tôt qu’on n’avait osé l’espérer. À la dernière page seulement, le cœur de l’écrivain se desserrait tout à fait, et le désir de revoir sa femme et ses petites filles y débordait.
« Donnez-leur à toutes de bons baisers, dites-leur que je pense à elles tous les jours et que chaque soir je prie pour elles. De tout temps, leur affection a été ma plus grande joie, et un an de séparation c’est bien cruel ; mais rappelez-leur que nous devons tous travailler et faire profit même de ces jours de tristesse. J’espère qu’elles se souviennent de tout ce que je leur ai dit. Elles sont de bonnes filles pour vous ; elles remplissent fidèlement leurs devoirs ; elles n’oublient pas de combattre leurs ennemis intérieurs, et auront remporté de telles victoires sur elles-mêmes, que, quand je reviendrai, je serai plus fier encore de « mes petites femmes » et que je leur devrai de les aimer encore plus si c’est possible. »
Elles se mouchaient toutes pour cacher leurs larmes lorsque leur mère lut ce passage. Jo ne fut pas honteuse de la grosse larme qui avait élu domicile au bout de son nez, et Amy ne craignit pas de défriser ses cheveux lorsque, tout en pleurs, elle se cacha sur l’épaule de sa mère, en s’écriant :
« Je suis très égoïste ; mais je tâcherai réellement d’être meilleure, pour que notre père ne soit pas désappointé en me revoyant.
Читать дальше