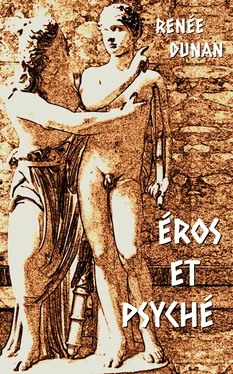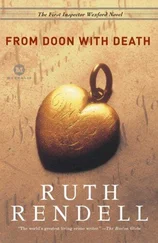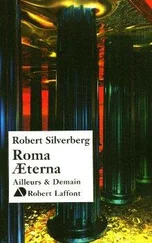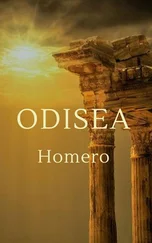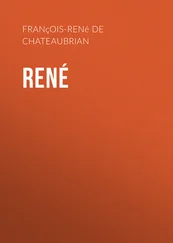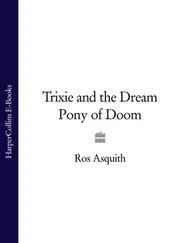· · ·
Le lendemain d’un de ces entretiens, Lucienne fut avertie qu’on la mariait à son oncle le forgeron. Elle n’avait, assouplie déjà à la misère et à ses suites, aucun désir de protester. L’aurait-elle fait que d’ailleurs on l’eût rouée de coups. Mais elle possédait ce fatalisme du pauvre qui se plie sans broncher aux servitudes les plus humiliantes. Quoique la mère de Lucienne allât à l’église, elle avait consenti au mariage exclusivement civil exigé par le forgeron franc-maçon. Lucienne possédait confusément cette idée que l’on n’est vraiment pas mariée lorsqu’il n’y a pas eu cérémonie religieuse. C’était cela seul le mariage à ses yeux. Mais sa ferveur restait trop courte pour qu’elle en tirât grand souci.
Seulement, le troisième soir, comme elle rentrait chez elle par une petite ruelle tortueuse et déserte, elle rencontre son oncle et futur époux. Il l’arrêta. Quelles étaient ses intentions réelles aux premiers mots ? Sans doute n’en avait-il aucune fermement formulée.
Mais cet homme sanguin et coléreux, devant une grande jeune fille, en vint tôt à l’excitation la plus précise. Il lutta en soi-même, moins par délicatesse que par prudence. L’instinct fut le plus fort. Il étreignit Lucienne et l’immobilisa, puis il tenta des contacts plus intimes. Elle se défendit. Ce fut une lutte silencieuse et violente. L’homme n’était pas le maître de sa proie. La colère le saisit et il brutalisa l’enfant farouche. Ce fut en vain. Il allait la jeter au sol, et, ignorant le lieu, tenter peut-être de la violer, mais elle laissa échapper un cri de douleur, tant la serraient les dures mains du forgeron.
Alors, d’une maison voisine, par la fenêtre, un buste se pencha. La ruelle n’était pas éclairée. Le curieux ne vit donc qu’une masse confuse, mais il devina bien que ce fut un couple dont la femme se défendait.
Il cria :
— Dis donc, cochon, vas-tu la laisser tranquille. Veux-tu que j’aille chercher les gendarmes.
Ce fut comme une douche sur la tête de l’homme au tablier de cuir.
Il se releva et se sauva éperdument, mais non pas sans avoir dit à l’oreille de Lucienne :
— Salope, tu peux dire adieu au mariage ! Je te laisserai crever de faim. Mais pas sans te retrouver ailleurs et te flanquer la tournée que tu mérites.
Elle resta seule, tremblante et affolée, dans la rue sombre et redevenue silencieuse. Enfin, le cœur battant, elle revint chez ses parents.
Lucienne Dué était une jeune fille très intelligente, mais elle ignorait bien des choses de la vie. Il ne lui était pas venu à l’esprit que son père et sa mère voulussent tout bonnement se débarrasser d’elle et même la vendre en quelque façon au forgeron qui « avait besoin d’une femme ».
Elle espérait donc un appui près des siens, contre le brutal et, sitôt rentrée, exposa aussitôt ce qui venait d’arriver. Alors les portes de l’enfer s’ouvrirent.
D’un bond, sa mère se jetait sur elle pour lui appliquer un soufflet. Le père, avachi, lui criait toutes les insultes de son répertoire ouvrier. Lucienne, que honnissait sa famille parce qu’elle n’avait voulu se donner dans la rue à son oncle et futur époux, connut cette fois la misère de vivre.
Elle reculait, blanche de désespoir, retenant d’une main son corsage déchiré. De grosses larmes coulaient sur ses joues et un dégoût atroce lui retenait dans la gorge tout ce qu’elle eût désiré dire, qui était vrai, et dont elle sentait confusément que cela dépassait les bornes de l’immonde. Elle se réfugia dans sa chambre, un débarras noir et puant, puis s’y cloîtra. Deux heures durant elle entendit hurler et brailler les siens. Six fois ils vinrent à sa-porte lui crier de nouvelles insultes. Enfin ils s’assagirent. Deux bouteilles d’eau-de-vie apportées par le forgeron noyèrent leur peine.
A dix heures, entendant les siens ronfler, Lucienne ouvrit, passa sans bruit dans leur chambre et gagna l’escalier. Une fois dehors elle respira. Où aller maintenant ?
Elle savait mille choses précises concernant ses parents les plus éloignés. Dans les familles pauvres c’est un sujet quotidien de conversation que le comportement des gens riches du même sang.
La manière de vivre des Dué magistrats et rentiers était donc particulièrement familière à Lucienne. Son cousin Jean, qu’elle avait rencontré une fois, dix-huit mois plus tôt, par hasard, se trouvait seul, du samedi au lundi, durant toute la belle saison. La chose était connue.
Lucienne, sachant cela, conçut de venir lui demander asile. Elle ne savait pas du tout ce qui pourrait advenir ensuite. C’était le seul espoir qui restât proche et put l’attirer.
D’ailleurs elle n’y réfléchit pas longtemps.
Il y avait un long chemin de la maison de Lucienne, dans la campagne suburbaine, à celle de Jean, au centre du quartier riche, dans la ville neuve. Lucienne marcha courageusement. Ce n’était pas encore le complet silence et la solitude des nuits pleines. Mais, fille du peuple, la jeune fille savait fuir les rôdeurs et les galants attardés. Elle arrivait enfin, frappait chez son cousin et écoutait, le cœur agité. Le silence dura… Elle ne s’éloignait pas et espérait toujours. Un moment âcre naissait enfin lorsque, la porte ouverte, elle voyait Jean regarder de l’autre côté de la rue, et puis…
Eh bien, tout coup vaille, quand ce serait de l’inclination ! Quand ce seraient des passions, des soupirs, des flammes, il n’y a rien de si gaillard. On a un cœur, on s’en sert, cela est naturel.
Pierre de Marivaux
Les Surprises de l’amour (III 2)
Ils étaient là, les deux enfants, étonnés et heureux vraiment de cette romanesque rencontre. En Lucienne naissait pourtant un sens exact de l’aventure prochaine. Sa vue déjà se montrait plus stable et nette parce que la douleur affine. Elle regarda toutes choses avec une curiosité volontaire et trouble. La simplicité austère du lieu l’étonna. Elle croyait naïvement que chez les riches tout est doré et magnificent. Elle attendait de voir des portraits de famille dans des cadres immenses, des tentures de velours rouge et des tapis épais d’une main.
Et l’attitude de son cousin la stupéfiait aussi. Elle le croyait un de ces garçons, audacieux de ne craindre rien, qui troussent les jupes des femmes, dans les venelles, le soir à peine venu. Elle ne savait ce qu’elle lui eût permis. Les femmes ne théorisent pas leurs volontés. En tout cas elle attendait de lui quelques-unes de ces paroles sucrées, à l’audition desquelles les jeunes femmes n’osent plus se défendre. Mais Jean ne ressemblait aucunement aux adolescents de son âge. Il était timide. Comment pouvait-on être timide et riche ? Ce problème tourmentait Lucienne Dué. La timidité lui avait toujours semblé être l’accompagnement de la faiblesse et de la pauvreté. Que d’étonnements encore ! Il serait avocat, ce puissant gaillard, et il paraissait incapable de trouver ses mots. Elle l’avait même déjà vu rougir…
Quant à lui, il cultivait, sans en formuler aucune interprétation verbale, un bonheur très fin et que seul le silence lui paraissait devoir compléter. Il sortait donc comme en trébuchant, de cette félicité, chaque fois qu’il lui fallait répondre. La présence parfumée et féminine réveillait en sa pensée surnourrie de classiques toute une littérature dont jamais il n’avait jusque-là compris le sens et la beauté formels. Cette fois il pénétrait l’arcane. Il pourrait désormais lire les poètes avec le juste sentiment de la passion qu’ils exprimèrent. Il n’avait d’ailleurs aucun désir sensuel.
Son ambition consistait à faire durer ce bonheur, égoïstement, le plus possible. Il restait incapable de deviner ce qui s’agitait en ce moment même dans la jolie petite tête qui lui faisait face. Il y voyait simplement fermenter toute la littérature amoureuse de ses auteurs favoris. Sans doute était-elle exprimée en termes moins précieux et choisis que dans les grands écrivains, car il avait le sens des hiérarchies sociales, et n’ignorait point que sa cousine fût de petite culture. Mais peu importe le mode d’expression des idées. Ce qui l’intéressait résidait moins dans les mots et la noblesse des syntaxes que dans les sentiments traduits. Or il croyait connaître ceux-ci.
Читать дальше