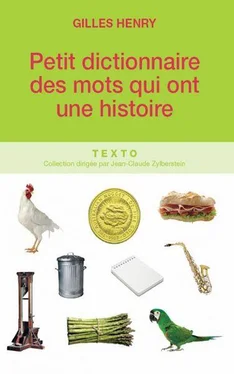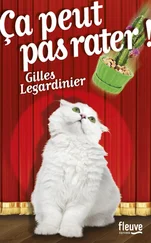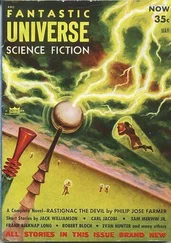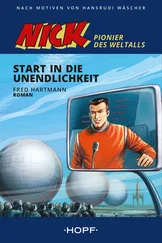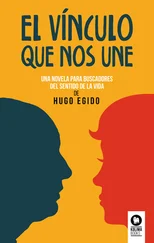On désigne ainsi celui qui cherche à exploiter la crédulité d’autrui par un grand étalage de mots.
CHAUVIN
Augustin Scribe fut un auteur d’une extraordinaire fécondité : pas moins de trois cent cinquante pièces de théâtre sortirent de sa plume dont une intitulée Le Soldat Laboureur . Cette pièce comportait un personnage qui se faisait remarquer par son enthousiasme militaire : Nicolas Chauvin, soldat de Napoléon et blessé dix-sept fois pour le servir !
Bientôt, le chauvin fut celui, patriote belliqueux, qui ne manquait jamais une occasion d’encenser Napoléon, puis, vers 1843, celui qui professe un patriotisme exagéré.
Il convient de préciser que certains attribuent ce type de soldat patriote et naïf dans son exaltation — et dangereux par là — à un Nicolas Chauvin créé, non par Scribe, mais par Charles Cogniard, auteur avec son frère de féeries et de drames à succès… Quoi qu’il en soit, voilà un personnage du monde théâtral qui a su franchir le rideau rouge.
CICÉRONE
Guide qui montre aux étrangers les curiosités d’une ville.
De Marcus Tullius Ciceron, 106-43 av. J.-C., homme politique et écrivain, dont le nom est alors employé ironiquement.
CORNÉLIEN
Pierre Corneille est né à Rouen en 1606, d’une famille de robe, si bien qu’il devint avocat en 1628, malgré sa timidité. Peu après, il commençait une carrière dramatique avec Mélite .
Auteur à la mode, distingué par Richelieu, il ne sut pas flatter les grands et fut éloigné. Qu’importe, il composa en 1636 Le Cid , immense succès, puis donna trois autres chefs-d’œuvre : Horace, Cinna, Polyeucte , tout en restant un bon bourgeois de Rouen.
Père de six enfants, il entra à l’Académie française en 1647 et fut pensionné par le roi ; ses pièces ; alors inégales et irrégulières, furent loin de lui assurer la même renommée qu’auparavant. La fin de sa vie fut triste, car ayant quitté Rouen pour Paris, il ne trouva que déboires dans la capitale, vit deux de ses fils mourir, pendant que Racine glanait les succès, à son tour. Il s’éteignit en 1684.
Le théâtre de Corneille est psychologique, le drame est dans l’âme des personnages, les mouvements les portent à leur plus haute expression morale.
C’est à Voltaire que l’on doit d’avoir créé l’adjectif cornélien, qui devait faire fortune pour qualifier ce qui fait triompher le devoir sur la passion. Le devoir et la passion : oui, le débat cornélien est là !
DANTESQUE
Né en 1265 d’une famille noble et fortunée, Dante Alighieri (dans l’ordre, le prénom et le nom) fut tôt orphelin de père et fut éduqué par sa mère.
Il étudia le latin et les œuvres classiques, ainsi que l’histoire, la philosophie, la physique, l’astronomie, la peinture et la musique. À l’âge de neuf ans, il s’éprit d’amour pour une enfant comme lui, Brice Portinari, et cela dura jusqu’à la mort de cette dernière, en 1290. Des sonnets, des ballades et des « canzoni » lui furent alors inspirés.
Marié en 1294, il fut un des six prieurs de la République de Florence, maïs les problèmes politiques le firent condamner à l’exil ; il séjourna à Bologne et Padoue, peut-être à Paris, puis à Ravenne où il mourut en 1321.
De son œuvre, c’est bien entendu La Divine Comédie qui fît son renom : cent chants racontant les visions du poète guidé par Virgile à travers les cercles de l’enfer puis au-delà, à travers le purgatoire. On attribue à Zola d’avoir utilisé en 1834 le mot dantesque dans le sens de terrifiant, grandiose, pour la première fois ; pourtant, la correspondance de Lamartine donne, quatre ans auparavant, le terme avec ce sens d’effroyable, d’inouï, de sublime.
Quoi qu’il en soit, il aura fallu cinq cents ans pour que le mot trouve sa place. Un enfer…
DAUPHIN
Le titre de dauphin était à l’origine porté par les comtes du Viennois, particulièrement par Guigues IV, qui vivait au XII esiècle. La raison ? Le dauphin que Guigues avait sur son écu (d’or, au dauphin d’azur, allumé, lorré et peautré de gueules).
En 1343, Humbert II, dauphin du Viennois sans enfants et endetté, vendit ses États à Philippe VI, à condition que les fils aînés des rois de France prendraient le titre de dauphin. Le futur Charles V, fils de Jean le Bon, fut le premier Capétien à porter ce titre, recevant l’investiture en 1349.
En littérature, on désigne sous le nom de Édition à l’usage du Dauphin un recueil de classiques grecs et latins à l’usage effectif du Grand Dauphin, le fils de Louis XIV. Mais, par extension, le terme qualifie toute collection expurgée destinée aux enfants. Le langage courant en a fait un synonyme d’héritier.
DON JUAN
La vie aventureuse d’un seigneur espagnol est à l’origine de ce personnage de théâtre. Don Juan Tenorio vivait à Séville au XVI esiècle et se rendit célèbre par ses débordements, tuant le commandeur Ulloa dont il avait enlevé la fille.
La légende raconte aussi qu’attiré une nuit dans le couvent de Saint-François, où se trouvait le tombeau du Commandeur, il aurait insulté sa victime et serait mort mystérieusement.
Au début du XVII esiècle, Tirso de Molina porta la légende au théâtre dans sa pièce El Burlador de Sevilla y el Convivado de piedra ( Le Séducteur de Séville et l’Invité de pierre ).
Ce fut ensuite le tout de Dorimond et Villiers qui intitulèrent la pièce le Festin de pierre . Enfin, en 1659, ce fut Molière, dans Don Juan ou le festin de pierre , trente-cinq ans après Tirso de Molina.
Si Stendhal cita « les vrais don juan » dès 1822, il semble que le sens actuel se soit fixé en 1840, Gérard de Nerval, pour sa part, créant le terme don juanesque dans son Voyage en Orient , qui date de 1851.
DON QUICHOTTE
Alonso Quijano, dit « le bon », naquit gentilhomme campagnard. Cet authentique personnage commença à vivre à l’âge de cinquante ans, « sec de corps et maigre de visage, fort matineux et grand amateur de chasse ».
En lui se ranima le souvenir de certain amour de jeunesse que son imagination s’empressa d’idéaliser : c’était Dulcinée, la dame de ses rêves, de laquelle il se mit brusquement en quête. Alors, sa triste figure d’halluciné, sa maigre carcasse et ses armes d’un autre âge contribuèrent à magnifier le mythe de l’homme aux sentiments pleins de noblesse et d’humanité. D’autant plus que son compagnon, Sancho Pança, était d’un caractère diamétralement opposé.
Miguel de Cervantès Saavedra écrivit son chef-d’œuvre entre 1605 et 1615, sous le nom de Don Quichotte de la Manche et si Don Quichotte est cité en 1631 par le poète Saint-Amant, il fallut attendre 1878 pour voir l’entrée du mot dans le Dictionnaire de l’Académie. Depuis longtemps le Don Quichotte redresseur de torts, chimérique et généreux, était devenu un grand héros populaire.
DRACONIEN
Au VII esiècle av. J.-C., à Athènes, six spécialistes étaient chargés de rédiger et de publier la loi pénale. Parmi eux se trouvait le nommé Dracon.
Vers 621, il rédigea, selon Aristote, un véritable code pénal. Ses lois étaient impitoyables, car pratiquement tous les actes qualifiés de crimes étaient sanctionnés par la peine de mort ! Même la simple oisiveté était l’objet d’une telle sentence.
L’élan était donné et le mot draconien fut inscrit en 1796 dans un Vocabulaire de la langue française . Mais pour lui également, le règlement fut draconien : il ne parvint à entrer dans le Dictionnaire de l’Académie qu’en 1878.
Читать дальше