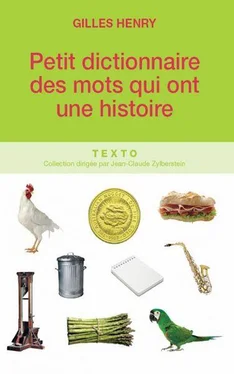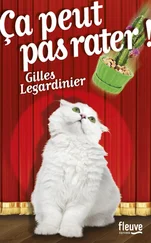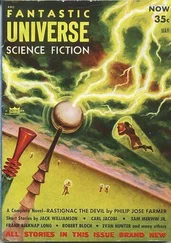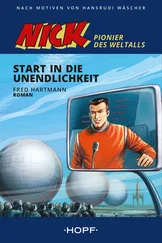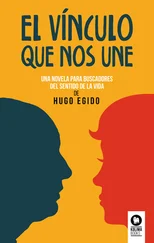Certains ont parfois des rôles ingrats, on les voit mentor, mouchard ou pipelet : Mentor était l’ami fidèle d’Ulysse, chargé de l’éducation de son fils Télémaque ; Antoine de Mouchy traquait les calvinistes avec des espions à sa solde ; « monsieur Pipelet » était concierge dans Les Mystères de Paris d’Eugène Sue.
Si vous êtes pris de panique, vous en appellerez au dieu Pan qui poursuivait les nymphes avec une excitation non dissimulée alors que si vous commettez un lynchage, vous évoquerez un planteur virginien du nom de John Lynch qui, en 1780, devant les troubles de la guerre d’Indépendance, institua un tribunal fort répressif.
Un regard chiffré sur l’origine des mots de ce chapitre montre l’importance de la mythologie et également de la France (une trentaine), l’Italie, l’Espagne, la Grèce, l’Angleterre, l’Autriche, la Hongrie, Israël et le Moyen-Orient figurent parmi les pays d’origine.
En tout une quarantaine d’hommes, une dizaine de femmes, dieux, rois, animaux, villages, sans oublier les noms sortis de la création littéraire, théâtrale ou artistique.
ACARIÂTRE
Il existait, au VII esiècle, un évêque à Noyon du nom d’Acaire (ou Achaire), également installé à Tournai ; il mourut en 639 et ses reliques passèrent pour guérir la mauvaise humeur. À la vérité, il est peut-être confondu avec Acaire, deuxième abbé de Jumièges, dont le corps fut transporté à Haspres au IX esiècle.
Quoi qu’il en soit, saint Acaire était réputé pour guérir les dérangements d’esprit et le premier sens d’acariâtre fut « privé de raison » ou qui « s’entête dans une idée déraisonnable ».
La prononciation du mot le rapprocha de celle d’un autre mot, aigre, et petit à petit l’alchimie du vocabulaire finit par transformer acariâtre et par lui donner le sens d’hargneux, déplaisant et tyrannique. Si le « mal aquariastre » est signalé en 1493, celui d’humeur aigre est relevé en 1524, dans Le Pionnier de Seudre , et le Dictionnaire de l’Académie a accueilli acariâtre en 1798.
ALIBORON
L’ellébore était dans l’Antiquité une plante employée pour traiter les maladies nerveuses et guérir la folie ; en ancien français, aliboron.
Au IX esiècle, l’Irlandais Jean Scot travaillait à un commentaire sur Martianus Capella, en latin bien entendu, et commit un contresens, prenant le nom de la plante ellébore pour le nom d’un philosophe de la même secte que Carnéade, et qualifié de Maître Aliboron.
Il est certes difficile d’expliquer le passage du sens de philosophe à celui d’un personnage qui sait tout et ne fait rien et les hypothèses sont diverses.
Mais après tout, peut-être le petit grain de folie que délivre l’ellébore suffît pour atteindre ce personnage habile à tout faire, cité dès 1440. Pourtant, certains tiennent à une autre explication, le philosophe mentionné plus haut ayant pu être un Arabe du nom de Al-Biruni dont le nom aurait facilité la confusion.
Depuis longtemps, les fabulistes — et le bon La Fontaine le premier — ont mis tout le monde d’accord en octroyant un autre rôle à « Maître Aliboron », dorénavant… un âne ; Sarazin, en 1654, a confirmé ce sens.
AMAZONE
François Pizarre (né en 1475) partit pour l’Amérique en 1509, son tempérament cupide et cruel lors de la conquête du Pérou allait lui valoir le surnom de grand marquis .
Il était accompagné de François Arellana, qui ne lui cédait en rien sur ce sujet. Ce dernier découvrit un fleuve immense — appelé Guiena — dont il remonta le cours jusqu’à son embouchure.
Pendant cette expédition, Arellana dut combattre des adversaires inattendus : des femmes, armées et pugnaces comme des hommes. Il les baptisa du nom d’Amazones, en souvenir des guerrières de la mythologie grecque, que le vocabulaire avait accueilli avec ce sens, dès 1246. Dorénavant, le fleuve Guiena allait s’appeler le fleuve des Amazones et plus simplement l’Amazone. C’était vers 1564.
AMPHITRYON
Prince thébain, fils d’Alcée et d’Astydamie, petit-fils de Persée, Amphitryon devint l’époux d’Alcmène, mais dut bientôt partir pour la guerre, en bon général qu’il était.
Zeus, amoureux d’Alcmène, trouva un moyen pour obtenir les faveurs de la belle : il prit les traits d’Amphitryon. Alcmène ne s’aperçut de rien ; sa vertu n’avait pas à en être offensée.
De cette union naquit un certain Héraklès, le plus célèbre des héros grecs, connu des latins sous le nom fameux d’Hercule.
Bien sûr, le théâtre s’est emparé du personnage, depuis Plaute jusqu’à Giraudoux (trente-huit pièces différentes recensées) mais c’est à Molière que l’on doit d’en avoir défini le sens actuel dans son Amphitryon , donné en 1668. Sosie, qui est le serviteur d’Amphitryon, célèbre la victoire de son maître lors d’un festin réunissant les héros, après que Zeus-Jupiter eût dévoilé son identité et son rôle. Il lui suffit de dire : « Le véritable Amphitryon est l’Amphitryon où l’on dîne » pour que le sens en fut déterminé.
ASSASSIN
Au XI esiècle vivait sur les territoires de l’Égypte, de la Syrie et de la Perse, une secte de musulmans dissidents, appelés Ismaélites. Un de leurs chefs, Hassan-ben-Sabbah-Homairi, conçut d’utiliser leur fanatisme à son profit exclusif. En 1090, il réussit à s’emparer d’une forteresse persane et, pour se protéger, s’entoura de sicaires qu’il s’attacha d’une manière tout à fait particulière.
En effet, il leur fournit un breuvage préparé avec du chanvre indien qui procurait aux intéressés une voluptueuse ivresse. C’était le haschisch ; bientôt, on surnomma les hommes du terme de haschischins et comme le mot n’était guère facile à prononcer, il se corrompit en assassins.
La puissance des Assassins fut détruite par les Mongols en 1258 et le mot se fixa en 1300.
BOBÈCHE
Dans son excellent Dictionnaire des inconnus , Michel Dansel a raconté l’histoire de ce personnage dont le nom était certes connu dans la langue, mais pour une autre raison : une bobèche étant un petit disque de métal qui, adapté à un chandelier, l’empêche de couler.
La vie de Bobèche nous fait entrer dans le monde des bouffons, des pitres ou joueurs de parade. Fils d’un tapissier du faubourg Saint-Antoine, Jean Antoine Anne Mandelart naquit en 1791 ; devenu familier des quartiers populaires il rencontra, boulevard du Temple, un garçon de son âge, nommé Auguste Guérin. Espiègles et farceurs tous les deux, ils décidèrent de se donner un surnom : Bobèche et Galimafré. Bientôt, ils se poussèrent parmi les comédiens du Boulevard et, en 1804, recevaient grand accueil.
Mandelart, surnommé Bobèche, paraissait revêtu d’une veste jaune, d’une culotte rouge, chaussé de bas bleus, coiffé d’une perruque rousse à queue rouge enrubannée, surmontée d’un lampion sur lequel était fixé un papillon.
En véritables titis parisiens, Bobèche et Galimafré connurent le succès qui ne cessa de grandir pendant le Premier Empire. La Restauration de 1814 les détourna de leurs grimaces et pitreries ; Galimafré se retira, finit ses jours à Montmartre, pendant que Bobèche essayait vainement de rester à l’affiche. Il termina sa vie dans l’anonymat le plus total, mais laissa le souvenir de son esprit gouailleur ; le mot bobèche entra dans le langage courant en 1836.
BOUGRE
Les Bulgares sont un peuple d’origine tartare qui envahit l’est de l’Europe au V esiècle et qui se mêla ensuite à diverses tribus slaves pour former un État.
Читать дальше