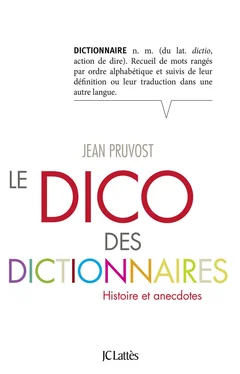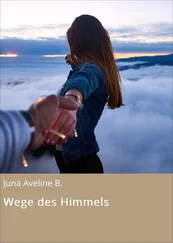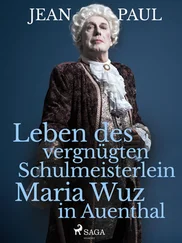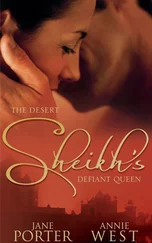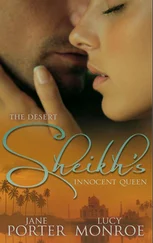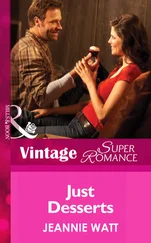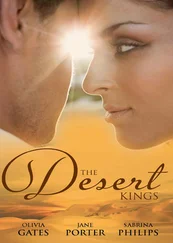Elles ne manquent pas si l’on en fait un relevé rapide…
Usage écrit, oral, didactique, archaïque, ancien, vieilli, désuet, récent, moderne, contemporain, courant, fréquent, rare, régional, dialectique, emphatique, ironique, elliptique, argotique, vulgaire, populaire, relâché, commun, familier, ordinaire, littéraire, poétique, soutenu, abusif, impropre, incorrect, péjoratif, injurieux, conforme, normal, technique, scientifique, général… Il serait aisé d’ajouter d’autres adjectifs ou d’autres commentaires. Par exemple, aucune mention de l’âge auquel correspond principalement l’usage du mot, pas de mention de l’usage ludique…
Ainsi, annoncer sérieusement qu’on ira à la teuf à quinze ans, cinquante ans plus tard, risque fort de ne plus être dans l’usage de la même personne. Aucun retraité n’utilisera le mot sérieusement, sans être ridicule ! Ainsi, à propos d’usage, pas de zion-clu-con tiva , comme disait mon fils à quatorze ans qui, non sans talent, pratiquait goulûment le verlan, avant de devenir un excellent professeur d’histoire-géographie.
VIONCHE. Vivax, secularis, homme de longue vie. Vionche est celui qui a dépassé les années ordinaires, et qui est par-delà de la vieillesse. Le Vionche Fontenelle alla jusqu’à cent années, malgré la faiblesse de sa complexion. Il existe aux invalides, un Vionche de cent dix-sept ans. J’ai vu ce matin un Vionche de cent douze années, et qui marche bien.
Louis Sébastien Mercier, Néologie ou Vocabulaire des mots nouveaux, 1801.
VACHERIE. Étable à vaches, Lieu où l’on trait des vaches et où l’on vend du lait. Les vacheries doivent être tenues dans un parfait état de propreté .
Petit Larousse illustré, millésime 1906.
VIRGULE s. f. Terme de grammaire. C’est une manière de petite marque en forme de c renversé qu’on met à la fin des parties des periodes quand il n’y faut pas un point seul, & cela pour en distinguer les divers sens. Faire une petite virgule.
Dictionnaire françois, P. Richelet (1680).
VIRGULE s. f. Terme de Grammaire. C’est une marque faite en forme de petit e renversé, qui fait partie de la ponctuation […]. L’exactitude de cet Auteur va jusques-là, qu’il prend soin des points & des virgules . […]
Dictionnaire universel, A. Furetière (1690).
Renversé ou crochu ?
« Petit c » ou « petit e » renversé, le sens du latin virgula ne se limite pas au petit bâton, la « petite verge », mais s’associe à la brindille, au rameau, et donc par extension au trait minuscule. C’est Gasparino Barzizza (1370–1431), auteur de la Doctrina punctandi , le premier traité de ponctuation, qui ajouta aux trois différents points d’Aristophane de Byzance (le « point d’en haut », le « point médian » et le « point d’en bas », marquant respectivement la fin d’une phrase, une pause moyenne et une courte pause) neuf nouveaux signes, dont deux sortes de virgules. Il imagine ainsi une barre oblique et le même signe, à l’horizontale, pour distinguer les différents rôles des virgules, tantôt introduisant une incidente, virgules-parenthèses disent les contemporains, tantôt proches d’une conjonction de coordination.
Le savant humaniste et imprimeur Geoffroy Tory sera en fait le premier à évoquer le point crochu qu’Estienne Dolet, également grand humaniste et éditeur, intégrera en 1540 dans De la punctuation de la langue Françoyse sous le nom d’ incisum ou de virgule . Il n’est sans doute pas inutile de rappeler que, avant le développement de l’imprimerie, les manuscrits étaient presque toujours lus à haute voix, qu’il y ait un auditoire ou que l’on soit seul. Et de fait, la ponctuation n’était là que pour permettre à la voix de se reposer, tout en faisant apparaître le sens du texte.
Affaire d’imprimeur
Une remarque s’impose : ce n’est que très récemment que l’écrivain est devenu maître de sa ponctuation. Cela n’a pas toujours été le cas et Voltaire, bien que très sensible à la ponctuation, n’hésitait pas à répondre à son imprimeur qu’en matière d’orthographe et de ponctuation ce dernier restait « le maître absolu de ces petits peuples-là »…
Le XIX esiècle fut à cet égard particulièrement délétère, les imprimeurs imposèrent en effet leurs règles pour les œuvres d’autrefois. On ne rappelle pas assez souvent que, dans la plupart des éditions des œuvres du XVII eet XVIII ereprises au XIX esiècle, la ponctuation n’est en rien celle d’origine, mais bien au contraire celle des éditeurs du XIX esiècle, qui ont agi à leur guise sans même respecter les écrivains dont la ponctuation était parfois originale, à l’image de Montaigne. On se souvient que lorsque Victor Hugo, exilé à Jersey puis Guernesey, dut faire publier ses poèmes à Bruxelles, il pestait contre les innombrables virgules ajoutées à ses vers par les imprimeurs belges, au point d’appeler « insectes belgicains » ces petits signes que naguère on avait aussi plaisamment qualifiés de « pausettes » ou de « points à queue ».
Les dictionnaires du Grand Siècle traduisent bien en fait la prise de conscience progressive de l’importance de la ponctuation. Ainsi, lorsque Furetière définit cette dernière, c’est pour ajouter dans les exemples, le lieu privilégié des confidences, qu’« il y a plus de difficulté qu’on pense à faire bien la ponctuation ». « Ce correcteur d’imprimerie entend fort bien la ponctuation », ajoute-t-il d’ailleurs, apparemment satisfait des services rendus. Mais cet avocat de formation devenu lexicographe, en procès avec l’Académie l’accusant à tort de plagiat, ne manque pas de signaler dans la définition du verbe ponctuer que l’« on a du mal à bien lire la chicane, parce qu’elle n’est jamais ponctuée ». Ainsi, la ponctuation commence-t-elle à faire l’objet d’une attention soutenue, et même d’un regard au microscope. Qu’on en juge par Furetière, que le microscope fascine, et qui ne peut s’empêcher de conclure l’article consacré au point par cette remarque émouvante : « Les points d’Imprimerie les plus ronds paroissent avec le microscope herissez comme des chastaignes » !
Quelle forme ? Quel sens ?
« Marque faite en forme de petit e renversé », déclare Furetière en 1690 au moment de définir la virgule dans son Dictionnaire universel . Mais quatre ans plus tard, dans la première édition du Dictionnaire de l’Académie française , la lettre change, il s’agit cette fois-ci d’une « petite marque en forme de c renversé ». Choisira-t-on alors de retourner la voyelle ou la consonne ?
L’histoire semble donner raison à la consonne. Jusqu’à la septième édition du Dictionnaire de l’Académie (1878) perdure en effet l’assimilation à la troisième lettre de l’alphabet. « Petit signe fait à peu près en forme de c renversé, et dont on se sert dans la ponctuation, pour séparer les membres de phrases… » De son côté, Pierre Larousse, dans le Grand Dictionnaire universel du XIX esiècle (1865–1876), décide d’en finir avec la comparaison litigieuse et d’aller au plus simple en représentant ladite virgule dans la définition, sans autre forme de procès. Pour l’instituteur bourguignon, la virgule, qui tient son nom du latin virgula signifiant « petite verge », représente donc un « petit trait un peu courbé vers la gauche (,), que l’on place à droite et vers le bas des mots, pour indiquer un léger repos dans la lecture, une légère suspension dans le sens. » Une telle définition est assurément infiniment meilleure que celle offerte dans la huitième édition du Dictionnaire de l’Académie (1935) où l’on se contente d’« un signe de ponctuation qui, dans une phrase, indique la moindre des pauses ».
Читать дальше