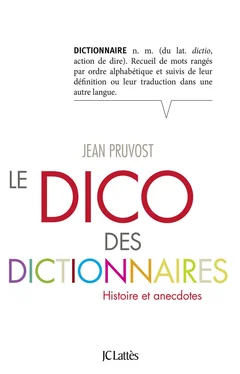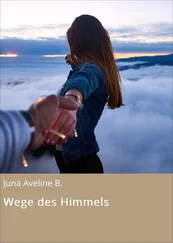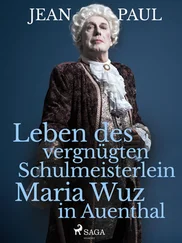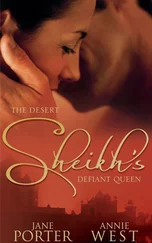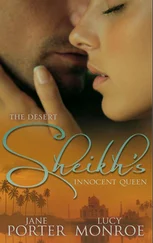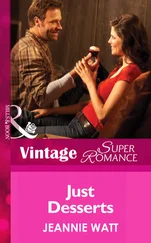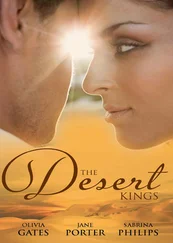U . La 21 elettre de l’Alphabet et la 5 edes voyèles. La prononciation de l’ u voyèle nous est venue des anciens Gaulois. Les Romains lui donnaient le son d’ ou , et ce lui que lui donnent encore les autres nations de l’Europe.
Jean-François Féraud, Dictionaire Critique de la langue française, 1787.
UNITÉ. Soudure aimante qui s’oppose à ce qui nous oppose.
Jacques Dor, Le Dico de ma langue à moi, 2000.
UT […] Premier mot du premier vers de l’hymne latin de saint Jean-Baptiste de Paul Diacre ( Ut queant laxis) choisi par Gui d’Arezzo (995-1050) pour désigner la première note de la gamme. Remplacé par do au XVIII es. dans les exercices de solfège.
Trésor de la langue française, 1971–1994.
Les mots sont jugés bons ou mauvais, selon qu’il plaît, et sans que l’on soit tenu à fournir un motif valable et discutable. Si l’on n’admet pas, comme jadis, l’autorité absolue de l’usage, du bel usage, on n’a pour guide que son propre goût.
Rémi de Gourmont, Esthétique de la langue française, 1899.
L’usage est chose complexe à définir. Tout comme le goût. Et c’est encore plus difficile lorsqu’il est question du bon usage , du bon goût . Le mauvais goût, c’est toujours celui de l’autre. Le bon usage, c’est toujours le sien. Et même lorsqu’on se fie à quelque autorité indiscutée, Littré ou l’Académie française par exemple, l’usage n’a pas nécessairement le même parfum.
De la vantance à la bouffe
Ainsi, pour Littré, particulièrement sensible à la langue classique des XVII eet XVIII esiècles, de Corneille ou de Voltaire, bien des archaïsmes font partie du bon usage. Et d’insister dans sa préface en rappelant que de nombreux mots « devenus archaïques veulent être inscrits, pour que, rencontrés, on puisse en trouver quelque part l’explication ». Un dictionnaire, affirme-t-il, « doit cette explication aux lecteurs qui en ont besoin », sans compter les « auteurs classiques eux-mêmes, à qui ce serait faire dommage de laisser perdre ces traces de leur pensée et de leur style ». C’est assez raisonnable mais il pousse loin l’archaïsme à garder dans l’usage et ne nous fera pas grâce, par exemple, de la vantance , la vantardise… Il est vrai que Chateaubriand, dans ses Mémoires d’outre-tombe , y fait encore référence, en regrettant que « les vantances […] font mettre en doute les vrais périls ».
Dans le Dictionnaire de l’Académie française , contemporain de celui de Littré, en 1878, la vantance , qui semblait indispensable à ce dernier, n’est pas retenue. De fait, dès la première édition de son dictionnaire, l’Académie considère « qu’elle ne devoit pas y mettre les vieux mots qui sont entièrement hors d’usage ». On l’admet volontiers. En réalité, le Dictionnaire de l’Académie , dictionnaire « de l’usage, simplement et suprêmement » selon le propos de Maurice Druon dans sa Préface de 1986, reste très sensible à l’évolution de la langue, dès lors que les nouveaux mots ne sont pas voués à une existence éphémère.
On aime à lire chez Littré les explications qu’il glisse parfois à la fin de ses articles, livrant son sentiment sur l’usage. Par exemple, à l’article Bouffer : « Le langage populaire confond bouffer avec bâfrer : il bouffe bien, sans doute à cause de la rondeur des joues, quand la bouche est remplie. Mais ce n’en est pas moins une locution rejetée par le bon usage. » Voilà qui ne se discute guère. Tout comme la définition et l’exemple immédiat donné par l’Académie pour le verbe « bouffer » : « Ingurgiter gloutonnement la nourriture ; manger. Il ne pense qu’à bouffer. » Quant à la marque d’usage apposée, « Pop. », elle ne fait pas de doute. Se voit-on proposer à son patron d’aller « bouffer » ?
Mais à dire vrai, toute marque d’usage demeure affaire de contexte : une Anglaise ravissante, avec un accent à la Jane Birkin, vous proposant une « petite bouffe », ce n’est peut-être pas vraiment populaire… En réalité, c’est inespéré.
Où est l’usage ?
Le philosophe et logicien français Edmond Goblot (1858–1935), tout en constatant dans son Traité de logique (1918) que la tâche du lexicographe est « d’enregistrer avec exactitude le sens que donnent à un mot ceux qui le prononcent et ceux qui l’entendent, en un temps, en un lieu et en un milieu donnés », n’en précise pas moins que « lorsqu’un dictionnaire fait autorité, il fixe, précise et unifie l’usage. Un bon dictionnaire améliore une langue ; il en diminue l’indétermination, en ralentit l’évolution, en élimine les variétés dialectales. Ses définitions ont, dans une certaine mesure, le caractère de conventions acceptées ».
La confusion est souvent faite entre le mot populaire inséré dans le dictionnaire et sa promotion. Quand, dans le millésime 2014 du Petit Robert , les lexicographes font entrer le mot bombasse , assorti d’une citation de Franck Thilliez, auteur de romans policiers, il n’est pas inutile d’en avoir la définition, « Femme (ou parfois homme) très sexy », même si l’on peut discuter la fréquence de la bombasse en tant qu’homme, et l’adjectif, sexy , qui aurait pu être précisé dans un français moins simpliste ; ce qui compte en revanche, c’est la marque d’usage offerte : « Familier. »
En fait, ce qui peut être discuté, c’est le choix du registre de langue proposé. Pour certains, bombasse sera familier, pour d’autres tout à fait vulgaire. En réalité se dégage toujours une tonalité générale du dictionnaire à travers le choix des marques. Le Petit Robert relève d’une assez grande tolérance dans les marques, indiquant pour familier ce que d’autres dictionnaires présenteront comme populaire. Les tenants du bel usage y seront souvent bousculés. Il faut cependant garder à l’esprit que « marquer » l’usage est parfois cornélien : injustice des situations, le mot bombasse , s’il est dit spontanément avec l’accent ziva , sera perçu comme vulgaire, mais prononcé avec un peu de recul et un accent aristocratique, il pourrait n’être que familier voire parodique. Quant au statut du mot, ce qui est dit n’est pas ce qui est écrit, l’usage littéraire magnifie un mot populaire. Dira-t-on que Céline est vulgaire ?
Dans la préface de ses Remarques sur la langue française, utiles à ceux qui veulent bien parler et bien escrire , publié en 1647, Vaugelas, qui fut le premier rédacteur du Dictionnaire de l’Académie française , avait défini ainsi le bon usage : « C’est la façon de parler de la plus saine partie de la Cour, conformément à la façon d’écrire de la plus saine partie des auteurs du temps. » Si on remplace la cour d’hier par les lieux de parole de bon aloi d’aujourd’hui, il faut alors oublier les auteurs qui, dans le sillage de Zola, de Céline, de Queneau ont su de la langue populaire et familière faire naître des œuvres incontestables. Et, en ne retenant que ceux qui n’exploitent pas la veine populaire, la définition de Vaugelas pourrait en définitive rester d’actualité.
En fait, entre le bon usage et la norme bien maîtrisée, l’écart est mince. Vaugelas avait déjà repéré la différence entre le bon usage à présenter dans un ouvrage et la démarche descriptive des auteurs de dictionnaires, d’un tout autre ordre : « Ces Remarques, affirmait-il judicieusement, ne sont pas comme un Dictionnaire qui reçoit toutes sortes de mots, pourvu qu’ils soient François, encore qu’ils ne soient pas du bel usage, & qu’au contraire ils soient bas & de la lie du peuple. » En effet, le mot enregistré dans un dictionnaire n’est pas pour autant promu, c’est un effet médiatique qui pousse à le croire ; en revanche, au lexicographe de savoir dire quelle est la marque d’usage à proposer.
Читать дальше