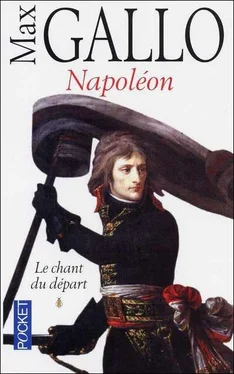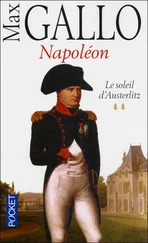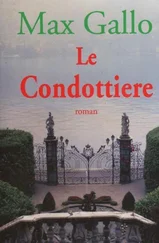Bonaparte l'accompagne jusqu'à leur voiture.
Lorsque les chevaux s'ébranlent, il se tourne avec brusquerie vers Lucien, lui parle sur le ton d'un maître.
Il a quinze ans. Il a déjà changé de rôle.
Le 25 juin, il prend la plume.
L'écriture est penchée, les fautes nombreuses, mais l'expression claire, la pensée forte. C'est un adulte de quinze ans qui s'exprime en s'adressant à son oncle Fesch. Il juge les uns et les autres, son frère cadet Lucien - qu'on nomme, parce que cadet, le Chevalier -, son aîné, Joseph. Chaque phrase indique un homme qui plie ses sentiments à sa raison.
Un homme - quinze ans à peine ! - qui pense par lui-même, forge seul son jugement. Il s'est construit une pensée personnelle en s'opposant à ceux qui l'entouraient. L'enfant qui a dû se défendre, se fermer pour ne pas se dissoudre dans la nostalgie, la tristesse, ou se fondre parmi les autres, est devenu une personne autonome, indépendante, sachant analyser et trancher, conclure.
Quinze ans !
Il écrit :
« Mon cher oncle :
« Je vous écris pour vous informer du passage de mon cher père par Brienne. Il a laissé ici Lucciano, qui est âgé de neuf ans et grand de trois pieds, onze pouces, six lignes2. Il est en sixième pour le latin, va apprendre toutes les différentes parties de l'enseignement. Il marque beaucoup de dispositions et de bonne volonté. Il faut espérer que ce sera un bon sujet. Il se porte bien, est gros, vif et étourdi, et pour le commencement on est content de lui. Il sait très bien le français et a oublié l'italien tout à fait...
« Je suis persuadé que Joseph mon frère ne vous a pas écrit. Comment voudriez-vous qu'il le fît ? Il n'écrit à mon cher père que deux lignes, quand il le fait. En vérité, ce n'est plus le même... Quant à l'état qu'il veut embrasser, l'ecclésiastique a été comme vous le savez le premier qu'il a choisi. Il a persisté dans cette résolution jusqu'à cette heure où il veut servir le roi : en quoi il a bien tort par plusieurs raisons... Il n'a pas assez de hardiesse pour affronter les périls d'une action. Sa santé faible ne lui permet pas de soutenir les fatigues d'une campagne, et mon frère n'envisage l'état militaire que du côté des garnisons... Il se tirera toujours bien d'une société, mais d'un combat ? »
Et Bonaparte, de son écriture rapide, poursuit le réquisitoire. Joseph, qui ne connaît pas les mathématiques, ne pourra faire un officier ni de marine, ni d'artillerie. Infanterie alors ? « Bon, je l'entends, il veut être toute la journée sans rien faire, il veut battre le pavé... Qu'est-ce qu'un mince officier d'infanterie ? Un mauvais sujet les trois quarts du temps, et c'est ce que, mon cher père, ni vous ni ma mère, ni mon cher oncle l'archidiacre ne veulent, car il a déjà montré des petits tours de légèreté et de prodigalité... »
C'est un cadet qui parle de son aîné ! Un adolescent-homme qui se sent responsable de toute sa famille, comme s'il en était le chef.
Quelques jours plus tard, Bonaparte reprend la plume. Il a essuyé une nouvelle déception. Son père ne repassera pas par Brienne. Il rentre directement de Paris en Corse.
« Mon cher père
« Votre lettre, comme vous pensez bien, ne m'a pas fait beaucoup plaisir, mais la raison et les intérêts de votre santé et de la famille qui me sont fort chers m'ont fait louer votre prompt retour en Corse et m'ont consolé tout à fait.
« D'ailleurs, étant assuré de la continuation de vos bontés et de votre attachement et de votre empressement à me faire sortir et seconder en ce qui peut me faire plaisir, comment ne serais-je pas bien aise et content ? Au reste, je m'empresse de vous demander des nouvelles des effets que les eaux ont fait sur votre santé et de vous assurer de mon respectueux attachement et de mon éternelle reconnaissance. »
Fils aimant, fils « respectueux », attaché à la famille, fils reconnaissant qui salue les efforts de son père pour le faire « sortir » de Brienne, il n'en poursuit pas moins sa lettre en conseillant son père quant au choix des études de Joseph. Il souhaite qu'il place son frère aîné à Brienne plutôt qu'à Metz, « parce que cela sera une consolation pour Joseph, Lucien et moi ». Il souhaite que son père lui envoie des ouvrages sur la Corse. « Vous n'en avez rien à craindre, j'en aurai soin et les rapporterai en Corse avec moi quand j'y viendrai, fût-ce dans six ans. »
« Adieu, mon Cher Père, conclut-il. Le Chevalier - Lucien - vous embrasse de tout cœur. Il travaille fort bien. Il a fort bien su à l'exercice public. »
Puis il adresse ses respects à tous les membres de la famille, aux Zie - les tantes -, et il signe :
« Votre très humble et très obéissant T.C. et fils de Buonaparte, l'arrière-cadet. »
Dans la lettre à son père, une phrase apparemment anodine - « Monsieur l'Inspecteur sera ici le 15 ou le 16 au plus tard de ce mois, c'est-à-dire dans trois jours. Aussitôt qu'il sera parti, je vous manderai ce qu'il m'a dit » - marque l'attente de Bonaparte.
Il doit comparaître en effet une nouvelle fois devant Reynaud des Monts, qui a reçu du ministre l'autorisation d'appeler à l'École Militaire de Paris « les boursiers des petites-écoles qui se recommanderaient non seulement par leurs talents, leurs connaissances et leur conduite, mais par leur aptitude aux mathématiques ».
En septembre 1784, il choisit, lors de son inspection à Brienne, cinq élèves des minimes, qui deviennent ainsi cadets-gentilshommes et sont destinés à rejoindre Paris. Le premier nom cité est celui de Montarby de Dampierre qui a opté pour la cavalerie. Le second, Castres de Vaux, se destine au génie. Les trois autres sont candidats à l'artillerie. Aux côtés de Laugier de Bellecourt et de Cominges, Napoleone Buonaparte.
Quand il entend son nom, l'adolescent se contente de redresser la tête, et son émotion ne se lit que dans l'éclat du regard.
Il sait ce que signifie ce départ. D'abord, échapper à la routine de Brienne, à ces lieux trop familiers, à ces paysages trop gris. Il y abandonne Lucien, c'est sa blessure. Mais il peut obtenir le grade d'officier en une année, et son frère Joseph disposera alors d'une bourse et rejoindra à son tour Brienne, pour y suivre les cours de mathématiques du père Patrault.
Bonaparte ne laisse rien paraître de sa joie. Mais il marche plus vite, arpentant la cour de long en large, les bras croisés derrière le dos. Il a franchi un obstacle. Il avance. Tout est possible.
Cependant il faut attendre. Les jours s'étirent démesurément. Et ce n'est que le 22 octobre 1784 que Louis XVI, « ayant donné à Napoleone de Buonaparte, né le quinze août 1769, une place de cadet-gentilhomme dans la compagnie des cadets-gentilshommes établie dans mon école militaire », prie « l'inspecteur général, M. de Timbrune-Valence, de le recevoir et de le faire reconnaître en ladite place ».
Le 30 octobre, Napoléon Bonaparte quitte Brienne en compagnie de ses quatre camarades et d'un minime qui les surveille.
Ils prennent d'abord la voiture jusqu'à Nogent, et là embarquent sur le coche d'eau pour Paris.
Le ciel est gris. De temps à autre il pleut.
Mais un cadet-gentilhomme de quinze ans peut-il se laisser aller à la mélancolie lorsqu'il se dirige vers la capitale du royaume de France, où le roi l'accueille comme boursier de sa plus prestigieuse école militaire ?
Voilà ce qu'arrache un étranger, le citoyen d'une patrie vaincue, un Corse, quand il sait vouloir.
« Je veux », murmure Bonaparte.
1- 1,58 m environ.
2- 1,10 m environ.
3.
Bonaparte marche dans Paris. C'est « un petit jeune homme fort brun, avec des culottes à parements rouges, triste, rembruni, sévère » mais dont les yeux avides dévorent la ville.
Читать дальше