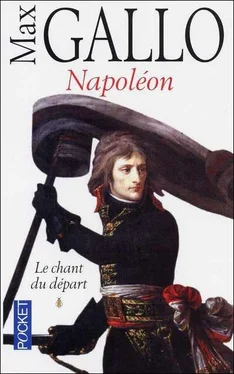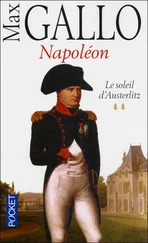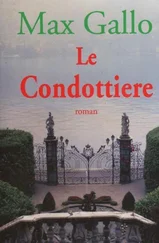Lorsqu'en septembre 1785, pendant la période d'examen, il constate l'absence de Bonaparte, il interroge ses camarades. On lui répond que Bonaparte concourt pour le grade de sous-lieutenant d'artillerie.
- Il sait donc quelque chose ? questionne Baur.
- Comment ? lui répond-on. C'est l'un des plus forts mathématiciens de l'école.
- Eh bien, dit l'Allemand, j'avais toujours pensé que les mathématiques n'allaient qu'aux bêtes.
Bonaparte néglige aussi les cours de danse. Il se désintéresse de la bonne éducation et des belles manières qu'on enseigne également à l'École Militaire de Paris dans le souci de conforter l'excellence et le prestige de la noblesse.
Mais Bonaparte, adolescent pressé, enfermé sur lui-même, obsédé par le but qu'il s'est fixé, n'a pas le temps d'apprendre ce qui ne lui est pas immédiatement utile.
Tout doit être subordonné à la réussite en une seule année des deux concours.
Peu importe qu'il n'obtienne à l'école, durant cette année, aucun des grades qui sont attribués à certains élèves, nommés sergent-major, commandant de division ou chef de peloton. Avec un sens de l'efficacité et de l'utilité, il se moque de ces trois galons d'argent que certains arborent avec fierté.
Il ne sera pas non plus décoré, comme Picot de Peccaduc ou Phélippeaux, de la croix de l'ordre de Notre-Dame-du-Mont-Carmel ! Il faudrait pour cela qu'il passe trois années à l'École Militaire !
Trois années ! À cette seule idée, il croit mourir ! Il lui faut dix mois pour, équation après équation, théorème après démonstration, figure après figure, apprendre tout le traité de mathématiques de Bezout.
Il ne se laisse distraire par rien, acharné, obstiné.
D'ailleurs la discipline de l'école ne tolère aucune sortie, ne prévoit aucun congé. Et il ne recevra qu'une seule visite dans le grand parloir de l'école, celle d'un cousin, Arrighi de Casanova.
Entre les leçons et les études, il arpente souvent un vaste espace de terrain que l'on nomme la Promenade et qui est pourvu de huit bancs de chêne et bordé, sur toute la longueur, par des barrières formées de planches en bois blanc.
On y avait bâti, au début de l'année 1785, deux hangars, puis une sorte de redoute, pour donner aux cadets l'idée exacte d'une ville fortifiée.
Bonaparte marche rapidement le long de cette promenade, un livre à la main. Il apprend. Il récite. Et parfois, il versifie.
Le voici, en janvier 1785, qui compose un poème maladroit. Et il recopiera ces vers sur la page de garde de son traité de mathématiques :
Grand Bezout, achève ton cours
Mais avant, permets-moi de dire
Qu'aux aspirants tu donnes secours
Cela est parfaitement vrai
Mais je ne cesserai pas de rire
Lorsque je l'aurai achevé
Pour le plus tard au mois de mai
Je ferai alors le Conseiller .
Il est sûr, dès ce mois de janvier, d'en avoir fini en mai avec l'étude du Traité de mathématiques , soit plus de quatre mois avant l'examen, prévu pour le mois de septembre.
Il organise son travail de manière méthodique, prévoit le temps des révisions, car les épreuves sont ardues et l'accès à l'artillerie, cette arme savante, difficile. Un noble désargenté, s'il a du talent, peut, dans cette arme, être sûr de gravir les échelons, la sélection se faisant par examen des qualités du candidat.
On compte vingt-cinq cadets-gentilshommes qui se destinent, en 1785, à l'artillerie. Mais le gouverneur de l'école, M. de Timbrune-Valence, n'autorise que dix-huit élèves à concourir.
Le premier est Des Mazis, l'ami de Bonaparte, qui avait échoué en 1784, puis vient Picot de Peccaduc. Bonaparte suit son ennemi, le Vendéen Phélippeaux. Plus bas dans la liste, on trouve Laugier de Bellecourt, qui, malgré sa dissipation, a été jugé apte à concourir.
Bonaparte, quand il voit cette liste, ne cède qu'un instant à un sentiment de supériorité : il ne craint pas ses concurrents.
Il se sait l'un des meilleurs mathématiciens de l'école.
Mais il y a les candidats des écoles de province, et notamment ceux de l'école de Metz, la plus prestigieuse école d'artillerie. De plus, il ne veut pas se contenter de réussir ce premier concours. Il n'oublie pas le concours d'officiers. Il redouble donc d'efforts.
Il aborde le troisième volume du traité de Bezout au mois de février 1785.
Rien ne doit dévier de la route.
Et pourtant, à la fin de ce mois-là, une nouvelle frappe Napoléon Bonaparte comme la foudre. Son père, Charles Bonaparte, est mort le 24 février 1785 à Montpellier. Il avait trente-neuf ans.
La douleur violente se lit sur le visage de l'adolescent. Ses traits se creusent. Il savait son père malade, mais le vide est là, devant lui, et Bonaparte se tient sur le bord, près de basculer.
Le directeur des études, Valfort, qui vient de lui annoncer la nouvelle, l'invite, comme c'est l'usage, à se retirer à l'infirmerie afin d'y pleurer et d'y prier, de se soumettre à la souffrance que le destin lui impose. Bonaparte reste un instant silencieux, puis il répond d'une voix sourde qu'un homme doit savoir souffrir. C'est aux femmes de pleurer. Il demande donc à reprendre sa place, comme si rien ne s'était produit. Le chagrin est une affaire personnelle. « Je ne suis pas venu jusqu'à cette heure sans avoir songé à la mort, dit-il. J'y accoutume mon âme comme à la vie. »
Et cependant sa peine est extrême.
Il apprend comment son père avait subi durant ces derniers mois les assauts de plus en plus cruels de la maladie. Des vomissements, des douleurs intolérables à l'estomac, l'impossibilité de s'alimenter.
En compagnie de Joseph, son fils aîné, Charles Bonaparte avait voulu gagner Paris pour s'y faire à nouveau examiner par le médecin de la reine, le docteur Lasonne. Mais le navire, dès qu'il a quitté la Corse, au mois de novembre 1784, a essuyé une tempête et a été rejeté vers Calvi, où il a fait escale, et il n'a abordé les côtes de Provence qu'après un nouveau et brutal coup de vent.
À Aix, Charles Bonaparte a retrouvé son beau-frère, le séminariste Fesch.
Les souffrances sont si vives qu'un médecin, le professeur Turnatori, conseille à Charles Bonaparte de se rendre à Montpellier où exercent des médecins renommés, La Mure, de Sabatier, Barthez.
Mais il est trop tard. À Montpellier, Charles Bonaparte s'affaiblit d'heure en heure.
Son fils Joseph, son beau-frère Fesch, une Mme Pernom et sa fille Laure l'entourent de soins.
Charles, l'esprit fort, l'ennemi des jésuites, le voltairien, réclame des prêtres, se confesse, prie. Sa voix se voile, puis par à-coups s'éclaircit, et dans les heures qui précèdent sa mort il appelle Napoléon, ce fils seul capable de le sauver, de l'arracher au dragon de la mort.
Dans des accès fébriles, il crie que l'épée de Napoléon fera trembler les rois, que son fils changera la face du monde. S'il était présent, « il me défendrait de mes ennemis », lance-t-il.
Il tente de se redresser, il répète : « Napoléon, Napoléon », puis retombe.
Il meurt ce 24 février 1785.
Les médecins, dans les heures qui suivent, procèdent à son autopsie, décrivent : « À l'orifice inférieur de l'estomac, une tumeur de la longueur et du volume d'une grosse patate ou d'une grosse poire d'hiver allongée. Les tuniques de l'estomac vers le milieu de sa grande courbure étaient très épaisses et d'une consistance très ferme approchant du cartilage... Nous avouons que nous trouvâmes le foie gorgé et la vésicule du fiel extrêmement remplie d'une bile très foncée, ayant acquis le volume d'une poire médiocre, allongée... »
Читать дальше