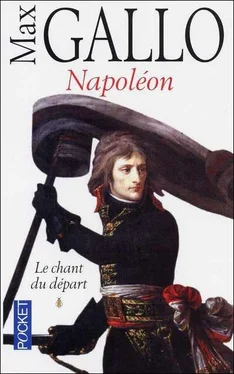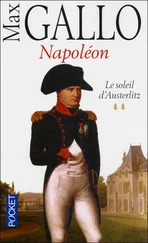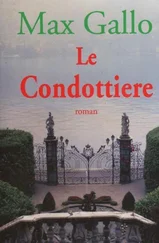L'émotion, au moment où Bonaparte se voit, la taille et les épaules prises dans cette tenue qui exprime son succès, est si forte qu'il baisse les yeux. Éprouvera-t-il jamais une joie aussi grande ? Portera-t-il jamais un uniforme aussi beau !
Il se dirige vers les casernes. Il prend la garde comme officier au poste de la place Clerc, au centre de la ville. Il participe aux manœuvres avec sa compagnie. Il suit la construction des batteries. Il écoute les leçons de géométrie et de calcul différentiel et intégral, de trigonométrie, que le professeur Dupuy de Bordes donne aux officiers du régiment pour compléter leurs connaissances. Certains jours, il reçoit des cours de dessin pour apprendre à tracer des plans, des profils et des cartes. Et, à la salle de conférences, les officiers exposent les leçons tirées de leurs expériences sur la façon de pointer et de charger les bouches à feu, de disposer les batteries et les mines.
Il est attentif, avide de connaissances. Il lit les traités de Guibert et Gribeauval, les théoriciens de la guerre « moderne ».
Il répond, quand on l'interroge sur ces matières, avec une précision qui étonne chez un jeune lieutenant en second de dix-sept ans à peine. Sa voix est creuse, son timbre sourd, sa parole brève et sèche. On devine sa passion. Il aime le métier des armes. Il apprend avec la même détermination que celle qu'il avait mise à posséder le Traité de mathématiques de Bezout. Il se sent à l'aise parmi ces officiers, parce qu'ils sont comme lui passionnés par la spécialité savante qu'ils ont choisie, l'artillerie.
Ce savoir exigeant qu'ils doivent posséder crée entre eux une amitié chaleureuse que Napoléon Bonaparte apprécie. Malgré son patriotisme corse qui demeure et même se renforce, il se sent à l'aise avec ses camarades.
« L'artillerie, dira-t-il, est le meilleur corps et le mieux composé de l'Europe. Le service est tout de famille, les chefs sont entièrement paternels, et les plus braves, les plus dignes gens du monde, purs comme l'or, trop vieux parce que la paix a été longue. Les jeunes officiers rient d'eux parce que le sarcasme et l'ironie sont la mode du temps, mais ils les adorent et ne font que leur rendre justice. »
Mais si, à Valence, la vie de Bonaparte est la plus douce qu'il ait jamais connue depuis qu'enfant il est arrivé en France, c'est qu'il est dans une ville qui appartient déjà à ce Sud, et que les gens de cette région sont des Méridionaux accueillants.
Corse ? lui demande-t-on.
Il est sur ses gardes. Il répond d'une inclination de tête.
Mais on le félicite pour son origine, on trouve que son accent encore teinté de sonorités italiennes rend la conversation plus attachante. On l'introduit dans la bonne société de la ville.
Il fait effort pour plaire, prenant des cours de danse et de maintien. Il reste maladroit et gauche. Cependant, il regarde ces nobles français dont l'élégance et la désinvolture, le brillant des manières et de la conversation paraissent innés.
Son uniforme est souvent froissé, plissé par les mouvements brusques de son corps. Son cou est enveloppé par une cravate tortillée. Ses tempes sont dissimulées par de longs cheveux plats tombant jusqu'aux épaules.
Il y a quelque chose de rustre et d'anguleux en lui. Pas de rondeur et de grâce, mais un mélange de timidité, de sauvagerie et de brusquerie dans le propos et dans l'allure.
Pourtant on le reçoit chez Jacques Tardivon, ancien prieur de la Platière et abbé général de l'ordre de Saint-Ruf, à qui l'évêque d'Autun, Mgr de Marbeuf, l'a recommandé, présentant Bonaparte comme un jeune officier de grand avenir et l'un de ses protégés.
M. de Tardivon l'accueille en son salon de l'hôtel de Saint-Ruf qui réunit la noblesse valentinoise.
Bonaparte, en uniforme, en impose, malgré son allure. Son silence intrigue. Son regard attire. Quand le beau-frère de M. de Tardivon, M. de Josselin, familier de l'hôtel de Saint-Ruf et ancien lieutenant-colonel du régiment d'infanterie d'Artois, l'interroge, Bonaparte répond brièvement, mais cette économie de mots retient l'attention.
Ce jeune lieutenant est singulier.
On le recommande aux dames de Valence, Mme Lauberie de Saint-Germain, Mme de Laurencin et Mme Grégoire du Colombier, qui tiennent salon chez elles.
Bonaparte se présente dans ces maisons où soufflent les idées nouvelles. Il est à la fois timide, ce qui séduit, et audacieux, provocateur même par franchise, ce qui émeut ces bienveillantes quinquagénaires. Il est si jeune !
Il s'habitue ainsi peu à peu à une vie sociale, se rendant souvent à la maison de campagne de Mme du Colombier, à Basseaux, à trois lieues de Valence.
Il marche d'un pas alerte, dans ce paysage déjà provençal qui lui rappelle les parfums et la végétation de la Corse. Il a la tête pleine de ses lectures.
En ce moment, il lit et relit les œuvres de Rousseau. Il connaît par cœur des passages des Rêveries d'un promeneur solitaire , des Confessions , de La Nouvelle Héloïse . Il est en sympathie avec celui qu'il appelle Jean-Jacques.
Cette Mme du Colombier, ce pourrait être Mme de Warens, l'initiatrice de Rousseau. Bonaparte, qui n'a pas encore connu l'amour, est sensible à la compagnie de cette femme instruite, spirituelle, distinguée, qui fait effort pour le charmer.
Bonaparte lui confie, assis près d'elle, qu'il pense à écrire une Histoire de la Corse . Elle s'enthousiasme. A-t-il lu les œuvres de l'abbé Raynal ? M. de Tardivon connaît cet auteur à la mode. Lorsque l'abbé descend de Paris à Marseille, il fait étape à l'hôtel de Saint-Ruf. Mme du Colombier conseille à Bonaparte d'écrire à l'abbé, de commander des livres à un libraire de Genève, Paul Borde.
Et aussitôt, Bonaparte prend la plume, demande que le libraire lui envoie des ouvrages qui puissent « servir de suite aux Confessions de Jean-Jacques Rousseau ». « Je vous prierai également, continue Bonaparte, de m'envoyer les deux volumes de l' Histoire de la Corse de l'abbé Germanes. Je vous serais obligé de me donner note des ouvrages que vous avez sur l'île de Corse ou que vous pourriez me procurer promptement. J'attends votre réponse pour vous envoyer l'argent à quoi cela montera. »
Il s'abonne comme le lui a conseillé Marie-Claude Bou au cabinet de lecture du libraire de Valence, M. Aurel, et les livres s'entassent sur la petite table de la chambre de la maison Bou.
Il lit. Il vit ses lectures. Jean-Jacques, c'est le double, celui qui exprime ce qu'éprouve ce jeune homme encore indécis sur son avenir. Bonaparte ne s'est-il pas senti différent ? N'a-t-il pas été incompris, moqué comme Rousseau ? Quand Bonaparte se rend à Basseaux, n'est-il pas le frère du promeneur solitaire ?
Quand Bonaparte escalade la montagne de Roche-Colombe avec un camarade du régiment de La Fère et qu'il s'exalte devant la beauté de la nature en ce mois de juin 1786, n'est-il pas semblable à Rousseau ?
Bonaparte marche, méditatif et ému. Il découvre un vaste panorama. Et il se sent grandi par l'étendue qu'il contemple. Il est en correspondance avec Jean-Jacques : « J'aime, dit-il, m'élever au-dessus de l'horizon. »
Il redescend avec le crépuscule. Il s'interroge. Que sera-t-il ? Un écrivain ? Un « philosophe » ? Un législateur, comme Rousseau a voulu l'être ? Un auteur qui définira, comme lui, un contrat social ?
Bonaparte passe de l'enthousiasme à l'abattement, de l'audace à la timidité. Il a moins de dix-sept ans. Que sera cette vie qui commence ?
Quelques mots échangés avec Mlle de Lauberie de Saint-Germain suffisent à l'émouvoir. Il admire sa beauté, sa « vertu ». Il ne va pas au-delà. Il n'a jamais fait l'amour.
Читать дальше