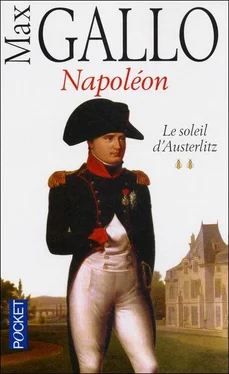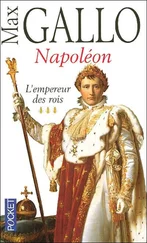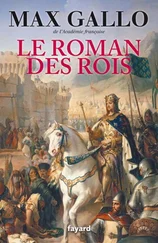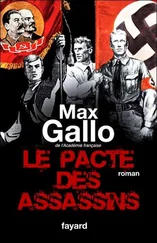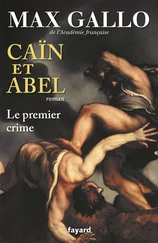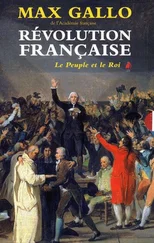Il a eu l'idée, en questionnant l'ingénieur de la Marine, Sganzin, et Forfait, expert en construction navale, de concevoir une flottille de petits navires. Ces chaloupes canonnières, ces bateaux canonniers, ces péniches transporteront chacun une centaine de soldats, des canons. Ils seront capables de naviguer à rames et à voiles, alors que le beau temps peut immobiliser les gros navires.
Il ne dicte plus. Il voit ces milliers de bâtiments harcelant les vaisseaux de ligne anglais.
Il faudrait plus de deux mille navires. Il faudrait utiliser pour la traversée les deux ou trois jours - il y en a en toute saison - où la mer est calme. Dût-on sacrifier cent de ces embarcations, que l'opération serait cependant possible. On pourrait réunir plus de cent soixante mille hommes, dont cent vingt mille à Boulogne.
Et si on ajoutait à cela, déjà suffisant pour réussir, les flottes de haut bord venues de Toulon, de Brest, de Ferrol et du Texel, capables de tenir, ne fût-ce que trois jours, la mer, et de fixer ainsi l'escadre anglaise, alors la réussite serait certaine.
Il ne jouera que quand il aura toutes ces cartes en main. « À la guerre, rien ne s'obtient que par le calcul, dit-il à Méneval. Tout ce qui n'est pas profondément médité dans les détails ne produit aucun résultat. »
Il se laisse aller contre le siège de la banquette.
« Et puis, murmure-t-il, il y a les circonstances imprévues, qui font échouer les bons plans de bataille et parfois réussir les mauvais. »
Lorsque la voiture traverse la place Vendôme, il la fait ralentir, puis tourner autour de la place et s'arrêter quelques instants.
Il imagine le monument auquel il songe depuis longtemps, peut-être depuis que Fontanes, l'amant de sa sœur Élisa, le compare sans cesse à Charlemagne.
Il descend de voiture, marche jusqu'au milieu de la place. Peut-être est-il en effet de la race des bâtisseurs d'empire ?
Des passants se sont arrêtés et l'acclament. Il remonte en voiture et commence à dicter.
« Il sera élevé à Paris, au centre de la place Vendôme, dicte-t-il, une colonne à l'instar de celle érigée à Rome en l'honneur de Trajan. La colonne sera surmontée d'un piédestal terminé en demi-cercle, orné de feuilles d'olivier et supportant la statue pédestre de Charlemagne. »
Il gagne son cabinet. Il continue de dicter. Il faut que toutes les fonderies de la République soient au travail, jour et nuit.
Il marche, les mains derrière le dos. Il prise.
Il faut prendre les dispositions pour armer et atteler quatre cents bouches à feu de campagne, sans compter l'artillerie de siège.
Où en sont les constructions de chaloupes ?
Il harcèle les chefs de chantier par de brèves dépêches, qu'on fait porter par courrier, quai de la Rapée et quai de Bercy.
Il faut que les troupes manœuvrent par tout temps, que les bâtiments sortent en mer, affrontent les frégates anglaises. Il faut construire des forts à l'entrée de Boulogne. Il faut, il faut, il faut...
Il veut tout voir par lui-même.
Il monte dans une péniche, quai des Invalides, et il commande la manœuvre cependant que, sur les berges, la foule s'agglutine, le reconnaît, l'applaudit. Il se met aux avirons, en aval du pont de la Concorde.
Il voudrait pouvoir ramer ainsi jusqu'à Londres.
Bientôt il sera à la tête de la « Grande Armée » d'Angleterre, et le temps viendra de l'invasion.
Il reçoit Philippe de Cobenzl, le cousin du chancelier d'Autriche. Il devine Cobenzl à l'affût d'informations. Vienne, comme Berlin, ne sait que penser de cette guerre qui commence. Les Autrichiens ont vu leur influence réduite en Allemagne, depuis la réorganisation sous inspiration française des principautés allemandes. L'empereur d'Autriche ne sera plus jamais empereur d'Allemagne.
J'ai obtenu cela.
- Les guerres inévitables sont toujours justes, commence Napoléon.
Puis, d'une voix égale, comme si cela n'avait aucune importance, il ajoute :
- Cette guerre entraînera nécessairement après elle une guerre sur le continent. Pour ce cas...
Il observe Cobenzl. L'homme fera son rapport à Vienne. Les choses ainsi seront claires.
- Pour ce cas, reprend Napoléon, je devrais avoir de mon côté l'Autriche ou la Prusse. Il me sera toujours facile de gagner la Prusse en lui donnant un os à ronger. Je n'ai en Europe que l'Autriche à redouter.
À Vienne de décider quel sera son camp. Il scrute le visage de Cobenzl.
L'Autriche se déterminera en raison de ma force ou de ma faiblesse. Est-il une autre loi ?
Il faut donc que je sois fort, invincible.
Et, pour cela, il faut qu'il veille personnellement à chaque détail.
Il va donc inspecter le camp de Boulogne, y choisir des résidences fixes qu'il retrouvera à chacun de ses séjours. Il participera aux manœuvres des troupes. Il veut les voir embarquer puis débarquer.
Il dit à Duroc : « La présence du général est indispensable : c'est la tête, c'est le tout d'une armée. »
Il partira donc pour Boulogne le 24 juin 1803.
Il a décidé de l'importance du cortège qui visitera d'abord les villes du Nord. Il veut un détachement de la garde consulaire, des aides de camp, le ministre de la Marine Decrès, et celui de l'Intérieur Chaptal, l'amiral Bruix, les généraux Soult, Marmont, Duroc, Moncey et Lauriston.
Le matin du départ, il choisit avec soin son uniforme. Commander, c'est être vu. Il portera celui des chasseurs des Guides, habit vert, garniture orange, et le petit chapeau de feutre noir sans galon mais avec une cocarde tricolore.
Il entre dans les appartements de Joséphine. Il veut qu'elle soit du voyage, comme une souveraine accompagne le roi.
Il s'approche d'elle, touche les plis de la tunique de mousseline de l'Inde et secoue la tête.
Il aime mieux, dit-il, qu'elle porte des vêtements de couleur, en taffetas ou en satin de soie qu'on fabrique à Lyon, et non ces tuniques en tissu anglais.
Il ne l'écoute pas cependant qu'elle se jette sur un canapé, qu'elle cache son visage derrière un mouchoir, qu'elle pleure. Elle ne peut pas renoncer à ses vêtements de mousseline, à cette tunique que toutes les femmes portent, à Paris.
Elles l'abandonneront, dit-il brutalement. Qu'elle cesse de pleurnicher.
« Souviens-toi que tu n'as plus quinze ans, ni même trente, pour faire ainsi l'enfant ! »
Il lui donne quelques instants pour se changer.
Sait-elle qu'on est en guerre avec l'Angleterre et qu'il a décidé d'interdire les produits d'origine anglaise ?
Elle est l'épouse du Premier consul. Elle doit donner l'exemple.
Elle a obéi, choisi un vêtement en tissu taffetas de couleur bleue, ample. Il lui sourit, puis il se dirige vers sa berline de voyage, dont les quatre chevaux piaffent.
Il va pouvoir continuer à travailler. Méneval a déjà préparé les dossiers enfouis dans les tiroirs qui sont placés à cet effet dans la berline.
Napoléon donne le signal du départ. La route est ouverte par la première voiture, celle du service, dans laquelle ont pris place les fourriers chargés de préparer le relais. Derrière la berline, une troisième voiture transporte la suite du Premier consul. D'un geste, il a invité Joséphine à monter près de lui, mais elle n'ira pas jusqu'à Boulogne. Elle doit le quitter à Amiens.
Il veut savoir si, dans ces villes du nord de Compiègne, Montdidier, Amiens, Abbeville, la fin de la paix a provoqué un changement dans l'opinion. Il est vite rassuré. L'accueil est partout enthousiaste.
Il est heureux de se retrouver seul à partir d'Amiens. À Abbeville, tôt le matin, il parcourt les côtes à cheval durant près de six heures. Le vent est frais, la journée belle, la mer calme. Au loin, il aperçoit les voiles d'une croisière anglaise. Il s'arrête. Au bout du regard, dans la brume, il lui semble qu'il distingue les falaises de la côte anglaise.
Читать дальше