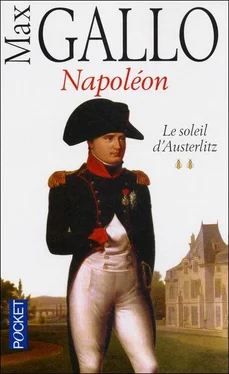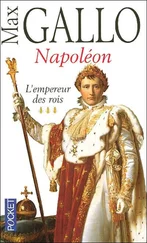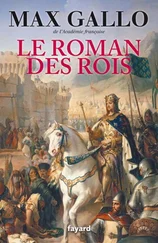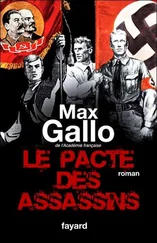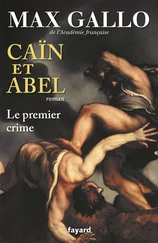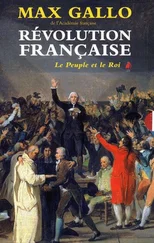Les autres sont malades. Ainsi ce préfet du Palais, M. de Rémusat, venu à Boulogne et qui n'a pas supporté l'humidité du temps. Comment ces hommes se laissent-ils ainsi terrasser ?
Il fait entrer dans le salon du château de Pont-de-Briques Mme de Rémusat, qui s'est rendue au chevet de son mari. Il compatit. Se souvient-elle de leur conversation sur la tragédie, Cinna ?
- Ici, dit-il, je ne me suis jamais si bien porté. La mer est horrible, et la pluie ne cesse de tomber, mais...
Il change de ton, déclame :
Je suis maître de moi comme de l'univers
Je le suis, je veux l'être...
Cinna , n'est-ce pas ?
Il veut la voir, puisqu'elle est au camp de Boulogne. Il la convie dans sa baraque. Il aime la retrouver, après ses chevauchées, ses sorties en mer. Il se confie. Il la sent fascinée. Il raconte ses campagnes. Elle n'a que vingt-deux ans.
- Le temps que j'ai passé en Égypte, dit-il, a été le plus beau de ma vie, car il a été le plus idéal...
Elle l'écoute, conteste parfois ses idées.
- Le style ne me frappe guère, dit-il, je ne suis sensible qu'à la force de la pensée. J'aime la poésie d'Ossian, parce que j'aime les vents et les vagues.
Il s'approche d'elle. N'a-t-elle pas, comme lui, la passion de la vie ?
Naturellement, Joséphine est jalouse, mais, après tout, n'est-ce pas son tour ? N'est-ce pas le mouvement naturel de la vie, qui fait se renverser les choses dans une révolution perpétuelle comme dans la mécanique céleste, chère à Laplace ? Il relit cette lettre que lui adresse Joséphine : « Voilà mon désir, mes vœux qui se réduisent tous à te plaire et à te rendre heureux. Oui, ma volonté est aussi de te plaire, de t'aimer ou plutôt de t'adorer. »
Jadis, d'Italie, c'était lui qui écrivait cette sorte de lettre.
Il revoit Joséphine et Mme de Rémusat côte à côte dans la salle des Tuileries où, le 15 janvier 1804, Joséphine donne ce qu'elle appelle un « petit bal ».
Il sourit à l'une et à l'autre mais refuse de danser, parlant avec Portalis, Lebrun, Girardin.
Il peut en quelques phrases les faire changer d'avis. Il les bouscule comme un bataillon de jeunes recrues. Ils ne sont pas de taille. Portalis défend la liberté de la presse ? Elle rétablirait bien vite l'anarchie, affirme Napoléon.
- Si les journaux pouvaient tout dire, Portalis, ne diraient-ils pas que Portalis a été un bourbonien dont je dois me méfier ? Qu'il a été favorable à leur cause en telle ou telle circonstance ?
Portalis toussote, baisse les yeux.
- Mais tout est oublié, mon cher Portalis.
Il fait quelques pas, regarde les couples danser. Ici se côtoient l'ancien et le nouveau, l'aristocrate et celui qui fut régicide. Cambacérès est à côté de M. de Rémusat.
- Dans ce pays, poursuit Napoléon, les éléments d'anarchie sont encore existants. Le nombre de gens qui n'ont rien est augmenté de ceux qui ont eu beaucoup. Il n'existe pas dans le clergé, dans le civil, dans le militaire, dans les finances, un seul emploi qui n'ait deux titulaires, l'ancien et le nouveau. Voyez que de ferments de révolution tout cela provoque !
Il fait quelques pas, salue d'un nouveau sourire Mme de Rémusat.
C'est pour cela, explique-t-il, qu'il a établi le livret ouvrier, pour contenir ces ferments, pour que le patron sache tout de celui qu'il emploie, qu'il en soit le chef.
- Mais les partis complotent, reprend-il. Ils savent que, moi vivant, aucune tentative ne peut réussir.
Il prise, puis croise les mains derrière le dos.
- Le but de leurs complots, c'est moi, dit-il. Moi seul. Bourboniens, terroristes, tous s'unissent pour me poignarder.
Des yeux, il fait le tour de la salle, et ajoute tout en se dirigeant vers Cambacérès :
- J'ai pour me défendre ma fortune, mon génie et mes gardes.
Il traverse la salle d'un pas rapide, invite Cambacérès à le suivre dans son cabinet de travail.
Il prend sur la table une lettre de Desmarets. Le responsable de la Police politique lui rappelle que cinq « brigands » bourboniens sont emprisonnés au Temple, et demande ce que doit être le sort de ces individus - Picot, Lebourgeois, Ploger et, d'abord Desol de Grisolles et Quérelle, ces deux derniers ayant été liés à Georges Cadoudal.
Napoléon lit la lettre. Il veut, dit-il, qu'on traduise d'urgence ces cinq hommes devant une commission militaire. Qu'on les juge. Qu'on les condamne. « Et ils parleront avant de se laisser fusiller », conclut-il. Puis il ajoute :
- Je sens l'air plein de poignards.
Sixième partie
Je suis la Révolution française et je la soutiendrai
Janvier - 28 juin 1804
22.
Napoléon avance lentement sur le front des troupes, à moins d'un mètre de la première rangée de soldats. Il s'arrête tous les trois ou quatre pas. Il regarde l'homme qui est en face de lui dans les yeux. Il reconnaît celui-là. Il interroge celui-ci. Égypte, Italie ? Il dit quelques mots. Il prend son temps.
Il se sent invulnérable. Et pourtant il suffirait d'un seul de ces hommes pour que tout s'arrête. Il imagine le coup de poignard d'un soldat ou d'un officier sorti des rangs et se précipitant, l'arme levée. On le frapperait là, à la gorge. Ou bien, d'une fenêtre du palais, on tirerait. Il fait une belle cible, dans la cour des Tuileries.
Il aperçoit, à la fenêtre du palais qui est proche de celle de son cabinet de travail, le conseiller d'État Réal. Réal a peur. Réal lui a conseillé de ne pas participer à la revue des troupes. Napoléon n'a même pas répondu. Il savait avant même que Réal parle, rapporte les aveux de ce royaliste, Quérelle, avant d'être fusillé, - les hommes sont ce qu'ils sont -, qu'on avait lancé les chiens contre lui. Combien de brigands pour le traquer ? Combien d'argent pour réussir enfin à tuer le Premier consul ?
Tous les rapports qui depuis plusieurs semaines arrivent d'Angleterre lui ont fait penser cela. Georges Cadoudal, disent les espions, vit à Londres dans l'opulence, réunissant des chouans. Autour du comte d'Artois et du duc de Berry, on ne parle que d'expéditions en France. Ces MM. de Polignac, Armand et Jules s'en vont proclamer partout qu'ils vont défier le Premier consul Buonaparte.
C'est si simple, pour l'Angleterre, de payer des assassins, alors qu'il est impossible pour elle de battre la Grande Armée et qu'elle craint l'invasion.
Si je meurs, que reste-t-il de mon œuvre ? Sans moi, tout peut s'effondrer. Sans moi, l'Angleterre est victorieuse .
On doit donc me tuer .
C'est la bataille qu'il faut affronter avant de livrer le combat des armées .
Napoléon s'est à nouveau arrêté de marcher dans la cour des Tuileries. Le vent tourbillonne. Il est glacial. Les visages sont rouges. Le froid s'insinue sous la redingote. Les doigts, malgré les gants, sont gourds. Mais il doit s'attarder, s'exposer aux exécutions.
Le royaliste Quérelle a parlé parce qu'il avait peur de mourir, qu'il tremblait à l'idée d'affronter les fusils du peloton d'exécution.
Je ne crains que la défaite .
Vais-je trembler pour une poignée de brigands ?
Il quitte la cour des Tuileries lentement.
Réal s'avance à sa rencontre. Il a le visage en sueur. Tout en marchant, Napoléon lui annonce qu'à partir d'aujourd'hui, ce 29 janvier 1804, Réal est chargé « sous la direction du Grand Juge, de l'instruction et de la suite de toutes les affaires relatives à la tranquillité de la République ».
Napoléon, de l'avant-bras, écarte les papiers qui se trouvent sur la table placée au centre de son cabinet de travail.
Plus rien ne compte à partir d'aujourd'hui que cette bataille. Non pour défendre sa vie. Le destin y pourvoira. Et il sent en lui tant de force et d'énergie, qu'il n'a pas d'inquiétude. On ne réussira pas à le tuer. Mais il faut extirper le mal, tout le mal. Trancher, car les conspirations sont une gangrène.
Читать дальше