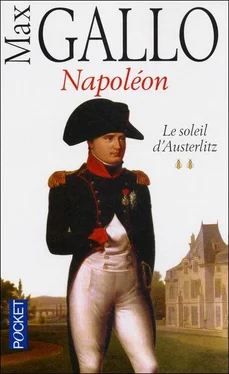Le seul danger, ce sont les généraux, vieux jacobins rancis que l'ambition et la jalousie aveuglent. Ils ne comprennent pas qu'il faut, pour être admis par les royaumes et les empires d'Europe, que « la forme des gouvernements qui nous environnent se rapproche de la nôtre ou que nos institutions politiques soient un peu plus en harmonie avec les leurs. Il y a toujours un esprit de guerre entre les vieilles monarchies et une République toute nouvelle »
Devenons roi, alors, peut-être accepteront-ils les conquêtes et les transformations de la Révolution et de la République .
Napoléon convoque Fouché aux Tuileries. Il ne veut pas faire de cet homme un ennemi. Mais le calme et l'assurance de Fouché le surprennent toujours et l'irritent.
- Monsieur Fouché, commence Napoléon, vous avez très bien servi le gouvernement. C'est avec regret que je me sépare d'un homme de votre mérite.
Fouché reste imperturbable. Il a ce petit sourire insupportable, comme s'il n'était en rien surpris par ce que Napoléon lui annonce. Il fera partie du Sénat. La suppression du ministère de la Police générale, rattaché désormais au Grand Juge Régnier, à la Justice donc, est imposée par la nouvelle situation internationale.
« Il a bien fallu, explique Napoléon, prouver à l'Europe que je m'enfonçais franchement dans le système pacifique et que je me reposais sur l'amour des Français. »
Mais un homme comme lui sait tout cela, ou ne se paie pas de mots.
- Vous vous en doutiez ? interroge Napoléon.
Naturellement, Fouché acquiesce, demande à présenter un mémoire sur la situation politique et l'emploi des fonds secrets de son ministère.
Napoléon l'écoute parler des périls qui subsistent, de la « coterie d'eunuques politiques qui au premier ébranlement livrerait l'État aux royalistes et à l'étranger ».
Napoléon le fixe. Cet homme est résolu. Il donne une impression de force. Il annonce maintenant qu'il reste dans sa caisse secrète deux millions quatre cent mille francs.
- Citoyen sénateur, dit Napoléon, je serai plus généreux et plus équitable que ne le fut Sieyès à l'égard de ce pauvre Roger Ducos en se partageant devant moi le gras de caisse du Directoire expirant. Gardez la moitié de la somme que vous me remettez ; ce n'est pas trop, comme marque de ma satisfaction personnelle et privée ; l'autre moitié entrera dans la caisse de ma police particulière qui, d'après vos sages avis, prendra un nouvel essor et sur laquelle je vous prierai de me donner souvent vos idées.
Il ne faut jamais cesser d'être sur ses gardes.
Le nouveau chef de la Police politique, Desmarets, vient d'annoncer la capture à Calais d'un prêtre, l'abbé David, qui, tremblant de peur, a avoué servir d'intermédiaire entre le général Moreau et le général Pichegru exilé en Angleterre. Desmarets a cru bon de relâcher l'abbé David, afin de le faire suivre. Mais ses espions seront-ils aussi efficaces que ceux de Fouché ?
C'est Londres, comme chaque fois, qui sert de refuge aux plus déterminés des ennemis, et sans doute les Anglais leur donnent-ils les moyens d'agir. La question revient, hante Napoléon : « Sommes-nous en paix, ou est-ce seulement une trêve ? »
Il a décidé qu'il donnerait chaque 15 du mois un grand dîner. Il y invite des artistes, des fabricants, des diplomates. Le 15 octobre 1802, il présente à Fox, un parlementaire britannique, et à lord Holland trois manufacturiers : Bruguet, Mont-golfier, Touney, qui viennent de participer à l'Exposition de l'industrie nationale et qui ont obtenu une médaille d'or.
Puis, durant le dîner, il interroge Fox, qui est assis à sa droite. Que veut l'Angleterre ? demande-t-il. Pourquoi laisse-t-elle le comte d'Artois, frère de Louis XVI, passer en revue un régiment, alors que Londres ne reconnaît plus cette monarchie, puisqu'elle traite avec la France consulaire ?
Fox se dérobe. Il est partisan de la paix, mais n'est-il pas l'un des seuls ?
Faudra-t-il à nouveau faire la guerre, alors que la paix commence à peine et que, comme chaque citoyen de ce pays, j'en jouis ?
Napoléon se rend en bateau au château de Saint-Cloud avec Hortense, qui maintenant est sur le point d'accoucher. Les rumeurs sur la paternité de Napoléon n'ont pas cessé, au contraire. Mais, après tout, peut-être est-il heureux qu'on le croie ?
Napoléon prend le bras d'Hortense, qui marche péniblement dans les allées du château de Saint-Cloud. Il regarde ce pavillon de l'Orangerie, où, il y a moins de trois années, s'est joué son destin. C'est là qu'il a pris le pouvoir. Mais il pouvait aussi tout perdre.
Il a redécouvert il y a peu le château de Saint-Cloud. Les Tuileries sont tristes. Il y est trop proche de Joséphine. Elle a l'habitude qu'il dorme avec elle. Quant à la Malmaison, c'est son domaine. Saint-Cloud, ce sera chez lui. Et même si Joséphine s'y installe, et il le faut, il a fait aménager pour lui un petit appartement privé au-dessus du cabinet de travail.
À chaque étape d'une vie, il faut des lieux. Ici, à Saint-Cloud, c'est la demeure du Premier consul à vie.
Il avance lentement au milieu de la galerie d'Apollon. Il sourit. De chaque côté de la galerie richement décorée se tiennent les proches, les invités, ou les aides de camp et les femmes. Ils s'inclinent et il les salue d'un petit mouvement de tête.
Il sait que derrière lui, loin derrière lui, suivent Cambacérès et Lebrun. Cambacérès donne la main à Joséphine. Puis viennent les membres de la Maison consulaire, suivis par les valets en livrée verte galonnée d'or.
Il faut une étiquette pour donner à voir le pouvoir et sa hiérarchie.
Il faut que l'on sache que le Premier consul est souverain en son pays, comme n'importe quel autre souverain dans le sien.
D'ailleurs, Napoléon a approuvé Talleyrand quand celui-ci a demandé au gouvernement prussien de sonder Louis XVIII pour savoir si les Bourbons n'accepteraient pas d'abdiquer leurs droits en faveur de Napoléon Bonaparte.
Ainsi, la déchirure politique de la Révolution serait refermée, et resterait l'essentiel, les transferts de propriétés, les nouvelles institutions, le code civil, les chambres de commerce, les lycées.
C'est dimanche. Napoléon prend place dans la chapelle, à la place qu'occupait Louis XVI. À côté de lui, et en avant des deux consuls, s'installe Joséphine, comme une souveraine.
C'est dans cette chapelle qu'on baptise le fils d'Hortense, Napoléon-Charles, né le 10 octobre 1802. Napoléon porte lui-même l'enfant sur les fonts baptismaux. Et peut-être cela accréditera-t-il encore les rumeurs ? Tant pis pour Louis. Il regarde cet enfant. Ce pourrait être en effet un héritier légitime, si c'est de cela dont l'opinion a besoin.
N'est-ce pas ainsi qu'agissaient les rois, et ne faut-il pas qu'il soit de plus en plus royal, pour qu'enfin tout le monde sache que la Révolution est finie ?
Il veut savoir comment le peuple perçoit cette évolution. Il écarte d'un haussement d'épaules et d'une mimique de mépris ceux, comme Lebrun, qui lui déconseillent de se rendre en Normandie, région monarchiste qui peut lui faire un mauvais accueil et où il peut courir des risques.
Précisément c'est là qu'il doit aller.
Le 29 octobre 1802, à six heures du matin, il quitte Saint-Cloud dans sa berline de voyage en compagnie de Joséphine. Il bruine. Il distingue à peine, en avant des voitures, la silhouette de Moustache, son courrier qui l'accompagne dans chacun de ses déplacements.
Il veut prendre son temps. C'est la paix. Si la guerre revient, il faudra à nouveau donner des coups d'éperon, mais, pour l'heure, il peut s'arrêter quand il veut. Il saute de voiture peu après Mantes, marche le long de l'Eure sous un ciel devenu bleu. Il veut voir le champ de bataille d'Ivry. Il couchera ce soir à la préfecture d'Évreux. Le lendemain, il est à Louviers. Puis ce sera Rouen, Honfleur, Dieppe, Le Havre, Beauvais.
Читать дальше