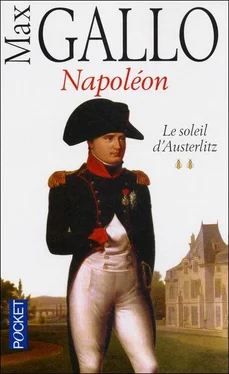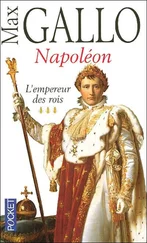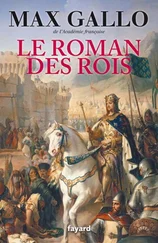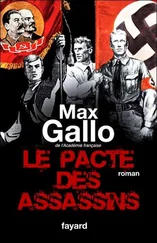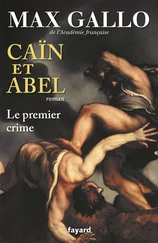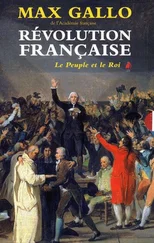Voici que s'avancent les membres du Sénat.
Les ambassadeurs se sont rangés de part et d'autre de la grande salle. Barthélémy, qui fut marquis puis l'un des Directeurs en 1795, déclare que le peuple français a nommé Napoléon Bonaparte consul à vie, et que le Sénat l'a proclamé. Une statue de la Paix tenant dans sa main le laurier de la victoire sera élevée en son honneur.
Barthélémy poursuit d'une voix forte : « Le Premier consul reçoit des Français la mission de consolider leurs institutions. Il ne leur donnera jamais que l'élan de la gloire et le sentiment de la grandeur nationale. »
Napoléon répond lentement, détachant chaque mot, son regard s'arrêtant sur chaque visage : « Sénateurs, la vie d'un citoyen est à sa patrie. Le peuple français veut que la mienne tout entière lui soit consacrée. J'obéis à sa volonté. »
Qu'est-il, sinon l'égal d'un roi ?
Il lève la tête, regarde au-dessus de la foule des personnalités, et ses yeux se portent vers le ciel légèrement voilé d'août.
« Content, poursuit-il, d'avoir été appelé par l'ordre de celui de qui tout émane, à ramener sur cette terre la justice, l'ordre et l'égalité, j'entendrai sonner la dernière heure sans regret et sans inquiétude sur l'opinion des générations futures.
« Sénateurs, recevez mes remerciements... »
15 août 1802. Il a trente-trois ans.
En ce jour, on fête dans toutes les églises de la République son anniversaire et le Consulat à vie.
Le matin, il a revêtu son uniforme de Premier consul et il a reçu les corps constitués aux Tuileries.
Trois cents instrumentistes jouent, cependant que conseillers d'État, sénateurs, tribuns, députés, ministres présentent leurs hommages.
À quinze heures, c'est le Te Deum à Notre-Dame.
Presque un couronnement.
Le soir, à la Malmaison, il danse. Et Hortense, grosse pourtant de sept mois, joue après le bal dans une petite pièce du citoyen Duval. Tout en applaudissant, il pense à la foule qui, place Vendôme, doit danser au son de quatre orchestres autour d'un autel à huit faces sur lequel on peut lire le texte du sénatus-consulte.
Il a donné l'ordre qu'on illumine les monuments de Paris. Et, sur les tours de Notre-Dame, brille le lion, son signe du zodiaque.
Qui eût imaginé cela ?
Qui peut imaginer ce qui surviendra ?
Le 21 août, il se rend au palais du Luxembourg pour présider la séance solennelle du Sénat.
Il est assis dans la voiture qui fut celle de Louis XVI et que tirent huit chevaux blancs. À sa droite et à sa gauche, il voit caracoler les officiers de son état-major et les cavaliers de sa garde. Au-delà, tout au long du trajet, des Tuileries jusqu'au Luxembourg, les troupes forment une haie d'honneur. Derrière les soldats, la foule se presse mais elle est silencieuse. Il la salue. Elle ne répond pas. Il se soulève un peu sur son siège et aperçoit la voiture où ont pris place ses frères. Ils saluent aussi. Il a lui-même prescrit à Fouché de ne rien organiser de factice sur son passage. Mais Fouché est assez retors pour avoir pesé dans l'autre sens. Des placards, selon les informateurs, ont été apposés, ici et là dans Paris, rappelant la maxime : « Le silence des peuples est la leçon des rois. »
Il convoque Fouché dès son retour aux Tuileries. Mais le ministre de la Police générale, comme à son habitude, se défend, glisse d'un argument à l'autre.
- Malgré la fusion des Gaulois et des Francs, dit-il, nous sommes toujours le même peuple ; nous sommes toujours ces anciens Gaulois qu'on représentait comme ne pouvant supporter ni la liberté ni l'oppression.
Quel est ce galimatias ? Fouché croit-il qu'il va se sortir de ce mauvais pas par des considérations historiques ?
- Que voulez-vous dire ?
- Que les Parisiens ont cru voir dans les dernières dispositions du gouvernement la perte totale de la liberté et une tendance trop visible au pouvoir absolu.
Napoléon prise avec une sorte de rage. Il connaît cette accusation de pouvoir tyrannique. Elle est stupide. Ce gouvernement, ici, dans cette France, ne peut pas être despotique, parce qu'il n'y a pour l'appuyer ni système féodal, ni corps intermédiaire, ni préjugé.
Et Fouché le sait bien.
- Je ne gouvernerai pas six semaines dans ce vide de la paix, reprend Napoléon, si, au lieu d'être le maître, je n'étais qu'un simulacre d'autorité.
Il déteste le mince sourire de Fouché, son calme, sa prétention.
- Soyez à la fois paternel, affable, fort et juste, dit Fouché, et vous reconquerrez aisément ce que vous semblez avoir perdu.
Napoléon s'éloigne, lance :
- Il y a de la bizarrerie et du caprice dans ce que l'on appelle l'opinion publique.
Il est sur le seuil de la porte.
- Je saurai la rendre meilleure, dit-il d'une voix forte.
Cinquième partie
On peut tuer le peuple français, mais non l'intimider
Septembre 1802 - Décembre 1803
18.
Ils sont assis autour de lui dans le salon du château de Mortefontaine, la demeure de Joseph. Les croisées sont ouvertes sur la forêt de Senlis qui commence, en ce début du mois de septembre, à roussir.
Napoléon se lève, quitte le cercle, mais d'un signe il exige que Lucien, Joseph, Talleyrand, Roederer, Lebrun, Cambacérès continuent de parler.
Il passe sur la terrasse. L'air est doux, chargé des odeurs de la futaie. Il n'entend plus que les éclats de voix de Lucien. À l'exception de Talleyrand qui est resté silencieux, tous les autres ont accablé Fouché. Ministre trop puissant, jacobin masqué, homme secret qui tient les fils de toutes les conspirations, adversaire du Consulat à vie, obstacle à toute évolution ultérieure.
Ce sont Joseph et Lucien qui ont insisté sur ce dernier point. Et Napoléon s'est contenté d'écouter.
Il sait bien ce à quoi ils pensent tous.
À l'après-moi !
Lucien a même conseillé à Joséphine de se rendre à Plombières en emportant les médecines de ce bon vieux docteur Corvisart. « Allons, ma sœur, prouvez au consul qu'il se trompe, a-t-il dit, et donnez-nous vite un petit césarien. » Il aurait même ajouté - Joséphine l'a rapporté pour que Napoléon la rassure : « Eh bien, si vous ne voulez pas ou si vous ne pouvez pas, il faut que Napoléon ait un enfant d'une autre femme et que vous l'adoptiez, car il faut assurer l'hérédité ; c'est dans votre intérêt, vous devez savoir pourquoi. »
Même Élisa, la sœur du Premier consul, dont Fouché murmure qu'elle est dévorée « par le double hoquet de l'amour et de l'ambition » - Élisa, qui se laisse conduire par les phrases ampoulées de Fontanes, son poète et amant -, s'est mise elle aussi à harceler Joséphine.
À celle-ci qui répondait qu'elle avait eu deux enfants, Élisa a rétorqué de sa voix aiguë :
- Mais, ma sœur, vous étiez jeune alors !
Et Joséphine de fondre en larmes. Napoléon a lancé :
- Ne savez-vous pas, Élisa, que toute vérité n'est pas bonne à dire ?
Et Joséphine de sangloter.
Napoléon donne un coup de cravache sur un massif de fleurs qui couronne une amphore disposée à l'angle de la terrasse.
Souvent, quand il est pris dans des situations qu'il ne peut ou ne veut encore dénouer, il laisse sa colère jaillir. Il saccage le jardin, il casse un vase de porcelaine. Il lui est même arrivé, le matin, de renverser d'un coup de pied Roustam qui peinait à lui enfiler une botte ou se trompait de pied.
Il rentre dans le salon. Roederer se tourne vers lui.
Ils sont unanimes, dit-il.
Napoléon annonce seulement qu'il rentre à Paris.
Il savait, avant cette réunion, qu'il fallait retirer à Fouché le ministère de la Police générale. Il n'a pu accepter cette opposition au Consulat à vie que Fouché a manifestée sans se dissimuler. Fouché est persuadé aussi que le péril aristocrate existe encore ! Allons donc. Les émigrés sont presque tous rentrés et se sont rués au service du Premier consul. Jusqu'à ce Chateaubriand, qui rêve d'un poste diplomatique !
Читать дальше