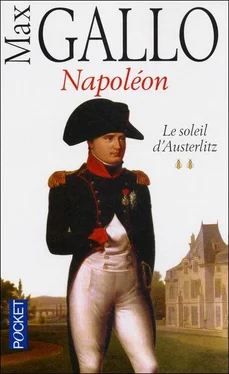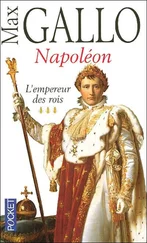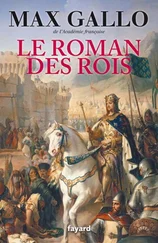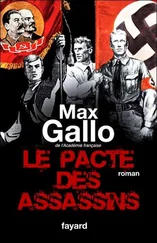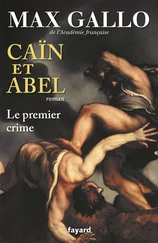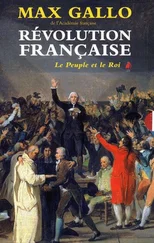- Une des choses qui contribuent le plus à la sûreté des rois, dit-il à Roederer, c'est qu'on attache à l'idée de couronne celle de propriété. On dit que tel roi est propriétaire du trône de ses pères, comme d'un particulier qu'il est propriétaire de son champ. Chacun ayant intérêt à ce que sa propriété soit respectée, respecte celle du monarque.
C'est le bon sens, n'est-ce pas ?
Mais faut-il franchir le pas ?
Il les voit autour de lui, comme des détrousseurs de cadavres sur le champ de bataille, ceux qui le poussent non seulement vers le Consulat à vie, mais aussi à désigner son successeur. Il y a ses frères, Lucien, Joseph : chacun d'eux proclame qu'il ne veut pas de l'héritage, qu'il faudrait pour succéder à Napoléon un homme comme Cambacérès, et cependant chacun pense à ce qui interviendra, après.
Après ma mort !
Il reçoit Cambacérès, venu une fois de plus soutenir l'idée qu'il faut que le Premier consul soit désigné à vie et, peut-être, ait la faculté de nommer son successeur.
Napoléon tourne dans son bureau, la tête baissée, et, comme chaque fois qu'il débat avec lui-même, il multiplie les prises de tabac.
Il s'arrête. Il fait entrer Roederer, qui les attendait dans l'antichambre.
- Tant que j'y serai, dit-il tout à coup brutalement, je réponds bien de la République, mais c'est vrai : il faut prévoir l'avenir.
Cambacérès et Roederer approuvent.
- Nous devons jeter sur le sol de la France quelques masses de granit, ajoute Napoléon.
Il veut que l'on crée partout, dans les départements, des lycées pour que l'instruction publique forme les esprits de ceux qui seront la charpente de la nation. Et pour les meilleurs d'entre les citoyens, il faut instituer un ordre, une nouvelle chevalerie, celle de la Légion d'honneur.
- On dira une nouvelle noblesse, murmure Roederer après un moment de réflexion.
- Il y aura une forte opposition dans les Assemblées, au Corps législatif, ajoute Cambacérès.
Napoléon s'emporte.
- Je défie, dit-il, qu'on me montre une République ancienne ou moderne dans laquelle il n'y ait pas eu de distinctions. On appelle cela des hochets, je sais, on l'a dit déjà. Eh bien, j'ai répondu que c'est avec des hochets qu'on mène les hommes.
Il gesticule, martèle les mots et le sol.
- Je ne crois pas que le peuple français aime la liberté, l'égalité. Ces Français ne sont point changés par dix ans de Révolution : ils sont ce qu'étaient les Gaulois, fiers, légers, il faut donc donner de l'aliment à ce sentiment-là. Il leur faut des distinctions. Croyez-vous que vous feriez battre des hommes par l'analyse ?
Il marche longuement, silencieux, puis, d'une voix résolue, ajoute :
- Croyez-vous qu'il faille compter sur le peuple ? Il crie indifféremment : « Vive le Roi ! Vive la Ligue ! » Il faut donc lui donner une direction et avoir pour cela des instruments.
- Justement, insistent Roederer et Cambacérès. Le Consulat à vie permettrait d'indiquer avec certitude le chemin.
Il écoute à peine leurs arguments. A-t-il jamais fait autre chose que ce qu'il a voulu ? Et s'imagine-t-il pouvoir renoncer un jour, après dix ou même vingt ans, aux fonctions qu'il exerce comme Premier consul ? Cet habit-là est devenu son corps et sa peau.
- Vous jugez que je dois au peuple un nouveau sacrifice ? Je le ferai si le vœu du peuple me commande ce que vous suggérez, dit-il.
Roederer présente aussitôt le plébiscite qui serait soumis au vote du peuple français, sur des registres ouverts dans chaque commune, à l'initiative du gouvernement. Les citoyens devraient répondre à deux questions : « Napoléon sera-t-il consul à vie ? » et « Le Premier consul aura-t-il la faculté de désigner son successeur ? »
Napoléon reprend le texte, s'approche de sa table et, d'un coup de plume rageur, raye la deuxième question.
- On n'a pas respecté le testament de Louis XVI ! lance-t-il. Respecterait-on le mien ?
Il fait quelques pas, prise d'une manière saccadée, puis ajoute :
- Un homme mort, quel qu'il soit, n'est plus rien !
Il se répète cette phrase tout au long du trajet qui conduit à la Malmaison. Il ne peut imaginer ce qui surviendra après lui, et il ne peut accepter l'idée que ses frères lui succéderont ou se disputeront entre eux pour occuper sa place, ou bien qu'ils devront partager le pouvoir avec un Moreau ou un Bernadotte !
Il passe une nuit difficile à la Malmaison et, le lendemain matin, à six heures, il fait manœuvrer deux bataillons de la Garde casernés à Rueil et à la Malmaison.
Il aime cet air vif de l'aube claire, les pas cadencés, l'ordre des colonnes, cette géométrie des bataillons, l'espace divisé en figures aux contours précis.
Tout en lançant des commandements, il pense à ce plébiscite. Les Français lui accorderont-ils le Consulat à vie ? Pourquoi refuseraient-ils ? Au Tribunat, seul Carnot a voté contre, et, au Corps législatif, trois députés seulement se sont opposés au plébiscite.
Il met fin aux manœuvres, convie les officiers des deux bataillons à déjeuner à la Malmaison.
Il apprécie ces rencontres. C'est dans et par l'armée, depuis l'enfance, qu'il a connu les hommes. Il évoque quelques souvenirs du siège de Toulon, puis d'autres campagnes.
« Le courage ne se contrefait pas, dit-il, c'est une vertu qui échappe à l'hypocrisie, mais il est comme l'amour, il veut de l'espérance pour nourriture. »
Quelle est mon espérance aujourd'hui, alors que j'approche de mes trente-trois ans ? Que, dans toutes les communes, les citoyens par centaines de milliers vont voter pour ou contre le Consulat à vie ?
Depuis que les registres sont ouverts, dans les mairies et les greffes des tribunaux, et chez les notaires, une foule nombreuse, selon les premiers rapports des préfets, vient apposer sa signature.
Il se lève et, avant que de quitter la table autour de laquelle les officiers se sont eux aussi dressés, il dit :
- Quelle que soit ma destinée, consul ou citoyen, je n'existerai que pour la grandeur ou la félicité de la France.
Le soir, dans la salle de spectacle de la Malmaison qu'on inaugure à cette occasion, il assiste à la représentation, par la troupe des Bouffons italiens, de La Serva padrona , de Paisiello.
Il rit à la farce, il ressent cette langue italienne comme la sienne. Il a fait beaucoup pour rendre l'indépendance à ce pays, mais les nouvelles qu'il reçoit de Milan montrent que le gouvernement de la République cisalpine est faible. Le sort de ce pays serait-il de ne jamais rien être ?
La France, elle, sera toujours la grande nation .
Il est fier d'être français, d'être à la tête de ce peuple et de cette nation à laquelle il s'est donné et qui lui a tout accordé.
« Le plus beau titre sur la terre est d'être né français, pense-t-il, c'est un titre dispensé par le ciel, qu'il ne devrait pas être donné à personne sur la terre de pouvoir retirer. »
Et je suis le Premier consul de ce peuple-là !
Le lendemain matin, Fouché demande à être reçu.
Napoléon, à dessein, le fait attendre.
Depuis quelques jours, il dispose des rapports de nombreux informateurs. Il y a bien eu complot des généraux. Bernadotte en a été l'âme. On a pensé à destituer Napoléon sous prétexte qu'ayant été élu président de la République italienne, il ne pouvait plus exercer les fonctions de Premier consul ! Les généraux ont voulu former une députation pour le menacer d'insurrection s'il empiétait sur la liberté. Bernadotte - Napoléon ricane - demandait seulement à ses complices de se contenter d'enlever le Premier consul, et non de le tuer !
Que peut dire de plus Fouché ? Et, quoi qu'il apporte comme élément nouveau, faut-il sévir ? Même si Bernadotte mérite d'être fusillé ? Il est populaire dans l'armée, comme Moreau. Pourquoi prendre le risque de dresser l'armée contre le pouvoir ? Il suffira d'éloigner Bernadotte, comme d'autres généraux. Lannes ira à Lisbonne, Brune à Constantinople, Macdonald à Copenhague, pourquoi pas Bernadotte en Louisiane, ou représentant de la France aux États-Unis d'Amérique ?
Читать дальше