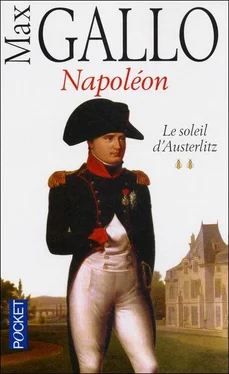« Un homme véritablement homme ne hait point, répète-t-il. Sa colère et sa mauvaise humeur ne vont pas au-delà de la minute. »
Ils ont pourtant écrit de lui le pire. Il retrouve ce portrait, publié lui aussi à Londres, qu'il relit :
« On a prétendu que ce grand homme d'État, ce grand capitaine, ce grand philosophe était l'ennemi de la débauche, exempt même des faiblesses qu'on peut reprocher à quelques grands hommes.
« En fait, il a deux goûts qui se trouvent rarement réunis dans le même homme : il est dissolu avec les femmes et il s'est montré adonné au vice dont on a faussement accusé Socrate. Cambacérès le seconde merveilleusement dans ce penchant honteux. Je ne serais pas étonné que pour imiter Néron, en tout, il n'épousât un jour un de ses pages et un de ses mamelouks. Sans respect pour la décence, l'inceste même ne lui paraît pas devoir être déguisé. Il a vécu publiquement avec ses deux sœurs, mesdames Caroline Murat et Pauline, épouse du général Leclerc. La première s'en vantait à tout le monde. On sait assez que madame Louis Bonaparte, fille de Joséphine, étant devenue grosse de Napoléon, celui-ci força son frère à l'épouser... »
Il se rejette en arrière. Il éprouve une impression de dégoût que peu à peu il chasse.
« Je désire, écrit-il à Joseph, que vous parliez à lord Cornwallis de l'abominable ouvrage que vous trouverez ci-joint, et lui fassiez sentir combien est contraire à la dignité des deux États de laisser à Londres un émigré imprimer de pareilles sottises. »
À moins que cette débauche d'injures reprises par la presse de Londres, où il est toujours traité d'« empoisonneur », ne soit la preuve que l'Angleterre recule devant la signature du traité de paix.
Il reçoit Talleyrand. Le ministre se dit persuadé que le gouvernement d'Addington veut la paix, mais qu'il est soumis à la pression des comités de négociants et d'armateurs. « La foi publique de ce pays n'a pas son centre à Saint-James mais à la Bourse de Londres, explique Talleyrand. C'est Otto, notre ambassadeur, qui l'écrit. »
- Une trêve alors, seulement, murmure Napoléon.
Ce serait affligeant, décourageant.
- Si lord Cornwallis est de bonne foi, conclut Napoléon, la paix doit être signée avant le 19 mars.
Il espère cette paix. Il la croit incertaine et elle sera fragile si elle est conclue, mais elle lui permettrait de se dévouer uniquement à l'administration de la France.
Il est si impatient que, durant ces jours d'attente, il prend encore plus de décisions qu'à l'habitude, multipliant les initiatives.
Il se rend place des Invalides, un matin. Il interroge les terrassiers. Il veut que la place soit promptement terminée. Il assiste au début du percement d'une nouvelle rue qui permettra de joindre la terrasse des Tuileries à la place Vendôme. Il visite le château de Saint-Cloud, qui doit devenir un palais consulaire.
Le 26 mars 1802, alors qu'il rentre de l'une de ces inspections dans Paris, il apprend que le traité de paix a enfin été signé à Amiens.
Londres doit évacuer Malte, et la France les ports napolitains qu'elle occupe. On ne dit rien, dans ce traité d'Amiens, des conquêtes françaises sur le continent européen, et rien non plus de l'ouverture des ports aux marchandises anglaises.
Mais c'est cependant la paix, tant attendue.
Le 27 mars, Napoléon demande à Constant de lui préparer un habit de soie, des bas blancs et des souliers à boucles d'argent.
Il veut recevoir en civil les ambassadeurs pour célébrer la signature du traité.
- C'est la première fois depuis 1792 que la France n'est plus en guerre contre personne, murmure Napoléon.
Il a déjà posé à son ministre de la Marine une question qui le hante, ce 27 mars 1802, jour de célébration de la paix : « Si le malheur voulait que la paix ne fût pas durable, que serait-il possible de faire ? »
Quatrième partie
Vous jugez que je dois au peuple
un nouveau sacrifice : je le ferai
Avril 1802 - Août 1802
15.
Napoléon tourne le dos à Bourrienne et s'approche de la fenêtre. Le ciel de ce 3 avril 1802 est d'un bleu léger, presque transparent.
Bourrienne parle d'une voix étouffée. Comment pourrait-il se justifier ? Il vient d'être pris la main dans le sac. Et, pourtant, le secrétaire tente d'expliquer qu'il n'est pas mêlé à cette affaire de faillite. Il connaît à peine les frères Coulon, dont l'un vient de se suicider, et qui, après avoir encaissé des centaines de milliers de francs, ont été incapables de fournir les équipements qu'ils devaient livrer à la cavalerie. Combien Bourrienne a-t-il touché pour ce marché ? Napoléon ne veut pas lui poser la question. Il se souvient de son compagnon d'études à Brienne. C'est son plus vieil ami. Ami ? Ils se sont retrouvés en 1792. Ils ont battu le pavé parisien ensemble. Ils ont le même âge.
Je l'ai sorti de la prison où on l'avait enfermé comme émigré .
Depuis, Bourrienne l'a suivi - l'Italie, Campoformio, l'Égypte, le 18 Brumaire. Pas un jour qu'il n'ait pris sous la dictée des dizaines de lettres. Il est le confident de Joséphine.
Il m'a menti pour elle, je le sais. Et il s'est enrichi. J'ai vu briller son œil de pie, cupide. J'ai accepté. C'est trop .
Bourrienne continue de se justifier.
Que d'hommes sur mon chemin, en qui j'avais confiance et qui m'ont trahi .
Il pense à Saliceti, qui l'a dénoncé en 1794. Saliceti, auquel il a pardonné et qu'il a éloigné de Paris, en Corse puis en Italie. Il songe à tous ceux qui se sont servis de lui, Tallien, Barras.
Mais faut-il s'en étonner ? On ne peut faire confiance qu'à soi.
Bourrienne continue de parler, mais d'une voix si sourde, si faible qu'on ne l'entend plus. Puis il remue les lèvres sans prononcer un mot.
D'un geste, Napoléon le chasse. Qu'il aille à Hambourg représenter la France comme chargé d'affaires. Il continuera, s'il le peut, à voler !
Mais sur qui peut-on compter ?
Voici le nouveau secrétaire, Méneval. Napoléon le dévisage. Selon Joseph, auprès de qui Méneval a servi, ce jeune homme de vingt-quatre ans est discret, efficace.
Napoléon lui donne ses consignes. Il doit être disponible à tout instant, jour et nuit, loger aux Tuileries, où quatre pièces lui sont réservées à l'étage des domestiques. Mais il doit se tenir là - Napoléon tend le bras -, entre l'appartement intérieur et l'appartement secret. Et il ne doit rechercher aucune aide dans son travail. Ni celle d'un secrétaire, ni celle d'un copiste.
Napoléon commence aussitôt à lui dicter ce règlement du Culte, qui va venir s'adjoindre au Concordat. Ces Articles organiques vont être une mauvaise surprise pour le pape, mais, après tout, ils ne font que reprendre la vieille tradition gallicane d'indépendance de l'Église de France vis-à-vis de Rome, et le principe selon lequel le gouvernement exerce la police des Cultes.
C'est moi qui vais choisir les évêques .
Et pour célébrer le Concordat, Napoléon a désigné M. de Boisgelin, cardinal archevêque qui, il y a vingt-cinq ans, a prononcé le sermon du sacre de Louis XVI !
Il scrute le visage de Méneval, mais celui-ci écrit sous la dictée. Il est trop jeune pour avoir été jacobin, pour être choqué par cette volonté de renouer la chaîne du temps, de rétablir l'autorité de l'État et la paix religieuse.
Mais quelques-uns se cabrent.
Et certains, dans l'armée, me voudraient mort .
Il les connaît, les Augereau, les Moreau, les Bernadotte, les Lannes, et tant d'autres généraux, « vieilles moustaches » de 1792, qui commencent à traîner leurs éperons à Paris, puisque la paix est faite.
Читать дальше