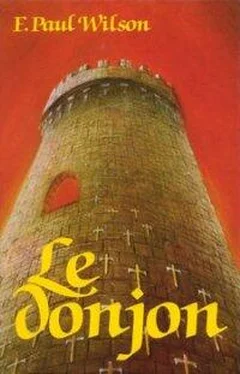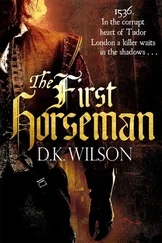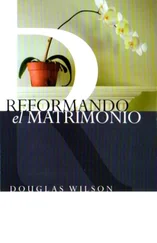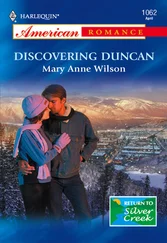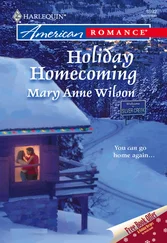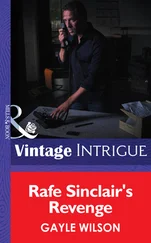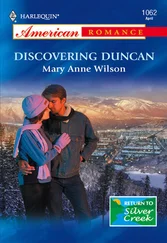— Je deviens fou, dit Waltz. On devrait faire quelque chose.
— Quoi ?
— Si on leur faisait faire un peu de Sachsengruss ?
— Ce ne sont pas des Juifs.
— Ce ne sont pas non plus des Allemands.
Flick réfléchit. Le Sachsengruss , ou salut saxon, avait été sa méthode favorite pour briser les nouveaux arrivants à Auschwitz : pendant des heures, il les obligeait à tomber à genoux, les mains croisées derrière la nuque. Une personne robuste aurait souffert le martyre en moins d’une demi-heure. Flick s’était toujours amusé de voir le visage des prisonniers quand ils sentaient leur corps commencer à les trahir. Ceux qui s’écroulaient d’épuisement étaient soit abattus sur place, soit roués de coups jusqu’à ce qu’ils reprennent l’exercice. Waltz et lui ne pouvaient pas tuer de Roumains mais ils pouvaient au moins se distraire un peu. Bien que cela fût tout de même quelque peu hasardeux.
— On ferait mieux de laisser tomber, dit Flick. On n’est que deux. Imagine qu’il y en ait un qui se mette à jouer les héros.
— On les sortira deux par deux. Allez, Karl, on va rigoler !
— Bon, d’accord, fit Flick en souriant.
Évidemment, ce ne serait pas aussi hilarant que le jeu auquel ils s’adonnaient souvent à Auschwitz, quand Waltz et lui-même organisaient des concours pour déterminer le nombre d’os qu’ils pourraient briser à un prisonnier avant qu’il ne s’effondre. Mais un peu de Sachsengruss pourrait toujours les divertir.
Flick fouilla dans sa poche pour trouver la clef de la pièce où étaient enfermés les prisonniers. Il y avait quatre chambres mais ils avaient préféré les regrouper dans une seule. Il pensait déjà à leur regard apeuré quand ils comprendraient qu’il ne céderait jamais à leurs supplications.
Il était tout près de la porte quand la voix de Waltz l’arrêta :
— Attends un instant, Karl.
— Qu’est-ce qui se passe ? demanda Flick, qui fit volte-face.
— Il y a une des ampoules qui est en train de lâcher. Tiens, celle-là, la première…
— Et alors ?
— Elle s’éteint, dit-il en parcourant le couloir. Tiens, la deuxième aussi !
Sa voix avait monté d’un ton. Il arma son Schmeisser et fit signe à Flick.
— Viens par ici !
L’autre lâcha la clef et se saisit de son arme pour rejoindre son compagnon. La troisième ampoule mourut à l’instant où il atteignit le croisement des couloirs. Il ne pouvait voir au-delà des ampoules qui s’étaient éteintes. On eût dit que le couloir avait été englobé par des ténèbres impénétrables.
— Je n’aime pas ça, dit Waltz.
— Moi non plus, mais je ne vois personne. C’est peut-être le générateur ou un fil qui joue, répondit Flick, qui ne croyait pas à ses propres arguments et cherchait seulement à contrôler la peur qui l’envahissait.
Ce fut bientôt le tour de la quatrième ampoule. L’obscurité commençait à quatre mètres d’eux.
— Allons par là, dit Flick, en montrant le couloir du fond.
Il entendait les prisonniers murmurer dans leur cellule. Ils ne voyaient rien mais sentaient qu’il se passait des choses étranges.
Flick se serra contre Waltz. Le froid le pénétrait et les ampoules s’éteignaient les unes après les autres dans le couloir donnant sur la cour. Il aurait voulu tirer mais il n’y avait personne. Rien que l’obscurité.
L’obscurité qui s’abattit sur lui, glaçant ses os et troublant sa vision. Pendant un instant qui parut durer une éternité, le soldat Karl Flick devint la victime de cette terreur aveugle qu’il aimait tant inspirer aux autres et éprouva cette douleur déchirante qu’il prenait habituellement tant de plaisir à provoquer. Puis il ne sentit plus rien.
La lumière revint progressivement dans le couloir en commençant par l’arrière. On n’entendait que les gémissements des femmes, les murmures des hommes enfermés dans la cellule et qui n’éprouvaient plus la panique qui les avait soudainement possédés. L’un d’eux s’approcha de la porte et colla un œil à un interstice. Son champ de vision se limitait à une partie du mur et du couloir du fond.
Il n’y avait personne. Le sol était nu, à l’exception de taches de sang vermillon et luisant. Sur le mur, le sang avait été étalé pour former des lettres qui ne lui étaient pas tout à fait étrangères et des mots dont il ignorait tout. Des mots semblables à des chiens qui hurlent dans la nuit, sans cesse présents mais toujours hors de portée.
L’homme s’éloigna de la porte et rejoignit ses camarades entassés au fond de la pièce.
Il y avait quelqu’un à la porte.
Kaempffer ouvrit tout grands les yeux ; il craignait que ne se reproduise le cauchemar qui l’avait déjà une fois tiré du sommeil. Non. Il ne sentait aucune présence malveillante de l’autre côté de la porte. C’était un homme qui se trouvait là…
— Qui est là ? dit Kaempffer, en tirant son Luger.
Pas de réponse.
Ce fut alors le bruit d’une main qui cherche à manœuvrer le loquet. Kaempffer pensa un instant allumer sa lampe mais il choisit de rester dans le noir. La silhouette de l’intrus se détacherait parfaitement sur le fond lumineux du couloir.
— Présentez-vous !
On se désintéressa du loquet. Ce furent alors des craquements et des grincements, comme si une masse énorme s’appuyait contre la porte pour l’enfoncer. Kaempffer était en sueur, il tremblait. La massive porte de chêne venait de bouger de quelques centimètres. Les gonds cédaient, lentement, puis la porte s’ouvrit brutalement.
Deux silhouettes se découpaient sur la lumière du couloir. Kaempffer vit à leurs casques qu’il s’agissait de soldats allemands ; leurs bottes montantes étaient celles d’hommes des einsatzkommandos. Cette révélation aurait dû le calmer mais il n’en fut rien. Pourquoi avaient-ils forcé sa porte ?
— Qui est-ce ? demanda-t-il.
Ils ne répondirent pas mais s’avancèrent vers le lit où il gisait, paralysé. Leur démarche avait quelque chose de mécanique, de grotesque. Kaempffer crut un instant que les soldats allaient lui marcher dessus mais ils s’arrêtèrent au bord du lit. Ni l’un ni l’autre ne parlèrent ni ne saluèrent.
— Que voulez-vous ?
Il aurait dû être furieux mais la peur étouffait sa colère. Malgré lui, il cherchait à se réfugier sous les couvertures.
— Parlez-moi ! fit-il, suppliant.
Toujours pas de réponse. Il tendit la main et trouva la lampe posée à terre. Ses doigts maladroits hésitèrent sur l’interrupteur puis il fit la lumière.
Les soldats Flick et Waltz se tenaient devant lui, immobiles, le visage livide, les yeux révulsés. Une barre rouge, horrible, laissait entrevoir la chair déchiquetée de leur cou.
Paralysé, Kaempffer tentait vainement de hurler sa terreur.
Les deux soldats se mirent alors à vaciller. Sans bruit, presque avec grâce, ils s’abattirent sur le lit, clouant l’officier sous des centaines de livres de chair morte.
Kaempffer luttait frénétiquement pour se dégager des deux cadavres quand il entendit une voix lointaine émettre un long hululement d’effroi.
Il lui fallut quelque temps pour se rendre compte que cette voix était la sienne.
— Alors, vous y croyez, maintenant ?
— Croire à quoi ?
Kaempffer refusait de regarder Woermann et préférait s’intéresser au verre de kummel qu’il tenait à deux mains. Il en avait vidé la moitié d’une seule traite et buvait maintenant le reste avec lenteur. Peu à peu, il reprenait contrôle de soi. Heureusement qu’il se trouvait chez Woermann et non chez lui…
— Les méthodes SS ne résoudront pas ce problème.
Читать дальше