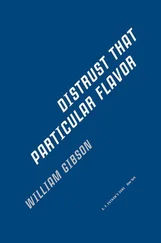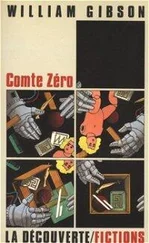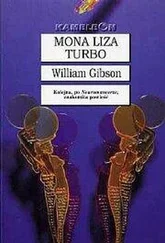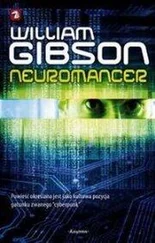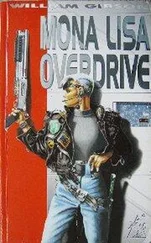— Y’avait notre copain à l’arrière ?
— Non. (Elle retirait les gants.) Y nous a fait repasser par Cleveland, dans cette banlieue. De grandes baraques anciennes mais avec des pelouses en friche et toutes pelées. S’est dirigé vers une bâtisse vachement bien gardée, je suppose que c’était la sienne. Celui-ci (et elle remonta le sac de couchage bleu jusqu’au menton de l’homme), il était dans une chambre. J’ai dû m’y mettre tout de suite. Kid m’a dit qu’il me paierait bien.
— Et vous saviez qu’il vous conduirait dans ce coin perdu, au milieu de la Solitude ?
— Non. J’crois pas qu’il savait non plus. Quelque chose s’est produit. Il est revenu le lendemain en annonçant qu’on partait. Je crois qu’un truc lui flanquait la trouille. C’est à ce moment qu’il l’a appelé comme ça, le Comte. Parce qu’il était en colère et, je crois bien même, effrayé. « Le Comte et son putain de LF », qu’il disait.
— Son quoi ?
— « LF ».
— C’est quoi, ça ?
— Je crois que c’est ça, dit-elle en montrant du doigt le boîtier gris anonyme accroché au-dessus de la tête du dormeur.
Elle s’imagina que Swift l’attendait sur la terrasse, avec les habits de tweed qu’il aimait porter en hiver à L.A. : gilet et veste dépareillés, l’un en chevrons et l’autre en pied-de-poule, mais l’ensemble tissé de la même laine, tondue sans doute sur le mouton, l’ensemble de la ligne ayant été orchestré à Londres, en petit comité, dans une pièce au-dessus d’une boutique de Floral Street qu’il n’avait jamais vue. On lui taillait des chemises à rayures, dans du coton de chez Charvet, à Paris ; on lui façonnait ses cravates, dans une soie tissée à Osaka, avec le sigle de Senso/Rézo brodé dessus en petits points serrés. Pourtant, il donnait l’impression d’être encore habillé par sa mère.
La terrasse était vide. Le Dornier plana, immobile, puis fila rejoindre son nid. La présence de Maman Brigitte lui collait encore à la peau.
Elle gagna la cuisine toute blanche et nettoya le sang coagulé sur son visage et ses mains. Quand elle pénétra dans le séjour, elle eut l’impression de le voir pour la première fois : le sol chaulé, les cadres dorés et les coussins de velours des chaises Louis XVI, l’arrière-plan cubiste d’un Valmier. Comme la garde-robe de Hilton, songea-t-elle, conçue par des étrangers talentueux. Ses bottes laissaient des marques de sable mouillé sur le sol lorsqu’elle se dirigea vers l’escalier.
Kelly Hickman, son costumier, était passé à la maison pendant qu’elle se trouvait à la clinique ; il avait vidé ses bagages dans la chambre principale. Neuf valises Hermès, lisses et rectangulaires comme des cercueils en croupon de cuir patiné. Ses habits n’étaient jamais pliés ; chaque pièce était posée à plat, entre deux feuilles de papier de soie.
Elle resta sur le seuil, à contempler le lit vide, les neuf cercueils de cuir.
Elle entra dans la salle de bains, bloc de verre et de carreaux de mosaïque blanche, ferma la porte derrière elle. Elle ouvrit une petite armoire au-dessus du lavabo puis une autre, ignorant les rangées bien alignées d’articles de toilette dans leurs emballages neufs, les flacons de médicaments, de cosmétiques. Elle trouva le chargeur dans le troisième placard, près d’un blister de timbres. Elle se pencha, scruta le plastique gris, le sigle japonais, sans oser y toucher. Le chargeur avait l’air neuf, inutilisé. Elle était presque certaine de ne pas l’avoir acheté, de ne pas l’avoir laissé ici. Elle prit la drogue dans la poche de son blouson et l’examina, la tournant et la retournant, regardant les doses calibrées de poudre violette flotter dans leurs compartiments scellés.
Elle se vit déposer le paquet sur la tablette de marbre blanc, disposer le chargeur au-dessus, retirer un timbre de sa bulle de plastique et l’y introduire. Elle vit l’éclair rouge d’une diode quand le chargeur eut aspiré une dose ; elle se vit retirer le timbre, le garder en équilibre comme une sangsue de plastique blanc au bout de son index, sa surface inférieure humide luisant d’infimes gouttelettes de DMSO.
Elle se tourna, fit trois pas vers les toilettes et laissa tomber le paquet non ouvert dans la cuvette. Il y flotta comme un radeau miniature, la drogue toujours parfaitement sèche. Parfaitement… Elle trouva une lime à ongles en inox et s’agenouilla sur le carrelage blanc, les mains tremblantes. Elle dut fermer les yeux quand elle harponna le paquet puis enfonça le bout de sa lime le long de la couture et déchira l’enveloppe de plastique. La lime tomba par terre en cliquetant, tandis qu’elle pressait le bouton de la chasse, faisant disparaître les deux moitiés du sachet vide. Elle posa le front sur l’émail frais, puis se força à se relever, aller au lavabo et s’y laver méticuleusement les mains.
Parce qu’elle avait envie, elle le savait à présent, vraiment très envie de se lécher les doigts.
Plus tard, ce même jour, par un gris après-midi, elle trouva dans le garage un conteneur d’expédition en plastique armé, le remonta dans la chambre et entreprit d’y entasser le reste des affaires de Bobby. Il n’y avait pas grand-chose : un jean en cuir qu’il n’avait jamais aimé, quelques chemises abandonnées ou oubliées et, dans le tiroir du bas du bureau en teck, une console de cyberspace. C’était une Ono-Sendaï, guère plus qu’un jouet. Elle traînait au milieu d’un fouillis de câbles noirs, entre un faisceau de sim-trodes bon marché et un tube en plastique graisseux rempli de pâtes électrolytiques.
Elle se souvint de la console qu’il utilisait, celle qu’il avait prise avec lui, une Hosaka grise, modifiée en usine, au clavier à touches vierges. Une console de pirate ; il tenait à voyager avec, même si cela créait des problèmes lorsqu’il passait la douane. Pourquoi, se demanda-t-elle, avait-il acheté l’Ono-Sendaï ? Et pourquoi l’avait-il abandonnée ? Elle était assise au bord du lit ; elle sortit du tiroir la console et la posa sur ses genoux.
Dans un passé lointain, là-bas dans l’Arizona, son père l’avait avertie des risques de l’interface. « T’as pas besoin de ça », avait-il dit. Et elle s’en était abstenue, parce qu’elle rêvait du cyberspace, comme si la matrice au canevas de néon l’attendait derrière ses paupières.
Il n’y a pas de là-bas, là-bas. C’est ce qu’on enseignait aux enfants pour leur expliquer le cyberspace. Lui revint en mémoire le discours d’un tuteur affable, dans la crèche réservée aux enfants des cadres de l’arcologie, et le défilé d’images sur un écran : des pilotes au casque énorme, aux gants malcommodes ; la technologie neuro-électronique encore primitive de « l’univers virtuel » les interfaçait avec ses plans de manière plus efficace grâce à des couples de moniteurs vidéo qui les gavaient d’un flot de données de combat générées par ordinateur, à des gants à rétroaction vibrotactile qui recréaient sous leurs doigts le contact des manettes et des boutons… Avec les progrès techniques, la taille des casques se réduisit, les moniteurs vidéo s’atrophièrent…
Elle se pencha pour saisir le connecteur à trodes, le secoua pour en démêler les câbles.
Pas de là-bas, là-bas.
Elle ouvrit le bandeau élastique et plaqua les trodes contre ses tempes – l’un des gestes les plus répandus dans l’humanité, mais qu’elle accomplissait rarement, pourtant. Elle pressa le bouton de test des batteries de l’Ono-Sendaï. Vert, c’était bon. Elle effleura la touche marche/arrêt et la chambre s’évanouit derrière un mur incolore de parasites sensoriels. Sa tête s’emplit d’un torrent de bruit blanc.
Читать дальше