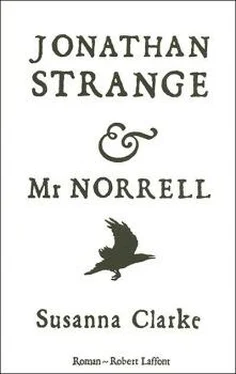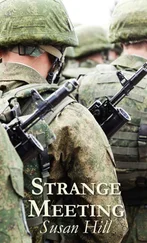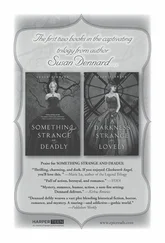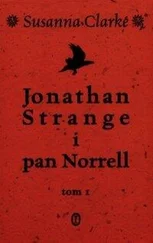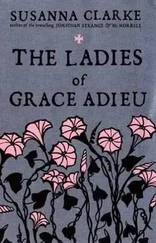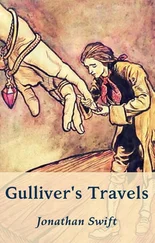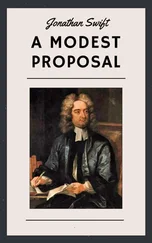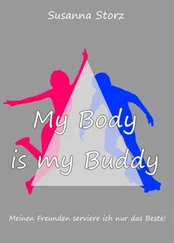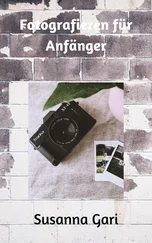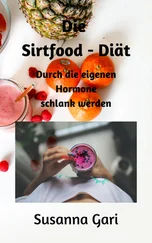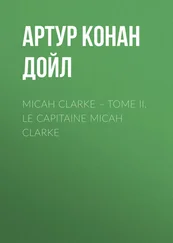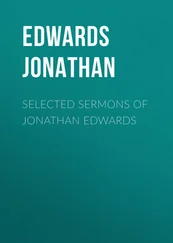Pale s’adonnait à écrire le nom de sa bien-aimée – qui était Francis – et dans une des lettres il composa même une espèce de calembour ou de rébus sur son patronyme, Pevensey. Au début, les spécialistes de magie du XVIII esiècle inclinèrent à soutenir que la maîtresse de Pale avait dû être la femme ou la sœur de l’autre Francis Pevensey. Au XVI esiècle, Francis était un prénom commun aux hommes et aux femmes. Puis Charles Hether-Gray publia sept extraits différents des lettres qui citaient Les Dix-Huit Merveilles de la maison d’Albion et montraient clairement que la maîtresse de Pale et l’auteur du livre n’étaient qu’une seule et même personne.
William Pander argua que les lettres étaient des faux. Celles-ci avaient été retrouvées dans la bibliothèque d’un certain Mr Whitdesea. Or Mr Whitdesea avait une épouse qui avait écrit plusieurs pièces de théâtre, dont deux avaient été données au Drury Lane Theater. À l’évidence, soutenait Pander, une femme qui s’abaisserait à écrire des pièces s’abaisserait à n’importe quoi, et il suggérait que Mrs Whitdesea avait contrefait les lettres «… afin d’élever son sexe au-dessus de la place naturelle que Dieu lui avait destinée…». Mr Whitdesea provoqua William Pander en duel, et Pander, qui était un clerc de bout en bout et ne connaissait rien aux armes, présenta ses excuses et publia une rétractation en bonne et due forme de ses accusations contre Mrs Whitdesea.
Mr Norrell était content de recourir à la magie de Pevensey, car il avait, voilà longtemps, vu en esprit que Pevensey était un homme. Quant aux lettres, puisqu’elles ne contenaient pas un mot de magie, il ne s’y intéressa pas. Jonathan Strange adopta un autre point de vue. Selon lui, il suffisait de poser une question et d’y répondre pour trancher : Martin Pale eût-il enseigné la magie à une femme ? La réponse, toujours selon Strange, était oui. Après tout, Martin Pale clamait avoir été initié par une femme : Catherine de Winchester.
Thaddeus Hickman (1700-1738), auteur d’une vie de Martin Pale.
Cf. : « Le lierre de ligoter les ennemis de l’Angleterre a promis / Les ronces et les épines de les fouetter ont promis / L’aubépine de répondre à toutes les questions a promis / Le bouleau d’ouvrir des portes sur d’autres pays a promis / L’if des armes nous a fournies / Le corbeau nos ennemis a punis / Le chêne a observé les monts lointains / La pluie a emporté tout chagrin. » Cette comptine traditionnelle anglaise énumère prétendument les divers contrats que John Uskglass, le roi Corbeau, a conclus au nom de l’Angleterre avec les forêts.
« Les Routes du Roi » ( cf . la célèbre King’s Road londonienne, ancien sentier qui resta voie privée jusqu’en 1830) (N.d.T.) .
Les Cinque Dragowni (les Cinq Dragons). Cette cour tenait son appellation non pas, ainsi qu’on le croit en général, de la férocité de ses juges, mais d’une chambre du manoir de John Uskglass, le roi Corbeau, à Newcastle, où les jugements étaient rendus à l’origine. On disait que cette chambre avait douze côtés et était décorée de magnifiques sculptures, certaines l’œuvre des hommes, d’autres celle des fées. Les plus merveilleuses de toutes représentaient cinq dragons.
Les crimes qui relevaient de la compétence des Cinque Dragowni comprenaient : les « Mauvaises intentions », magie dont la finalité était malveillante en soi ; la « Fausse magie », soit feindre ou promettre de pratiquer une magie qu’on ne pouvait ou ne voulait pas pratiquer ; vendre anneaux, chapeaux, chaussures, redingotes, ceintures, pelles, haricots, instruments de musique, etc., magiques à des personnes dont on ne pouvait guère penser qu’elles maîtriseraient ces articles dotés de pouvoirs ; feindre d’être magicien ou prétendre agir au nom d’un magicien ; enseigner la magie à des personnes peu faites pour cela (par exemple, des ivrognes, des déments, des enfants, des individus dotés de mauvaises habitudes et inclinations) ; et maints autres crimes magiques commis par des magiciens confirmés et autres chrétiens. Des crimes contre la personne de John Uskglass furent aussi jugés par les Cinque Dragowni. La seule catégorie de crimes de magie pour lesquels les Cinque Dragowni n’étaient pas compétents étaient les crimes commis par des fées. Ceux-ci relevaient de la cour spéciale des Folflures.
En Angleterre, aux XII e, XIII eet XIV esiècles, une florissante communauté de magiciens et de fées recourait continuellement à la magie. Il est notoire qu’il est difficile de plier la magie à des règles ; toute la magie qui est pratiquée n’obéit pas toujours à de bonnes intentions. John Uskglass semble avoir consacré beaucoup de temps et d’énergie à la création d’un recueil de lois destinées à régir la magie et les magiciens. Quand l’art de la magie se répandit à travers l’Angleterre, les rois du Sud n’étaient que trop reconnaissants de profiter de la sagesse de leurs voisins du Nord. Même si l’Angleterre était divisée en deux pays aux systèmes judiciaires distincts, c’est une particularité de ces temps-là que l’ensemble de lois qui régissaient la magie était le même pour les deux. L’équivalent des Cinque Dragowni d’Angleterre du Sud portait le nom de Petty Dragowni de Londres et était situé près de Blackfriars.
Divinité grecque représentant la Vengeance des dieux contre la démesure (l’ hybris ) (N.d.T.) .
Noms de deux personnages du livre de Pierce Egan, Life in London ; or the Day and Night Scenes of Jerry Hawthorn, Esq. And His Elegant Corinthian Tom, Accompanied by Bob Logic, The Oxomanian in Their Rambles and Sprees Through the Metropolis (1821) (N.d.T.) .
À la fin du XVII esiècle, il était un gantier de la cité royale de Newcastle qui avait une fille, une petite créature hardie. Un beau jour, cette enfant, dont tout le monde croyait qu’elle jouait dans un coin de la maison paternelle, disparut. Sa mère, son père et ses frères la cherchèrent partout. Les voisins aidèrent aux recherches, elle n’était nulle part. Puis, vers la fin de l’après-midi, levant les yeux, ils la virent descendre la côte cailloutée et boueuse. Certains crurent apercevoir fugitivement quelqu’un derrière elle dans la rue obscurcie par l’hiver, mais elle continua son chemin seule. Elle était indemne et son histoire, une fois reconstituée, était la suivante : elle avait quitté la maison paternelle pour aller se promener en ville et était rapidement tombée sur une rue qu’elle n’avait jamais vue. Cette rue, large et bien pavée, la conduisit tout droit dans les hauteurs, plus haut qu’elle n’était jamais allée auparavant, à la grille et à la cour d’une grande demeure en pierre. Elle était entrée dans la maison et avait visité plusieurs pièces, mais toutes étaient silencieuses, vides, pleines de poussière et d’araignées. Dans une aile de la maison, il y avait une enfilade de salons, où les ombres des feuillages d’été tombaient sans cesse sur les murs et le plancher, comme s’il y avait des arbres de l’autre côté des carreaux, cependant il n’y avait pas d’arbres (et, de toute façon, c’était l’hiver). Un des salons ne contenait qu’un grand miroir. Le salon et le miroir semblaient s’être brouillés à un moment donné, car le miroir représentait la pièce pleine d’oiseaux alors que celle-ci était vide. Pourtant la fille du gantier entendait des chants d’oiseaux tout autour d’elle. Un long couloir obscur résonnait de bruits d’eau, comme s’il donnait à l’autre bout sur une mer ou sur un fleuve ténébreux. Des fenêtres de certaines pièces, elle apercevait la cité de Newcastle ; depuis d’autres, elle découvrait une cité complètement différente. D’autres encore ne montraient que des landes escarpées et sauvages et un ciel bleu glacial.
Читать дальше